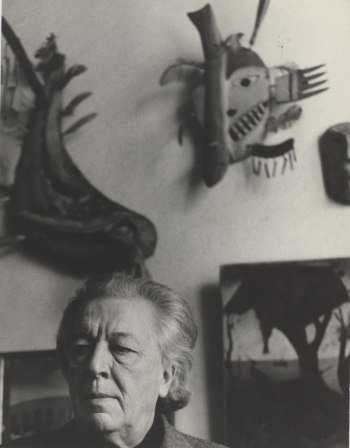jeudi, 07 février 2008
Léo Ferré et les surréalistes, encore une découverte
« Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c’est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune ». On connaît ces extraits de la préface de Poète… vos papiers ! et la façon qu’avait Léo Ferré de les donner en rafale, quand il interprétait ce texte en scène.
Or, Martine vient de me faire remarquer une chose qui m’avait toujours échappé. Peut-être ces trois aphorismes assénés avec force par leur auteur sont-ils autre chose que des formules-choc. L’un d’entre eux, au moins.
C’est dans le André Breton, quelques aspects de l’écrivain, de Julien Gracq (Corti, 1948) qu’on peut lire, p. 37 : « Plus que tout autre, le groupe surréaliste, irradié par Breton du début à la fin, encore qu’avec humilité celui-ci lui demande de s’effacer « devant les médiums qui, bien que sans doute en très petit nombre, existent » – tient à porter à son actif d’avoir « fait surgir une curieuse possibilité de la pensée, qui serait celle de sa mise en commun » ».
Gracq donne comme référence le Second manifeste du surréalisme.
Alors ? Il est de plus en plus évident que Breton, lisant le texte de Ferré, ait pu crier à la trahison. Sa mise en cause est immédiate, concrète. Qui plus est, la série d’aphorismes, prise dans sa continuité, tend à faire du surréalisme une simple « société littéraire », c’est-à-dire très exactement le contraire de ce qu’il est.
Que doit-on interpréter ? Il est peu probable, à mon avis, que Ferré ait voulu égratigner Breton, aussi directement. Même compte tenu du dépit qu’il éprouva en n’obtenant pas la préface demandée, je n’y crois guère. Léo Ferré n’a rien d’un exégète, il fonctionne au sentiment, au coup de cœur. Je ne serais pas étonné – je n’affirme rien, bien sûr – que cette « mise en commun » soit restée inscrite dans sa mémoire lors de sa lecture du Second manifeste et qu’elle soit ressortie inconsciemment au moment de l’écriture du texte polémique, comme une tournure qui l’aurait frappé.
J’avoue sans nulle honte que, jusqu’à ce jour, je n’avais nullement fait le lien entre le texte de Breton et cette « pique » particulière. Quelqu’un s’en était-il aperçu ? Si oui, si je découvrais brusquement l’eau chaude, j’en demande excuse par avance.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 25 janvier 2008
Une opinion de Gracq sur Breton
L’histoire de Léo Ferré et des surréalistes a été reconstituée dans son déroulement factuel. J’ai fait mon possible pour en mieux cerner la chronologie complète. À ce jour, en croisant et refondant mon récit des Chemins de Léo Ferré, les deux notes complémentaires parues sur ce blog il y a quelque temps et la Lettre à l’ami d’occasion, il est possible de relire cette histoire et de mieux apprécier les raisons de Breton qui, lorsqu’on dépasse l’« interdiction » de publication qu’il formula à l’encontre de son ami, paraissent maintenant bien plus claires et compréhensibles. On n’y reviendra pas ici.
La succession des faits mise à part, il reste, pour moi, un point obscur. Breton n’aime pas Poète… vos papiers ! qu’il vient de lire sur manuscrit. On ne sait d’ailleurs pas si l’état du texte correspondait exactement à ce qui fut publié peu après par La Table Ronde. Vraisemblablement, oui. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fond.
Mais voilà : Breton, homme d’une très grande culture et d’une forte lucidité, ne nous a pas habitués à se tromper sur les œuvres de tel ou tel auteur. Ce qui me frappe, c’est qu’il n’ait pas su voir, lire dans ce manuscrit confié un soir par Ferré, les évidentes promesses qu’il contenait. Car si l’on n’aime pas Poète… vos papiers !, ce qui est parfaitement admissible, évidemment, il reste que ce recueil est attachant et contient en germe bien des choses. Il me paraît incroyable qu’un homme comme Breton n’ait pas su (voulu ?) voir cela, lui qui discernait en tous lieux la petite flamme de la beauté.
C’est en lisant cette phrase de Julien Gracq sur le jugement de Breton, qu’il a connu et admiré – et l’on sait que Gracq n’admirait pas facilement – que je me suis fait les réflexions qui précèdent. Voici cet extrait de Gracq (En lisant, en écrivant, Corti, 1980) : « Ce qu’il y avait de vibrant – pour reprendre son vocabulaire – dans les refus de Breton, venait, j’en ai eu souvent le sentiment, de ce qu’ils étaient conquis plus d’une fois sur une secrète complaisance, non tout à fait abolie, à ce qu’il refusait, ou plutôt se refusait. Plus que son opposé Valéry, si dédaigneusement étranger à ce qu’il rejette, il était riche, comme presque tous les bons gouvernements de combat, de quelques utiles et secrètes intelligences avec l’ennemi ».
Breton s’est-il refusé toute secrète complaisance envers son ami Léo Ferré ? A-t-il conquis sur elle son propre refus ? Ce n’est pas impossible. Cette comparaison que fait Gracq avec l’attitude de Valéry me rappelle que, jeune homme, Ferré lui avait envoyé un poème et n’avait jamais obtenu de réponse. Ce qui se comprend facilement : Valéry devait certainement recevoir chaque jour un très grand nombre de textes d’apprentis écrivains et ne pas s’en soucier outre-mesure. Mais Breton ? Cette opinion de Gracq serait-elle une clef permettant de comprendre pourquoi Breton n’a rien vu de prometteur dans le recueil incriminé ?
Peut-être suis-je en train de faire fausse route, mais ce lieu est aussi un chantier de réflexion.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)
jeudi, 29 novembre 2007
Léo Ferré et les surréalistes, encore de nouveaux éléments
Après la parution des Chemins de Léo Ferré en 2005, Patrick Dalmasso m’a envoyé un extrait d’émission radiophonique malheureusement non référencé, qui avait sa place dans le livre. Il était trop tard. Puisque l’on revient sur le sujet à la faveur des lettres découvertes il y a peu, je donne ici le texte de ce fragment. Il s’agit d’un entretien avec Marie-Hélène Estienne, compagne de Charles Estienne, ami commun de Breton et de Ferré. Voici la transcription exacte, hésitations comprises, de ses propos.
 « Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.
« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.
La journaliste : Comment ont réagi les gens des galeries, du monde parisien quand il s’est lié avec Léo Ferré ? Est-ce que ça ne paraissait pas un petit peu étrange, un petit peu curieux ?
Marie-Hélène Estienne : Je crois, il me semble – enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais il me semble que certaines personnes pensaient que Charles était cinglé. Que Charles, qui était un bon critique, qui aurait pu faire une carrière raisonnable, gagner de l’argent, etc., se mette à faire des chansons et à aller fréquenter Léo Ferré. Je crois que oui, les gens pensaient qu’il était drôle. Il y avait une drôle d’histoire aussi, c’est que Léo Ferré était très, très, très passionné par André Breton. Il y avait un… et je ne crois pas que ça ait vraiment marché. Au bout d’un certain temps, je ne sais pas, il y a eu une polémique assez triste. Charles, qui était, lui, ami avec Breton, était toujours hésitant entre les deux, mais c’était assez ambigu ».
On observe la permanence des étiquettes que l’on colle : Charles Estienne, critique d’art, romancier, ne peut pas écrire de chansons et fréquenter Ferré sans être « cinglé » ou « drôle ». Cela, semble-t-il, n’était pas compatible avec « une carrière raisonnable ». C’est la plus stupide des caractéristiques françaises : la mise en casiers. Heureusement, Estienne se moquait bien de cela, sa femme également.
Je me suis toujours demandé pourquoi Estienne n’avait jamais rien tenté pour rapprocher Breton et Ferré. Peut-être d’ailleurs l’a-t-il fait et n’a-t-il pas réussi ? Il est important cependant de remarquer que sa propre épouse lui prête un sentiment partagé, hésitant et ambigu. Je livre ces réflexions pour ce qu’elles sont. Elles témoignent, il me semble, d’un certain trouble, d’une gêne manifestée par Estienne. D’autres surréalistes le partagèrent-ils ?
Remerciements : Patrick Dalmasso.
(Marie-Hélène et Charles Estienne en 1965,
photo Jean Messagier)
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (6)
dimanche, 25 novembre 2007
Léo Ferré et les surréalistes : nouveaux éléments
De nouveaux documents provenant des archives d’André Breton ont été récemment rendus publics, en particulier une partie de sa correspondance « passive » (« reçue », dans le jargon des archivistes) émanant de Léo Ferré ou d’autres personnes qui font référence à Léo Ferré. Ces documents éclairent d’un jour nouveau toute l’histoire qui eut lieu entre les deux hommes. Il s’agit bien évidemment de sources de première main, absolument indubitables puisque reproduites intégralement et en fac-similé, ce qui évite d’éventuelles erreurs de transcription. J’ai pris connaissance de l’ensemble de ces lettres rigoureusement inédites et il m’est apparu qu’elles permettaient d’approfondir le sujet sur trois points : la nature de l’amitié qui exista entre Breton et les Ferré ; l’histoire du ballet La Nuit ; l’affaire de Poète… vos papiers ! et son écho chez les surréalistes. Je me propose par conséquent d’établir une synthèse appuyée sur des extraits de ces échanges, étant bien entendu que l’intégralité des documents cités est consultable en ligne sur le site officiel L’atelier d’André Breton ou sur celui de Patrick Dalmasso, Léo on the web.
Je dois, avant de commencer, supposer connus la chronologie générale de l’histoire et les faits matériels, tels que j’ai tenté de les reconstituer précédemment dans un livre, Les Chemins de Léo Ferré, notamment au travers des deux récits intitulés Léo Ferré et les surréalistes et De La Nuit à L’Opéra du pauvre [1]. Il ne s’agit évidemment pas, ici, d’auto-promotion, mais seulement de ne pas redire toujours les mêmes choses. En effet, les nouveaux documents ne modifient pas le déroulement factuel de mes textes. En revanche, ils vont permettre d’aller plus loin.
L’amitié
Une carte de visite non datée – mais manifestement la plus ancienne dans la collection qui est offerte – indique : « Cher monsieur André Breton, je ne veux pas que vous achetiez mon nouveau disque. C’est pour cela que tout simplement et de tout cœur je vous l’envoie. Léo Ferré ». C’est ainsi que commencent les choses. On imagine, selon toute vraisemblance, que cette carte et le disque furent envoyés après l’entrevue de 1955 à l’Olympia avec Jean-Claude Tertrais, missionné par Breton pour signifier à Ferré son désir de le rencontrer. Le « cher monsieur » indique encore une distance polie.
Au début de l’année 1956, a lieu la rencontre physique. Breton vient dîner boulevard Pershing. Ferré a souvent fait allusion à cette première rencontre. On apprend aujourd’hui, grâce à ce fonds, qu’il était accompagné d’Élisa, son épouse, et de sa fille Aube, et que Ferré les a ensuite raccompagnés. Il n’était pas encore revenu que, déjà, Madeleine prenait la plume : « Jeudi, 2 h [du matin] » est la date de la lettre dans laquelle elle se félicite de cette rencontre, de cette amitié nouvelle, et remercie le poète avant de s’inquiéter de ce que, peut-être, son mari et elle ont trop parlé d’eux-mêmes durant la soirée. Dès son retour, Ferré lui-même écrit une autre lettre : « Jeudi matin… avant l’Aube… Cher André, vous voyez, je ne tarde pas à vous appeler André… ça m’est très facile… et je vous remercie de me l’avoir demandé. Je rentre et Madeleine m’a devancé ! C’est bien la première fois que cela lui arrive, d’avoir le besoin d’écrire à pareille heure… Considérez sa lettre comme une lettre d’amour… Nous désespérions de trouver des amis. Nous laissons croire aux fâcheux que nous sommes très occupés ! Pour vous, à partir de cette minute, nous sommes toujours libres. Je suis votre ami et votre frère, André… et nous n’avons qu’une famille : celle de la lumière et de l’intelligence du cœur. Dites à votre femme mon amitié et à votre fille qu’elle est un peu notre fille. Je vous embrasse bien bien volontiers. Léo Ferré ».
J’ai toujours pensé que Breton était un des rares – le seul, peut-être – à avoir vraiment impressionné Léo Ferré, qui a dû s’émerveiller d’avoir connu un personnage aussi exceptionnel. Les lettres dont on dispose maintenant confirment ce sentiment. En les lisant dans l’ordre chronologique (quelques unes, non datées, peuvent, par leur contenu, être situées au plus près), on observe une véritable fascination qui n’est pas courante chez Léo Ferré. Il a souvent dit son amitié pour telle ou telle personne, il n’en a jamais écrit comme ici.
À tel point qu’on se demande – je me le demande de plus en plus – si un rapport père-fils, évidemment inconscient, ne s’est pas créé. Ce n’est absolument pas péjoratif et ce n’est pas déprécier l’un ou l’autre que d’estimer qu’une différence d’âge de vingt ans (Breton est né en 1896) a pu jouer en faveur d’une compréhension recherchée par Ferré, dont on sait qu’il en a toujours voulu à son père de ne l’avoir pas compris. Selon Céline Caussimon, Ferré lui aurait confié que, sur son lit de mort, en 1973, Joseph Ferré avait encore demandé à son fils, alors au sommet de sa popularité, pourquoi il n’était pas devenu avocat. Or, voici que, brusquement, un aîné combien prestigieux et talentueux s’intéresse à lui et lui parle d’amitié passionnée (le mot et le soulignement sont de Breton, on le sait, dans sa dédicace de la carte du ciel de Ferré, établie avec sa fille Aube et datée du 18 février 1956).
Madeleine se met à lire Breton à fond. Trois livres à la fois. Léo Ferré et elle écrivent une lettre commune datée « Samedi 11 h soir » [6 février, date de la poste]. Ferré note entre autres : « Je ne veux pas que vous me disiez « Soyons simples » quand je vous parle d’Arcane 17. Je veux que vous m’y regardiez enfoui jusqu’au cou et que vous soyez heureux de la joie que vous me donnez car je ne lis que très peu, André, et tout m’indiffère, sinon une certaine bonté de l’homme ; et vous êtes la première intelligence bonne que je rencontre ». Le mardi 14 (la lettre indique « Mercredi soir 14 février 1956 » par erreur – ou bien alors, il s’agirait du mercredi 15), Ferré écrit de Bruxelles où il chante au cabaret et propose d’organiser « une grande conférence sur le Surréalisme avec textes dits par Madeleine », lui-même chantant « par ci, par là ». Cela n’aura jamais lieu, mais il est intéressant d’observer que, chaque fois qu’il se trouve avec des artistes qu’il estime, Ferré ne tarde pas à évoquer des réalisations communes. La proposition qu’il fera en 1969 à Brel et Brassens d’un récital à trois perd en cela beaucoup de l’originalité qu’on lui a toujours supposée – et ce qu’il expose à Breton est d’une autre mesure.
Une certaine intimité est vite perceptible. Breton initie les Ferré à la fréquentation des salles des ventes : « L’autre jour à l’hôtel Drouot où nous sommes allés « regarder » quelques vacations, il y avait votre admirable double entre nous, ce double que vous avez eu la bonté de déposer au 28, boulevard Pershing, avant de prendre le train pour vos vacances », lui écrit Ferré « vendredi soir 22 juin 1956 », ajoutant un peu plus loin : « De cette vente à Drouot, Madeleine a rapporté deux énormes vases en bronze, de Chine. Elle dit que c’est barbare… moi, je ne m’y suis pas encore habitué et si je les trouve barbares aussi, ce n’est peut-être pas dans le même esprit. Ils sont très envahissants. Madeleine les imagine pareils à ce qu’elle croit être des récipients à laisser macérer des têtes (cf. les réducteurs !) » Il semble qu’il y ait eu invitation lancée par Breton pour séjourner chez lui, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot) : « Chère Élisa, attends un peu pour aller chez les antiquaires du Lot. Nous ne manquerons pas le rendez-vous promis ! » Cette même lettre apprend qu’il y eut entre eux des discussions sur le Moyen-Âge. En conclusion de cette missive de deux grandes pages, Ferré écrit : « Vous êtes gâté ! Je n’écris JA-JA-JAMAIS… qu’à vous. Ou alors, c’est la barbe et le pensum ». Madeleine ajoute, quant à elle, deux autres pages datées « La maison, ce soir, 10 h » dans la même enveloppe. On y lit une chose ahurissante : « J’en étais même venue à haïr « l’Idée » de vous avoir donné cette veste (tant je vous voulais du velours flatteur près de vos cheveux gris !). Je me disais : « André n’a pas été content que je l’habille de force et à ma guise ! » » Elle paraît ici complètement séduite par celui qu’elle appelle au début de sa lettre « André chéri » et pour qui elle va jusqu’à acheter des vêtements selon son goût à elle. Et puis, voici un télégramme déposé à Paris le 27 juin à 16 h 22, parvenu à Saint-Cirq-Lapopie à 18 h 15 : « L’objet est à la maison. Envoyez 97. 000 francs à maître Rheims. Lettre suit. On vous embrasse. Madeleine ». D’évidence, il est ici question d’un achat en salle des ventes, fait au nom de Breton en son absence. Intimité, comme, encore, ce carton qui a dû être punaisé sur une porte : « On arrive. Madeleine. Léo », message non daté écrit de la main de Léo Ferré, témoignant de rapports libres, simples. Breton est attendu, les Ferré doivent s’absenter, ils lui laissent un mot, sachant qu’il patientera et ne s’offusquera pas.
Le « feuilleton lyrique » La Nuit
La lecture de cette correspondance permet de se rendre compte de l’importance que le ballet La Nuit a eu pour Ferré et son épouse. La première fois où Ferré évoque ce travail se situe le lundi 16 juillet, dans une lettre à Breton qu’il rédige au château de Costaérès, bâti sur une île, sur la commune de Trégastel-Ploumanac’h, château qu’il loue pour les deux mois d’été : un château construit au XIXe siècle dans un faux style médiéval par l’auteur de Quo Vadis ? Il est venu là parce que son épouse aime la mer et parce qu’il lui fallait un piano. Pour toutes ces raisons, ils n’ont pas choisi le chalet des Alpes où, jusque là, ils passaient leurs vacances. Ferré doit en effet livrer La Nuit le 15 septembre. Il donne à Breton quelques indications sur ce que sera ce « feuilleton lyrique » et ajoute : « Je souhaite que cela vous plaise ! » Il invite ensuite Breton à venir les retrouver, l’assurant qu’il viendra le chercher à la gare de Lannion, s’il consent à abandonner le Lot où il se trouve alors. Le 30 juillet, Madeleine insiste, dans une carte postale représentant le château : « Espérons que vous allez crever de chaleur et vous décider à venir ». Ironie du sort, c’est dans le Lot, qu’ils ne connaissent pas encore, que les Ferré s’installeront eux-mêmes sept ans plus tard.
Une lettre de Madeleine, datée « Verneuil [2], 14 septembre, 2 h… La Nuit » précise à Breton et à son épouse que Léo Ferré « passe jour et nuit à orchestrer La Nuit. C’est plein de chansons, de texte… magique, sans compromissions (vous connaissez votre Léo) et chaque soir il me dit : « Ça plaira à André », c’est tout ». L’idée qu’ils se font tous deux de cette œuvre est grande : « Nous y avons mis notre âme (!), une sorte d’espoir monstrueux à notre époque ». Madeleine regrette de n’avoir pas à réserver aux Breton « la place d’honneur à la première » puisqu’ils ne seront pas de retour à Paris. Elle enchaîne sur l’argument de La Nuit. Puis Ferré, qui a « une barbe de huit jours et dort trois heures par nuit pour que sa musique « sonne » ! » ajoute un mot en fin de lettre : « Dès que j’en aurai terminé avec ce travail de bagnard, je vous écrirai une très longue lettre. J’ai une très grande hâte de vous voir, de vous parler, d’entendre votre chère voix que bien des nuits je sentais passer sur ma musique ».
On mesure l’allégresse de Léo Ferré et de son épouse, une allégresse doublée d’inquiétude quelquefois. Mais ils sont persuadés que La Nuit sera un beau succès. On sait que ce sera un échec et qu’au lendemain de la première, la presse lui ayant tiré dessus à boulets rouges, elle sera retirée de l’affiche. J’ai raconté cette histoire en détail. Ce qui est nouveau à présent, c’est ce télégramme du 2 octobre : « La Nuit vous aurait beaucoup plu. Malheureusement, on la retire de l’affiche après les assauts conjugués de toute la presse et sans que le public y ait participé. Baisers. Léo. Madeleine ». Cette dépêche montre deux choses : les Ferré sont meurtris par l’abandon de l’œuvre ; ils ne peuvent s’empêcher de raconter immédiatement à Breton ce qui s’est passé. Étonnant réflexe d’enfants meurtris se confiant à un adulte comme pour lui demander justice. C’est en tout cas ce qui transparaît dans la lettre non datée mais qui suit évidemment le télégramme. C’est une lettre commune. Madeleine dit à Breton qu’elle lui adresse par courrier séparé les coupures de presse, une mise au point de Ferré qui devait paraître dans Paris-Presse et n’y parut pas, un enregistrement de La Nuit avec leurs deux voix et la musique, la jaquette du livret correspondant qui doit paraître à La Table Ronde, l’article qu’écrivit Louise de Vilmorin dans Marie-Claire (elle devait en faire paraître un autre dans Arts, dit-elle). L’auteur et sa femme n’acceptent pas cet échec et n’acceptent pas, surtout, que les commanditaires du ballet n’aient pas choisi de le défendre davantage. Ce courrier est très intéressant car il confirme beaucoup de choses : il n’y eut qu’une représentation et le bruit selon lequel Ferré aurait par la suite chanté lui-même depuis les coulisses est une légende ; il existe ou a existé un enregistrement personnel ; Madeleine a demandé à Breton d’intervenir : « Pour moi, la coupe est pleine. Que devons-nous faire, André ? Je crois qu’il faudrait peut-être aider Léo… sous la forme que vous jugerez utile pour lui, la polémique, le sourire ou l’admiration mais quelque chose venant de vous nous laverait de toutes ces souillures ».
Cette demande a une importance car elle éclaire enfin le passage de cette Lettre à l’ami d’occasion que Ferré écrira plus tard et qui ne sera jamais publiée de son vivant : « Si l’on m’attaque dans un journal pour un fait qui m’est personnel, vous ne levez pas le petit doigt sur votre petite plume même si c’est ma femme qui vous le demande, sans vous le demander tout en vous le demandant ». Breton, en effet, n’a rien écrit à ce sujet. En cette occasion, il faut le dire, ce sont les Ferré qui se trompent. Breton n’était pas obligé de faire quelque chose et d’ailleurs, qu’aurait-il pu faire ? Un échec artistique est un échec artistique et aucune polémique littéraire – comme Breton savait les créer, certes – n’aurait pu faire que l’œuvre soit reprise, eût-il engagé sa réputation. De plus, les Ferré supposent que Breton aurait aimé La Nuit. Mais la seule trace qu’on en relève dans un écrit surréaliste – datant d’après la brouille, il est vrai, et non signé expressément par Breton mais par la rédaction tout entière du Surréalisme, même en son second numéro – est : « Un « feuilleton lyrique » assez médiocre précisa ainsi son esthétique : « Un amoncellement d’argot ! Avec de la musique ! Un ramassis de vieux clichés ! (…) Le bottin de l’ordure ! » Outrances verbales, pensions-nous ». Qu’a répondu Breton à l’envoi de l’enregistrement ? A-t-il écrit, téléphoné ? On l’ignore. Les Ferré comptaient sur une reconnaissance d’office, une admiration automatique, toutes deux dues à l’amitié et entraînées par elle. C’était plutôt contraire à ce qu’était Breton mais, apparemment, ils ne le savaient pas. Léo Ferré croyait que Breton était comme lui : « Je ferai n’importe quoi pour un ami, vous m’entendez, cher ami, n’importe quoi ! Je le défendrai contre vents et marées – pardonnez ce cliché, je n’ai pas votre phrase acérée et circonspecte – je le cacherai, à tort ou à raison, je descendrai dans la rue, j’irai vaillamment jusqu’au faux témoignage, avec la gueule superbe et le cœur battant », se décrit-il dans Lettre à l’ami d’occasion. Je crois pouvoir dire qu’il n’y a pas là d’exagération : Ferré était ainsi. Breton était autrement : la raison littéraire et artistique l’emportait certainement sur le sentiment, la rigueur sur l’affectivité, et c’est ce qui va se produire dans l’épisode suivant.
En attendant, on relève encore dans cette lettre la présence, extrêmement importante pour Ferré, de la musique : « Léo a envie de casser la figure à ceux qui l’appellent « mélodiste » (un monsieur qui trouve des airs mais ne sait pas les écrire et donne ses idées à… rédiger). Tout cela relève de l’injure la plus grossière. (…) Je dois vous dire que, musicalement, il avait beaucoup travaillé, jours et nuits, que sa partition est admirable, je crois que c’est de ce côté-là qu’il est blessé », explique encore Madeleine à Breton. Et Ferré, dans le mot qu’il ajoute à la lettre de sa femme, écrit : « Les fumiers courent toujours… comme des lièvres aux oreilles rognées… et jamais un chasseur pour les arrêter ! À quand l’ouverture de la chasse à l’homme ?… dans une prochaine planète ! » La blessure est béante, décidément.
Le fait que Breton se soit abstenu de défendre La Nuit ne laissera pas de trace, en tout cas dans l’immédiat. En effet, une lettre de Madeleine, simplement datée « Jeudi » [15 novembre 1956], adressée à « André, Élisa chéris », transmet à Breton l’opinion de Ionesco, parue dans un journal hollandais dont la date n’a pas été conservée, mais qu’un ami de La Haye, Solar, a transmis aux Ferré, traduite, par une lettre du 2 novembre. Ionesco déclare : « Qui je hais et méprise le plus ? Staline, Hitler, Luis Mariano, Gilbert Bécaud, Léo Ferré et beaucoup d’autres, mais je ne puis me les rappeler sur le champ ». À juste titre, elle ajoute : « Hitler et Léo, tout de même ! » Ionesco sera épinglé par Ferré dix ans plus tard dans la troisième version des Temps difficiles.
Mais… lorsque Breton refusera de préfacer Poète… vos papiers ! et conseillera à Ferré de ne pas le publier, cette vexation et cette incompréhension viendront très certainement s’ajouter au silence de Breton lors de l’échec de La Nuit. Inconsciemment peut-être, mais il est très vraisemblable que Ferré y verra une seconde défection, se manifestant pratiquement après la première. Ce qui expliquerait les débordements de la préface qu’il signera lui-même.
La préface de Poète… vos papiers !
On connaît – on n’y reviendra pas – l’origine de ce texte, initialement paru dans Arts du 9 au 15 janvier 1957 sous le titre En France la poésie s’est sabordée, qui a été véritablement ressenti comme une trahison par Breton et ses amis surréalistes. Ce qu’apporte cette correspondance enfin sortie des archives, c’est l’étendue de la déception.
Breton téléphone, Madeleine répond, il hurle à la trahison. Georges Goldfayn qui avait loué Léo Ferré dans un article, « La fleur qui est sur les lèvres », paru dans la première livraison du Surréalisme, même, est consterné. Il écrit une lettre à Breton, le vendredi 11 janvier 1957 (c’est par erreur qu’il écrit « 1956 », bien sûr ; par erreur aussi qu’il écrit « Jeudi »). On y lit : « Je n’ai certainement pas été moins bouleversé que toi par cette sale histoire de Léo Ferré. L’article lu attentivement, je me suis bien persuadé qu’il était d’une grande canaillerie de formulation. Mais, en raison de cette affection particulière que j’avais pour Léo, je n’ai pas pu m’empêcher de vouloir des raisons personnelles pour le détester ». À cette lettre manuscrite, il joint un double de celle qu’il adresse le même jour à Ferré, dactylographiée celle-là, et par pneumatique. Le courrier pneumatique était un système de tubes introduits et propulsés dans des tuyaux à air comprimé, qui transportaient des lettres d’un bureau de poste à un autre, à l’intérieur d’une même ville. À l’arrivée, un postier apportait le « pneu » au domicile du destinataire. C’était la rapidité du télégramme associée à la possibilité d’envoyer une lettre véritable. L’envoi coûtait très cher et n’était utilisé que dans les cas d’urgence ou pour signifier une réelle importance. Un pneumatique de deux pages dactylographiées, c’était pour Goldfayn un signe d’urgence dans l’expression. Il dit à Ferré ne pas comprendre que, s’il s’agit d’un malentendu, il n’ait pas tenté de le dissiper. On sent bien que Goldfayn n’y croit pas et le regrette. D’où cette sommation : « Tu me connais assez Léo pour savoir que sans nouvelles immédiates de toi je me verrais dans la déchirante obligation de penser que l’étalage de ton affection était l’hypocrite manœuvre d’une abominable canaille ». L’expression est très dure, et certainement à la mesure de la déconvenue de Goldfayn.
Cette longue lettre confirme l’appel téléphonique de Breton à Madeleine et le cri à la trahison dont seul Ferré avait témoigné, jusqu’à présent. Elle révèle surtout que Breton avait déjà entretenu Léo Ferré des problèmes du vers classique, rimé et du vers libre. Aucun document n’avait jamais livré cette information (même si l’on pouvait se douter qu’inévitablement, leurs conversations avaient dû amener le sujet). On comprend mieux, alors, combien Poète… vos papiers ! a pu lui paraître une preuve de trahison. Mais Ferré, déjà, créait la langue de tous les registres et le vers libre, conspué dans l’article devenu préface et qui, cependant, sera plus tard utilisé, était présent antérieurement dans Cloches de Notre-Dame (1953) et même, plus anciennement, dans À la Villette (1950).
Le texte de Ferré a été fort mal ressenti, y compris par des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, en tout cas moins que Breton. C’est encore un avantage de cette correspondance découverte, que de montrer combien les surréalistes ont pu être touchés par ce libelle.
Par exemple, Adrien Dax, le vendredi 1er février, écrit à Breton, de Toulouse : « J’ai, bien sûr, parcouru le livre de Léo Ferré. Un curieux titre… « pas mal » sans doute (vocabulaire maison) mais je ne vous cache pas que je préfère – et de beaucoup – les chansons aux poèmes. Ces mots coupés en deux par des apostrophes, ces lettres entre parenthèses… aussi cette préface où l’on s’en prend, en roulant des épaules – pourquoi diable ! – à l’écriture automatique, tout cela m’agace un peu ».
De Londres, le 10 février, Mesens raconte : « Je lis de temps en temps un hebdomadaire littéraire français comme on avale une potion amère et, parmi ceux-ci, assez régulièrement Arts qui me tient au malcourant des expositions pharisiennes… C’est ainsi que le texte de Léo Ferré, qui est paraît-il la préface à un livre de ses poèmes que l’on vient de publier, m’est tombé sous les yeux. Impossible, bien entendu, de trouver ce livre à Londres ; non plus d’ailleurs que l’anthologie de Benjamin (jadis ce dernier m’envoyait ses livres avec de belles dédicaces…) Mais que signifie, au juste, ce texte de Ferré (curieux par quelques tournures) dont certaines phrases m’ont étonné et d’autres m’ont abasourdi. « … aux dictats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique » ». « L’art abstrait est une ordure magique [souligné trois fois] où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue ». Mais de quel abstrait s’agit-il ? Le cubisme, Chirico ? Chagall ? Klee ? Le tachisme ? L’abstrait « lyrique » ? Ce qui milite pour la « plus libre expression » ou pour l’« académisme » modernes ? Pourrais-tu m’expliquer ? »
Renée Beslon, le dimanche 10 février, écrit : « Nous avons lu avec surprise et quelque indignation l’article de Léo Ferré dans Beaux-Arts [sic]. On lui pardonnerait son accent passionné s’il s’accompagnait d’une pensée plus sérieuse, et s’il n’était gâté par trop d’humeur. C’est une bien étrange contradiction que d’appeler à l’Anarchie pour mettre la poésie à la laisse du vers. Il semblerait que la révolte précisément puisse s’accorder toute licence et l’allure même la plus effrénée. En parcourant le volume de Léo Ferré me revint en mémoire une opinion de Jules Monnerot qui alors m’avait blessée dans mes sympathies et pourtant assez troublée pour que je ne l’aie depuis oubliée tout à fait. À savoir que l’anarchiste serait un esprit à qui manquerait hauteur et profondeur ? »
Dans un courrier daté « Jeudi » [vraisemblablement le 12 mai 1957, selon la date de la poste très difficilement lisible sur l’enveloppe], Jacques B. Brunius note : « J’ai acheté sur la recommandation de Benayoun un disque de Léo Ferré. Il y a en effet quelques très belles chansons, sur un ton assez inusité. Le Monsieur en Blanc [sic] est très remarquable. Je n’avais pas assez d’argent pour acheter beaucoup de disques, très chers à Paris en comparaison de Londres, mais il m’a semblé qu’il y avait pas mal de chansons d’un style assez neuf ». Ici, pas d’allusion à la préface. Il semblerait que Brunius découvre seulement Ferré. Et l’on ne sait pas à quand remonte la recommandation de Robert Benayoun à laquelle il fait allusion.
On mesure, au lu de ces lettres – et peut-être en existe-t-il d’autres encore – combien le pamphlet de Léo Ferré a déçu des artistes et des auteurs qui l’avaient accueilli et lui avaient ouvert les bras. Mais on mesure également combien ils n’avaient pas compris que Ferré était un homme indépendant, qui ne serait jamais adhérent d’un parti ou affilié à un quelconque coterie littéraire. Or, comme le sous-entendait Goldfayn dans la lettre déjà citée, le surréalisme était tout, sauf une coterie : « Voilà donc Léo que tu écris un manifeste dans lequel tu mets en cause l’écriture automatique en la rapprochant de l’hermétisme de coteries littéraires ». Le malentendu est total, de chaque côté. Léo Ferré n’a pas saisi les surréalistes (du reste, seuls Breton et Péret l’intéressaient, pas ceux qui les entouraient) ; les surréalistes ont pris pour des contradictions ce qui était des complémentarités de la part d’un auteur qui ne s’est jamais interdit aucun moyen d’expression.
Plusieurs années plus tard, Breton recevra une lettre datée du mercredi 27 mars 1963, de Marie-Josèphe, auteur du recueil Les Yeux cernés paru chez Debresse en 1955, qui lui valut le prix Max-Jacob. D’elle, Pierre Béarn disait : « C’est par le sarcasme que ce petit démon de l’expression dépeint ses sentiments intimes. Elle est la révolte de la chair à l’état brut ; elle est nature ; elle s’amuse et nous amuse ». Et Jean Rousselot : « Marie-Josèphe, sous le parrainage de Tristan Corbière et de Renée Vivien, écrit – Les Yeux cernés – des alexandrins fouaillés, énervés, audacieux ». Elle sollicite un entretien pour montrer à Breton son nouveau manuscrit et écrit : « Je vous rappelle que nous nous sommes déjà rencontrés, ce chez un « ami » qui pour moi n’est plus qu’un souvenir (assez déprimant) à savoir, le narcissiste [sic] Léo Ferré aujourd’hui vedette alimentaire sur les murs de la Capitale dite des douleurs ». Le moins qu’on puisse dire est que se rappeler au souvenir de Breton en débinant celui chez qui ils se sont rencontrés est plutôt indélicat, ou, si elle était au courant de leur brouille, relevant de la flagornerie. On ne comprend guère, non plus, le jugement qu’elle porte sur la célébrité de Ferré, avec une étonnante allusion à un titre d’Éluard, sinon par une espèce de rancœur : Marie-Josèphe est alors oubliée, Ferré au contraire a connu le succès. Il n’y aurait guère d’intérêt à citer cette lettre, si l’on n’en pouvait tirer un enseignement. La poétesse a connu Ferré enregistrant chez Odéon. Il est aujourd’hui chez Barclay. Son ressentiment est révélateur d’une réaction alors fréquente : en changeant de maison de disques, Ferré se serait compromis. Ce que produit Barclay serait plus commercial, les disques de Ferré seraient moins bons qu’autrefois… C’est très amusant car, lorsque Léo Ferré quittera Barclay, il se trouvera beaucoup de gens pour regretter – et aujourd’hui encore – ce catalogue, supposé indépassable. C’est un autre sujet.
Pour ne pas conclure
À l’histoire telle que je l’avais reconstituée en son temps, sont donc venus s’ajouter la Lettre à l’ami d’occasion et tous les documents aujourd’hui disponibles. La Lettre à l’ami d’occasion reste un exercice de style : jamais envoyée, incorporée au recueil inachevé des Lettres non postées, elle est un texte de Ferré avant tout. Son ton est radicalement différent de la correspondance réellement échangée avec Breton. Parmi les passages de ce texte qu’éclaire désormais le fonds d’archives, on trouve : « Je ne vous avais jamais lu, parole d’honnête homme, je ne l’ai guère fait depuis à quelques pages près. Les compliments qu’il m’a été donné de vous faire à propos de ces quelques pages étaient sincères, je le souligne ». Ces phrases sont sans nul doute à rapprocher de l’allusion faite à Arcane 17 dans la lettre du 6 février 1956.
Il manque évidemment, à ce jour, les lettres adressées par Breton à Léo Ferré. Elles permettraient que l’éclairage soit complet et ne s’exerce pas d’un seul côté. Lorsqu’on disposera de ces pièces indispensables, il faudra revoir ces réflexions pour les compléter à nouveau.
Cette aventure s’avère de plus en plus complexe. Au-delà de l’aspect outrancier de la phrase de Breton (« En danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre »), on commence à mieux comprendre. Breton n’aime pas le recueil Poète… vos papiers !, ce qui est son droit, et sa phrase est pour lui un conseil d’ami. Il veut éviter à Léo Ferré la publication de ce qui lui paraît un mauvais livre. Disons qu’il s’y prend mal : c’était mal connaître Ferré. Cette rupture signe finalement des différends littéraires plus profonds, si l’on en croit Goldfayn. Les deux hommes s’étaient déjà entretenus du vers libre et du vers classique. Avec le recul et sachant ce que Ferré écrira par la suite, on peut se dire que c’était un faux problème : Ferré voulait utiliser toutes les formes d’expression sans rien s’interdire, et son vers classique ne l’est pas toujours, notamment lorsqu’il mêle à la préciosité ou à la simple délicatesse le trivial, le scabreux ou l’humour. Les apocopes qu’on a critiquées (lettre d’Adrien Dax), lui en use et s’en moque puisqu’il admet d’écrire avec ou sans, éventuellement dans le même texte.
Je pense que l’erreur – je veux dire le raté de l’amitié – vient de la sensibilité de l’un et de l’autre. Breton ne peut pas admettre le manuscrit qu’on lui a fait lire et pour lequel on lui a demandé une préface. Ce recueil est trop contraire, dans sa forme, à ce qu’il défend depuis 1924 et le pire est qu’il vient d’un ami, reconnu et encensé dans une publication qu’il dirige. Maladroitement peut-être, il use d’une formule que Ferré ne comprend pas réellement parce qu’il se place sur le terrain affectif et que les prises de position « techniques » ne sont pas son fait. Léo Ferré transforme ce refus littéraire en peine personnelle. Je crois que c’est cela : un motif littéraire se mue en coup affectif et le désordre s’installe.
Remerciements : Patrick Dalmasso.
________
[1]. Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, Christian Pirot, 2005.
[2]. La maison de Normandie se trouve à Notre-Dame-des-Puys, près de Nonancourt, près de Verneuil. Les Ferré disent indifféremment « Nonancourt » ou « Verneuil » pour désigner l’endroit comme, plus tard, ils diront « Cahors » ou « Gourdon » pour désigner Saint-Clair, où se trouve le château de Perdrigal.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (32)
lundi, 12 novembre 2007
Léo Ferré acteur et musicien du cinéma : nouveaux éléments
Dans le livre Les Chemins de Léo Ferré, j’avais évoqué les quatre films courts auxquels il a participé par le commentaire, la musique. Voici quelques précisions complémentaires, tant il est vrai qu’un livre n’est jamais achevé, une quête toujours infinie, une vague renouvelée sans cesse à l’horizon documentaire.
Tout d’abord, un retour sur Paris-Taxis, et non Paris-Taxi comme je l’avais indiqué fautivement, le pluriel faisant bien partie du titre. Voici ce que j’écrivais dans mon livre.
Plus anciennement, Ferré écrivit quelques musiques de films courts, et c’est ce domaine qu’il faut explorer le mieux possible, car il est le moins connu. En tout état de cause, c’est sur lui que les tentatives de reconstitution documentaire, le plus souvent, achoppent. En ces années, une séance de cinéma ne se concevait pas sans première partie, laquelle comprenait des actualités, un dessin animé, l’annonce des prochains spectacles et un documentaire ou un court-métrage, dit aussi « petit film ». Quand ne s’ajoutaient pas à tout cela quelques attractions, durant l’entracte !
Le premier de ces films est Paris-Taxi, court-métrage d’Édouard Logereau, en 1949, dont la chanson, interprétée par Zizi Jeanmaire, fut enregistrée, longtemps plus tard, dans Zizi Paris, un 25-cm Philips assez rare [1] ; curieusement, aucun autre interprète ne l’a inscrite à son répertoire ; le titre du film était très exact, puisqu’on y montrait quelques aspects de la vie à Paris, d’après des scènes vécues par des chauffeurs de taxi ; la chanson, traitée en une très jolie valse, est bien dans la manière de Léo Ferré, puisqu’elle se rattache finalement à l’esprit des Amants de Paris, des Forains et de L’Île Saint-Louis. On peut en juger par ces quelques extraits : « Les beaux taxis / Font la cour à Paris / À la nuit / Mais les amants / Font l’amour à Suresnes / Je t’aimais tant / Sur les bords de la Seine / Qu’il n’est plus temps / De finir ma rengaine (...) / Mais à Paris / On s’aime davantage (...) / L’amour ça n’a pas de prix / Ça se fait sans bagages / Combien d’amoureux / Ont usé leur tendresse / Oublié leur adresse / Dans les taxis (...) / Qu’importe où vont les taxis / Puisqu’ils vont où l’on s’aime... »
On peut ajouter à présent que le commentaire est de Pierre Dac et que Léo Ferré a signé la chanson, mais aussi la musique qu’on peut entendre tout au long du film, musique hélas couverte par la voix du commentateur, toujours haut perchée ainsi qu’il était d’usage dans ces courts-métrages un peu parodiques, au rythme accéléré, dont on produira de nombreux exemplaires jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle vague, ou à peu près. Cette partition, a priori, s’apparente à Musique byzantine. La chanson est interprétée par Jacqueline François – il y eut donc deux interprètes et non une seule comme je le croyais – qui ne chante que deux couplets : le premier disparaît. Zizi Jeanmaire, elle, ne chantait pas le dernier. Cette valse, finalement, ne fut donnée intégralement que par Ferré lui-même, lors de son récital au Vieux-Colombier, en janvier 1961.
Voici ce que j’écrivais encore.
Le second, Au temps du cinématographe, autre court-métrage, de Pierre Céris cette fois, date de 1950. À ce jour, malheureusement, il n’a pas été possible d’apprendre quoi que ce soit concernant cette réalisation, mais les recherches se poursuivent.
Il s’agit finalement d’une évocation du cinématographe débutant, faite avec les caractéristiques ci-dessus énoncées : choix du burlesque, commentaire dit d’une voix haut perchée, musique un peu « écrasée » par le texte. On note que celui-ci fut établi par Paul Guimard et dit par André Var. Le générique mentionne : « Accompagnement musical de Léo Ferré ». Cet accompagnement est fait au piano et l’on y entend notamment quelques mesures de Paris-Canaille (alors que la chanson n’était pas encore écrite) et de Martha la mule. La seconde partie est soutenue par une partition orchestrale, mais elle ne paraît guère relever de Ferré, tout au moins dans les conditions d’écoute possibles.
Remerciements : Daniel Dalla Guarda et Donatella Nebbiai.
___________________________
[1]. Zizi Paris, 33-tours, 25-cm, Philips, B 76523 R.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (16)
mardi, 28 novembre 2006
Les Lettres non postées, un livre rêvé
Quand le chanteur le cœur usé par sa chanson
Vient demander son bien au langage commun
(JEAN MARCENAC)
À partir de 1953, Léo Ferré anime, sur les ondes, hebdomadairement, une émission intitulée Musique byzantine, qui lui vaut un courrier nombreux. C’est au sujet de cette correspondance qu’il déclare à Claude Obernai « (...) avoir une émission de radio est la chose qui rend le plus rapidement misanthrope. Musique byzantine [m’]apporte tout de même une trentaine de lettres capables de [me] réconcilier avec les autres. [J’ai] été surpris de constater que, dans l’ensemble, les gens sont plus cultivés qu’on ne le croit ». [1]
« On m’écrit très peu. Presque toujours des lettres médiocres. Aucun intérêt. Les gens bien sont ceux qui ne m’écrivent pas » déclare-t-il seize ans plus tard, sans ambages, toujours en réponse à Claude Obernai, et pour la même publication. [2]
Loin de ces rapports d’amour mêlé de détestation qu’il entretient avec le courrier, lui, s’est plu à écrire de drôles de lettres dans une prose incomparable. C’est une œuvre qu’on ne connaît pas assez et qui aurait pu constituer un tout remarquable.
Le projet
En 1961, Ferré répond à la revue Chansons : « J’ai deux livres en préparation : Benoît Misère, qui sera un roman et Lettres à un jeune musicien qui me permettra d’exprimer ce que je pense des musiciens en général et des musiciens contemporains en particulier ». [3]
En 1962, il chante au théâtre de l’ABC, 11, boulevard Poissonnière à Paris (Central 19-43). Après son triomphe de l’année précédente à l’Alhambra et la parution d’un ouvrage de Gilbert Sigaux, [4] avant sa toute prochaine entrée chez Seghers dans une collection plus que prestigieuse, [5] ce spectacle est attendu et la presse est nombreuse. « Complet partout » prévient un panonceau, sur le trottoir.
Au cours d’une interview, Ferré annonce à Charles Dobzynski son intention de publier prochainement deux ouvrages. L’un, dont le titre, Lettres non postées, est déjà choisi, consiste en une série de « lettres écrites à des correspondants inconnus, ou même à des objets inanimés, et qui ne sont jamais parvenues à leurs destinataires ». [6] On le voit, le projet des Lettres a évolué : il ne s’agit plus uniquement de les adresser à un jeune musicien.
Il se trouve que l’éditeur René Julliard, qui avait retenu Lettres non postées et le roman Benoît Misère – c’est le second volume – sur manuscrit, est mort peu auparavant, le dimanche 1er juillet 1962. Léo Ferré l’avait connu lors de « l’affaire Minou Drouet ». [7] Et rien, finalement, ne se fera. Seul, Benoît Misère verra le jour, en 1970, chez un autre éditeur, Robert Laffont, après avoir failli être imprimé par Léo Ferré lui-même, qui le typographiait encore en janvier 1968, comme l’atteste sa chronique Je donnerais dix jours de ma vie. [8] Les Lettres non postées ne seront jamais rassemblées en volume du vivant de leur auteur. Il s’agit donc d’un livre mythique, d’un livre rêvé.
Quelques pièces connues
Un livre rêvé qui est cependant partiellement connu car, depuis cette annonce malheureusement sans lendemain, douze textes ont été édités, dont certains plusieurs fois, sans aucun ordre particulier.
On a pu lire en effet, dans le premier volume des « Poètes d’aujourd’hui » consacré à Léo Ferré, [9] Lettre au miroir et À la folie. Dans Il est six heures ici... et midi à New York, [10] une plaquette au format tout en hauteur, imprimée par Léo Ferré à l’enseigne de ses propres éditions, on trouve À mes lunettes, À un jeune talent, Au Tout-Paris, À un directeur de music hall, À une lettre anonyme et À %, imprésario. Dans les Poésies illustrées par Jacques Pecnard, publiées en tirage de luxe par les éditions du Grésivaudan, [11] on voit figurer Au Tout-Paris, À mes lunettes, À un jeune talent, À un directeur de music hall et À une lettre anonyme. Dans le recueil La Mauvaise graine, [12] figurent À mon habit et Lettre à la mer, ainsi qu’une nouvelle fois, À la folie. Dans l’ouvrage La musique souvent me prend... comme l’amour, [13] est encore donné À mon habit ; on y trouve également À un jeune musicien (survivance du projet initial), texte inclus dans le corps d’une émission de radio de 1980. Dans le n° 8 du bulletin d’informations Les Copains d’ la neuille, daté printemps-été 2005, a paru Lettre à l’ami d’occasion.
Il s’agit de proses qui, lyriques ou caustiques (parfois même, ce sont de franches mises en cause), rassemblent plusieurs caractéristiques de style et de pensée de Léo Ferré. Tout son art est dans ces quelques pages. La prose est de haute tenue et l’expression poétique toujours présente. Se manifeste là son sens du raccourci. Évidemment, métaphores et absence de concessions se mêlent à une extrême sensibilité comme à l’expression d’une enfance conservée.
L’auteur s’adresse ici, finalement, au monde entier. Il interpelle – quelquefois, il somme – les hommes, les choses, les éléments. Héler un personnage, lui dire « tu » ou « vous » et conduire simultanément l’action est pour le romancier, par exemple, un exercice périlleux. Dans la tradition épistolaire que Ferré renouvelle et dépoussière, tout en développant jusqu’au bout son propos, il toise ou invoque le supposé correspondant, ce qui ne semble pas être une difficulté majeure pour le musicien, qui possède évidemment la maîtrise du rythme.
Ferré n’a jamais connu de frontière entre sa vie et son œuvre ; les Lettres non postées sont, sur ce point, révélatrices. La vie et le métier d’artiste, dans ces douze textes « rescapés », sont indissociables. Au Tout-Paris, À un jeune talent, À un directeur de music hall, À %, imprésario, mettent en scène les personnages qu’on croise dans une vie professionnelle, et Léo Ferré leur dit leur fait.
Dans Au Tout-Paris, les personnes visées sont celles qui auraient « renvoyé leur carton en rayant la mention inutile : Je n’assisterai pas » – mais il se serait agi d’être présent, précisément, à des dates vraiment particulières : 1789, 1848, 1871, 1968. « Vous êtes du Tout-Paris et de toute la Viande qui sent un peu », écrit Ferré.
Le texte À un jeune talent est relativement bref et ce que recommande Ferré n’étonnera pas. Il s’agit finalement de se comporter comme lui : « Soyez dans la marge », « Ne prenez jamais de conseil de personne » et surtout : « Soyez orgueilleux. L’orgueil, c’est la cravate des marginaux ».
À un directeur de music hall est bref et brutal. L’homme en question n’est pas nommé mais l’allusion est transparente. On relève entre bien des propos peu amènes : « Vous avez vieilli, on vieillit tous, me direz-vous, moi aussi, mais chez vous c’est indécent ».
À %, imprésario rappelle au monsieur en question qui fait quoi dans le monde du spectacle et l’invite à ne pas confondre les rôles : « Vous me faites penser à un maître d’hôtel qui oublierait chaque soir de se mettre en livrée pour servir ses clients. En augmentant le chiffre de votre %, vous finissez par ne plus savoir qui est le servi et qui est le serveur. (…) Et puis, apprenez à dire merci, comme les domestiques. C’est bien le moins que vous devez aux imprudents qui vous font vivre ».
Il y a aussi, là, l’autre côté de la célébrité, certains aléas de la notoriété qui impliquent une réponse cinglante (À une lettre anonyme). Ce texte répond à une lettre comme en reçoivent quelquefois les artistes. Léo Ferré, qui n’a jamais supporté le manque de courage, ne pouvait rester sans réagir face à un anonymographe. Il a donc rendu publique sa réponse à défaut de pouvoir l’adresser directement à son destinataire, encore qu’il eût mieux aimé, lui dit-il, « vous dire par le fouet ce que vous me contraignez à vous faire savoir par la grâce de la typographie ». Tout, ici, est morsure et dégoût envers la petitesse et cette particulière attitude, fût-elle une maladie, qui consiste à ne pas signer ses envois. Dès le début du texte, il est question de s’abaisser (« cloportes », « plume d’égoutier »). Pour l’auteur de la lettre anonyme, ne demeure que le trait du mépris. Comme souvent chez Léo Ferré, les mots et les idées en entraînent d’autres. Ainsi, l’utilisation du terme « poulet » appliquée au courrier en question l’emporte vers des considérations qui, de « manières policières » en « flic », le fait conduire l’auteur anonyme au Quai des Orfèvres où, l’assure-t-il, « on ne vous convoquera pas. On vous recevra ». Là-dessus, Ferré revient à son propos, s’attachant à traiter la lettre, partie « où vous pensez » mais pas oubliée, comme elle le mérite (« certains graffiti qu’on peut lire dans certains lieux », « les cabinets publics », « votre obole », « votre "contenu" », « les odeurs particulières ») et cela ira, sans modération, jusqu’à la fin où, il ne faut pas s’en étonner, apparaît encore la notion d’homme debout et d’homme à terre. Dans toute l’œuvre de Léo Ferré, dans ses propos tenus lors d’entretiens, cette obsession qui est la sienne de se tenir droit et libre est présente. Une attitude pleine de cet orgueil dont il disait qu’il le tenait debout, un maintien de seigneur qu’accusent les fréquentes allusions à un secrétariat et à des employés (faites uniquement pour accentuer encore le mépris hautain de l’artiste face à l’abjection et à la couardise), dominent ce texte vengeur qui, par son sujet, par son ton, aurait pu n’être pas littéraire. Il n’en est rien. Chez Léo Ferré, c’est une constante, la qualité du style est toujours là et, même lorsqu’il s’agit de textes de circonstance, chacune de ses compositions est écrite, à proprement parler.
À l’opposé, À mes lunettes, un des textes les plus brefs, est écrit sur un ton plus intimiste. Il évoque le temps où Ferré devait en chausser constamment et, en même temps, la jeunesse, les femmes dont Ferré a toujours été persuadé qu’elles ne l’avaient pas aimé à cause des verres qu’il portait : « Les femmes n’aiment pas cette superstructure de visionnaire, elles ont l’impression d’être vues deux fois ».
À la folie, qui n’est pas une lettre écrite à la folie comme pourrait le laisser supposer le titre, est un magnifique texte d’amour. Ferré s’y présente comme un mot, le mot « croup », maladie mortelle pour les enfants, qui n’a plus cours. Il est délicat d’évoquer ce mélange de souvenirs, de métaphores, de vers et de prose dont certains passages sont à la limite de la préciosité. Le mot, d’ailleurs, est écrit : « Nous sortîmes par vos masques, lentement, avec préciosité, et tout penchait autour de nous, les arbres, les plis d’ombres, les roses pâleurs du soleil couchant ». On a peine à détacher du tout des notations remarquables : « Nous marchions ensemble, depuis la dernière glaciation » ou « Nous étions toujours l’un à l’autre, comme deux feuilles accolées d’un papier bible et pour nous séparer il fallut qu’un oiseau des îles infime, petit, petit, vint immiscer son bec entre nos songes ».
Lettre au miroir vient sublimer l’objet domestique, la chose quotidienne, pour déboucher sur de nouvelles interrogations. La présence de l’auteur dans son texte est constante, ce qui peut se comprendre puisqu’il s’adresse à un objet familier. Ce n’est donc pas qu’une figure de style : « Quand je passe devant toi, dans le couloir, tu me renvoies l’image d’un piège : c’est toi l’oiseau et moi la glu, et je me colle à toi, bouche à bouche et la brume de nos haleines n’est qu’une gaze de nausée ». À la clausule, cette présence persiste et s’y ajoute un souci métaphysique : « Quand je pense que tu n’as pas encore vu que je me teignais les cheveux ! Tu ne vois donc pas la Vérité ? Au fait, qui la voit ? ».
À mon habit entrecroise le métier (ici, la direction d’orchestre) et la vie (la nostalgie d’un mémorable concert et le temps qui passe). Ce texte non daté, mélancolique et lucide, fut écrit quelque temps après la soirée donnée à l’Opéra de Monte-Carlo, le jeudi 29 avril 1954, au cours de laquelle Léo Ferré dirigea La Chanson du mal-aimé, oratorio lyrique qu’il composa sur le poème d’Apollinaire, ainsi que sa Symphonie interrompue, écrite en complément de programme à la demande du prince Rainier. S’adressant à l’habit de gala spécialement acquis pour ce moment qu’il n’oublia jamais, Léo Ferré donne un texte typique de sa manière. Aux éléments autobiographiques s’ajoute une dimension quasi métaphysique, désabusée en tout cas, qui se fait jour dans la phrase ultime. De plus, Ferré prête ici une vie aux objets et leur donne donc de l’amour, cet amour caractéristique de sa vie et de son œuvre, éprouvé pour les gens, les animaux, les choses, et qui fut toujours son seul et unique « programme ». Les métaphores se succèdent, le frac devient « un smoking à l’échelle 20 » ou « l’empereur des habits de soirée », cette seconde image permettant à l’auteur d’enchaîner sur un coup de griffe bien personnel aux autres empereurs, les vrais. Apparition inattendue d’une certaine Denise (Ferré introduit souvent des personnes réelles dans ses textes) qui est vraisemblablement chargée du ménage, mais ne croit pas devoir « réprimander » la poussière, cette poussière qui, chez Ferré, est anarchiste (n’est-il est pas naturel, alors, qu’elle n’en fasse « qu’à sa laine, qu’à ses catons, qu’à ses mèches » ?). On observe là non seulement la vie encore une fois prêtée aux choses, mais aussi la langue de Léo Ferré, réinventée, celle de tous les registres. « Ne vous faites pas de trame », dit-il à l’habit, comme il eût dit : « Ne vous faites pas de souci ». Semblable à la promiscuité de l’artiste dans la foule, voici, avec beaucoup d’humour et de tendresse, celle du frac dans la penderie où se trouvent déjà « des tissus compromis et fatigués ». Puis viennent la hantise de ne jamais plus avoir l’occasion de diriger un orchestre (on sait que Ferré en conduira de nombreux, plus tard, et cette fois sans frac) et l’ironie attristée de la phrase, dite au fripier par l’habit. Habit qui finira, lui aussi, dans l’usure, le temps qui passe et la mort, rejoignant par là la condition de l’homme, omniprésente chez Léo Ferré, achevant ainsi logiquement le fait de s’être vu prêter une vie.
Lettre à la mer, texte daté « En Bretagne, le 20 août 1957 », [14] évoque la fascination d’un méditerranéen devant l’autre mer, celle qui a « fait la croche à Debussy ». On sait qu’un peu plus tard, Ferré achètera une maison fortifiée sur l’îlot Du Guesclin, commune de Saint-Coulomb (Ille-et-Vilaine), entre Cancale et Saint-Malo. De cette déclaration d’amour mêlée d’ironie et mouillée de mal de vivre, on retient toutefois une volonté d’œuvrer au recueil et au-delà : « (…) parce qu’il faut que je t’écrive une lettre qui composera mon livre qui n’est pas encore composé, parce qu’il ne faut pas que je meure avant d’avoir fini ce que j’entreprends aujourd’hui avec toi et avant même d’avoir écrit beaucoup d’autres choses ». Cette belle ingénuité dans l’aveu est remarquable.
À un jeune musicien prend pour cible « l’artillerie dodécacophonique » et l’abstraction dans l’œuvre contemporaine qui « doit être concise, hautaine, à tirage de luxe, voire hors commerce ». Les préoccupations artistiques de Léo Ferré dans le domaine musical sont là, telles qu’il les exprimera ailleurs en de nombreuses occasions.
Lettre à l’ami d’occasion est une adresse à André Breton qui n’est jamais nommé dans le texte, après leur brouille des débuts de l’année 1957, consécutive à la parution du recueil Poète... vos papiers ! Mais, comme les autres, cette lettre ne fut jamais postée et Ferré, sa vie durant, garda de Breton un souvenir ému, impressionné, et ne manqua jamais de le rappeler. [15] On peut, avec la distance, raisonnablement considérer cette lettre comme un exercice de style, le résultat d’une tristesse, d’une amertume. En aucun cas comme un soufflet : on ne range pas les gifles dans un dossier.
L’état du texte
Il existe beaucoup d’autres lettres inédites : Lettre à l’Angleterre, long texte dans lequel l’auteur évoque son séjour de 1950 durant lequel il tourna dans le film de Basil Dearden, Cage of gold ; [16] Lettre à une tombe dont des extraits sont incorporés, parfois retouchés, à un chapitre de Benoît Misère ; Lettre à un critique.
On trouve des titres auxquels sont liées quelques notes destinées à des textes plus avancés dans leur écriture : À l’Angleterre ; À une tombe ; À un imprésario ; À un jeune talent ; Au Tout-Paris ; À un porte-manteau ; À un miroir ; À un directeur de music hall ; À une lettre anonyme.
Il existe également des titres auxquels sont associées des idées notées sous la forme de quelques mots seulement : Lettre à un porte-manteau ; Lettre à un chiffon ; Lettre à un ouvrier ; Au communiste ; À l’île Saint-Louis ; Au téléphone ; À l’hôtel de passe ; À un vers libre ; À un vitrail ; À un carnet de chèques ; À la lune ; À une dame du monde ; À l’arriviste ; À ma maison. L’exemple de Lettre à un chiffon est frappant : c’est une longue liste de mots, dont certains disposés en deux colonnes, que l’auteur, d’évidence, aurait aimé employer lors de la rédaction de son texte. S’agissait-il pour lui de goûter pleinement ces termes qu’il devait trouver plaisants, sensuels, curieux, ou bien une idée précise leur était-elle attachée ? On l’ignorera sans doute toujours. Lettre à un porte-manteau est aussi remarquable, puisque Ferré y voit une potence et imagine, dans les vêtements suspendus, des condamnés au gibet. D’où toutes les réminiscences de Villon possibles. Ce texte est révélateur du type de regard que pouvait porter l’auteur sur tout ce qui l’entourait. Vision de poète, évidemment.
Il est encore des textes inachevés : Lettre à mon costume de scène ; Lettre à un jeune soldat du contingent (en vers) ; Lettre à un portefaix.
On trouve enfin de nombreux projets dont Léo Ferré n’a noté que les titres, sans avoir eu le loisir ou l’occasion d’en concrétiser l’idée initiale : La putain ; La pucelle ; Annie ; À Pépée ; Sosthène ; À Canaille (école d’Alfort) ; À Denise.
L’établissement du texte se heurte à une difficulté supplémentaire : certaines lettres présentent des variantes entre le manuscrit original et un premier dactylogramme, lui-même raturé quelquefois. Seule certitude, les feuillets portent, inscrite à la main ou à la machine selon le cas, la mention L/n/P qui identifie sans doute possible leur destination.
On voit combien le dossier de ce livre est divers et inachevé. On reste rêveur : qu’aurait pu dire Ferré à un vers libre, en dehors des quatre phrases consignées ? À un vitrail (trois courtes phrases seulement) ? À un carnet de chèques (quatre phrases) ? On ne peut le savoir mais l’examen des lettres et des notes ne laisse pas de doute. On aurait pu lire des textes emplis d’un humour triste, parfois caustiques et toujours ouverts sur l’espérance, malgré tout.
On observe aussi une chose. Cet ouvrage laissé en chemin met à mal la légende d’un Ferré pratiquant une écriture rapide, de premier jet. Pour ces textes en prose en tout cas, et au moins au cours d’une période donnée, il compose lentement son œuvre, bâtit l’ensemble sur la durée, prend des notes, consigne des idées, des séries de mots, des bribes de phrases, des citations. Les manuscrits sont travaillés, les dactylogrammes sont raturés. Ferré créateur prend son temps.
Le ton des Lettres non postées, la forme générale de leur écriture, leur unité qui persiste malgré l’inachèvement, les situent sans doute possible dans les années 50 (certainement dans la seconde moitié) et les toutes premières années 60 (selon toute vraisemblance, avant le départ de l’auteur pour le Lot, en 1963). La Lettre à la mer donne la date précise du 20 août 1957 et le projet, non réalisé, d’une lettre À Pépée fournit le repère de 1961, date à laquelle Ferré adopta son petit chimpanzé. Le livre était donc encore sur le métier à cette date. Une exception cependant, Au Tout-Paris, où la date de 1968 est inscrite. Mais, si l’on met en regard les notes correspondantes, on s’aperçoit qu’elle a été ajoutée a posteriori.
Il faut avoir présent à l’esprit ce que représentait le courrier à l’époque du projet, dans une société extrêmement codifiée et rigide. La lettre est à peu près le seul moyen de communication, le téléphone, rare et onéreux, étant relativement peu utilisé. Il arrive encore, au milieu des années 60, qu’on écrive pour dire : « Je vous téléphonerai demain vers dix heures ». Il arrive qu’on aille téléphoner chez son voisin, qui fait payer la communication en disposant une boîte près du combiné. Le télégramme, qui coûte cher, est réservé aux grandes occasions (naissances, mariages, décès) ou, dans la vie professionnelle, aux ordres urgents. Léo Ferré, lui, l’utilisait aussi pour signifier des choses définitives, des fins de non-recevoir. C’est dire que la lettre, toujours manuscrite (la dactylographie est réputée extrêmement incorrecte) possède une valeur très grande. On achète son papier à lettres chez le papetier, on le fait parfois imprimer ou graver à son chiffre. Recevoir une lettre a une importance et induit un comportement : répondre sur tel ou tel ton ou ne pas répondre, par exemple, a un sens réel et fortement ressenti. L’absence de réponse est une grossièreté, parfois une offense volontaire. Dans cette optique, les Lettres non postées ont une résonance différente de celle qu’elles pourraient avoir aujourd’hui, surtout lorsqu’elles sont adressées à des types sociaux, à plus forte raison à des personnes réelles. Si ce recueil avait paru dans les premières années 60, il aurait presque été considéré comme un brûlot. C’est en cela que Ferré, s’inscrivant dans un genre littéraire existant, le secoue et le marque. Le courrier électronique a rendu plus banales les relations contemporaines.
L’édition posthume
Après avoir lu douze lettres lentement égrenées au fil du temps et patienté durant quarante-cinq ans, voici qu’enfin, en 2006, on peut trouver une édition de ce recueil voulu par Ferré, puisqu’annoncé dès 1961 et plus précisément depuis 1962. L’édition posthume a un double aspect. Un disque dans lequel Michel Bouquet dit un choix de ces lettres est publié, [17] tandis que, parallèlement, le texte est enfin édité avec, en couverture, un graphisme de Charles Szymkowkicz, [18] qui dessine aussi la pochette du disque.
Huit textes ont été retenus, qui sont dits par le comédien : Lettre à l’Angleterre, Lettre à la mer, Lettre au miroir, À mon habit, Lettre à un critique, À un jeune musicien, Lettre à l’ami d’occasion, À une lettre anonyme. Ce sont évidemment quelques unes des pièces des plus achevées. La voix de Bouquet et les petits rires ironiques mêlés à sa diction auxquels il a accoutumé son public, donnent à ces pages de Ferré un ton évidemment autre que celui que leur auteur leur eût conféré s’il les avait, par exemple, mises en musique. Lors de la sortie du disque, Bouquet déclare dans une émission de radio : « Lorsque je les ai lues, j’ai encore compris, mieux, à quel point l’homme était un écrivain, l’homme était un poète, l’homme était véritablement quelqu’un d’important pour la littérature de tous les temps ». [19] Il dit encore : « Je les ai enregistrées avec énormément de bonheur profond. J’espère que je ne les ai pas trop mal faites, parce que j’ai peur de ça. Quand on touche à ce qui est authentique chez un poète, il faut faire très attention ». [20] Enfin, il ajoute : « Je les ai bien préparées pour essayer de rendre le secret qui accompagne cette écriture, c’est-à-dire cette chose qui est presque en marge de la vie ». [21] Huit morceaux de piano intitulés Intermezzo 1 à 8, très courts, s’intercalent entre les textes. Ce sont des enregistrements faits par Ferré lui-même, des bandes de travail qui trouvent ici leur place, à la fois inachevées et attachantes, comme les écrits qu’elles relient.
L’ouvrage, lui, présente l’ensemble de l’œuvre tel qu’il a été décrit plus haut, textes achevés et sujets non aboutis, à l’exception de la lettre en vers (Lettre à un jeune soldat du contingent) et augmenté d’une missive écrite sur une feuille de papier hygiénique adressée à un journaliste non nommé. Mathieu Ferré a jugé que ce texte pouvait parfaitement être inclus dans le recueil. C’est un livre au format 13 x 17, qui compte quatre-vingt seize pages s’ouvrant sur une note de l’éditeur.
De la lecture, en continu, de ces lettres, se dégage une grande mélancolie. Sous les fortes injonctions, les savoureuses prises à parti, demeure un mal de vivre avoué ici et là. Même la Lettre à la mer, pleine d’exaltation, dit au détour d’un paragraphe ce spleen constitutif de l’auteur. Peut-être la prose laisse-t-elle mieux passer le courant amer ? En tout cas, il est difficile de ne pas sentir la tristesse dont est empreint ce recueil d’imaginaires correspondances.
Ce beau livre baroque, dont la diversité des « correspondants » augmente vivement l’intérêt, n’aura évidemment jamais la forme définitive que lui aurait donnée son auteur. On ne ressentira pas l’étonnante impression d’ensemble qu’eût conférée au lecteur la réunion de personnes réelles, de types sociaux, d’objets, d’éléments, d’abstractions même, tous destinataires des missives. Vraisemblablement, cette œuvre eût été une des plus attachantes créations de Ferré dans le domaine du livre. Cependant, un artiste, c’est aussi une série de projets non aboutis par manque de temps ou d’opportunités. La recherche ne peut se passer d’étudier, dans les limites même de leur inachèvement, ces cris restés dans la gorge du temps.
[2]. Femmes d’aujourd’hui du 18 novembre 1970.
[3]. Chansons, octobre 1961.
[4]. Gilbert Sigaux, Léo Ferré, op. cit.
[5]. Charles Estienne, Léo Ferré, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 93, Seghers, 1962.
[6]. Les Lettres françaises du 7 au 13 décembre 1962.
[7]. Voir Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, op. cit.
[8]. Léo Ferré, « Je donnerais dix jours de ma vie », in La Rue, n° 1, mai 1968.
[9]. Charles Estienne, Léo Ferré, op. cit.
[10]. Léo Ferré, Il est six heures ici... et midi à New York, Gufo del Tramonto, 1974.
[11]. Léo Ferré, Poésies, éditions du Grésivaudan, 1987 (édition en trois volumes) et 1988 (édition en cinq volumes), illustrations de Jacques Pecnard, préface de Françoise Travelet.
[12]. Léo Ferré, La Mauvaise graine, textes, poèmes et chansons 1946-1993, Édition n° 1, 1993 (préface de Robert Horville) (rééd. Le Livre de poche, n° 9626, version abrégée, sous deux couvertures).
[13]. Léo Ferré, La musique souvent me prend... comme l’amour, La Mémoire et la mer, 1999.
[15]. Voir Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, op. cit.
[17]. Léo Ferré, Lettres non postées lues par Michel Bouquet, CD La Mémoire et la mer 10093.
[18]. Léo Ferré, Lettres non postées, collection « Les Étoiles », La Mémoire et la mer, 2006.
[19]. Pollen, France-Inter, 12 mai 2006.
[20]. Ibidem.
[21]. Ibidem.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 24 novembre 2006
Pierre Mac Orlan et « l’affaire Villon », 3/3
Une seule chanson
Il reste que tout cela n’apporte aucune explication d’ordre artistique au fait qu’ayant proposé une série dédiée, Ferré se soit finalement cantonné à une seule chanson de Mac Orlan, qu’il ne pouvait interpréter lui-même. Cette brouille a peut-être interrompu l’œuvre commune, ce qui constituerait naturellement l’explication la plus simple, mais, pour en être certain, il faudrait pouvoir la situer dans le temps avec davantage de précision. Si, au contraire, Ferré avait renoncé à aller plus loin avant que cette dispute se soit produite, alors, on en ignore les raisons. On mesure ici l’importance de la chronologie et l’impuissance du chercheur devant les documents non datés qui, lorsqu’il s’avère impossible de recouper ou de compléter les informations qu’ils donnent, deviennent inutilisables.
C’est en tout cas en 1958 que Ferré écrit La poésie fout l’camp, Villon ! qu’il n’enregistrera pas mais interprètera sur scène, en janvier 1961, au Vieux-Colombier. Saura-t-on jamais si ce fut en réaction à cet épisode qu’il nota : « Emmène-moi dedans ta nuit / Qu’est pas frangine avec la loi » ? Ou bien si la chanson fut composée avant ? Peut-être fut-elle d’ailleurs le point de départ de cette discussion qui aboutit à la dispute ? Qui peut le dire ? L’hypothèse est séduisante mais rien n’autorise à s’y arrêter. Le manuscrit n’est pas daté.
En 1962, Mac Orlan est en possession du Léo Ferré de Gilbert Sigaux, qui vient de paraître. [1] Il l’achète ou, plus sûrement, Sigaux le lui fait parvenir. Le fait est attesté par la présence de l’ouvrage dans le lot de documents dont on a parlé plus haut. Il l’a donc conservé et c’est presque certainement une preuve qu’il n’y avait pas eu de réel éloignement entre Ferré et lui, au moins de sa part. Autre indice : Mac Orlan signe, toujours en 1962, un article sur son interprète de prédilection, Germaine Montero. Il écrit : « Les meilleures chansons authentifiées par des poètes comme Jacques Prévert, des musiciens comme Léo Ferré, Philippe-Gérard, Christiane Verger, Van Parys, Marceau et d’autres que j’oublie, ou qui appartiennent au folklore, sont la nourriture essentielle de ses programmes ». Ce passage n’est pas révélateur d’une acrimonie quelconque. Ferré est même cité comme musicien, ce à quoi il a toujours tenu. [2]
En 1965, Mac Orlan recueille La Fille des bois dans son deuxième volume de chansons, à l’intérieur d’une section qu’il intitule « Chansons de charme pour des bagnes périmés ». [3] Il ne fait aucune observation particulière et se contente de noter, à la fin des cinq huitains qui constituent le texte : « Musique de Léo Ferré ». Il se trouve que ce recueil a fait l’objet, par la suite, en 1969, d’une réunion en volume avec d’autres ensembles de chansons et de poèmes en prose. On pouvait espérer quelques détails supplémentaires du fait que le maître d’œuvre de l’édition en question était Gilbert Sigaux lui-même, exégète de l’un et biographe de l’autre, mais ce ne fut pas le cas. [4] Sur le sujet des mises en musique, Sigaux se borne à quelques lignes concernant les interprètes et les maisons de disques.
Demeure finalement la partition d’une unique chanson, une musique bien accordée à son propos, mélange d’insolence et d’amoralité. D’ironie, également. À ce sujet, on relève, dans la préface de Sigaux, ces mots : « L’aventurier et le poète subissent les mêmes lois : ils sont trop proches de ce qu’ils vivent pour le connaître clairement. Mac Orlan établit la juste distance, avec une ironie constante. (…) Le créateur traite sa création avec tendresse et avec un certain détachement. Il refuse de se laisser détruire – car l’aventure-aventure et l’aventure intérieure, littéraire, aboutissent à la destruction ; ou menacent de destruction celui qui est dépourvu d’ironie ». [5] Continuant d’affirmer son amour de la chanson, Mac Orlan, dans l’avant-propos de Mémoires en chansons, précise, quant à lui : « Pour moi, écrire des chansons, c’est écrire mes mémoires : les textes rassemblés ici correspondent à une somme d’expériences vécues, pour l’essentiel, entre 1899 et 1918. Les images auxquelles ils se réfèrent sont aujourd’hui détruites ».
De Mac Orlan, Pierre Berger écrit avec intelligence : « Loin des querelles, des manifestes, il n’a jamais eu qu’une préoccupation : mettre les mythes du monde occidental au service de son dilettantisme », [6] et, plus loin : « Il ne porte en lui nul système, il est pur de tout pathos. Il y a en cela une belle raison : le décor l’intéresse bien plus que l’homme ». [7] Surtout, il note ceci, qui nous concerne au premier chef : « Jusque dans ses chansons, il étale cette étonnante malice des mondes insolites. C’est elle qui n’a cessé de le pousser dans l’aventure lyrique. À ce sujet, il faudra bien s’aviser un jour que la chanson a le droit de cité dans la poésie ». [8]
Ces « mondes insolites » sont-ils représentés par La Fille des bois, texte que Mac Orlan n’avait pas encore composé au moment où écrit Pierre Berger ? Pourquoi Ferré a-t-il choisi cette chanson de Mac Orlan, quand certains poèmes des années 20 n’étaient pas indignes d’Apollinaire ? De plus, ils auraient mieux représenté le « fantastique social » de Mac Orlan – lequel, sans porter ce nom, était déjà partiellement présent chez Apollinaire. On pense, en particulier, à Vénus internationale ou Tel était Paris, textes qui se seraient parfaitement inscrits dans l’œuvre de Ferré. Il est remarquable en tout cas que cette Fille, et quelques autres avec elle, voisine sans trop de difficultés avec L’Inconnue de Londres ou Monsieur William.
Une seule chanson. C’est certainement regrettable car, si Prévert et Aragon sont sans conteste les poètes les plus mis en musique et les plus chantés par d’innombrables interprètes, Mac Orlan est peut-être le troisième, si l’on en juge par les compositeurs qu’il a su intéresser (André Astier, H.-J. Dupuy, Willy Grouvel, Lino Léonardi, V. Marceau, Daniel Outin, Philippe-Gérard, Georges Van Parys, Christiane Verger) et par les voix qui l’ont servi (aux noms évoqués plus haut, joignons encore ceux de Béatrice Arnac, Simone Bartel, Laure Diana). Léo Ferré pouvait donc aisément imaginer plusieurs chansons, cela se serait inscrit logiquement parmi les séries déjà signées par Marceau, Philippe-Gérard ou Léonardi. Cela dit, on peut au bout du compte s’interroger sur cette forme de mode qui consistait à composer sur des textes de Mac Orlan, mode qui a entièrement disparu. Ici, il n’est pas question d’acheter l’îlot du Guesclin et de devoir, pour cela, composer de nombreuses musiques. [9] Ferré a bien eu le désir authentique d’écrire plusieurs chansons avec l’auteur de Quai des brumes.
Alors ? Ferré, on le sait, n’a jamais manqué de textes. Pourquoi Mac Orlan ? Était-ce une tentative : voir si cela pouvait marcher, s’il pouvait s’entendre avec lui ? Après tout, Caussimon met aussi en scène marins et légionnaires, prostituées et beaux garçons. On peut penser qu’il le fait avec davantage de chaleur humaine, mais c’est une question d’appréciation. Je n’ai pas de réponse définitive à apporter à ces interrogations qui me paraissent néanmoins nécessaires.
Mac Orlan est mort le samedi 25 juin 1970 dans sa maison de quinze pièces, route de Biercy, à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne) où il demeurait depuis 1924. Ses biographes n’évoquent pas sa rencontre avec Léo Ferré. Leur ami commun, Jean-Pierre Chabrol, n’en a jamais parlé non plus. Il n’est décidément pas aisé de démêler l’écheveau.
Il nous reste de lui ce portrait : « Il donnait libre cours, vers le soir, au pessimisme bien portant qui marque la plupart de ses livres. (…) Sa misanthropie appliquée donnait la mesure de la foi bafouée qu’il avait en la vie. (…) Des flammes dansaient dans son regard, plutôt froid, un regard d’homme du Nord, parcouru de courroux et de malice ». Cette peinture est d’autant plus intéressante qu’elle est signée… Luc Bérimont et trouve ici, par conséquent, une place obligée. [10]
On terminera sur une vision, celle de Pierre Berger, biographe inspiré souvent cité ici : « À notre tête, son accordéon au cou, marche Pierre Mac Orlan. Je ne sais s’il nous conduit vers une étape sans violence, mais je puis vous conseiller de marcher dans son sillage. La poésie de silex est au bout de la route ». [11]
On le voit, bien qu’il soit difficile de reconstituer totalement cette histoire, il est important tout de même de le faire, si l’on veut mieux connaître la totalité de l’aventure ferréenne. Cette rencontre et cette création commune, incontestablement, appartiennent à son univers. Elles en sont indissociables parce qu’elles témoignent de recherches faites dans des directions nouvelles, à tel moment de sa vie d’artiste. Qui plus est, le nom en question n’est pas sans importance dans l’histoire poétique et littéraire comme dans celle de la chanson. On ne peut par conséquent choisir d’ignorer sa place chez Léo Ferré.
[11]. Pierre Berger, Pierre Mac Orlan, op. cit.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 23 novembre 2006
Pierre Mac Orlan et « l’affaire Villon », 2/3
Il est évidemment indispensable, à ce stade, de chercher à comprendre, autant que faire se peut, comment ont pris fin les relations entre Léo Ferré et Pierre Mac Orlan. C’est Philippe Val qui relate ce que Ferré lui a raconté. La date exacte n’est malheureusement pas précisée dans ce souvenir. Léo Ferré, au volant de sa voiture, raccompagne Mac Orlan jusqu’au cabaret montmartrois Le Lapin agile. On imagine Mac Orlan, avec son béret à carreaux et à pompon, vêtu d’un ample col roulé à grosses côtes et d’un gilet de laine écossaise, la lippe légèrement boudeuse et le regard sombre sous les sourcils se rejoignant en haut du nez en bec d’oiseau. Les deux hommes discutent et Mac Orlan expose une idée qui est sienne : François Villon était un indicateur de police, un « donneur ». Il donnait pour de l’argent. C’est plus que n’en peut entendre Léo Ferré, sur le compte d’un poète qu’il aime. Il prend cela très mal, s’arrête et... met Mac Orlan à la porte. Il le fait descendre de voiture et le laisse là, tout simplement. Il ne l’a plus revu. [1]
Cette « affaire Villon » demande à être instruite plus avant. Cette histoire, à ma connaissance, n’apparaît dans aucun entretien accordé par Ferré. Il n’est pas question de mettre en doute les propos de Val, bien entendu. Qui plus est, cette réaction ressemble bien à celles, passionnées, de Léo Ferré. Il faut se rappeler, par ailleurs, que Mac Orlan est l’auteur du scénario original du film d’André Zwobada, François Villon (1945), avec Serge Reggiani dans le rôle principal. Le poète hantait Mac Orlan depuis longtemps. On peut aussi imaginer que les deux hommes, dans le véhicule, discutaient du film plus que de Villon lui-même. On ne le saura pas. Faut-il le dire, le biographe n’était pas présent dans la voiture et, à partir de là, toute interprétation est possible, aucune n’est certaine, toute extrapolation est risquée. Néanmoins, il importe d’aller plus loin. C’est pourquoi on s’appuiera, plus que jamais, sur des documents écrits et rendus publics.
Pierre Berger affirme : « Au risque de causer quelques peines à certains initiés, il me plaît de croire que Mac a de Villon la plus décisive des expériences. Alors que tant d’autres, non des moindres, se sont égarés, allant jusqu’à donner autant d’importance au voyou qu’au voyant, Mac a reconnu une poésie fille de la Peur. Celle-là seule l’intéresse, elle seule le porte jusqu’à cette frontière où la création est l’égale de n’importe quel mythe. Villon, cela est désormais clair, n’a cessé de connaître et de vivre avec la peur au ventre. Cela n’a pas échappé à Mac ». [2] Peut-être faut-il voir là la justification d’un point de vue personnel qu’aurait eu Mac Orlan sur Villon. Dans l’ignorance de l’état où se trouvait la recherche le concernant dans les années 50 (les « initiés » qu’évoque Berger), on ne peut espérer qu’une solution unique : le film de Zwobada dont le scénario, très romancé, a été publié. [3] C’est un ouvrage de cent quatre pages au format 14 x 20, 5 cm, à couverture rempliée, imprimé en bichromie et orné de quatre planches en couleurs d’André Jean figurant les maquettes des costumes, qui furent exécutés par Germaine Lecomte. Il a connu un seul tirage à trois mille exemplaires (plus soixante hors-commerce) sur bouffant Finlandia, tous numérotés, vendus cent cinquante francs belges. C’est un beau volume. Que saura-t-il révéler ? On ne peut faire l’économie de cette recherche car, si Villon a privé l’œuvre de Ferré d’un disque consacré à Mac Orlan, cette conséquence n’est pas négligeable.
Dans la préface qu’il rédige pour son scénario, Mac Orlan note : « Il [Villon] fréquentait à l’occasion des personnages haut-placés. Ses relations parmi les gens de justice étaient souvent efficaces ». Un peu plus loin, il ajoute : « Il fut peut-être victime de ce "milieu" dont il avait pu éveiller la méfiance à cause de ses relations compromettantes avec les gens de justice ». On peut lire, alors que les personnages s’apprêtent à partager le produit du vol d’une église, ces mots adressés à Villon : « Tu auras la tienne [ta part]… comme indicateur ». Plus loin encore, le prévôt de Paris, sollicité par sa femme pour intervenir en faveur du poète, précise qu’il est déjà intervenu plusieurs fois. Cependant, le parlement casse la sentence et la peine de Villon est commuée en dix années de bannissement de Paris. Villon est ensuite montré, embauché comme secrétaire, à Orléans, par le procureur du roi. Un jour, pris de boisson, il donne ses anciens camarades les Coquillards dans le but de sauver un innocent injustement condamné comme l’en avait supplié la mère de celui-ci, inspirée par la Vierge. Les Coquillards lui tendent un piège : ils le font revenir à Paris et le tuent.
Voilà la version que propose Mac Orlan de la fin du poète François Villon, dans un scénario médiocre qui accumule clichés et conventions. Plus ennuyeux, on n’aperçoit pas ici, une seule seconde, la « peur au ventre » dont parle Pierre Berger. Mac Orlan lui-même avoue dans sa préface : « L’histoire contée sur l’écran est sommaire et arbitraire puisqu’elle se déroule à peu près tout entière dans un laps de temps qu’aucun document historique ne vient éclairer. On peut imaginer de bien des manières la mort de François Villon. À mon avis, il mourut probablement d’épuisement dans les premiers temps de son bannissement. L’image que cette hypothèse provoque n’est pas suggestive, tout au moins pour le film. (…) Je m’en suis tenu à cet aspect plus décoratif ». On le voit, de l’aveu même de l’auteur, toute cette « chute » est un pur ornement, produit de son imagination, dans le but de rendre le propos plus spectaculaire. Le plus fort est que le bandeau qui ceint le livre déclare, en blanc sur fond rouge : « Le vrai Villon », tout simplement. Est-ce cette pauvre vision de Villon qui mit en colère Léo Ferré, treize ans (au moins) plus tard ? On n’y reconnaît pas vraiment la relation que fit Ferré à Val, de sa dispute avec Mac Orlan.
Et pourtant, quelque chose, dans ce film, rend plus plausible l’altercation qui se produisit entre eux. À mon sens, la raison la plus vraisemblable est là. Le souvenir confié à Val par Léo Ferré semble avoir été un peu érodé par le temps : c’est en fait dans le cadre d’une vie romancée que Mac Orlan rêva Villon comme un « donneur ». Cela montre d’ailleurs tout le mal que peut causer une biographie répondant à ces critères qui existèrent jusqu’en 1968, à peu près. Encore que des éditeurs, aujourd’hui, n’aient aucun scrupule à proposer d’autres vies « arrangées » et publient sans sourciller des livres contenant par exemple des dialogues imaginaires.
Pour en terminer avec ce film, cette coïncidence amusante. Le rôle d’un étudiant y est tenu par un homme jeune, grand, aux mains interminables. Il se nomme Jean-Roger Caussimon. Caussimon qui, en 1945, n’a pas encore rencontré Léo Ferré.
Pour en finir avec la légende créée par Mac Orlan, on rétablira la vérité ou ce qu’on en sait, qui est peu de chose : « L’arrêt du parlement est du 5 janvier 1463. La Louange à la Cour doit être du même jour. La Question au clerc du guichet n’est guère postérieure. Le 8 janvier, au plus tard, Villon quitte Paris. Ici s’arrête l’histoire. Le poète a trop chanté la mort pour laisser aux historiens le droit de conter la sienne », écrit Jean Favier dans une biographie savante.[4]
(À suivre)
[1]. Cité par Philippe Val, in Globe-hebdo, n° spécial « Merci Léo », 21-27 juillet 1993.
[2]. Pierre Berger, Pierre Mac Orlan, collection « Poètes d’aujourd’hui », n° 26, Seghers, 1951.
[3]. Pierre Mac Orlan, François Villon, film, Bruxelles, Maréchal, 1945.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (6)
mercredi, 22 novembre 2006
Pierre Mac Orlan et « l’affaire Villon », 1/3
Mac Orlan révèle une foi jamais démentie en la toute puissance de la chanson, une toute puissance qui, par le biais de la parole, est humaine parce que littéraire.
(LUCIENNE CANTALOUBE-FERRIEU)
Entre son spectacle à Bobino (du samedi 3 au jeudi 15 janvier 1958) et celui qu’il présente au Vieux-Colombier (à partir du mercredi 25 janvier 1961), Ferré ne se produit sur aucune grande scène parisienne. Pas de « rentrée », donc, durant trois ans, mais beaucoup de travail : la musique du film de Geza Radvanyi, Douze heures d’horloge ; [1] l’enregistrement des derniers disques Odéon avant une période intermédiaire précédant son entrée chez Barclay ; une chanson avec Michèle Senlis et Claude Delécluse intitulée La Belle amour ; quatre mises en musique de textes de Mouloudji ; [2] une « exploration » des poètes vivants (Seghers, Aragon dont le disque sortira plus tard, Bérimont), parfois en vue d’une éventuelle collaboration poussée. Ce sera le cas, par exemple, de Pierre Mac Orlan, mais l’idée initiale échouera dans les étonnantes circonstances que l’on va tenter de reconstituer.
Pierre Dumarchey, alias Pierre Mac Orlan, est né le dimanche 26 février 1882 à Péronne (Somme). Il jouait lui-même de l’accordéon et a toujours aimé la chanson. [3] Il a adhéré à la Sacem en 1936. Il a par la suite recueilli ses textes en deux volumes. [4] Dans le « Prélude sentimental » qui ouvre l’un d’entre eux, Chansons pour accordéon, il note : « Il est souvent plus difficile d’écrire une chanson que de composer un roman ou de peindre une toile. Il faut beaucoup de loyauté pour écrire une chanson… et beaucoup de confiance dans la sensibilité de l’auditeur ». On lui doit aussi, entre de nombreux écrits sur le sujet, La chanson populaire dans les disques. [5] Tous ces travaux de sa plume montrent également l’idée qu’on pouvait se faire alors de la chanson et constituent à ce titre d’intéressants documentaires.
La rencontre
C’est dans les derniers mois de 1953 que, pour la première fois, se trouvent réunis les noms de Léo Ferré et de Pierre Mac Orlan, sous la signature de ce dernier, qui écrit dans un article : « Tantôt l’auteur mène le jeu, tantôt c’est, au contraire, le musicien et, très souvent, l’interprète prend la place qui donne à la chanson sa personnalité. Quand l’auteur est (…) Léo Ferré (…), il est certain que l’auteur tient le jeu, même si l’interprète est de grande classe comme Édith Piaf, ou, dans un autre climat, Germaine Montero, comédienne d’une puissante personnalité ». [6]
L’année suivante, préfaçant un 25-cm de Catherine Sauvage, l’écrivain note : « Dans ma pensée, c’est-à-dire dans les minutes qui suivent l’audition d’un disque quand il donne un de ces "chocs" qui semblent de plus en plus nécessaires pour meubler l’extraordinaire solitude des hommes de ce temps, je ne peux m’empêcher d’associer Léo Ferré à Catherine Sauvage. Léo Ferré est un poète pour qui la chanson est une forme d’expression puissante et efficace : c’est un poète de l’authenticité, un poète précis de la vérité ; et les personnages qu’il confie souvent à la voix de Catherine Sauvage nous apportent vraiment une présence humaine, une ouverture humaine : celle de L’Homme ou celle des Amoureux du Havre qui ne sont pas, grâce à cette précision, de simples lieux communs sentimentaux. Catherine Sauvage est une interprète de qualité ; sa personnalité est évidente : elle aime ce qu’elle chante et nous le fait aimer. La sensibilité de cette jeune femme est intelligente : elle conduit à la mélancolie qui est la grande force des chansons, quand elles sont de la "classe" littéraire de celles de Léo Ferré ». [7]
Comment est considéré, à l’époque où il écrit cela, celui qui est membre de l’académie Goncourt depuis quatre ans ? Dans son édition 1954-1955, le Dictionnaire biographique français contemporain note, d’une plume bien-pensante : « Pierre Mac Orlan a trouvé son originalité en peignant une humanité désespérée et aventurière et s’adonne à une littérature d’imagination. (…) Il préfère, à l’ordre naturel et aux mœurs civilisées, des situations inquiétantes et des renversements humains ». [8]
Dans son numéro 2, qui paraît en juin 1954, Le Flâneur des deux rives [9] publie un article consacré à la mise en musique par Ferré de La Chanson du mal-aimé d’Apollinaire. Ce texte n’est pas signé mais il est habituellement attribué soit à Cocteau, soit à Mac Orlan. Cette seconde hypothèse n’est pas saugrenue, elle est même séduisante (Mac Orlan écrivait régulièrement dans cette publication), mais absolument rien ne permet à ce jour de l’affirmer sérieusement. Elle suppose principalement que Mac Orlan se soit trouvé à Monaco le jeudi 29 avril 1954 puisqu’à l’époque, l’œuvre n’a pas connu d’autre représentation et n’est pas encore enregistrée dans un disque. La présence de Cocteau à une soirée de gala est plus probable. À moins que l’auteur de l’article ait seulement entendu la retransmission de la soirée sur les ondes de Radio Monte-Carlo. Or, l’article fait mention d’indications portées dans le programme. On demeure décidément dans le vague et surtout, l’on ne comprend pas pourquoi Mac Orlan, qui a signé d’autres articles dans la même livraison du Flâneur, n’aurait pas signé celui-là.
Les propos de Mac Orlan sur Ferré et Catherine Sauvage seront bientôt repris dans le programme du spectacle que Ferré présente à l’Olympia, l’année suivante, du jeudi 10 au mardi 29 mars 1955.
Mac Orlan poursuit, à la fin de l’année, évoquant « la poésie authentique de Léo Ferré » et, dans le même article, il note : « Léo Ferré, plus préoccupé par le décor social que Charles Trenet, a également composé des chansons d’amour étroitement liées à la présence du temps présent dans la vie sentimentale (Les Amoureux du Havre, Mon pt’it voyou) ». [10]
Ailleurs, il insiste : « Je ne veux que citer Trenet, Brassens et Léo Ferré, ces trois grands poètes-chansonniers qui représentent la chanson durant ces dernières années pour prendre place dans les anthologies ». [11]
Il ne craint pas, plus tard, de répéter : « On retrouve toujours Germaine Montero avec son choix, de Bruant à Léo Ferré, et Catherine Sauvage toujours fidèle à Léo Ferré » et, quelques lignes plus loin : « Il faut encore une fois insister sur la présence de (…) Léo Ferré ». [12]
La même année , il ajoute : « J’aime toutes les chansons de (…) Léo Ferré ». [13]
Toutes ces citations montrent a priori d’excellentes dispositions de Mac Orlan envers Ferré, et l’on ne voit pas pourquoi une collaboration, logiquement, ne s’ensuivrait pas. C’est encore par une lettre que tout va commencer.
Dans le courant de l’année 1958, Léo Ferré écrit à Mac Orlan pour lui proposer de réaliser un disque complet en commun. La lettre a été vendue salle Drouot en avril 1986, en même temps qu’un ensemble de documents. Le lot comprenait Poète… vos papiers ! en édition originale sous étui, [14] vingt-six petits formats imprimés par Ferré et illustrés par Frot, sept disques de Ferré et quatre de ses interprètes, un disque inédit d’épreuve contenant l’enregistrement de quatre poésies d’Aragon avec douze lignes autographes d’Aragon lui-même, le Léo Ferré de Gilbert Sigaux, [15] et la fameuse lettre.
Le catalogue la reproduit partiellement, sans malheureusement en préciser la date. Son acquéreur n’a pas accepté que j’en prenne photocopie ou que j’en relève une copie manuscrite. Je ne peux par conséquent citer que l’extrait présenté au catalogue : « J’aimerais beaucoup faire une série de chansons avec vous. Je suis sûr que la chose est possible, et puis cela nous distraira l’un et l’autre du train-train habituel. Dans notre espace non-euclidien, il me semble que nos parallèles pourront vite se rejoindre ! Téléphonez-moi, s’il-vous-plaît, et croyez à ma fidèle amitié. Léo Ferré ». Mac Orlan répondit-il effectivement par téléphone ? Adressa-t-il à Ferré un message qui se serait perdu ? On ne connaît pas, en tout cas, de trace écrite signée Mac Orlan en écho à cette première prise de contact. Le projet n’aboutira pas, mais une chanson au moins est née.
En 1960, Léo Ferré cède aux Nouvelles éditions Méridian cette chanson qu’il n’enregistrera pas lui-même, La Fille des bois. Monique Morelli, Catherine Sauvage et Francesca Solleville l’interpréteront, ainsi que Mistigri. Cette œuvre est tout ce qui subsiste de la proposition faite à l’écrivain deux ans plus tôt. La collaboration s’est interrompue immédiatement. On tentera plus loin de comprendre pourquoi.
La même année, les noms des deux hommes sont rapprochés, sinon réunis, dans un volume de René Maltête, Paris des rues et des chansons, [16] où des photographies de la ville sont commentées par des vers et des textes de nombreux auteurs.
En 1961, la préface de Mac Orlan, déjà citée, est encore reprise, cette fois au verso de deux nouveaux 25-cm de Catherine Sauvage. [17]
On observera que, en-dehors de La Fille des bois, les textes respectifs de Ferré et Mac Orlan ont eu les mêmes interprètes. Aux trois grandes chanteuses déjà citées, il faut ajouter évidemment Barbara, Juliette Gréco et Germaine Montero. Celle-ci, hormis les microsillons qu’elle a consacrés à Ferré d’une part, à Mac Orlan d’autre part, enregistrera un disque hors-commerce non daté dont la pochette est due au graphiste Massin, qui réalise pour elle une maquette originale. Ce disque, Germaine Montero chante Charles Béranger, Aristide Bruant, Léo Ferré, Federico Garcia Lorca, Pierre Mac Orlan, est tiré à trois mille exemplaires numérotés pour les membres du Club des disquaires de France, dont le directeur est Robert Carlier. L’orchestre est celui de Philippe-Gérard. On peut y lire un article de Mac Orlan, intitulé Pour une discothèque sentimentale, duquel se détache ce bref passage : « Les autres chansons [contenues dans le disque], celles de Marguerite Monnot, de Léo Ferré et de Federico Garcia Lorca, donnent également des souvenirs de qualité à ceux qui n’en ont pas et, peut-être, n’en auront jamais ».
Toujours des interprètes féminines, donc. C’est que les chansons de Mac Orlan parlent le plus souvent de vies de femmes, à la première personne. [18] Léo Ferré avait parlé d’« une série de chansons ». Imaginait-il, par conséquent, un microsillon complet qu’il eût confié à une chanteuse, mais n’aurait pu enregistrer lui-même ? La question peut se poser.
(À suivre)
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (5)
mardi, 21 novembre 2006
Avec Luc Bérimont, 4/4
À la disparition de Luc Bérimont, Léo Ferré adresse à sa femme un télégramme de condoléances qu’il rédige à sa manière : « Luc Bérimont, 78120 Rambouillet. Pourquoi ce Noël pourquoi ces lumières il n’est rien venu d’autre que les pleurs et ton souvenir m’arrache le cœur, disais-tu. Repose-toi bien Luc. Léo Ferré ». Cet homme qui a chanté tant de Noëls et tant d’hivers – deux thèmes récurrents chez lui, en prose comme en vers – est mort à cette période qu’il avait rimée, le jeudi 29 décembre 1983. Vingt jours plus tôt, le vendredi 9, il a composé La Tentation du requiem, son ultime poésie. Son dernier livre, publié cette année-là, s’intitule Le Grenier des caravanes. [1]
En 1994, l’intégrale en disques compacts, publiée par Sony, du fonds Odéon, intitulée Léo Ferré, les années Odéon, comprend les deux poèmes de Bérimont, non intégrés chronologiquement à l’ensemble de la production de Ferré dans cette maison mais figurant sur un disque de « bonus ». [2] On est étonné, car ces œuvres sont excellentes, paraissent parfaitement accomplies et auraient pu, en leur temps, trouver place dans des disques. Pourquoi sont-elles considérées comme des maquettes et ne sont-elles jamais sorties ? Cela signifie-t-il que Ferré a écrit ces musiques sans avoir l’intention de les chanter, les chansons étant alors uniquement destinées à des interprètes et les maquettes réalisées à titre d’exemple ? Or, selon Catherine Sauvage, Ferré a chanté Noël en scène. Malheureusement, elle ne précise pas où, ni quand. Qu’en pensait Bérimont lui-même ?
Il reste que Marc Ogeret, Francesca Solleville, Jacques Douai et Catherine Sauvage ont chanté Noël tel quel, sans que Ferré y trouve à redire, ce qui est légitime puisqu’ils ont respecté la partition originale, ainsi que l’imposait l’avertissement cité plus haut. Quel degré d’achèvement estimait-il n’avoir pas atteint dans ses mises en musique ? Eût-il voulu, avant de les chanter lui-même, donner à ces textes une orchestration plus ample, les faire bénéficier d’un orchestre plus important que la formation réduite qui servit à la maquette ? Il faudra attendre 2006 pour que les éditions La Mémoire et la mer publient le volume 1959 de l’intégrale Léo Ferré, plaisamment dénommée La « the » intégrale. [3] Ce disque contient les versions enregistrées pour la radio des deux poèmes, une photographie des deux hommes par Grooteclaes enfin rendue publique et le texte manuscrit du télégramme d’adieu. Il comprend aussi de nombreux passages de Ferré dans les émissions de Bérimont, et la voix de celui-ci, avec qui il s’entretient. À ce propos, Bertrand Dicale écrit : « Le disque de l’année 1959 est composé de passages radiophoniques de Léo Ferré, la plupart précédés d’interviews. Les aînés reconnaîtront l’emphase du poète-speaker Luc Bérimont ("Comment le public réagit-il à vos chansons, à la chanson de qualité, à la chanson poétique ? – Le public réagit très bien"), les plus jeunes générations combien l’utilisation de poèmes d’Aragon ou de Verlaine put être un sujet polémique à l’époque ». [4]
Selon Alain Raemackers, qui présente cet album, le travail de Ferré en 1959 doit beaucoup à l’obligation qui lui est faite de livrer aux éditions Méridian cent cinquante-neuf chansons, afin de réaliser son rêve : l’acquisition de l’îlot du Guesclin sur la commune de Saint-Coulomb, entre Cancale et Saint-Malo (Ille-et-Vilaine). C’est en effet le mercredi 20 avril 1960 que sera signé l’acte devant Me Serrand, notaire à Cancale.
C’est certainement exact et cela pourrait constituer une réponse d’ordre pratique à toutes les questions posées ici. D’ailleurs, Jacques Lubin et Jacques Miquel précisent, dans leur très minutieux travail consacré aux enregistrements de Ferré, [5] que la maquette de Noël était uniquement destinée aux éditions Méridian, « peut-être pour témoigner de la façon dont Ferré recommandait l’interprétation ». Tout cela est fort vraisemblable et émane de personnes compétentes, mais ne justifie pas cependant que Léo Ferré n’ait pas, au moins par la suite, fait figurer ces chansons dans un de ses disques. Quant aux mises en musique évoquées en 1963 et jamais abouties, le mystère reste entier.
Au-delà de leur opinion commune sur la poésie chantée, l’univers des deux hommes paraît proche, ne serait-ce qu’au registre de la sensualité. Ainsi, on peut rapprocher des nombreux développements sur l’odorat contenus dans le roman de Ferré, Benoît Misère, [6] ces propos extraits d’une interview de Bérimont : « Un monde d’odeurs, c’est, je crois, ce qui m’est apparu avant que je n’aie ouvert les yeux ! (…) Je pouvais tout identifier, dans mon enfance, grâce aux odeurs. (…) J’ai été élevé dans un univers de femmes, au milieu d’un royaume d’odeurs. (…) La nature m’a doté d’un nez que les signalements d’identité qualifient de "fort" par euphémisme ! ». [7]
Autre facteur de proximité intellectuelle : comme Ferré, Bérimont a raconté son enfance, ses initiations. Lorsque paraît Le Bois Castiau, l’écriture de Benoît Misère est en cours depuis plusieurs années et ne s’achèvera que bien plus tard. Les deux livres sont donc partiellement contemporains. Chez ces deux petits garçons qui ont presque le même âge, on remarque des émotions communes – jusqu’à l’amour des tramways – et, chez les adultes qu’ils sont devenus, une analyse similaire du monde de leur enfance, recréé longtemps plus tard par une plume de poète. Culturellement, leurs milieux d’origine sont similaires. La différence essentielle tient à ce que Bérimont, né en Charente du fait de l’invasion allemande dans ses Ardennes familiales, et Ferré, né à Monaco, n’ont naturellement pas vécu la Première Guerre mondiale de la même façon. Mais il ne faut pas interpréter abusivement les biographies : Bérimont enfant demeure croyant alors que son père est un farouche mécréant, au rebours de Ferré qui perd la foi et dont le père est très croyant. Bérimont oubliera lui aussi son catholicisme, allant jusqu’à écrire, à propos de Noël, qui n’est peut-être pas seulement une complainte de l’amour triste : « Il n’est rien venu d’autre que les pleurs ». [8] L’anniversaire de l’avènement ? Des pleurs, uniquement des pleurs. Pas de sauveur, pas de bonne nouvelle. Bérimont, dit-on, se trouvait laid, notamment à cause de ses lunettes, comme d’ailleurs Ferré jeune. Il n’était pas plus laid qu’un autre : avec son grand front et son nez puissant, il avait au contraire un visage ouvert, intelligent. Bérimont déclare : « En fait, raconter son enfance n’a rien de vraiment original. Alors, permettez-moi une question, à mon tour : pourquoi est-ce dans ce registre que la littérature contemporaine a donné ses œuvres majeures ? ». [9]
Aujourd’hui, on ne trouve plus les poèmes de Bérimont en librairie. Le Cherche-Midi avait entamé une édition des Poésies complètes, préparée par Jean-Yves Debreuille, avec un avant-propos de la compagne du poète. [10] Seul le tome premier a paru. Les deux autres volumes, initialement prévus, semblent bien avoir été abandonnés. On ne trouve pas non plus de biographie du poète et son nom ne figure pas au dictionnaire Robert des noms propres, comme si l’homme, pourtant célèbre, avait sombré dans l’oubli, d’une façon incompréhensible. Sauf erreur, les manuels scolaires ne l’ont pas retenu davantage. Un temps, il s’est trouvé à l’école maternelle et primaire où, habituellement, on lui préfère son ami Desnos. Il publie en effet, en 1974, un recueil de comptines. [11] Ce faisant, il ne perd évidemment pas de vue l’absolue nécessité, pour lui, de chanter la poésie, et c’est son ami Jacques Douai qui s’en charge, mettant douze de ces textes en musique et les enregistrant. [12] La même année, il fait paraître Les Ficelles, [13] « roman » résolument anti-conformiste où sont peints les déboires d’un auteur avec ses éditeurs, mais aussi avec ses personnages. Il opte pour une construction en éclats où se mêlent tous les genres et où le propos se diversifie. Typique des recherches techniques et artistiques des années qui suivirent 1968, Les Ficelles témoigne amplement de la volonté de renouvellement de l’auteur. Cette année-là, d’ailleurs, il publie trois livres.
Dans Les Ficelles, on trouve une nouvelle allusion à Léo Ferré, au détour d’un portrait de Michel Simon qui avait adopté un chimpanzé, Zaza. Il ne faut pas confondre cette Zaza avec celle de Ferré. La Zaza de Michel Simon avait d’ailleurs un comportement plus proche de celui de la Pépée de Ferré. Voici cet extrait : « Zaza, une guenon morte depuis longtemps, le laisse inconsolable. Elle marchait debout, paraît-il, cousait, se poudrait, faisait son lit, griffonnait au crayon d’indéchiffrables messages de tendresse. Michel Simon en parle comme d’une fille disparue. J’éprouve de la gêne à prononcer le mot "singe" devant lui, la même que devant Léo Ferré. On sent que l’on commet, non une incongruité, mais une faute. Comme si l’on portait un coup bas. Je leur donne raison à tous deux pour le respect, la tolérance, dont nous devrions témoigner envers les créatures qui peuplaient la terre avant nous. L’illusion d’appartenir à une race supérieure, à qui l’on passe ses crimes, finira bien par nous être fatale ». [14]
Dans son Jacques Douai de cette même année, Bérimont évoque Ferré sans le nommer, d’une manière plaisante : « C’est chez Francis Claude, rue du Pré-aux-Clercs, que vont se tendre certains ressorts du destin. Un jeune homme à lunettes, cheveux longs, romantique et cracheur, s’accompagne au piano. Douai, enthousiaste, s’empare des partitions de L’Étang chimérique, de L’Inconnue de Londres, du Scaphandrier, du Bateau espagnol ». [15]
Heureusement, donc, demeure la chanson qui rend maintenant à Bérimont, au moins en partie, ce qu’il lui a donné. On peut écouter sa poésie par la voix de Jacques Bertin [16] ou dans une belle anthologie de la très bonne collection « Poètes et chansons ». [17] Cette dernière a l’avantage de regrouper non seulement plusieurs interprètes, mais aussi plusieurs compositeurs (Reinhardt Wagner, Léo Ferré, James Ollivier, Michel Aubert, Jacques Douai, Lise Médini, Nicolas Vaillant, Hélène Triomphe, Lino Léonardi). Le microsillon conserve encore quelques pièces rares ici et là. Par exemple, Marc Ogeret chantant J’ai rencontré la cinquantaine sur une partition de Lise Médini [18] ou Hélène Martin interprétant Amazonie sur sa propre musique. [19] Il est d’autres enregistrements, comme celui de Quand tes cheveux étaient courts par Michel Aubert [20] ou celui de La Complainte du bourreau par Jacques Douai, sur une musique du même. [21] Toujours chanté par Jacques Douai, Je suis plus près de toi (musique de Lise Médini). [22] Le disque garde aussi l’interprétation d’un comédien (on sait que la diction n’a jamais eu la mauvaise réputation de la chanson), celle de Robert Hossein, [23] et Hélène Martin dit elle-même Entrée du fer. [24]
[2]. Léo Ferré, Les Années Odéon, coffret de huit CD.
[3]. Léo Ferré, 1959, CD La Mémoire et la mer, op. cit.
[4]. Le Figaro du 8 avril 2006.
[5]. Travail paru in Sonorités, bulletin de l’Association française des détenteurs d’archives audiovisuelles et sonores, du n° 20, décembre 1988, au n° 23, janvier 1990, avec des addenda et des errata du n° 24, juillet 1990, au n° 27, décembre 1991.
[6]. Léo Ferré, Benoît Misère, roman, Laffont, 1970 (rééd. Plasma, 1980, Gufo del Tramonto, 1989, La Mémoire et la mer, 2001).
[7]. Luc Bérimont, Le Bois Castiau, récit, Laffont, 1963 (rééd. Rombaldi avec une longue interview en préface, 1975, Stock, 1980). Prix Cazes 1964.
[8]. Noël.
[9]. Luc Bérimont, interview en préface à la réédition du Bois Castiau, article cité.
[10]. Luc Bérimont, Poésies complètes, vol. 1, 1940-1958, collection « Amor fati », Le Cherche-Midi et Presses universitaires d’Angers, 2000 (édition établie par Jean-Yves Debreuille, avant-propos de Marie-Hélène Fraïssé).
[11]. Luc Bérimont, Comptines pour les enfants d’ici et les canard sauvages, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1974.
[12]. Jacques Douai, Comptines de Luc Bérimont, 45-tours Unidisc 45524.
[13]. Luc Bérimont, Les Ficelles, roman, EFR, 1974.
[14]. Ibidem.
[15]. Luc Bérimont et Marie-Hélène Fraïssé, Jacques Douai, op. cit.
[16]. Bertin chante Bérimont, CD Velen VO 11.
[17]. Luc Bérimont chanté par Jacques Bertin, Jacques Douai, Monique Morelli, Marc Ogeret, James Ollivier, Marc Robine et Claude Vinci, collection « Poètes et chansons », CD EPM-Musique 980622.
[18]. Marc Ogeret, Rencontres, disque cité.
[19]. Hélène Martin, Le Condamné à mort, 33-tours 30-cm La Fine fleur (BAM), n° 1, C 500.
[20]. Michel Aubert, 33-tours 30-cm BAM, C 428.
[21]. Jacques Douai, Récital n° 7, 33-tours 25-cm BAM, LD 380.
[22]. Jacques Douai, Autrefois aujourd’hui, chansons de poètes, vol. 2, double 33-tours 30-cm Disc’AZ, AZ/5 391.
[23]. Robert Hossein dit les poèmes de Luc Bérimont, collection « Poésie de demain », 33-tours 17-cm, Seghers-Véga, 10003.
[24]. Anthologie 1, poésie française contemporaine, collection « Plain chant », 33-tours 30-cm disques du Cavalier, LM 184-185.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 20 novembre 2006
Avec Luc Bérimont, 3/4
On peut s’étonner de ce silence, lorsqu’on sait que Luc Bérimont n’a eu de cesse de rapprocher la poésie et la chanson et de faire sauter les barrières dont toute l’histoire de la poésie prouve l’inanité. Il est membre de l’Académie du disque français, dans la catégorie « Hommes de lettres ». Il écrit : « La poésie ne guérit pas de la chanson. Elle se console mal d’avoir été séparée, divisée comme au couteau, de la compagne qui réchauffait son souffle. Orphée sans sa lyre n’est plus entendu. Il pense. Il est triste. Il sait les choses que savent les ingénieurs, mais il oublie de se laisser gagner par l’ivresse obscure qui faisait de lui un demi-dieu ». [1] Bérimont œuvre en tous points pour rapprocher la parole et le vers. En 1954, il préface un disque de poèmes du XVIe siècle, dits par Gérard Philipe et André Reybaz : « La langue est mûre, savoureuse, éclatante, non encore sclérosée par l’usage écrit : l’imprimerie date de la veille ». Il évoque « le tremblement qui s’empare de la voix de nos grands-pères inspirés quand il s’agit de célébrer la seule beauté absolue qui soit au monde : celle du corps féminin dévêtu, livré dans l’attente du désir ». [2] Dans l’ensemble de son œuvre, Ferré dira des choses souvent proches de cela et cette étude porte aussi bien sur les rapports entre les deux hommes et leur travail commun que sur la question de la poésie chantée, qui demeurera pour eux une conviction constante.
En 1957, dans Combat, Alain Spiraux soutient que « le public a plus facilement accès à la poésie par la chanson que par les plaquettes de poèmes ». [3] Aussitôt, le poète Marc Alyn qui, à l’âge de vingt et un ans, a reçu le prix Max-Jacob, signe dans Arts une prise de position contre les paroliers, estimant que l’écriture de chansons doit être exclusivement confiée aux poètes, c’est-à-dire aux poètes du livre. C’est très vraisemblablement à ce moment que Ferré écrit Conseils à un jeune lauréat de vingt et un ans, sans nommer celui-ci. Ce texte est inachevé. Sans doute Ferré s’est-il désintéressé de cette affaire, trouvant qu’elle n’en valait pas la peine, ou bien a-t-il pensé qu’il n’avait pas de conseils à donner. Ce fragment a été publié longtemps plus tard, dans le livre de photographies d’Alain Marouani. [4]
En 1964, dans son Félix Leclerc, Bérimont constate : « En fait, pourrait-on réintroduire la poésie authentique dans la chanson, renouer avec une tradition millénaire qui fut celle des troubadours à l’époque où les cathédrales, toutes blanches, [5] sentaient grouiller sur leurs flancs les grappes de leurs bâtisseurs ? ». [6] Dans le même ouvrage, il précise avec vigueur : « Or, la poésie – de toute évidence ! – existait avant Gutenberg et avant l’invention de l’imprimerie. Gutenberg a offert un "support", un véhicule pratique – moitié encre, moitié papier – que les poètes (et beaucoup d’autres) ont utilisé durant quelques siècles mais qui ne saurait être, en aucun cas et sans abus, confondu avec la poésie elle-même. Ce véhicule, ce support du poème, a changé, change, est susceptible de changer encore. Orphée est représenté tenant une lyre, et nous sommes à l’orée d’une civilisation dite "audiovisuelle" qui gagne chaque jour du terrain, où le graphisme de l’imprimeur cède devant le son et le mouvement. Pourquoi ne pas imaginer une opération ayant pour objet d’arracher la prisonnière à sa Bastille d’encre et de papier ? Clairement, nous constatons le mal : nous savons que la poésie a perdu tout contact, toute liaison véritable avec l’extérieur, que la notion de "dimension verbale", loin de laquelle elle reste lettre morte pour les non-initiés, est réputée méprisable chez des poètes qui ambitionnent d’être publiés et lus, plutôt que dits. (…) On a toujours chanté la poésie – jusqu’au XVIe siècle à tout le moins ! Sait-on que les règles de la prosodie classique, celles du poème à forme fixe, l’élision, la césure, la rime féminine, etc., ont été établies – à seule fin de donner une structure "carrée" au texte que la musique devait nécessairement servir ». [7]
Léo Ferré a-t-il jamais dit autre chose, notamment dans la préface de son recueil Poète… vos papiers ! [8] : « La poésie est une clameur, elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n’être que lue et enfermée dans sa typographie n’est pas finie ; elle ne prend son sexe qu’avec la corde vocale tout comme le violon prend le sien avec l’archet qui le touche ». Tout au long de sa carrière, dans de multiples entretiens, il défendra cette idée, parlant à de très nombreuses reprises de la musique comme d’un « véhicule qui apporte la poésie dans l’oreille des gens ». Enfin, dans la grande famille des poètes qu’il choisira de chanter, il remontera jusqu’au XIIIe siècle, rejoignant ainsi la mémoire des troubadours et des « cathédrales toutes blanches » qu’évoquait Bérimont.
Préfaçant en 1972 un disque de Marc Ogeret, Bérimont écrit encore : « L’existence devrait être une fête : joie d’écrire, de chanter, de bouger. J’écris. Tu chantes. C’est la même chose ». [9] Pierre Seghers, lui aussi auteur de chansons et poète ne répugnant pas à être mis en musique, [10] présente au même moment son complice Bérimont : « Vitalité, invention, lyrisme, Bérimont, fils des Ardennes, est un foisonnement d’initiatives, de réalisations, d’entreprises. Romancier, poète, producteur de radio et de télévision, créateur des Jam sessions poésie, il est le "manager" des jeunes poètes, des tentatives – réussies – pour arracher la poésie à son splendide isolement en lui faisant passer la rampe du théâtre ». [11]
Toujours ce rapprochement entre la parole du poète et la voix d’un interprète, qui vaudra à Bérimont des désaccords. Jean Rousselot, son vieil ami, ne le suit plus et regrette : « Bérimont a cédé aux sortilèges et aux facilités de la chanson ». [12] Ailleurs, Rousselot écrit, dans le même ouvrage, des choses parfaitement contradictoires. Tout d’abord : « Ce rapprochement [de la poésie et du public] s’est accompli dans la chanson, genre mineur, certes, mais qui ne l’a pas toujours été (rappelons-nous chansons de gestes et troubadours) et qui retrouve aujourd’hui une qualité indiscutable grâce à des chansonniers-poètes comme Charles Trenet (…), Léo Ferré (…), ou à des poètes devenus auteurs de chansons à leurs heures (Pierre Seghers, Paul Chaulot, Marc Alyn, Luc Bérimont, Armand Lanoux, Louis Amade, enfin, dont les succès, répandus par Gilbert Bécaud, ne se comptent plus ». [13] Un peu plus loin : « Il est bien évident que seule, une poésie facile, de consommation immédiate, peut être mise en chanson. On ne conçoit même pas qu’un poème de Mallarmé, de Valéry, de Jouve ou de Char, ou de tout autre poète appliqué à créer son propre langage en même temps qu’il demande à ce langage de l’exprimer, puisse tenter un compositeur et cela amène naturellement à se demander si toute communication entre le poète et le public ne repose pas sur quelque compromission de la poésie ». [14] On est sidéré de voir combien les deux amis, Bérimont et Rousselot, peuvent défendre des points de vue aussi éloignés. Rousselot, grand connaisseur de la poésie de tous les temps, perd tout recul et toute objectivité lorsqu’il aborde la poésie chantée. Il insiste, toujours dans le même livre : « Je signale le succès actuel de la "chanson poétique" et c’est pour souligner l’ambiguïté de ce succès. Car enfin, pas plus qu’il n’y avait de commune mesure entre un Pierre Dupont et son préfacier Charles Baudelaire, il ne saurait y en avoir une, aujourd’hui, entre un Léo Ferré ou un Georges Brassens et un René Char ou un Francis Ponge. Il suffit de dépouiller de leur musique et de leur appareil spectaculaire – autrement dit de les réduire à leur texte – la plupart des chansons poétiques de notre temps, pour voir clairement la différence. (…) Il n’empêche que la faveur dont jouissent des "bardes" de qualité prouve que le grand public a besoin de poésie. Ce besoin, peut-on le satisfaire en substituant un récital de poèmes à un récital de chansons ? Les "poésie sessions" organisées par Luc Bérimont, les enregistrements publics des émissions radiophoniques de Philippe Soupault Vive la poésie, les séances de Poésie vivante organisées et animées par Pierre Vasseur (pour ne citer que quelques initiatives) ne sont pas allés jusque là. Si leur succès a parfois passé toute espérance, il faut bien reconnaître que leur enrobage (mise en scène des poèmes, projections, ponctuations musicales, voire utilisation de "vedettes" du cinéma ou de la chanson) y était bien pour quelque chose ». [15]
Claude Sarraute s’étonne encore lorsqu’elle rend compte du spectacle donné par Ferré au Vieux-Colombier en 1961 : « Pourquoi emprunter à d’autres des poèmes qu’il écrit si bien lui-même ? Les vers de Rutebeuf lui ont réussi, j’en conviens. De là sans doute cet acharnement à mettre en musique Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Aragon. D’autres s’y sont essayés avant lui avec un bonheur inégal ». [16]
De telles opinions étonnent d’autant plus qu’elles paraissent vouloir ignorer le véritable appel au chant que constituent les titres choisis par les poètes eux-mêmes : Verlaine (Chansons pour elle, Chanson d’automne, Gaspard Hauser chante), Rimbaud (Chanson de la plus haute tour), Charles Cros (Chanson des peintres), Mac Orlan (La Chanson de Margaret), Seghers (Chanson à tuer le temps), Desnos (La Chanson du petit jour), Richepin (La Chanson des gueux) et tant d’autres.
Apollinaire lui-même écrivait à Madeleine Pagès, le 30 juillet 1915 : « J’aime beaucoup mes vers, je les fais en chantant et je me chante souvent le peu dont je me rappelle ». [17] Il persiste en notant, le 3 août : « Je suis rudement content que vous aimiez ce que je fais, bien plus : que [vous] l’ayez pénétré au point d’ajouter : "Il faudrait chanter vos vers". En effet Madeleine, je ne compose qu’en chantant. Un musicien a même noté une fois les trois ou quatre airs qui me servent instinctivement et qui sont la manifestation du rythme de mon existence ». [18] Apollinaire est pourtant une référence et, s’il chantait lui-même, on peut penser qu’il n’avait rien contre le fait d’être mis en musique et interprété.
Et tandis que certains se demandent si la poésie doit être chantée, des maisons proposent des disques didactiques intéressants explorant des territoires historiques, sociaux et littéraires dans des séries exigeantes. Ainsi, la firme phonographique Reflets et, à titre d’exemple, deux microsillons : Poèmes et chansons messagers de l’histoire, avec Anne Sandrine, James Ollivier et Vicky Messica, [19] ou bien Jacques Douai chante le travail et les travailleurs. [20] Ces initiatives montrent que Bérimont n’est pas isolé.
Le débat, décidément, ne sera jamais clos. Longtemps après la mort de Bérimont, on lui reprochera aussi ses positions, mais d’un autre point de vue cette fois, en déclarant qu’il n’était pas allé assez loin : « Virulent défenseur, avec Jacques Douai, de la "chanson de qualité", c’est-à-dire poétique et privilégiant le texte à la musique, il ne perçut guère les mutations que le rock et les autres musiques actuelles apportaient à la chanson ». [21] Ce reproche est mal venu. Bérimont a poursuivi l’action de longue haleine qu’il avait entreprise. Il est difficile de prendre en compte, lorsqu’on vise un but, les circonstances qui évoluent dans l’intervalle. Qui plus est, l’ouvrage d’où est tiré ce jugement fait mourir Bérimont douze ans après son décès réel. En douze années, les choses avaient encore changé. Par ailleurs, ces mutations, ces possibilités offertes à la chanson, sont prises en compte par Ferré qui tentera un travail commun avec le groupe Zoo : la pop music et la poésie chantée seront alors regroupées. Ferré envisagera aussi, mais cela ne se fera pas, une collaboration avec les Moody Blues comme avec les Pink Floyd.
Bérimont est producteur d’émissions de radio et de télévision où poésie et chanson occupent une place de choix (Les Chemins du jour, présentations thématiques de disques durant quatre heures de 1958 à fin 1962, les Jam sessions chanson-poésie, émissions publiques d’environ trois-quarts d’heure nées en 1961, et La Fine fleur de la chanson française, poésie dite et chantée, tous les mardis soir, depuis 1961). Une constante de ces deux dernières séries : il présente, en ouverture, l’ensemble des participants et le propos de la soirée. Après quoi, il laisse le micro aux artistes dans une organisation très libre. Appréciable discrétion qu’il ne brise un instant qu’en fin de première partie pour récapituler les noms des interprètes et des auteurs… en « oubliant », lorsqu’on chante ses textes, de citer son propre nom.
Bérimont animera aussi, à partir de 1966, le Club de la fine fleur, collection de disques éditée conjointement par l’excellente firme phonographique BAM (La Boîte à musique) et par Pierre Seghers. Le projet est ambitieux : « Le Club de la fine fleur vous invite à rejoindre ceux qui veulent défendre la vraie chanson de notre temps sans souci des modes passagères ou commerciales. La poésie est une aventure. En même temps, elle est une tradition. La chanson du XXe siècle renoue avec la poésie de toujours. Celle qui va d’Orphée à René-Guy Cadou et à Aragon ». Les trois premiers enregistrements sont consacrés à Hélène Martin, James Ollivier et Jacques Douai, chacun Grand Prix du disque de l’académie Charles-Cros, qui chantent les poètes. Les souscripteurs reçoivent en cadeau le volume de la collection « Poètes d’aujourd’hui » de leur choix. Le prospectus de lancement de cette collection cite un extrait des propos déjà connus de Ferré sur Jacques Douai : « Jacques Douai chantera encore, quand bien des voix se seront tues ». [22] Il est préfacé par Max-Pol Fouchet, admirateur de Ferré, qui a fait figurer celui-ci dans son anthologie de poésie. [23]
Le mardi 10 décembre 1963, devant la salle de la Mutualité, à Paris (deux mille huit-cents places), « plus de trois mille personnes se pressaient dans une bruine nocturne et glacée, difficilement contenues par les cordons de police ». [24] Tout cela pour… assister à une Jam session chanson-poésie. Comment, en cet instant, ne pas rapprocher du célèbre cri final des Quatre-cents coups : « La poésie est dans la rue », ces mots de Bérimont : « Il faut descendre dans la rue avec la poésie. Il faut aller aux foules et la donner à voir, insolente dans sa nudité ». [25]
Il est décidément difficile de ne pas remarquer la proximité de vues qui existe entre les deux poètes. Léo Ferré fera une sortie, en 1975, dans une émission de télévision proposée par son ami Jean-Pierre Chabrol : « La chanson, un art mineur ? Qu’est-ce que ça veut dire ? Et quand des écrivains comme Mac Orlan ou Queneau… On dit "des chansons d’écrivains"… Mais qu’est-ce que ça veut dire ? C’est pareil, c’est aussi con. "Des chansons d’écrivains", "art mineur"… Mais ça les empêche de dormir, ça les fait chier, les poètes officiels, les gens qui tirent tout de suite deux cents plaquettes et qui sont vendues en vingt ans, alors ça les emmerde, la chanson, parce qu’avec la chanson, il y a la musique qui apporte la chose dans l’oreille des gens. Même s’ils ne veulent pas apprendre les paroles, les gens les reçoivent, on viole les gens avec la musique. Alors, si on les viole et que c’est bon, ils en redemandent ». [26]
Lucienne Cantaloube-Ferrieu écrit avec intelligence : « Luc Bérimont n’hésite pas à confier ses vers aux compositeurs soucieux de les mettre en musique. À la manière des poètes du XVIe siècle, il laisse délibérément à Léo Ferré, à Michel Aubert, à Hélène Martin, à Marie-Claire Pichaud et à bien d’autres, le soin d’unir à la musique certains de ses poèmes, sans jamais tenir ces textes devenus chansons pour la partie mineure de son œuvre. L’adjonction musicale (…) est un signe difficilement récusable. Il importe, cependant, de voir qu’il ne s’agit, alors, que d’une conséquence d’un fait plus fondamental qui est l’orientation d’un nouveau lyrisme vers une grande simplicité d’expression et une large communication humaine. Qu’elle soit ou non effectivement associée à la musique, cette poésie est incitation au chant, parce que, généreuse et fraternelle, elle se veut ouverte au plus grand nombre, populaire, somme toute, comme la chanson ». [27]
Dans son Jacques Douai, Bérimont enfonce le clou. Il répète inlassablement son idée-force : « La poésie, grâce à la radio, à la télévision, au disque, fait une reconversion inattendue, qui ressuscite le temps où le chant n’était pas dissociable de son exercice (…). La poésie de réflexion et de recherche s’accommode du silence de la page imprimée. Une poésie "pour l’œil", élitiste, inaccessible aux foules, s’est développée au détriment de la grande poésie orale populaire. Cette attitude d’initié conduit à l’usage solitaire d’un bien collectif. L’apparition des auteurs-compositeurs-interprètes démontre que le besoin de communiquer est resté le plus fort. Les masses n’acceptent pas de vivre, coupées de cette parole proférée que fut la poésie à toutes les époques, même si les tenants de la poésie typographique se détournent avec dégoût ». [28] On pourrait donner de larges pans de ce petit volume où le nom de Ferré est cité en plusieurs endroits et dans lequel, au cœur d’un choix de textes chantés par Douai, se retrouvent Noël de Bérimont et Le Bateau espagnol de Ferré, ainsi que Pauvre Rutebeuf et Il n’aurait fallu.
(À suivre)
[1]. Cité par Paul Chaulot, in Luc Bérimont, op. cit.
[2]. Les Blasons du corps féminin, 33-tours 30-cm Pathé, DTX 147.
[3]. Cité par Gilles Schlesser, Le Cabaret « rive gauche », 1946-1974, L’Archipel, 2006.
[4]. Alain Marouani, Inédits, textes de Léo Ferré, Michel Lafon, 2006.
[5]. Expression peut-être empruntée à Le Corbusier, Quand les cathédrales étaient blanches, Plon, 1937.
[6]. Luc Bérimont, Félix Leclerc, op. cit.
[7]. Ibidem.
[8]. Léo Ferré, Poète… vos papiers !, La Table Ronde, 1956 (rééd. La Table Ronde, 1971, collection « Folio », n° 926, 1977, sous deux couvertures, Édition n° 1, 1994).
[9]. Marc Ogeret, Rencontres, 33-tours 30-cm Vogue, SLD 839.
[10]. On écoutera par exemple, Pierre Seghers chanté par Hélène Martin, Monique Morelli, Catherine Sauvage, Jacques Douai, Roger Lahaye et Marc Ogeret, collection « Poètes et chansons », CD EPM-Musique 985682.
[11]. Pierre Seghers, Le Livre d’or de la poésie française contemporaine, vol. 1, de A à H, Marabout-Université, n° 174, 1972.
[12]. Rousselot, par ailleurs exégète de bien des poètes, paraît oublier qu’il a cédé lui-même aux facilités de la biographie romancée telle qu’on la concevait encore dans les années 60, avec les nombreuses vies de musiciens qu’il publie chez Seghers.
[13]. Jean Rousselot, Poètes français d’aujourd’hui, Seghers, 1959.
[14]. Ibidem.
[15]. Ibidem.
[16]. Le Monde du 31 janvier 1961.
[17]. Guillaume Apollinaire, Lettres à Madeleine, Gallimard, 2005.
[19]. Poèmes et chansons messagers de l’histoire, avec Anne Sandrine, James Ollivier et Vicky Messica, 33-tours 30-cm Reflets, SM 30 M-197.
[20]. Jacques Douai chante le travail et les travailleurs, 33-tours 25-cm Reflets, SM 25 A-193.
[21]. Yann Plougastel (ss. dir. de), La Chanson mondiale depuis 1945, Larousse, 1996.
[22]. « Depuis dix ans… », texte sans titre donné en préface à Jacques Douai chante Léo Ferré, 45-tours BAM, vol. 1, EX 212, et vol. 2, EX 215.
[23]. Max-Pol Fouchet, Anthologie thématique de la poésie française, Seghers, 1958.
[24]. Pourquoi des Jam sessions chanson-poésie ?, cité in Signes, n° 8, « spécial Luc Bérimont », Éditions du Petit Véhicule.
[25]. Ibidem.
[26]. Marginale, 27 octobre 1975.
[27]. Lucienne Cantaloube-Ferrieu, Chanson et poésie des années 30 aux années 60, Trenet, Brassens, Ferré ou les « enfants naturels » du surréalisme, Nizet, 1981.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 19 novembre 2006
Avec Luc Bérimont, 2/4
À l’automne 1955, on trouve la première trace connue du nom de Ferré sous la plume de Bérimont. Dans la revue La Tour de feu que Pierre Boujut édite à Jarnac, il publie une interview imaginaire d’Henry Miller et lui prête ces propos : « Il existe [en Amérique] des groupes de jeunes gens qui se réunissent pour écouter des disques enregistrés à Paris et qui pleurent en entendant Catherine Sauvage chanter Léo Ferré ! ».
Dans les émissions radiophoniques de Bérimont, Ferré est régulièrement convié. À cette période, Bérimont anime, en collaboration avec Jean Grunebaum, Avant-premières, chaque semaine. Il fera vivre cette émission de 1951 à 1965. Le jeudi 25 mars 1954, Ferré, s’accompagnant au piano, chante là Le Piano du pauvre. Ferré y parle souvent des poètes qu’il habille de musique. À une date hélas imprécise, il présente Pauvre Rutebeuf qu’il vient d’enregistrer et chante le poème avec un accompagnement original. Cette émission prend place entre novembre 1955 (enregistrement chez Odéon) et juin 1956 (parution du disque). Bérimont introduit ainsi le propos : « Le plus grand courage, le courage le plus insolite, c’est d’aller rechercher dans le vieux fond national de la poésie des poètes inconnus, ignorés, de les remettre au jour et on s’aperçoit alors que ces poètes d’hier sont plus jeunes que les poètes d’à présent ». Ferré répond : « Vous savez, ce n’est pas tellement un courage, je crois que c’est une grande joie. Ainsi, dans le microsillon que je viens d’enregistrer, j’ai une chanson dont la musique est de moi et dont les paroles sont de ce grand poète d’avant Villon, qui a dû vivre en 1240-1250, qui s’appelle Rutebeuf, qui était pauvre. J’ai extrait quelques poésies de ses nombreux recueils et j’en ai fait une chanson que j’ai appelée Pauvre Rutebeuf. Je crois d’ailleurs que ça aurait vraiment pu être écrit aujourd’hui ». [1] Le jeudi 15 janvier 1959, Bérimont annonce que Ferré a mis en musique quinze chansons d’Aragon et l’on écoute Tu n’en reviendras pas. Le jeudi 12 février, Ferré interprète Je chante pour passer le temps. Le jeudi 19 mars, Léo Ferré évoque au micro de cette même émission douze chansons seulement (et chante L’Étrangère). On n’en connaîtra, au bout du compte, que dix, enregistrées chez Barclay les mardi 10, mercredi 11 et vendredi 13 janvier 1961. Le jeudi 9 avril, Ferré donne La Belle amour de Claude Delécluse et Michelle Senlis. Le jeudi 28 mai, Des filles, il en pleut… de Pierre Seghers. Le jeudi 25 juin, Ferré précise qu’il vient de mettre en musique douze poésies de Verlaine et chante Green. Le jeudi 17 septembre, il vient interpréter cette fois un texte de lui, L’Âge d’or, chanson qu’il n’enregistrera finalement qu’en février 1966 chez Barclay. Le jeudi 22 octobre, il chante, toujours de Verlaine, Sérénade. Le samedi 12 décembre, il interprète, de lui, La Mauvaise graine.
On en arrive aux créations communes de Bérimont et Ferré. Dans l’œuvre de Ferré, le cas de Bérimont est différent de ceux de Seghers (dont Ferré a enregistré Merde à Vauban, mais pas Des filles, il en pleut...), de Rouzaud (Quand c’est fini, ça recommence, mais pas Ce garçon-là), de Baer (La Chambre et La Chanson du scaphandrier, mais pas Oubli ni Le Banco du diable) ou même de Mac Orlan dont il sera question plus spécifiquement dans ce livre (Ferré ne chante pas La Fille des bois parce que la chanson est faite pour une femme). S’agissant de Bérimont, Ferré met en musique deux poésies, effectue les dépôts à la Sacem, publie les partitions, enregistre mais ne publie pas de disque, ce qui est étonnant. Il s’agit de Soleil et de Noël.
Soleil est une poésie en fait intitulée Capri par son auteur, et publiée dans son recueil L’Herbe à tonnerre, qui obtiendra le prix Apollinaire. [2] Au moment où Ferré compose sa musique, Capri (avant-dernière pièce du recueil) fait partie des plus récentes œuvres de Bérimont. La même année, il a publié un roman, Le Carré de la vitesse, chez Fayard, mettant en scène, de façon amère et désabusée, les milieux de la radio publicitaire et de la télévision. Roman de poète au ton noir et lucide, Le Carré de la vitesse est une œuvre où les inquiétudes de la poésie de Bérimont se retrouvent, tissées en prose. C’est aussi une peinture sévère d’un certain milieu dans les années 50, et une abondante digression sur les questions de société et les angoisses existentielles de l’auteur. Parallèlement, Bérimont a signé une dramatique diffusée sur Paris-Inter, Au sentier des nuages, ainsi qu’une autre, C’est Dupont, mon Empereur !, en collaboration avec Armand Lanoux, d’après Jean Burnat.
Maurice Frot, donc, dessine la couverture du « petit format » de Soleil, à cette époque où Ferré les imprime lui-même, sous les combles de son appartement, 28, boulevard Pershing. Léo Ferré l’envoie à Bérimont, avec une lettre non datée : « Cher Luc, voici notre chef-d’œuvre 1959 ! Dûment édité… et imprimé au château Pershing ! Je te joins la feuille Sacem et la feuille SDRM. Celle-ci tu peux la signer et l’envoyer par la poste. Quant à celle de la Sacem je te demande d’y faire un saut s’il-te-plaît et déposer en même temps deux exemplaires (because édition et copyright). Je t’envoie des formats quand tu en auras besoin. Mille bonnes amitiés de nous deux. À bientôt. Léo Ferré ». Cette chanson, enregistrée le jeudi 30 avril 1959, est diffusée au moins une fois à la radio, le samedi 22 août 1959, dans l’émission La Maison de vos rêves réalisée par Pierre Lhoste, émission au cours de laquelle Luc Bérimont parle de son passé et de ses rêves.
Une seconde poésie, Noël, est enregistrée pour la radio le jeudi 17 décembre 1959. Dans la présentation qu’ils en font conjointement, Bérimont déclare, avec le « vous » public alors de rigueur : « J’ai pensé, et vous étiez de mon avis, qu’il ne fallait pas faire un Noël traditionnel, enfin, qu’il fallait sortir un peu du Noël des anges, du Noël des crèches ».[3]
En 1959 et 1961, Léo Ferré cède aux Nouvelles éditions Méridian les partitions des deux textes signés Luc Bérimont. Le mercredi 9 mars 1960, il écrit une nouvelle lettre à Bérimont : « Cher Luc, voici, en retour, la chanson, avec la déclaration Sacem. L’hiver est enfin terminé… presque. Nous sommes bien tristes car nous avons perdu notre chienne Canaille. C’était un peu beaucoup comme ma fille. Enfin, que veux-tu, c’est le seul mur contre lequel nous butions et c’est bien désespérant, la mort. À bientôt et bonnes amitiés de nous deux. À toi. Léo Ferré ». Le dépôt de Noël à la Sacem est d’avril 1960. Ferré l’enregistre à titre de maquette, en novembre 1960, sur un 45-tours simple face, avec cet accompagnement : au piano, lui-même ; au saxophone, Pierre Gossez ; aux ondes Martenot, Janine de Waleyne. La partition de Noël porte la mention expresse : « Aucun arrangement n’est autorisé s’il ne se réfère exactement au présent texte musical et littéraire. L. Ferré ».
L’excellente entente entre les deux poètes et la réussite de leurs deux créations communes font qu’évidemment, on se demande pourquoi ils n’ont pas poursuivi leur collaboration. En réalité, Léo Ferré en a bien eu l’intention, si l’on en croit une lettre adressée par son épouse à Bérimont. Ce courrier n’est pas daté, mais son contenu (une allusion au livre de Bérimont, Le Bois Castiau, dont on reparlera plus loin) permet de le situer à l’automne 1963. Il est écrit à Perdrigal, dans le Lot, et fait allusion – sans préciser leurs titres – à d’autres poésies de Bérimont pour lesquelles Ferré était en train de composer des musiques. Malheureusement, il semble bien que cela n’ait pas eu de suite, pour une raison encore inconnue. Les courtes lignes ajoutées en marge de la lettre par Ferré lui-même sont un message de sympathie, un mot d’amitié, mais ne se rapportent pas à ce travail : « Nous sommes au "vert", comme on dit, le vert de l’"espère", perhaps, un vert qui jaunit drôlement en ce moment. Paraît qu’c’est la môme Automne qui se fait son tweed. Grosse bise. Léo ».
En 1966, alors que Bérimont publie Le Bruit des amours et des guerres [4] qui lui vaut un prix, paraît aussi le volume qui lui est consacré dans la belle collection « Poètes d’aujourd’hui ». [5] Il mentionne Noël dans la discographie, mais ne fait aucune allusion à Soleil. C’est évidemment parce qu’il se trouvait des enregistrements du premier par des interprètes, mais aucun du second. Bérimont est par ailleurs l’auteur de textes sur Hélène Martin, sur Robert Hossein et sur Serge Kerval et, chez Seghers, celui d’un Félix Leclerc, [6] ainsi que d’un Jacques Douai réalisé en collaboration avec sa compagne, [7] mais n’a vraisemblablement pas écrit à propos de Ferré, hormis la « trace » citée plus haut et quelques autres, qu’on lira plus loin. Il l’a certes convié de nombreuses fois à la radio, on l’a vu, mais n’a pas commis d’œuvre critique à son sujet.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 18 novembre 2006
Avec Luc Bérimont, 1/4
Le lyrisme de plein vent de Luc Bérimont
(JEAN ROUSSELOT)
« Demain peut-être, grâce à l’effort des poètes qui ont accepté d’accomplir loyalement leur tâche de leur vivant, la poésie sera redevenue ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : une voix et un miroir ». Une phrase de Bérimont qui pourrait bien convenir à Léo Ferré, son cadet d’une année puisque Luc Bérimont, de son vrai nom André Leclercq, est né le jeudi 16 septembre 1915 à Magnac-sur-Touvre (Charente), au sein d’une famille ardennaise chassée par l’invasion allemande. Du poète, Max Jacob dira : « Votre simplicité va à l’humilité. C’est en cherchant humblement au plus profond de soi-même qu’on trouve la personnalité. Buffon dit que bien écrire, c’est bien définir et bien peindre. Mais vous êtes plus fort que lui dans cet art-là ! ». [1] Plus tard, le prix Max-Jacob sera décerné à Bérimont. [2]
Durant l’Occupation, quelques amis poètes fondent l’École de Rochefort. « Cela se passait, aux rives de Loire, Rochefort, dans un pays large et vert, bordé de collines, de châteaux et de sables. Dans cette contrée où les vignes et les roses ajoutent leurs parures à la couleur ardoise du ciel, un pharmacien : Jean Bouhier, et un instituteur : René-Guy Cadou, avaient décidé d’ôter le baîllon que l’Occupant tentait d’imposer à la poésie. Souvenons-nous un instant du climat : chacun avançait à tâtons sur un parcours semé d’embûches, cherchant à reconnaître les amis sous le masque, à déceler l’adversaire sous la cordialité d’emprunt. 1941, c’est la guerre. Paris a faim. Paris a froid. L’Europe est un camp retranché. Les veilleurs de Londres et de Moscou chuchotent pendant que les bruits de bottes signalent l’approche d’une patrouille allemande dans la rue où les lampadaires sont éteints… Vichy prône une poésie "nationale et traditionnelle", pieusement enroulée autour d’un bâton de Maréchal. Aragon publie Le Crève-cœur. Pierre Seghers lance les premiers numéros de Poésie 41. Max-Pol Fouchet édite la revue Fontaine, à Alger. En zone occupée, la poésie, cette dignité de l’homme, a officiellement disparu… », écrit Luc Bérimont. [3]
Il a pourtant tenté de faire entendre la poésie dans une émission diffusée sur les ondes de Radio-Paris, à partir du vendredi 12 décembre 1941. Cela s’intitulait Puisque vous êtes chez vous, un programme hebdomadaire d’une demi-heure pour lequel il choisissait les textes, tandis que Pierre Hiégel sélectionnait sons et musiques. Quatre interprètes avaient été retenus pour leur voix : Hélène Garaud, Jacqueline Bouvier (future Mme Pagnol), Pierre Viala et Michel Delvet.
Son expérience d’homme de radio est grande. On y reviendra souvent dans cette étude. Pour le moment, il faut lire cette description qu’il fait du travail à la radio, à la fin des années 40 et dans les premières années 50 : « Les émissions sont inventées en studio ; peu de disques, beaucoup d’imprévu. La création constante exige du talent, de la culture et des nerfs. Être dans une émission ne signifie pas, pour un chanteur, présenter une rondelle de résine vynilique. Il faut auditionner devant le producteur et le réalisateur, faire preuve d’une qualification professionnelle. Paul Gilson organise des séances pour détecter de nouveaux venus. La radio devient une école puisqu’elle s’emploie, au Club d’Essai, sous l’impulsion d’un autre poète – Jean Tardieu – à former des chanteurs, à les rompre à la technique maison. La préparation d’une émission prend des aspects que l’on trouvera comiques ou touchants, selon l’âge. Les micros sont des boîtes grillagées qui ont la forme d’un "pavé normand". On grave "à l’escargot", sur des Pyral fragiles qui font de l’enregistrement une chose périssable, détruite après quelques utilisations, inférieure au direct. Les artistes répètent longuement, reviennent. Souvent, un professeur de chant, dans la cabine, joue les "conseillers artistiques" ». [4]
En 1952, Jean Rousselot présente son ami Bérimont : « Une sauvagerie narquoise, une légèreté d’Ariel, une allégresse un peu hagarde, le goût des mots juteux, sucrés, de l’embrassade, du rire et du vin blanc, voilà Luc Bérimont qui est partout et nulle part, rime d’affilée trois strophes dans l’autobus sans perdre de l’œil sa belle voisine, parle en cataracte et s’enfuit de même quand on croyait le tenir, toujours bourré de papiers, de fleurs à offrir et de services à rendre ». [5]
(À suivre)
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 16 novembre 2006
L’ogre et le chien
Qu’en est-il des relations de Ferré avec Bernard Dimey ? Il était nécessaire de dresser un état des connaissances. Hélas, le peu d’informations dont on dispose n’a permis, à ce jour, que la rédaction d’un texte comprenant encore beaucoup de questions. Il fallait les poser, pour espérer avancer. Je présente donc cette étude en l’état, en souhaitant qu’elle puisse être complétée dans l’avenir. Elle est fondée, en tout cas, sur des traces écrites, enregistrées ou iconographiques indéniables.
On pourrait appeler cela L’Ogre et le chien, un titre de fable pour une histoire vraie jamais racontée. Personne, en effet, n’a cru devoir, à ce jour, tenter de reconstituer l’amitié, même épisodique, de Bernard Dimey et Léo Ferré. On a parlé de cette amitié, ici et là, très en surface, mais on n’en a pas écrit la trop brève chronique, qu’étayent pourtant quelques documents rares. Si les deux hommes n’ont pas été extrêmement proches, ils ne se sont jamais oubliés et, par-delà les années, ont connu des retrouvailles régulières, cimentées par l’estime.
Rencontre et créations communes
Cette histoire commence par une lettre, lettre apportant chez Léo Ferré, qui demeure alors 28, boulevard Pershing à Paris, où le Bottin le mentionne comme « compositeur de musique », des poèmes et des peintures de Dimey. Cet envoi n’a pas été retrouvé pour le moment mais on dispose heureusement de la réponse.
Le [jeudi] 3 mai [1956], l’épouse de Ferré répond à l’envoi de Dimey. La lettre ne porte pas de date complète et l’enveloppe d’expédition manque, mais le contenu autorise à penser à 1956. Elle transmet elle-même des poésies de son mari et des coupures de presse en demandant à pouvoir ensuite les récupérer, n’en ayant pas de double. Elle invite Dimey à venir les voir à Paris. Un mot chaleureux est ajouté à la lettre par Léo Ferré : « Cher monsieur, si ces poésies devaient être "lues", j’aimerais qu’elles le soient par ma femme. Je suis très fétichiste et assez sauvage... Je sais que vous me comprendrez. À bientôt, j’espère et merci de votre rare sensibilité ». [1] On déduit donc que la lettre d’appel demandait des textes de Ferré, à lire, vraisemblablement, dans une émission radiophonique.
Dimey est né à Nogent (Haute-Marne), le jeudi 16 juillet 1931. À l’âge de vingt-cinq ans, à l’expiration de son sursis pour études, il est incorporé le mercredi 5 septembre 1956 à la caserne Mortier, à Paris, sa myopie lui ayant permis d’être exempté du départ en Algérie. Le service militaire dure alors trois ans. C’est, selon toute vraisemblance, durant ce séjour parisien forcé qu’il vient rendre visite à Léo Ferré, comme l’en priait la lettre du 3 mai. Il a raconté plus tard à sa compagne Yvette Cathiard que les chiens de Ferré n’avaient pas apprécié son uniforme. [2] Il est bien dommage, pourtant, qu’on ne dispose pas d’une relation moins anecdotique de ces instants.
Où en est Léo Ferré à cette période de son existence ? Il vit les premiers mois de son amitié avec Breton, il vient de cesser de prendre part à « l’affaire Minou Drouet ». Il a rencontré Roland Petit et Zizi Jeanmaire chez Louise de Vilmorin. Il va publier dans l’année La Nuit et Poète… vos papiers ! [3]
Cette première rencontre semble s’être fort bien passée puisqu’elle débouche immédiatement sur une confiance authentique, qui va permettre à Dimey de participer à quelques créations de Ferré.
Ainsi, le lundi 8 octobre 1956, est achevé d’imprimer La Nuit, feuilleton lyrique (La Table Ronde), dont Dimey dessine la jaquette. On connaît l’histoire de cette œuvre. [4]
En 1957, Dimey aperçoit Ferré sortant du cabaret Chez Plumeau, place du Calvaire, à Montmartre, établissement que dirige Jean Méjean, futur président-directeur-général de la Société parisienne de spectacles et responsable de la programmation du théâtre de l’ABC. Ferré est accompagné de ses saint-bernard qu’il fait monter dans une belle voiture, garée non loin de là. Un clochard avise la scène et demande à Ferré : « Il n’y a pas moyen d’être chien chez vous ? » [5] Il faut ajouter qu’à cette date, Léo Ferré n’est pas encore réellement célèbre (il ne le sera qu’en 1961) et que les automobiles du moment ne convenaient pas au transport de gros chiens. Ferré avait une voiture spécialement aménagée pour cela. La scène est effectivement très vraisemblable, cependant, elle est susceptible de comporter toute la part de jeu et de fantaisie dont était capable Dimey. De plus, elle est relatée longtemps après à quelqu’un qui la raconte à son tour, plus tard encore.
En 1961 (le disque n’est pas daté, mais la pochette l’est, heureusement, par l’imprimeur) paraît un 45-tours Philips de quatre titres, Zizi Jeanmaire chante Bernard Dimey. [6] On y trouve un texte mis en musique par Léo Ferré, Les P’tits hôtels. Ce n’est d’ailleurs pas le meilleur poème de Dimey, loin de là. Il est regrettable que la collaboration des deux hommes ne se soit pas poursuivie avec des textes d’une qualité supérieure. Cette petite histoire est très loin de ce que peut signer Dimey par ailleurs, lui dont les poèmes ont été mis en musique par de très nombreux compositeurs et chantés par tant d’interprètes prestigieux.
Lorsqu’en 1963, Ferré quitte Paris pour s’installer dans le Lot, il continue à voir certains de ses très proches mais perd un peu de vue d’autres personnes et, notamment, Dimey, qui n’est jamais venu au château de Perdrigal. Leurs rencontres ultérieures seront encore parisiennes. Des rencontres distantes dans le temps, mais constantes toutefois.
Ferré n’oublie pas ses compagnons anarchistes. Régulièrement, il regagne Paris, parfois spécialement pour eux. Le vendredi 10 novembre 1967, à la Mutualité, il chante pour le gala annuel du Monde libertaire. En première partie, Colette Chevrot, Bernard Dimey, Marie, Anne et Julien, Pierre Provence, Les Poémiens et les Garçons de la rue.
Au cours du quatrième trimestre 1968, Léo Ferré, qui cette fois a quitté le Lot, imprime lui-même un recueil de textes et d’illustrations, Mon programme, daté 1969 sur la couverture. Dans le copyright, il indique l’adresse monégasque de ses parents. On remarque que cette même couverture reprend un détail du dessin que Dimey lui avait fait en 1956 pour La Nuit. La plaquette comprend en outre un portrait de son chimpanzé Pépée par Dimey, non daté. [7] Il envoie certainement ce volume à Dimey, puisqu’une photographie de Pépée adulte faite par Hubert Grooteclaes, qui y est insérée, sert à présent de point de départ à un nouveau dessin de Dimey, toujours non daté, qu’on ne connaîtra que plus tard.
Au Don Camilo
À partir du vendredi 3 octobre 1969 et durant vingt jours, Dimey figure en première partie du spectacle de Léo Ferré au cabaret Don Camilo, 10, rue des Saints-Pères (Littré 65-80 ou 71-61). C’est un dîner-spectacle à formule fixe : repas, boisson, café, droit d’entrée et service compris. Au même programme, Jean Courtil, Pascale Concorde, les Frères ennemis et Toulaï. Les Frères ennemis se sont déjà produits en première partie de Léo Ferré. C’était à Bobino, à partir du mercredi 17 mars 1965, lorsque le poète avait remplacé Trenet, souffrant, au pied levé. Pour Dimey, c’est aussi la seconde fois, la première étant la soirée unique de 1967, en soutien au Monde libertaire. Il écrit à sa mère : « Je passe tous les soirs dans quatre cabarets, le Don Camilo, la boîte ultra-chic de Paris, avec Léo Ferré en vedette... Après le Don Camilo, je passe au Port du Salut, autre cabaret très coté de Saint-Germain-des-Prés, ensuite je remonte à Montmartre où je fais le Tire-Bouchon et je termine avec le Gavroche, ce qui me fait quatre cabarets par soirée... Il faut le faire ». [8]
Pour Ferré, qui, cette même année, a triomphé à Bobino du mercredi 8 janvier au lundi 3 février, c’est un retour d’un moment au cabaret mais, explique-t-il, « je ne prépare jamais un tour en conséquence. Je tente même d’être plus violent que je le suis habituellement. (...) je chante des chansons de cabaret. (...) Disons que j’ai fait un certain choix mais je n’ai pas de chansons adaptées pour tel ou tel endroit ». [9]
Des travaux viennent d’être effectués dans le cabaret, maintenant climatisé, il y a un rideau, les tables sont alignées. Dimey est en scène avec son allure imposante et des textes somptueux. Sa compagne se rappelle le moment : « Par son regard scrutateur il stoppe les gestes des clients appliqués à manger leur langouste, après son récital les assiettes pleines et froides retourneront en cuisine, intouchées ». [10]
Puis, c’est le tour de la vedette. À la fin, bien entendu : « Quand je passe au Don Camilo, dit Ferré, les gens ont fini de dîner. D’ailleurs, si je voyais un monsieur continuer à manger, je vous affirme que j’irais m’installer avec lui pour "bouffer" ». [11]
Dans sa chronique du Monde, Claude Sarraute écrit : « Surgit celui qu’on n’attendait plus (...). Et le voilà qui se dresse là-bas, en bout de table, poings fermés, col ouvert, et qui dit et qui crie des indécences gênantes et de troublantes évidences ». [12] Le scandale arrive, en effet. Quels sont ces mots dans cet établissement ? C’est que Ferré, parmi seize chansons dont Le Mal, L’Âge d’or, Monsieur Tout-Blanc, Paris, je ne t’aime plus, dit maintenant Le Chien. « Scandalisés par les "prières inversées" et les "mots sans culotte" de Léo Ferré, certains n’ont pas hésité à lever le siège, et un siège qu’on lève dans l’obscurité faussement complice de la salle et le silence franchement narquois de la scène, cela fait du bruit », poursuit la journaliste. [13] Des clients effarés, choqués, se dirigent vers l’escalier de sortie. Claude Sarraute poursuit sa relation : « Alors Popaul, le pianiste aveugle, souriant derrière ses lunettes de soleil : "Qu’est-ce qui se passe, Léo, ils se tirent ?" Et Ferré : "Oui mon gars, il y en a tout un gros tas qui descend" ». [14]
Cependant, Ferré s’offre au Don Camilo un beau succès. Souvent, Gainsbourg vient l’écouter – il habite 5 bis, rue de Verneuil, à l’angle de la rue, quelques mètres à peine. Cette année-là, Ferré l’a salué dans sa chanson Pépée. Gainsbourg a bien compris que l’allusion à son physique était tendre et non ironique. Aznavour est là, le samedi 4 octobre, et, devant les photographes, les deux hommes se croisent dans l’escalier.
Toujours complices
C’est presque sans aucun doute au début de l’année 1970 qu’il faut situer la seule photographie retrouvée de Dimey et Léo Ferré, hélas non datée, non signée. C’est le grand problème de ces documents inconnus que des recherches minutieuses finissent par faire apparaître au grand jour. Ils ne présentent presque jamais de références. On y voit un grand sourire amical, échangé par les deux hommes. Cette image est inédite. [15]
En octobre 1972, Dimey et sa compagne vont entendre Ferré, accompagné par Paul Castanier, à l’Olympia. Yvette Cathiard note simplement : « À côté, à l’Olympia, passe Léo Ferré, c’est une messe que nous ne voulons pas manquer. Après le spectacle, nous traînons en coulisse... ». [16] Nous n’en saurons malheureusement pas davantage.
Il faudra attendre deux années encore pour trouver enfin quelques traces de Ferré sous la plume de Dimey, traces plus conséquentes mais non publiques puisque rédigées dans des journaliers. Le dimanche 17 novembre 1974, dans son journal inédit, Dimey évoque en effet Léo Ferré par trois fois, très chaleureusement. Il écrit : « J’écoute Léo Ferré pleurer sa chanson sur Richard, Richard Marsan, vieil [mot illisible] des nuits de Montmartre et de la rive gauche réunis ». Plus loin : « Je suis à Lille depuis une semaine pour tourner la cinquième de mes émissions Pour l’amour de... Cette fois il s’agit de Pour l’amour du fric. Nous avons tourné dans le parc de M. Prouvost, l’une des plus grandes fortunes de France et c’est dans ce décor que Jacques Marchais enregistrera demain deux chansons de Léo Ferré, encore lui, La Fortune et Le Parvenu, ce qui me semble assez coquin ». Enfin, on peut lire : « Et soudain, voilà que le transistor d’à côté m’envoie Le Bateau espagnol, de Léo, toujours lui (...) et que je songe au Bateau espagnol, j’ai toujours un peu l’impression d’avoir embarqué dessus ». [17]
À une date totalement incertaine, Dimey, connaissant l’amour que Léo Ferré éprouve pour les chevaux, lui offre un collage de grand format qui comporte également un poème de deux strophes, sans titre, avec cet incipit : « Cheval de plein soleil avons-nous trop couru… ».
Dimey meurt le mercredi 1er juillet 1981, à quinze jours de son cinquantième anniversaire. Le vendredi 3, il est inhumé à Nogent, sa ville natale.
En novembre 1993, la parution de Léo Ferré, la chanson du bien-aimé de Didier Barbelivien et Dominique Lacout, permet de faire connaître le second portrait de Pépée par Dimey, signé mais, encore une fois, non daté. [18]
On observe donc, entre les deux artistes, une longue complicité qui n’aboutit toutefois à aucune collaboration de grande envergure. Et cependant, au fil du temps, ils se retrouvent pour des moments de fidélité. Je poursuivrai mes recherches, il y a forcément des choses nouvelles à découvrir, d’autres faits à établir. Ce texte vaut pour une simple étape, qu’il conviendra de franchir.
Remerciements : Alain Fournier, Philippe Savouret.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 15 novembre 2006
Cet air qu’on cherche, 4/4
La radio
Le soir, sur cette radio au coffre de bois sombre, aux gros boutons déplaçant une aiguille sur un cadran, on parcourt le monde à la recherche de voix et de musiques. En 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, on comptera en France cinq millions de postes. « Mon oncle avait la manie de la radio. Il avait une radio chez lui et à ce moment-là c’était des radios avec plein de boutons. C’était comme dans un avion. Il avait d’abord eu un poste à galène et après un poste qui marchait avec des batteries. Un jour, je lui ai dit : "Tonton, quand est-ce que ça marchera avec le trou de l’électricité ?" Et ce type, qui était très au courant au sujet des radios, m’a dit : "Ça mon petit, je ne sais pas quand, mais ça sera très difficile !". Et alors, j’écoutais des tas d’émissions de radio », raconte Léo Ferré dans un entretien. [1]
En 1931 – Léo Ferré a maintenant quinze ans, en octobre il entrera en classe de seconde B –, on entend Peanut Vendor, une rumba fox-trot de Moises Simon, chanson parue aux États-Unis l’année précédente, enregistrée par Don Azpiazu dans le disque Victor 22483-A, avec un texte original d’Antonio Machin. Il écoute cet air cubain populaire sur lequel ont été à présent écrites des paroles anglaises. Peut-être entend-il aussi la version enregistrée par Mistinguett sous le titre La Rumba d’amour. Ce ne serait pas étonnant puisqu’il écrira un jour La Rengaine d’amour dont le titre semble être la réminiscence, mais il faut s’interdire formellement toute extrapolation. Un an plus tard à peine, en 1932, année où il entre en classe de première B et découvre l’œuvre de Céline, Don Azpiazu et son orchestre (anciennement, orchestre du casino de la Havane) se produisent à Monaco : la formation comprend batterie, bongo, violon, clarinettes, saxophones, contrebasse, piano, trompettes, et le spectacle s’intitule La noche de los tropicos. Il est peu probable qu’il soit demeuré inconnu de l’adolescent Ferré. Le succès de Peanut Vendor ouvrira aux États-Unis la voie à la musique dite latine. Ainsi, en 1931 encore, sort le film Cuban Love Song qui, bien que n’étant pas un musical, contient tout de même une chanson, ainsi que cela se faisait beaucoup. Les auteurs sont Herbert Stothart, Jimmy Mc Hugh et Dorothy Fields. Peut-être Ferré l’a-t-il vu : ce sont les débuts du cinéma parlant et ce qu’on qualifie de simple « attraction » attire le public tandis que, convaincu au contraire de l’avenir de la chose, Marcel Pagnol s’en empare pour signer des chefs-d’œuvre. Longtemps plus tard, en 1964, dans sa demeure du Lot, Ferré écrira Quand j’étais môme où l’on trouve un souvenir de cette chanson : « Quand j’étais môme / À la radio on jouait Please / Peanut Vendor / C’est bien d’accord »… Il gravera la chanson dans son disque de l’année. [2]
Cet autre titre, Please, accolé à celui de Peanut Vendor et montré comme un succès du moment, quel est-il ? Il a été plus difficile de l’identifier. Il pourrait s’agir d’une chanson de Robin et Rainger, enregistrée par Bing Crosby le 16 septembre 1932 avec The Anson Weeks orchestra. Si tel est le cas, c’est une chanson de crooner aux paroles un peu convenues. On y célèbre l’amour et ses suppliques et la manière n’est pas neuve. Ferré a maintenant seize ans, on se situe là exactement dans la période qu’on vient d’évoquer et cela explique qu’adulte, évoquant cette radio qui joue encore dans son esprit, il assimile les deux morceaux. À défaut d’être assuré, c’est parfaitement plausible.
Est-il possible enfin d’imaginer qu’en 1941, le poste aux gros boutons n’ait pas vu se réunir autour de lui la famille Ferré pour écouter la toute première émission de Radio Monte-Carlo, enregistrée dans la salle François-Blanc du Sporting d’Hiver ? Sous les nombreux lustres, un orchestre, un piano droit, un piano à queue, des choristes… Rares ont dû être les Monégasques ne s’intéressant pas à cet événement.
Au bout du compte, ce compte merveilleux de l’enfance et de la jeunesse que le temps tue de ses mains recouvertes de gants d’étrangleur, reste un Ferré de trente ans qui débute en 1946. Ses influences musicales sont acquises. Après celles qu’on a détaillées ici, la musique « classique » est venue. Six ans plus tôt, en effet, l’occupation allemande a fait cesser en France l’arrivée de toute nouvelle musique américaine et Ferré peut alors se donner à sa passion découverte dans l’enfance. Après 1945, Ferré n’est plus l’adolescent qu’il a été et l’aventure de Saint-Germain-des-Prés où l’on a vingt ans n’est pas exactement la sienne. Lui a été marié une première fois le jeudi 2 octobre 1943, il chante maintenant pour tenter de gagner sa vie. Comme il le dit, il serait allé à Montmartre ou à Pantin s’il s’était passé quelque chose à Montmartre ou à Pantin : il va où le public se trouve, il n’est pas réellement dans la mouvance germanopratine. De cette musique qu’il a en lui, il réinvente l’histoire à sa manière : ses tangos, ses javas, ses foxs sont, à la fin des années 40 et au début des années 50, des musiques un peu anciennes déjà. Mais de ces styles musicaux, il fera du Ferré.
Cette étude devra forcément demeurer brève car l’on reste ici dans le domaine du vraisemblable, voire du très vraisemblable, mais, en vérité, peu de choses étant attestées par l’œuvre ou les souvenirs de contemporains, il est extrêmement périlleux d’aller plus avant. Léo Ferré a rapidement évoqué le cinéma de sa jeunesse (Chaplin, Garbo, Danielle Darrieux…), ainsi que l’habillement, la bicyclette et les amours (La Vieille pélerine), et quelques airs. Il serait aisé d’affirmer que, tout jeune, il a entendu et même écouté tel artiste célèbre du moment. Ce serait sans risque – et sans intérêt. Car l’objet de ce texte est de relever ce que le poète a dit lui-même, dans sa création, de ces morceaux d’alors et, par conséquent, ce qu’il en est resté en lui. De toute manière, il est vrai, ces chansons « se tuent à nous dire / Comme à l’école / Des paroles / Qui s’envolent ». [3] Oui, mais, dans les livres, heureusement, scripta manent et le diamant brut des mots brillera en bague, au doigt de la mémoire.
[1]. Léo Ferré, Vous savez qui je suis, maintenant ?, recueil d’interviews de radio et de télévision transcrites et thématisées par Quentin Dupont, La Mémoire et la mer, 2003.
[2]. Ferré 64, 33-tours 30-cm Barclay, 80218.
[3]. Cette chanson.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 14 novembre 2006
Cet air qu’on cherche, 3/4
Le banjo
Introduit en Amérique par les esclaves africains, le banjo est un instrument curieux puisqu’il possède à la fois des cordes et une peau tendue. Malgré cela, on le considère comme de la famille des instruments à cordes. Au style de banjo « classique » dans lequel tous les doigts de la main droite sont utilisés, a succédé, après la Première Guerre mondiale, le style dixieland : plus de cinquième corde et un rôle de rythmique d’accompagnement des cuivres, c’est-à-dire essentiellement des accords, avec utilisation du médiator. Ainsi, en 1925, Copenhagen et Sugar foot stomp par Fletcher Henderson, I’m a little blackbird et Mandy, make up your mind par Louis Armstrong. Après les années 30, survient un jeu à trois doigts, dit style bluegrass. À ces styles s’ajoute celui dit « music hall », mélange de jazz et de musique allemande de cabaret. Kurt Weill en est une illustration. Ces airs ont très certainement influencé Léo Ferré qui, lorsqu’il utilisera le jazz, en appellera au style dixieland et non à un autre (Le Jazz-band) – à l’exception de Dieu est nègre.
Musicalement, la chanson Monsieur mon passé, dont le copyright date de 1955, où l’on entend : « J’ai dans la tête un vieux banjo / De mil neuf cent vingt cinq », montre une influence du style dixieland. L’allusion est claire : « Ce banjo-là donnait le la / De mil neuf cent vingt cinq ». La partition précise en outre : « Tempo di fox (dans le style 1925) ».
On peut légitimement imaginer que se trouve un banjo dans la petite formation d’orchestre qui, traditionnellement, accompagne alors la projection des films muets. C’est certainement ainsi qu’il faut comprendre les vers : « Un vieux banjo qui s’grattait l’dos / En regardant Chaplin ». Léo Ferré a neuf ans et, d’évidence, cela l’impressionne, puisqu’il en parle trente ans plus tard. Cette année 1925 paraît l’avoir marqué ; il en retient en effet non seulement ce banjo de cinéma, mais aussi un guignol et un « je n’sais plus » qui ressemble très fort à une ambiance, un climat, une odeur. Et si les souvenirs sont douloureux, si leur lame, souvent, est davantage celle d’un couteau que celle de la mer, ce n’est pas grave car « Pour pas fair’ d’histoir’ / On chang’ra d’trottoir ». Passez muscade. Surtout, l’année 1925 est pour lui celle où s’ouvrent les portes du pensionnat. Il est inscrit comme interne au collège des Frères des écoles chrétiennes, à Bordighera (Italie), entre Vintimille et San Remo, dans un paysage de palmiers et d’oliviers qui s’étage au flanc des collines sur lesquelles s’appuie l’étroite bande de littoral.
Dans la version enregistrée en studio de la chanson La Zizique – dont le copyright est de 1959 mais qui fut enregistrée en 1958 et chantée à Bobino au début de cette même année – le banjo est présent : on l’entend très nettement à la fin. Cette chanson, déjà citée ici plusieurs fois, marque une étape dans la création musicale de l’artiste, nourri de musique « classique », qui a toujours voulu être compositeur et chef d’orchestre. Sur le plan musical, provisoirement, il paraît délaisser parfois cette « grande » musique. C’est ce que l’on peut comprendre lorsqu’il écrit : « Car au beau milieu du concert / À côté d’un’ valse à Schubert / Un saxo costaud / Le dièse à l’air / Montrait c’ qu’il avait d’ plus cher », puis, plus loin : « J’ai laissé mon Tchaïkowsky / Et patati / Ma quinzaine aussi », et enfin : « J’ai planqué la mer calmée / Et j’ai dansé / Sur cell’ de Trenet » . Cette dernière allusion ne souffre pas de doute puisque cette « mer calmée » est chez Puccini (Un bel di vedremo, au deuxième acte de Madame Butterfly), mort en 1924. On la retrouvera ensuite dans Ta parole : « Des voix qui vont sous la ramée / Ou qui vont sur la mer calmée ». Elle était déjà dans Moi, j’ vois tout en bleu (« J’imagine au fond d’ vos yeux la mer calmée »), fragment de chanson retrouvé et donné dans l’édition posthume des Années Odéon (fragment dont la musique sera reprise, au moins partiellement, dans Cette chanson ; décidément, l’enfance est toujours là). Cet air est, lors des seize ans de Léo Ferré, extrêmement populaire. [1] La façon qu’a Ferré d’ainsi mêler, dans ses paroles, l’évocation de la musique « classique » et celle d’airs plus « légers » était déjà présente dans Le Piano du pauvre (« La chanson guimauve / Toscanini s’en fout », mais aussi « Sonate ou java / Concerto polka », « C’est l’ Chopin du printemps », « Ravel ou machin », « Quand Paderewsky », « S’ tape un air guimauve / En s’ prenant pour Mozart », « Des javas perverses ») depuis 1954. Caussimon, qui le connaît bien, écrit dans Ne chantez pas la mort : « Pauvre valse musette au musée de Saint-Saëns ». C’est la même chose.
Cependant, c’est en référence à sa jeunesse des années 20 et 30 que Ferré évoque cette constante oscillation, ce mouvement de balancier entre le « classique » et la « distraction ». C’est qu’en ces années, il étudie la musique – des échos de cet apprentissage figurent dans Mon piano – et va aussi danser (Le Guinche). Cela paraît fort naturel et, en tout cas, s’explique. Ferré a quitté, en 1933, le collège de Bordighera après huit années d’internat dans un milieu de garçons et une discipline rigide. Il désire s’amuser, connaître des filles : il va au bal. En 1938, il danse à Monaco avec une jeune femme, ravie de ses premiers congés payés : l’histoire a souvent été contée. Son père le surveille encore mais, à Paris, il est plus libre : « Vous venez souvent danser ici, mademoiselle ? C’est bien, hein ? ». [2] « Ici », il y a un accordéon, des chanteuses réalistes, des lustres, une boule de cristal au plafond. Sur les guéridons trônent des siphons d’eau de Seltz, le public est endimanché et les femmes aux lèvres très rouges, aux sourcils interminables redessinés au crayon, toujours chaperonnées, boivent de petits verres de liqueur que leur offre leur cavalier portant casquette. Un accroche-cœur glisse son croissant sur la pâleur de leur peau. Il se souviendra, bien plus tard, de ces moments : « Dans les bals d’avant la guerre », écrira-t-il dans une chanson mélancolique. [3] Puis, en scène, il fera un prologue de ces quelques mots : « Tu te rappelles cette chanson qu’on chantait et qu’on dansait avant la guerre… Elle était de Cole Porter… Night and day…Tu te rappelles cette chanson ? Avant la guerre ! Cole Porter… » [4]
Simultanément, la musique le hante, il prend quelques leçons et étudie seul, beaucoup. Il croise les compositeurs qui viennent à Monaco : cela a déjà été dit de multiples fois. Ce double aspect est le sien, il le conservera sa vie durant. En 1984 encore, il reprend Le Jazz-band au théâtre des Champs-Élysées et danse sur scène.
(À suivre)
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
lundi, 13 novembre 2006
Cet air qu’on cherche, 2/4
À l’âge de dix-sept ans, en 1917, Gerardo Matos Rodriguez écrit la musique de La Cumparsita. Il la vend vingt pesos à l’éditeur Breyer. En 1924 – Léo Ferré a alors huit ans – , Rodriguez se rend à Paris et rencontre Francisco Canaro, qui vient d’arriver en France avec son orchestre. Enrique Maroni et Pascual Contursi écrivent des paroles sur la musique sans avoir l’autorisation de l’auteur. À partir de 1925, le tango La Cumparsita va faire le tour du monde. Il est hautement probable que Léo Ferré ait lui-même dansé un jour sur cette musique. En tout cas, il l’a entendue, puisque personne n’y a échappé.
Dans son disque de 1962,[1] il interprètera, pour saluer l’accordéoniste Jean Cardon, la chanson qu’il lui dédie, Mister Giorgina. Le mot giorgina signifie « accordéon » en argot italien. À travers cet hommage à son ami, il évoque évidemment le célébrissime tango dont il fait quasiment une figure emblématique, obligée. Il forge même un verbe savoureux : « se faire cumparsiter », expression justifiée puisque, c’est bien connu, « On va au bal pour tu sais quoi ».[2] On reparlera plus loin du bal.
Quatre ans auparavant, son ami Caussimon lui avait confié sa chanson Le Temps du tango dont Ferré fit un beau succès. Ces couplets lui rappelaient certainement sa jeunesse. Il est peu douteux en effet que, comme l’auteur des paroles, il ne se soit dit un jour, saisi par le vertige du temps et son intolérable poigne : « Faudrait pouvoir fair’ marche arrière / Comme on l’ fait pour danser l’ tango ».[3] En 1958, Ferré a quarante-deux ans, l’âge où déjà remontent les marées amères sur les plages de la maturité.
(À suivre)
[1]. Léo Ferré, 33-tours 30-cm Barclay, 80185 M.
[2]. Le Guinche.
[3]. Le Temps du tango.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)
dimanche, 12 novembre 2006
Cet air qu’on cherche, 1/4
Un air qui semblait toujours monter de la rue...
(CETTE CHANSON)
Les textes de Léo Ferré contiennent quelques allusions, finalement peu nombreuses, à des musiques, des airs, des chansons qu’il entendit dans son enfance, disons jusqu’à sa majorité. Il pouvait être intéressant de chercher à en savoir davantage. Sur une idée originale de Patrick Dalmasso et à partir d’une documentation musicale nombreuse réunie par ses soins, j’ai effectué cette recherche de probables influences ou, à tout le moins, d’un univers sonore familier. Qu’est-ce que Léo Ferré écoutait ou pouvait entendre, à part les musiciens « classiques » que l’on sait et dont il a souvent été traité ?
Si l’on excepte les bals populaires qu’il imagine avoir précédé sa venue au monde, sa mère enceinte dansant la polka au son du piston de M. Camaro, si l’on excepte encore le mendiant violoniste dont il rêve, jouant lors de la naissance de son oncle Stradi, que demeure-t-il ? Quelles sont les traces et qu’évoquent-elles ?
La chansonL’enfance, chacun sait que « C’est un pays plein de chansons » [1] et chacun conserve les siennes dans l’enclos caché de son cœur, au coin du bois de son passé. Enfances de silence ou de soleil, d’effrois ou de chansons, de petits pas ou de sept lieues, pays de fruits rouges ou d’amertume, fragiles et définitives constructions. Celle de Léo Ferré est bien sûr placée, du moins peut-on le supposer, sous le signe de « Cette chanson / Comme une sœur / Avec ses chanteurs de rue / Et ses histoires / Cette chanson / Comme une fleur / Une fleur fanée perdue / Dans la mémoire ». [2] Oui, les chanteurs de rue existaient quand le petit Ferré découvrait le monde. Ils faisaient chanter les badauds et vendaient des petits-formats. Il y avait parfois un air qui emportait tous les cœurs, bouleversait les esprits et, croyait-on, s’installait à jamais. Croyait-on… « Jamais », « toujours », ce sont des mots d’amoureux. Et pourtant, demande l’homme mûr et nostalgique, un poignard planté dans le rêve : « Où est passée cette chanson / Qui traînait dans tout’s les guitares / Avec ses rime(s) et ses raisons / Qui nous faisaient veiller si tard » ? [3] L’air néanmoins s’est incrusté dans les cerveaux et dans les êtres, il revient aimer, gueuler parfois avec la houle du passé (« Padam padam padam », criait Piaf, écorchée), il revient bien qu’il n’ait « plus que trois notes / À fredonner / Pour parler / Du passé ». [4] Dira-t-on jamais suffisamment cette étourdissante puissance des chansons qui gravent les souvenirs, déterminent la souvenance, vrillent le cœur à l’angle de deux rues, fixent à jamais la jeunesse, tandis que « Sans fair’ de bruit va grisonnant ton beau visage » ? [5] À la maison, avenue Saint-Michel à Monaco – l’enfance va toujours de pair avec la maison, elle est couleurs et senteurs, elle est à elle seule un foyer – on écoute donc cette chanson « Qui remontait du phono / À manivelle » [6] (faut-il imaginer que ce ne soit pas n’importe quel appareil, mais plutôt « Un vieux phono / D’aristo / Un phono d’avant / L’ magnéto »). [7] Qu’était-ce donc que cette chanson ? Si l’on s’en tient à ce qu’écrit Ferré, « Un air accompagnait des paroles émues », [8] cela laisse supposer une romance sentimentale. On ne sait pas de quelle chanson il s’agit, peut-être de plusieurs en fait, peut-être, uniquement, de trois ou quatre mesures retenues par le jeune garçon… Il reste que l’influence fut assez forte pour que le poète évoque ce souvenir dans son microsillon de 1967, [9] à cinquante et un ans, alors qu’il se trouve empreint de « Cette cruelle exhalaison / Qui monte des nuits de l’enfance / Quand on respire à reculons / Une goulée de souvenance ». [10] Léo Ferré découvre la vie sur les bords de la mer qui l’a vu naître. « La Méditerranée est grosse de traditions. L’esprit des collégiens suit les méandres de toutes les histoires qui courent sur ses rives, qui emplissent les manuels en vers ou en prose, raccourci des épopées appropriées à leur âge et le nom de cette mer fabuleuse s’incruste dans leur mémoire martelée par son effet sublime », [11] peut-on lire dans la publication la plus avant-gardiste de l’année de ses huit ans.
Mais encore ? Au-delà de l’accumulation de citations qui ne veulent être, ici, que des indications, que peut-on certifier ou simplement avancer ?
Il est extrêmement vraisemblable que le jeune Ferré, âgé de seize ans, fut frappé par le duo de Jean Villard et Aman Maistre, dits Gilles et Julien, à partir du mois d’avril 1932, date de leur premier spectacle. Ces duettistes maniant l’humour grinçant (Parlez pas d’amour), la poésie et la satire sociale, alternant les œuvres revendicatives (Dollar, Vingt ans) et celles plus « classiques », voire humoristiques, sans réelle discrimination, ces artistes bien accueillis par le public de leur temps, reconnus par la presse communiste et anarchiste comme par les conservateurs, se produisant dans des spectacles progressistes comme dans des casinos, en tournée comme sur les grandes scènes parisiennes, ont certainement de quoi lui plaire, en tout cas de quoi l’intéresser. On remarque, dans le texte de Dollar, une expression qui n’est pas si courante : « On met les vieux pneus en conserve / Et même afin que rien n’ se perde / On fait d’ l’alcool / Avec d’ la… ». Il s’agit bien sûr d’« Afin que rien n’ se perde » qu’on entendra chez Léo Ferré dans Les Étrangers et Un jean’s ou deux… aujourd’hui ! Il ne faut pas exagérer les possibilités d’influence, mais on ne peut pas ne pas formuler cette remarque. Gilles et Julien se produisent à Nice, au Palais de la Méditerranée, le samedi 20 avril 1935, en première partie de la chanteuse Mireille. À cette période de l’année, Ferré est à Monaco. Peut-être les a-t-il vus en scène. En tout cas, il les évoque une fois au moins dans une interview de 1966 : « Avant la guerre il y avait Trenet, Jean Nohain et Mireille, Gilles et Julien et Jean Tranchant – je ne parle pas des faiseurs de romances – c’était tout ». [12]
Dans le livret présentant l’intégralité de sa production enregistrée, [13] Christian Marcadet décrit ainsi le duo : « Gilles : sous un abord débonnaire, un tempérament intègre et résolu, poète sensible et écorché qui dissimulait mal ses émotions, esprit plus philosophe que gestionnaire. (…) Julien : (…) tempérament méridional, séducteur latin avec le sens du panache et de l’abattage, tempérament extraverti et impulsif à la limite de la provocation (…) ». Voilà deux portraits qui rappellent quelqu’un… Qui le rappellent même singulièrement, lorsqu’on poursuit la lecture de cette présentation : « Début 1934, conscients de la contradiction entre leur tenue de soirée et leur répertoire dissident, ils rejettent le frac pour le maillot noir de marins et le pantalon pattes d’éléphant ». Léo Ferré ne s’habillera pas en marin mais abandonnera un jour, lui aussi, le costume qu’il portait, par exemple, à l’Alhambra, pour un habit de velours noir auquel succèderont chemise et pantalon noirs. « Ce costume n’est nullement une provocation : il fait se fondre les artistes sur le rideau noir d’où seuls émergent les visages, les mains, le clavier », poursuit Marcadet. Comme eux encore, Ferré entretiendra toute sa vie des rapports amicaux, mais toujours indépendants, avec le Parti communiste, la Fédération anarchiste, les divers mouvements de gauche, sans nullement y adhérer.
Gilles et Julien se séparent en 1937, lorsque Ferré atteint sa majorité, alors fixée à l’âge de vingt et un ans et qu’il loge à Paris, pension de l’Abbaye, 6, rue Saint-Benoît, un petit immeuble sur cour pavée, au coin de l’impasse des Deux-Anges. Depuis deux ans, il est étudiant, inscrit à la faculté de droit et à l’école libre des sciences politiques, section administrative, 27, rue Saint-Guillaume. Il danse alors au Mikado et se rend au cinéma Gaumont-Palace, le jeudi soir. La même année, débute Trenet qu’il saluera dans La Zizique en évoquant La Mer. Trenet dont il chantera Que reste-t-il de nos amours ? dans une émission de radio, longtemps après. [14] Trenet enfin, qui lui-même citera le nom de Ferré dans Moi, j’aime le music-hall. De lui, Ferré dira : « Les "interprètes" de chansons n’ont même pas eu le temps de se rhabiller. Ils étaient tout nus sur la route, avec Trenet devant, seul, magnifique ». [15]
(À suivre)
[1]. L’Enfance.
[2]. Cette chanson.
[3]. Ibidem.
[4]. Ibidem.
[5]. Ibidem.
[6]. Ibidem.
[7]. La Zizique.
[8]. Cette chanson.
[9]. Léo Ferré, 33-tours 30-cm Barclay, 80350 S.
[10]. Les Chants de la fureur, chant I, Guesclin.
[11]. L’Esprit nouveau, numéro spécial Apollinaire, octobre 1924.
[12]. Candide du 2 au 8 mai 1966.
[13]. Intégrale Gilles et Julien, 1932-1938, double CD Frémeaux et associés, FA 5085.
[14]. Le Tribunal des flagrants délires, France-Inter, 24 décembre 1980.
[15]. Cité in Le Monde du 20 décembre 1988.
07:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (0)