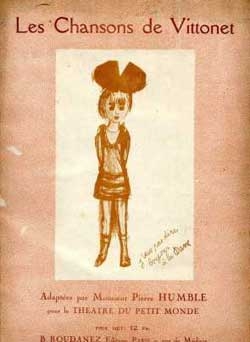vendredi, 14 novembre 2008
Armand Lunel le méconnu... (1892-1977), par Francis Delval
Je remercie une fois de plus Francis Delval pour sa participation érudite et amicale à la vie de ce lieu.
J’avais évoqué dans ma note de juin, Ferré et les philosophes, très brièvement, la figure d’Armand Lunel, en une dizaine de lignes. Je reviens sur ce personnage mal connu qui traversa la vie de Léo Ferré. Cette note sera très différente de mes notes déjà mises sur le blog.
Armand Lunel est né à Aix-en-Provence en 1892, et descend d’une vieille famille de lettrés liés à la communauté juive du Comtat Venaissin, plus précisément de Carpentras. Jacob de Lunel, poète et rabbin, écrivit au XVIIIe La tragédie provençale de la reine Esther, et le grand-père d’Armand Lunel fut un ami très proche de Frédéric Mistral, co-prix Nobel de littérature en 1904.
 Lunel fera ses études au lycée Mignet d’Aix-en-provence, où il se liera d’amitié avec Darius Milhaud, son condisciple, juif également. Cette amitié durera jusqu’à la mort de Milhaud en 1974. Après le baccalauréat, il continue ses études à Paris, notamment en khâgne au lycée Henri IV, où il suit les cours d’Alain. Puis il intègre Normale Sup et passe avec succès l’agrégation de philosophie. Après avoir participé à la Grande guerre, il sera nommé professeur au lycée de Monaco en 1920, poste qu’il occupera jusqu’à la retraite.
Lunel fera ses études au lycée Mignet d’Aix-en-provence, où il se liera d’amitié avec Darius Milhaud, son condisciple, juif également. Cette amitié durera jusqu’à la mort de Milhaud en 1974. Après le baccalauréat, il continue ses études à Paris, notamment en khâgne au lycée Henri IV, où il suit les cours d’Alain. Puis il intègre Normale Sup et passe avec succès l’agrégation de philosophie. Après avoir participé à la Grande guerre, il sera nommé professeur au lycée de Monaco en 1920, poste qu’il occupera jusqu’à la retraite.
Armand Lunel a souvent dit qu’il n’était pas philosophe, mais seulement professeur de philosophie. Il se bornait à traiter le programme et n’a jamais publié de texte philosophique, n’étant pas, ne se voulant pas un « créateur de concepts ». Il consacrera sa plume à d’autres tâches.
Ainsi, il publie un premier roman en 1925, L’Image du cordier (NRF), et la même année offrira un livret d’opéra à D. Milhaud : Esther de Carpentras, début d’une longue collaboration. C’est à cette époque qu’il rencontre Albert Cohen, l’auteur de Solal et de Belle du seigneur, œuvre majeure, un des plus grands romans sur l’amour qu’on puisse lire. Cohen suggère à Lunel d’écrire un autre roman, qui serait entièrement hébraïco-comtadin. Ce sera Nicolo-Peccavi ou l’affaire Dreyfus à Carpentras, qui fut en 1926 le premier roman à inaugurer le prix Renaudot, que l’on venait de créer. Ce roman nous conte à la fois les troubles que causa à Carpentras l’assignation à résidence de Dreyfus, troubles que Lunel vécut enfant, son père s’étant installé dans cette ville, et l’histoire de Nicolo-Peccavi, antisémite notoire, marchand d’habits ecclésiastiques, qui découvrira qu’il est l’arrière petit-fils de juifs convertis au christianisme. Ce livre fut réédité en collection « Folio » en 1976 pour le cinquantenaire du Renaudot. Il fut vite épuisé et non réédité depuis… Pas rentable, Lunel ?
Armand Lunel publiera six romans, des recueils de nouvelles, des essais savants sur les juifs du Languedoc et de Provence, un ouvrage sur le Sénégal. En 1945, il publie un livre appelé Par d’étranges chemins, où il rapporte les scènes atroces dont il fut le témoin en 1940.
Lunel fut aussi librettiste d’opéra. Il écrivit La Chartreuse de Parme pour Henri Sauguet, et bon nombre de livrets pour son très prolifique ami Milhaud : Les malheurs d’Orphée, Maximilien (mal accueilli par la critique), Esther de Carpentras, Barba Garibo, et David, pour le tri-millénaire de Jérusalem… Lucien Rebatet traite cette œuvre de « chromo » dans son Histoire de la musique, mais avec Rebatet, on ne sait jamais si c’est le critique, le wagnérien ou l’antisémite qui juge…
Un ouvrage de jeunesse, écrit vers 1912 ou 1913, fut publié en 2000, Frère gris, une prose poétique aux accents claudéliens, mais qui fait aussi penser aux Nourritures terrestres de Gide, et qui abuse un peu du « ô » vocatif… (Milhaud mit aussi ces deux écrivains en musique).
Armand Lunel ne quitta donc jamais le lycée de Monaco. Rappelé aux armées en 1939 comme interprète, il fut, après la défaite de 1940, atteint par le statut des juifs, mis en place dans la région par les troupes italiennes d’occupation. Les autorités monégasques purent le maintenir un an à son poste en payant elles-mêmes son salaire. Lorsque les Allemands succédèrent aux Italiens en 1943, le Prince Louis II, à la demande de Lunel, prit en charge une trentaine de familles juives… D’où l’attachement de Lunel à la famille Grimaldi.
Armand Lunel est mort à Monte-Carlo en 1977. On dit qu’il fut le dernier locuteur vivant du judéo-provençal, langue qui s’est éteinte avec lui.
Recentrons-nous sur la rencontre Lunel-Ferré.
Le collège de Bordighera n’ayant pas de classe terminale, Léo Ferré rejoindra en octobre 1933 le lycée de Monaco. Il passera donc une année, à raison de neuf heures par semaine, dans la classe de philo d’Armand Lunel. Lunel traite le programme, rien que le programme. Ce n’est pas un professeur charismatique, il ne prétend pas innover en philosophie. Il crée sur d’autres terrains. Léo Ferré, apparemment, s’est passionné pour la philosophie. On le sait, cette année-là, il reçut de ses camarades le surnom de « Philo »…
Plusieurs questions restent sans réponse. Ferré savait-il qui était Lunel ? Qu’il était romancier, librettiste, ami de nombreux musiciens (le Groupe des Six, particulièrement) ? C’est fort probable. Aussi discret puisse être le professeur, les élèves finissent toujours par découvrir ce genre de choses. Si la philosophie a accroché Ferré, le cursus très particulier de Lunel n’y est sans aucun doute pas étranger… Un grand bol d’air, d’intelligence, et de liberté après les années de censure des livres chez les frères…
Autre question sans réponse : Ferré et Lunel se sont-ils revus après 1934 ? Ferré retourne plusieurs mois à Bordighera pour enseigner le français, puis ce sera la fac à Paris, le service militaire, la « drôle de guerre ». Il ne réintègre Monaco qu’en 1940. Mais Monaco n’est pas grand… Il est hautement probable qu’ils se soient rencontrés, au moins croisés. Si Léo Ferré a, comme l’a confié Maurice Angeli, son ami depuis le lycée, aidé des juifs à se cacher, avant de passer en Italie, l’antisémitisme étant peu virulent en Ligurie, ou joué les passeurs, il n’est pas impossible qu’il ait eu des contacts avec Lunel.
Il est de même plausible que Lunel, en tant que président du Pen Club de Monaco, ait assisté aux concerts et spectacles de Ferré dans la principauté (comme la création de La Chanson du mal-aimé, en 1954), et qu’il ait suivi de près sa carrière.
On n’oublie pas ses anciens élèves si facilement… Je parle d’expérience.
Léo Ferré fut en certaines circonstances un homme discret. Il a par exemple dit très peu de choses sur Léonid Sabaniev. Il fallut une recherche serrée de notre ami Jacques Miquel pour savoir qui était exactement ce musicien émigré à Monaco.
Si Ferré n’a jamais parlé de Lunel, cela ne signifie rien. Il faudrait consulter le fonds d’archives Armand Lunel, consultable à la bibliothèque municipale d’Aix-en-Provence, mais c’est un peu loin. Ou les archives Ferré.
La ville d’Aix a tenu à honorer la mémoire d’Armand Lunel, à sa manière : une salle de cinéma porte son nom ! Sic transit gloria mundi...
15:39 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (10)
lundi, 09 juin 2008
Léo Ferré et les philosophes, par Francis Delval
Je remercie Francis Delval de voler à mon secours et de redonner vie à ce lieu que des questions de santé et d’autres travaux m’empêchent en ce moment d’animer – mais ça reviendra.
(Cette note peut être lue comme une suite de la note Léo Ferré lecteur de Sartre. Une troisième note consacrée à Ferré, Stirner et Bakounine verra peut-être le jour, mais le sujet a déjà été traité à plusieurs reprises, en des lieux divers… L’implicite de cette note est aussi le problème de l’abondance des noms propres dans l’œuvre de Léo Ferré).
« car , tout ça, vraiment, l’être, le néant, l’en-soi, le pour-soi... Ta gueule, Philo ! » (in La Queue).
En octobre 1933, Léo Ferré revient à Monaco pour faire sa « classe de philo », le collège de Bordighera n’assurant les cours que jusqu’en première. Il semble s’être tout particulièrement intéressé à la philosophie, au point d’être surnommé « Philo » par ses camarades. Le fait d’avoir eu Armand Lunel comme professeur y fut certainement pour beaucoup, Lunel sur lequel on passe trop vite, voire pas du tout, dans les biographies de Ferré. Passer des « Chers frères » à Lunel est quand même un sacré changement !
Armand Lunel (1892-1977), normalien, agrégé, mais aussi poète et romancier (il fut le premier lauréat du prix Renaudot en 1926 pour son roman Nicolo Peccavi), grand ami de Darius Milhaud pour qui il écrivit quelques livrets, spécialiste de l’histoire et de la langue de la communauté juive du Comtat Venaissin, qui se fit l’ethnologue du pays niçois et fut le dernier locuteur vivant du judéo-provençal, ne put laisser le jeune Ferré indifférent. Lunel n’ayant pas quitté Monaco, qui n’est pas très grand, il est vraisemblable qu’ils se rencontrèrent par la suite...
De l’enseignement de Lunel, Ferré semble avoir particulièrement apprécié les cours de philosophie des sciences. Il y découvrit (bien sûr de façon sommaire, étant donnée la complexité de ces questions) Einstein (« le plus grand des poètes »), la relativité générale, les géométries non- euclidiennes, Lobachevski, Riemann , les espaces courbes…
« Le théorème de Thalès quelle foutaise du moment que je vous dis que tout est courbe Misère » (Benoît Misère, p. 273)… Étant donné le contexte, on attendait le postulat d’Euclide plutôt que le théorème de Thalès !
Le relatif, la parallèle, le courbe, la courbure, etc., feront désormais partie du vocabulaire poétique de Ferré, notamment dans La Mémoire et la mer, par exemple :
Emme C2 EmmeC2
Aime moi donc ta parallèle
Les métaphores reposant sur le courbe et la parallèle sont fort nombreuses, mais elles relèvent de la poésie, jamais de la science. Les mots de la science, des mathématiques deviennent des images récrites au poème.
Notons que le hasard a fait que l’autre grand poète et écrivain anarchiste né à Monaco en 1924, Armand Gatti, heureusement toujours bien vivant et hyperactif, a la même passion que Ferré pour la relativité, les géométries nouvelles, la théorie des quanta, et est à la recherche d’une écriture neuve, d’une écriture quantique, et construit ses pièces de théâtre, poèmes, voire chansons, avec les mots de la science. N’ayant connu que l’école primaire avant de rejoindre le maquis à seize ans, il est , lui, autodidacte.
Ferré et les philosophes... Rentrons dans le vif du sujet. À lire Ferré, on voit bien que pour lui certains philosophes sont des personnages parfois ridicules, de même qu’il y a un ridicule de certaines prétentions de la philosophie dans sa quête de vérité.
Le ton est donné dès la préface de Benoît Misère : « Bossuet vissé à Confucius, siamoisement, Aristote lunettes ouvertes sur la Série Noire, Monsieur Sartre dans un claque avec Bergson à mesurer le poids d’un clitoris tarifé… » Même Sartre, qu’il admire, n’échappe pas aux sarcasmes. Quant à Bergson, dont le public au Collège de France était essentiellement féminin, on l’imagine mal dans la posture où Ferré le met. Nous sommes dans la blague, et on pense à ce que Voltaire disait de Marivaux, qu’« il pesait des œufs de mouche dans des balances de toiles d’araignées »... Les philosophes discutent sur des riens , de Confucius à Sartre (notons que Marx sera un des rares philosophes que Ferré ne critique (presque) jamais…)
Entrons dans l’œuvre de Ferré, où nous rencontrerons Aristote, Kant et Freud. Puis, dans un autre registre, Nietzsche et Bachelard.
a) Aristote.
On trouve dans la brochure de 1969, Mon programme, la reproduction d’une gravure anonyme sur bois du XVIe, reprise en petit format dans Testament phonographe (p. 307). Dans les deux cas, Ferré l’a sous-titrée « Toutes des salopes »... Formule que selon lui répétait un de ses camarades d’études.
On sait que Ferré fut grand amateur de gravures, qu’il admirait Dürer, et on peut penser qu’il a parfaitement identifié le sujet : il s’agit – légende ou fait historique peu importe – d’« Aristote chevauché par la courtisane ». Il sert de monture à Phyllis, marchant à quatre pattes et la portant sur son dos, le mors entre les dents. Phyllis a un fouet dans une main. Il existe au Louvre une gravure sur le même thème, œuvre de Hans Baldung Grien, élève de Dürer. Selon les versions qui ont couru surtout au Moyen-Âge (Le lai d’Aristote était fort répandu), c’est tantôt Hermias, tantôt Alexandre, dont Aristote était le précepteur, qui auraient « prêté » Phyllis à Aristote, à condition qu’il lui serve de monture. D’autres versions disent qu’Aristote voulait montrer à Alexandre le piège dangereux que représentaient les femmes, et qu’il a été pris à son propre stratagème. On trouve souvent cette scène sculptée sur de nombreux porches d’églises et de cathédrales gothiques.
Voilà donc Aristote, initiateur avec Platon de la philosophie occidentale, le philosophe le plus influent du Moyen-Âge, dont les concepts ont façonné le christianisme et l’islam, ici réduit à l’état de bête de somme. Animal à quatre pattes. Un âne. Il est probable que c’est moins Aristote qui intéressait ici Ferré que la possibilité de mettre le sous-titre... En 1969, il a quelques comptes à régler, sur lesquels on ne s’étendra pas.
b) Freud et Kant. Ici associés car il en est question dans le même texte : L’Imaginaire.
Freud : « L’angoisse se parlera avec des paroles nouvelles et venues des magasins surpris, ces magasins PSYCHIAD’HORREUR où s’entassent depuis des lustres le style et la phrase de ces dérivés de l’autrichienne FREUD’SEXY ». Formule pour le moins sibylline. Mais voici la psychanalyse clouée au pilori, et Sigmund Freud curieusement féminisé... À travers cette féminisation insolite, on sent la réticence, voire le refus ferréen des idées freudiennes. Il n’argumente pas, il « féminise » : l’analyse, les rêves, voire l’inconscient, des histoires de « bonnes femmes »... ? Il nous dit quelque part (je n’ai pas retrouvé la source, donc je cite de mémoire) que « l’inconscient a longtemps été confondu avec une maison de tolérance, la Maison Libido ». Et dès la chanson L’Esprit de famille, il épingle le complexe d’Œdipe, nous en avions discuté en ce lieu il y a fort longtemps, à propos de J.-F. Revel qui donnait la chanson de Ferré comme exemple de contresens sur l’Œdipe, alors qu’il s’agit d’une plaisanterie.
Kant : « Les banques échangeront quelques coups d’œil, quelques idées subversives, enfin ! et diront à Emmanuel Kant de se taper une fille au lieu de se masturber, chaque vendredi, au pied du même arbre. Elles lui placeront, s’il le désire, « LA CRITIQUE DE LA RAISON MANDRAGORE »... Quant à la pureté, il pourra toujours aller à son arbre » et déjà, dans un entretien de 1971 (À bout portant) il racontait les vendredis de Kant, avec un regard plus compréhensif : « Il avait besoin d’une communication sexuelle. Et il l’avait trouvée au pied d’un arbre ».
Que penser de cette anecdote ? On a la belle formule « Critique de la raison mandragore »... Quel titre de livre cela ferait ! On retrouve ici l’obsession ferréenne du gibet, du pendu, qui traverse son œuvre de Graine d’ananar à En Angleterre a long time ago, la mandragore, plante aux vertus prétendument aphrodisiaques, était censée naître du sperme des pendus. Machiavel a écrit une comédie fort amusante sur le thème de la séduction par la mandragore.
Qu’en est-il en réalité de cette histoire des vendredis kantiens ? J’ignore où Ferré a trouvé cela, mais rien, à ma connaissance, ne permet d’avérer cette anecdote, ni dans l’œuvre et la pensée de Kant, ni dans les rares textes biographiques. Elle ne figure pas dans le petit livre de Thomas de Quincey, Les Derniers jours d’Emmanuel Kant, ni dans la seule biographie existant de Kant, écrite par Arsenij Goulyga, en 1981, et traduite du russe en français en 1985 seulement. Quincey a compilé quelques souvenirs d’amis du Kant vieillissant, avec son humour habituel, petit livre très juste dont le cinéaste Philippe Colin a tiré en 1993 un excellent téléfilm produit par Arte. La biographie de Goulyga est très savante et complète. Rappelons que Kant a été élevé dans la religion protestante dans son courant le plus austère, le piétisme, qui prônait notamment l’égalité d’humeur en toute circonstance (on en trouve un bon exposé dans le Wilhem Meister de Goethe). Que dans son ouvrage Métaphysique des mœurs (tome 1, doctrine du droit), il condamne toute sexualité hors mariage, notamment la masturbation, et que Kant n’était pas homme à désobéir à ses propres principes. Cela dit, il ne fut pas insensible au beau sexe et envisagea, étant tombé amoureux, le mariage par deux fois. Mais, écrit-il : « Lorsque je pouvais avoir besoin d’une femme, je ne pouvais en nourrir une. Lorsque je pus en nourrir une, je n’en avais plus besoin ». Il eut même, à l’approche de la soixantaine, des propositions d’une jeune femme mariée de vingt-trois ans, insatisfaite, qui lui écrit : « Nous vous attendrons donc et ma montre sera remontée »… Cette étrange formule vient du livre de Sterne, Tristram Shandy. C’est la formule qu’emploie le père Shandy pour dire à sa femme qu’il est l’heure d’aller accomplir son devoir conjugal du dimanche après-midi. Le livre de Sterne fut en 1760 un best-seller européen, et « remonter sa montre » est devenu une formule courante… Kant, apparemment, ne donna pas suite. Si quelqu’un connaît la source des dires de Ferré, l’information sera la bienvenue.
(Pause : signalons pour le fun les livres de Jean-Baptiste Botul, philosophe créateur du botulisme, dont plusieurs textes ont été publiés aux éditions Mille et une nuits : Nietzsche et le démon de midi, Landru précurseur du féminisme et La Vie sexuelle d’Emmanuel Kant… En fait, l’œuvre de Botul est un aimable canular, créé par un collectif de six ou sept personnes dont G. Mordillat, Frédéric Pagès, l’oulipien H. Le Tellier et quelques autres...)
c) Nietzsche et Bachelard.
Il y a chez Ferré plusieurs passages (chansons, poèmes, entretiens) où Nietzsche apparaît. Mais de la même façon que pour le poète-philosophe Dante, dont il cite presque toujours les mêmes vers, toutes les occurrences de Nietzsche se rapportent au même épisode : l’effondrement de Turin. Ceci dès la chanson Les Poètes :
Ils marchent dans l’horreur la tête dans les villes
Et savent s’arrêter pour bénir les chevaux
Le nom de Nietzsche n’apparaissant pas, ce n’était pas évident quand, comme moi, on était encore lycéen, de comprendre l’allusion. L’allusion devient claire avec le poème Le Chemin d’enfer, publié en 1969 dans Mon programme :
Ô Nietzsche agrippé naseaux de Turin
Ce fiacre roulant dans le fantastique
Et la Folie te prenant par la main
J’entends dans la rue une hippomusique
Ô Nietzsche l’entends-tu ? C’est du chagrin
Avec le mors au cœur, c’est une clique…
L’allusion se fait plus précise, sans être explicative pour autant. Il suffit dès lors de chercher la source. Belleret voit une énigme dans l’absence de « aux » entre « agrippé » et « naseaux ». Alors que cette absence renforce l’identification de Nietzsche au cheval battu, et qu’en mettant « aux », Ferré aurait dû renoncer au « Ô » vocatif, très rimbaldien. On retrouve ce poème dans les recueils ultérieurs, l’histoire racontée à P. Wiehn en 1971, reprise dans la plupart de ses récitals à partir de 1983.
Rappelons brièvement les faits : Nietzsche, malade, est en 1888 aux portes de la folie. Il réside alors à Turin. Fin 1888, il n’écrit plus guère, improvisant des heures entières au piano. Le 3 janvier 1889, sortant de sa maison, il voit à la station de fiacre (je cite le Dr Podach, auteur d’un excellent petit livre : L’Effondrement de Nietzsche, Gallimard) : « Une vieille rosse éreintée sur laquelle s’acharne un cocher brutal. La pitié l’envahit... Il se jette au cou de la bête martyrisée. Il s’écroule ». À son réveil, Nietzsche se prend à la fois pour Dionysos et pour le Crucifié. Il a sombré dans la folie, il est désormais de l’autre côté et mènera jusqu’à sa mort en 1900 une vie végétative.
Je ne connais pas d’autre évocation de Nietzsche chez Ferré que cet épisode tragique, et qui semble pour lui fortement symbolique, si nous nous référons à la chanson Les Poètes.
Quant à Bachelard, nous voici dans un contexte très différent. Ferré avait très envie de le rencontrer, de le connaître, il avait même pensé l’inviter à Perdrigal ! Ayant une grande estime pour le philosophe et son œuvre, même si nous ignorons ce qu’il en a lu, il lui envoya un exemplaire de Poète.. vos papiers !, dédicacé. Des destinataires de ces envois rituels, Bachelard fut le seul à répondre, réponse amicale et pleine d’humour. La lettre de Bachelard a été reproduite plusieurs fois, par exemple dans le Belleret. Bachelard réapparaît dans L’Opéra du pauvre, curieusement dans la monologue de la baleine bleue : la baleine connaît le philosophe et sait qu’il préfère rater sa leçon de philo que l’allumage de son poêle le matin. Ici encore, Ferré met en avant l’anecdote, le lieu commun, alors qu’il avait sûrement bien d’autres choses à dire sur Bachelard. On comprend mal que Ferré n’ait pas cherché à le voir. Ferré était-il un timide, bien qu’extraverti ? Bachelard, qui se disait l’ami de tous les vagabonds, qui discutait avec les clochards... Il était d’un abord facile, mais sans doute le Bachelard philosophe, le scientifique, l’impressionnait-il. Bachelard le « liseur » insatiable, vivant au milieu de piles de livres entassés à la diable, l’érudit... Notons que Ferré semble avoir pris la fille de Bachelard, Suzanne, philosophe des sciences, pour la sœur de Gaston... Une rencontre manquée...
Ainsi, Sartre mis à part, qu’il a lu en grande partie, ainsi que Marx, Stirner, Bakounine, Kropotkine, il semblerait que Ferré ait eu une connaissance impressionniste de la philosophie, et qu’il se focalise volontiers sur des détails ou des anecdotes. Mais nous ne savons pas tout sur ses lectures.
Peut-on parler comme on l’a fait de « textes philosophiques » pour certains textes en prose ? Est-ce légitime, est-ce un abus de langage, les extraits du Traité de morale anarchiste que nous connaissons sont trop elliptiques pour porter un jugement. Ses textes dits « théoriques » demeurent d’abord de grands textes de prose poétique, et c’est bien comme cela.
Ferré-Philo, Ferré et la philosophie, il y aurait presque matière à faire un livre.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (89)
vendredi, 04 janvier 2008
Dĕkuji ti, Ferré ! (ou Ferré traduit en tchèque), par Daniel Dalla Guarda
J’accueille aujourd’hui un nouvel « invité du taulier », Daniel Dalla Guarda, qui nous propose un ample travail consacré aux versions tchèques des chansons de Léo Ferré. Je le remercie de s’en être chargé.
Dès 1961-1962, Daniel Dalla Guarda fait montre d’un esprit rebelle : lecteur assidu de Hara-Kiri (mensuel), (télé)spectateur des Raisins verts d’Averty, il se complaît à écouter une musique de voyous, le rock ‘n’ roll, et surtout Vince Taylor. Cela aurait pu durer longtemps, mais 1968 est arrivé, qui lui a grand ouvert les yeux. Avoir eu dix-huit ans dans ces années a été jubilatoire : outre Hara-Kiri hebdo (le vrai), il redécouvre la chanson française et… Léo Ferré : c’est un énorme choc, au Théâtre Montansier de Versailles. Avec un doute : était-ce avant ou après le spectacle de Bobino 1969 ? Presque sexagénaire, informaticien de profession, l’humour et la poésie lui permettent de belles échappées. Ses rencontres avec Léo Ferré ont bouleversé sa vie. Collaborateur du site Thank You Ferré (leo.ferre.org), hélas disparu avec Julien, puis des Cahiers d’Études Léo Ferré, il souhaite partager cette passion.
C’est à la suite de son article « De par le monde », paru dans les Cahiers d’études Léo Ferré n° 4 (Écoute-moi) que j’ai pris contact avec Jacques Layani pour la première fois. À l’époque, je désirais apporter quelques petites précisions à cet article. Depuis, de nombreuses traductions ont été publiées (ou simplement retrouvées). C’est le propos de ces notices que je proposerai sur ce site.
Chaque notice traitera d’un pays, plus précisément d’une langue, et citera l’article de Jacques pour le compléter. J’apporterai également les éléments discographiques dont je pourrai disposer.
Remarques générales : j’emploierai le terme de « traduction » pour les simples traductions (plus ou moins littérales) et le terme « adaptation » quand il s’agit de traductions destinées à être chantées. Ces adaptations pouvant être de simples modifications de contexte (cf. les traductions d’Enrico Médail en italien), mais pouvant être de véritables transpositions comme Die dame, adaptation en hollandais de L’Homme.
Seront également citées comme traductions de chansons de Ferré, les poèmes qu’il a mis en musique (bien sûr, uniquement quand elles ont un lien direct avec Ferré).
Les traductions en langue tchèque
Pour cette première note, je traiterai des traductions en langue tchèque. Pourquoi ? Pour la simple raison que cette langue n’apparaissait que partiellement dans l’article de Jacques. Il y citait un livret qu’il avait feuilleté et qu’il pensait être polonais. Il s’agissait en fait d’un encart publié avec le disque 33-tours de Léo Ferré édité par Supraphon, la maison de disques tchécoslovaque, laquelle avait des liens étroits avec la société Barclay (c’en était une filiale selon Éric Lipmann, ancien directeur financier de Barclay).
Les disques tchèques de Léo Ferré
Une remarque qui concerne tous les disques tchèques présentés dans cette notice : ils ne sont accompagnés d’un livret que s’ils sont co-édités par Supraphon et un club d’auditeurs, à l’image de clubs de lecteurs en France. C’est le cas du seul disque entièrement consacré à Léo Ferré et publié en Tchécoslovaquie et dans les pays dits de l’Est.
Le 33-tours « Léo Ferré »
Ce disque est accompagné d’un livret de vingt-quatre pages contenant les textes français et les traductions en tchèque de toutes les chansons du disque. Il est richement orné de photographies, dont trois en couleurs, représentant Léo Ferré, bien sûr, mais aussi Madeleine, leur fille Annie, Léo et Pépée...
Titre du disque : Léo Ferré.
Coédité par Supraphon et Hudby Gramofonového.
Référence : 0 13 0908 (version mono) ou 1 13 0908 (version stéréo).
Date de la première publication : 1971.
Le livret donne le nom du traducteur en couverture : Jaroslav Mysliveček, qui détient les droits sur tout le livret.
Chansons :
Cannes-la-Braguette : Cannes-la-Braguette.
Nous deux : My dva.
À Saint-Germain-des-Prés : Saint-Germain-des-Prés.
Rotterdam : Rotterdam.
Les Poètes : Básníci.
Les Assis : Sedici.
Si tu t’en vas. Až odejdeš.
Paname : Paname.
Jolie môme : Holka milá.
Tu sors souvent [la mer] : Často vycháziš.
Les Tziganes : Cikáni.
La Marseillaise : Marseillanka.
Les traductions semblent littérales, elles sont bien évidemment destinées à expliquer la chanson au public tchèque, sans visée poétique apparente. Elles sont présentées en vis-à-vis du texte français. Pour Cannes-la-Braguette, le jeu de mot n’est pas indiqué, la traduction donnant tout simplement Cannes-la-Braguette.
Les textes des Assis et Nous deux sont bien attribués à leurs auteurs respectifs.
Les 33-tours collectifs tchèques
Deux autres disques, collectifs, avaient précédé le Léo Ferré cité plus haut. Le public tchèque avait pu découvrir Léo Ferré dès 1962, toujours grâce à Supraphon.
Le 33 tours Sous les toits de Paris.
En 1962 donc, Supraphon-Artia publiaient un disque collectif intitulé Sous les toits de Paris (référence SUA 14 472). Quatre artistes Barclay y sont présentés, Ferré étant le premier par ordre d’apparition :
Léo Ferré : Blues, Elsa, Je chante pour passer le temps, Je t’aime tant.
Charles Aznavour : Plus heureux que moi, L’amour et la guerre, Fraternité.
Lucienne Delyle : Bistrot, Les Bleuets d’azur.
Jacques Brel : Les Biches, Zangra, Une île, Madeleine.
Mais les textes y étant donnés uniquement en français, je n’en parlerai pas plus, sauf à remarquer que pour le premier disque de Ferré édité dans un pays « du bloc soviétique » ou « du bloc de l’Est » comme on les désignait à l’époque, il s’agit de quatre chansons dont le texte est de Louis Aragon.
Les 33 tours Paris, Paris et Pařĭźskŷ šanson.
Le deuxième disque collectif, paru en 1966, est intitulé selon les éditions Paris, Paris ou Pařĭźskŷ šanson. Trois chanteurs (Barclay) y sont présentés : Aznavour et Brel se partagent la première face, Léo Ferré occupe à lui seul toute la deuxième face :
Charles Aznavour : Donne tes seize ans, Au clair de mon âme, Jolies mômes de mon quartier, Trop tard.
Jacques Brel : Les Bourgeois, Jeff, Les Bonbons, Mathilde.
Léo Ferré : T’es chouette, Thank you Satan, Paname, Merde à Vauban, Les poètes, Franco la Muerte.
Ces deux disques ont des pochettes et des labels différents.
L’édition Paris, Paris est publiée par Supraphon-Artia (référence SUA 14 716). Elle était probablement destinée au marché étranger (notamment à l’Allemagne). Les textes des chansons sont donnés en français sans traduction.
Plus intéressante à mes yeux, l’édition Pařĭźskŷ šanson publiée par Supraphon-Gramophonovŷ Klub (référence DVD 10197) est destinée au public tchèque et contient les traductions de toutes les chansons (sans les textes français !). Certaines traductions de chansons de Ferré sont accompagnées de courts commentaires explicatifs. Les traductions sont d’Alena Čapková. Elles semblent plus littéraires que celles de Jaroslav Mysliveček, publiées avec le disque Léo Ferré. Cela apparaît sur les deux chansons communes à ces deux disques (Paname et Les Poètes). De plus, les commentaires sur Vauban, sur le mot « Paname », sur la chanson Les Poètes, montrent un réel souci d’explication. En voici la liste :
T’es chouette : Jsi půvabná.
Thank you Satan : Dĕkuji ti, Satane.
Paname : Paříž.
Les Poètes : Básníci.
Franco la Muerte : Smrt Francovi.
Hana Hegerova et « Maestro tango »
Hana Hegerová est une artiste tchèque (d’origine slovaque, comme il convient de le préciser depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993) qui jouit d’une réelle ferveur du public tchèque. J’ai pu le constater à Prague où les disquaires la connaissent très bien et parlent d’elle comme d’une Piaf tchèque (personnellement, je la rapprocherais plutôt de Juliette Gréco, pour la qualité de ses textes).
Commentaires de Radio Praha : En octobre 2001, Hana Hegerova fête ses 70 ans devant la salle archi-pleine du Théâtre na Vinohradech. Deux ans après, elle récidive avec un concert tenu, cette fois-ci, dans un espace on ne peut plus prestigieux de Prague, au Théâtre national. Pendant deux heures, la salle vibre sous ses fameuses chansons, qui jalonnent une quarantaine d'années de sa trajectoire artistique. Certaines sont empruntées aux célèbres chansonniers français...
Cet été, était annoncé un concert au centre-ville de Prague.
Tous ses disques ont été réédités en CD, qui figurent dans les meilleures ventes. Enfin un DVD est paru récemment.
Le titre qui nous intéresse ici est Maestro tango, publié en 1973 sur l’album Récital 2 par Supraphon-CS Hifi-Klub (référence 1 13 1310 ZB). Il en existe une version, sans livret, éditée par la seule compagnie Supraphon.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il ne s’agit pas d’un enregistrement en public. Il contient des chansons originales et quelques adaptations du répertoire français. En voici le détail :
Face 1 : Penzión na pŕedmĕsti, Tak to na tom svĕtĕ chodi, Svatebni piseń, Maestro tango (Mister Giorgina), Rāmusy blues, Váňa.
Face 2 : Bože můj, já chci zpĕt (Ma jeunesse fout l’camp), Bud’to ty, anebo já (Giroflée girofla), Surabaya Johnny, Rýmováni o životĕ (It Hurts To Say Good Bye, en français : Comment te dire adieu), Rozvod.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’adaptation de Mister Giorgina qui devient Maestro Tango.
L’adaptation est de Pavel Kopta, qui restera son parolier privilégié pendant toute sa carrière.
Le texte en est publié dans le très beau livret qui accompagne le disque original (version CS Hifi-Club). On la trouve également sur Internet, c’est pour cela que je me permets de la citer in extenso :
Maestro tango
Byl jednou jeden kabaret,
vám býlo sotva dvacet let.
Pod rampou hnĕdý klavir stál
a vy jste na nĕj z hecu hrál
svý prvni tango.
Ten večer mĕ jste trochu vztek,
když jedna z mistnich baletek
vás libala
a řikala : Maestro Tango !
A když vás přešla prvni zlost,
tak byl jste každodenni host.
Sál celý na vĕdomi vzal,
Že jste si pseudonym dal :
Maestro Tango
Když uslyšel to direkto,
tak řek vám : To je dobrej fơr !
Dal na plakát :
Dnes bude hrát,
dnes bude hrát,
MAESTRO TANGO !
Nĕkdo se ptal :
Ale co dál ?
Co bude dál ?
To ptal se doma každý den
Pod vrstvou prachu Beethoven.
A Chopinovi šeptal Litz
že neni si tak zcela jist
tim, co je tango.
To nechápal by jaktĕživ,
Že za pár korun, za pár piv,
Jde nĕkdo hrát
a k tomu rád,
a k tomu rád, Maestro Tango !
Proč dennĕ čistit od rána
falešný zuby piána
Nač etudy, nač prstoklad ?
I bez nich dá se přece hrát
vášnivý tango
Ted’ zni to jako špatný žert,
že pomýšlel jste na koncert
a kde a jak
vzit černý frak,
ach, černý frak, Maestro Tango
Nĕkdo se ptal,
co bylo dál ?
co bylo dál...
Když přeletĕlo roků pár,
tak stal se z kabaretu bar.
To tam je hrani za pár piv,
jen zni tam stejnĕ jako dřiv
půlnočni tango.
A nikdo se vám nedivi,
že smutný jste a šedivý
Jak starý snih,
Jak vdovcův smich,
Jak vdovcův smich, Maestro Tango
Když s ūpornosti pijanů
se naklánite k piánu
a hledáte co odvál čas,
tak ozývá se zas a zas
pliživý tango.
Tam dole na dnĕ pamĕti,
v tom zasypaném podsvĕti
je hrstka not.
Ted’ přijde vhod,
ted’ přijde vhod, Maestro Tango !
Tam dole přece nĕco muselo zůstat...
Alespoň trochu hudby...
Byla tak krásná !
Vzpominejte !
Johann Sebastian Bach.
Poznáváte ?
L’interprétation qu’en fait Hana Hegerová est très vivante, et fidèle à celle de Léo Ferré, y compris le final musical, qu’elle laisse se prolonger.
« Muj dik, Hana !» (Merci beaucoup, Hana !)
Pour ceux que cet album intéresserait, il a été pressé en CD en 2006 (référence Supraphon SU 5722-2), avec un booklet réduit, sans le texte.
À défaut, le titre Maestro tango a été repris en CD sur deux compilations :
Všechno nejlepší, double CD Supraphon SU 5726-2 ;
Můj dík, CD Supraphon SU 5633-2 ;
et bien sûr sur l’intégrale Zlata kolekce, coffret de six CD B&M Music BM0047 (paru en 1996).

Adresse URL du site Internet d’Hana Hegerova : http://www.hanahegerova.cz/
Malheureusement, si ce site est riche d’illustrations, il est assez pauvre en informations.
Autres traductions en langue tchèque
Les institutions culturelles.
Le Lycée Français de Prague et Eva Kriz-Lifková.
Eva Kriz-Lifková enseigne la musique au Lycée Français de Prague.
Elle a également publié de nombreux CD dont un consacré à la chanson française :
Eva Kriz-Lifková : Sous les toits de Paris (Pod střechami Paříže). CD PRAG-DATA, 2001 (épuisé).
Eva Kriz-Lifková y interprète Paname (c’est aussi le titre tchèque) dans une adaptation très poétique de Stuka. Pour avoir conversé avec elle, elle pourrait très bien la chanter en français !

Adresse URL du site d’Eva Kriz-Lifková :
http://www.kriz-lifkova.cz/ (site bilingue français-tchèque)
Un grand merci aussi à Eva Kriz-Lifková pour son accueil sympathique !
L’Alliance Française à Prague.
L’Alliance Française organise des spectacles. On peut penser que des traductions figurent dans le programme de ces soirées, comme c’est souvent le cas (voir la notice Traductions en allemand, pour paraître). C’est peut-être le cas de la chanson Y a une étoile, qu’y a chantée Fabiola Toupin en mars 2006.
Les enseignants du Français en Tchécoslovaquie.
Ces enseignants organisent des soirées de chanson française. On y entend quelques chansons de Ferré dont Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, devenue Cožpak takhle lidé žijí dans le programme, apparemment consacré principalement à Édith Piaf (Program koncertu Pod krídly Edith Piaf).
Divers.
Uvod do poetiky.
Je rappellerai la traduction que Jacques Layani citait dans son article : Préface : Uvod do poetiky (traduction en tchèque) de Sergej Machonin publiée dans Litterarni noviny du 6 août 1993.
Sergej Machonin est une personnalité éminente de la vie culturelle tchèque : cinéaste, poète, traducteur et j’en oublie... Cela est significatif de l’importance que la revue accordait à Ferré.
Marta Balejová.
Dans son spectacle Édith & Frank, elle interprète Les Amants de Paris, titre qu’elle ne reprend pas sur son CD. Je n’en sais donc pas plus.
Paris-Canaille.
C’est une des chansons de Léo Ferré les plus reprises. En Tchéquie, elle est interprétée par Duo Canto, duo formé de Tomáš Krejèí et Zuzana Pálenská.
On peut aussi l’entendre par Yves Montand sur un disque 33-tours Supraphon (référence SUA 14846).
Mais sans traduction à ma connaissance.
Conclusion
Si l’on s’en tient aux seules traductions avérées, nous arrivons à un total de quinze titres traduits en tchèque dont deux dans des traductions différentes : deux pour Les Poètes et trois pour Paname.
Dix-huit traductions : c’est énorme pour ce pays finalement pas très grand, surtout si l’on compare avec le nombre très réduit de traductions dans l’ensemble des autres pays de l’Est. Il est vrai qu’il n’y a pas de disques de Ferré pressés dans ces pays à l’exception, donc, de la Tchécoslovaquie.
Il faut en remercier principalement Supraphon et les clubs coéditeurs qui accompagnaient leurs disques de livrets, démarche que l’on ne retrouvera qu’au Japon (ce sera l’objet d’une notice à venir).
Faut-il y voir un des nombreux exemples d’ouverture sur le monde qu’offrait alors la Tchécoslovaquie ? Je le pense.
Bien évidemment, cette notice ne prétend pas à l’exhaustivité : d’avance, un grand merci à ceux qui pourraient m’aider à la compléter.
Hodně štěstí a zdraví v novém (Bonne année et bonne santé).
Fiche synthétique :
| À Saint-Germain-des-Prés | Saint-Germain-des-Prés |
| Cannes-la-Braguette | Cannes-la-Braguette |
| Franco la Muerte | Smrt Francovi |
| Jolie môme | Holka milá |
| La Marseillaise | Marseillanka |
| Mister Giorgina | Maestro tango |
| Nous deux | My dva |
| Paname | Paname |
| Paname (texte différent) | |
| Paříž | |
| Les Poètes | Básníci |
| Básníci (texte différent) | |
| Rotterdam | Rotterdam |
| Si tu t’en vas | Až odejdeš |
| T’es chouette | Jsi půvabná |
| Thank you Satan | Dĕkuji ti, Satane |
| Tu sors souvent [la mer] | Často vycháziš |
| Les Tziganes | Cikáni |
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 18 décembre 2007
Léo Ferré lecteur de Sartre, par Francis Delval
Je remercie une fois encore Francis Delval pour cette nouvelle et riche contribution au fonctionnement de ce lieu.
Cette note se limitera à ce que le titre annonce. On ny trouvera pas de propos sur Saint-Germain-des-Prés ou la mode existentialiste, brocardée par quelques chansons de Ferré, comme Complainte pour Popaul que Belleret a bien expliquée, ou par Stéphane Golmann (Les Prés à Germain, La Petite existentialiste), ou les romans de Vian. De même, on laissera de côté les démêlés avec L’Idiot international, ainsi que la rencontre avec Sartre en 1973, au lancement de Libération. Tout ceci est bien connu, et a été souvent conté. Ce n’est pas davantage une note visant à développer la philosophie sartrienne, qui défie le résumé.
Je prendrai les lectures de Ferré dans l’ordre chronologique de la bibliographie sartrienne (du moins celles dont il a parlé). Puis je m’attarderai sur deux thèmes : la fameuse formule « L’enfer, c’est les autres », que Ferré cite et utilise souvent. Et le problème de l’engagement de l’artiste, de l’écrivain. Nous verrons que Ferré, malgré ses propos souvent critiques envers l’engagement est, au fond, d’accord avec Sartre sur l’essentiel.
Léo Ferré n’a guère d’atomes crochus avec les écrits des philosophes, en général. Il a certes lu Stirner et Bakounine. Il a lu Marx. Nous savons qu’il admirait fort Bachelard, qui lui a écrit après avoir lu Poète... vos papiers !, et il évoquera toujours Bachelard avec ferveur et émotion. Si dans ses textes nous trouvons bon nombre de noms de philosophes (ou de mathématiciens...), il est peu probable qu’il en ait lu beaucoup... Le langage technique des philosophes le rebute. Ayant rencontré Lacan à l’époque où il fréquentait Breton, Ferré le trouve « incompréhensible ». S’étant plongé dans la lecture de L’Être et le néant, Ferré critiquera vertement le discours sartrien qui, pour lui, ne veut pas dire grand-chose, du moins certaines phrases seraient dépourvues de sens !
« Dans L’Être et le néant, je vous demanderai ce que ça veut dire, je n’ai jamais compris, et puis je ne tiens pas à comprendre, il y a, c’est d’une connerie rare, la « transcendance transcendée ». Et vas-y... » [1], et en 1980, dans Apostrophes : « L’Être et le néant, hein, c’est vrai, non, il faut être raisonnable. Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est une chose qui m’inquiète ».
Cette allergie déclarée à la langue philosophique devrait mettre en garde ceux qui veulent à tout prix faire de Ferré un penseur, un philosophe. Le concept n’est pas son domaine de prédilection. À la décharge de Ferré, il faut reconnaître que L’Être et le néant est un ouvrage difficile, avec peu de références explicites, qui s’appuie sur Descartes, Hegel, Husserl ou Heidegger sans toujours les nommer ou les citer. Sartre fait confiance au lecteur. Ce n’est pas un livre de débutant, bien que ce fut souvent celui-là que les étudiants lisaient d’abord dans les années 50-60, notoriété de Sartre oblige. On peut conjecturer que Ferré ne lira pas les livres philosophiques qui suivront, Critique de la raison dialectique, par exemple, plus difficile d’accès que le précédent.
Mais en 1969, Léo Ferré dit à Michel Lancelot : « Sartre, il restera, c’est le plus intelligent. Il est d’une intelligence foudroyante, c’est le type qui a tout trouvé, qui a trouvé l’homme d’aujourd’hui », à la suite de quoi il évoque ses lectures : « Le premier livre de Sartre que j’ai lu, c’était Le Mur... J’ai lu La Nausée après, et puis tout le reste... Je le lis souvent, je le lis toujours. C’est un grand mec ».
Qu’entendre par « tout le reste », si nous laissons de côté les sommes philosophiques par principe de précaution ? Vraisemblablement les autres romans, le théâtre, les volumes de Situations, etc. Mais Ferré ne cite nommément que le Baudelaire et Saint-Genet, comédien et martyr. Des approches biographiques. Probablement aussi Les Mots. Quant à L’Idiot de la famille, ce livre-monstre de trois mille pages sur Flaubert, il est peu probable que Ferré l’ai lu, en raison de ses très nombreuses occupations dans les années 70.
Nous ne pouvons parler ici que de ce qui est certain, ce sur quoi Ferré s’est exprimé : le Baudelaire, le Genet, le théâtre (du moins Huis-clos), certains textes sur l’engagement, nombreux chez Sartre. Ferré, à l’évidence, en a lu, mais difficile de les identifier. Et la précision na jamais été son point fort, il n’a ni la mémoire des noms, ni celle des titres ou des dates... !
Avançons donc avec prudence.
Sartre, on l’a souvent fait remarquer, s’intéressait peu à la poésie. Encore qu’il fut un des premiers à montrer l’importance et la nouveauté de l’œuvre de Ponge (Situations, 1).Dans sa conférence de 1946, à l’Unesco, La Responsabilité de l’écrivain, Sartre distingue le poète et le prosateur : « Le prosateur utilise les mots pour nommer », donc pour constituer des significations, des idées, le poète, lui, « utilise les mots dune autre manière… Ils sont des objets dont l’assemblage produit certains effets, comme des couleurs sur une toile en produisent ». Pour Sartre, dès lors, on ne peut demander à un poète de s’engager « en tant que tel » dans une lutte sociale. S’il ne le fait pas, on ne peut le lui reprocher qu’en tant qu’homme.
Et pourtant, Sartre consacrera plusieurs ouvrages à des poètes, des approches « biographiques » d’un type nouveau. À Baudelaire, à Genet, à Mallarmé (inachevé), même à Leconte de Lisle (plus de cent pages dans le tome III de L’Idiot de la famille), et aussi à des peintres (Le Tintoret, également inachevé).
Avec les poètes, Sartre est dans le même projet qu’il tentera vis-à-vis de lui-même dans Les Mots : comprendre, expliquer, le devenir-poète, le devenir-écrivain. Par quelle alchimie personnelle, sociale, langagière, tel ou tel enfant devient l’homme (ou la femme) qui écrit, qui se construit en construisant une œuvre singulière ?
Ferré a lu le Baudelaire, paru en 1947. Il raconte : « Un jour, j’ai lu un livre de Sartre sur Baudelaire, avec certaines vérités bien sûr, mais très méchant. C’était très méchant, et il m’a convaincu un moment. Un moment, je ne pouvais plus le voir, Baudelaire. Je n’aime pas que Sartre ait parlé comme ça d’un tel poète » [2] ... et aussi : « Avec Baudelaire, je suis passionné et passionnément critique ». Contrairement à son rapport à Verlaine ou Rimbaud, Ferré gardait donc toujours un regard critique sur Baudelaire.
Sartre, dans son livre, ne parle que de l’enfant et de l’homme Baudelaire, mettant le poète entre parenthèses. On a souvent donné comme raison de ce choix la similitude de situation familiale : Sartre, comme Baudelaire, est orphelin de père, et a un beau-père qu’il détestera toujours. Mais cette similitude de situation n’explique en rien les thèses du livre.
Pour Sartre, Baudelaire, c’est l’homme qui a choisi de se voir comme s’il était un autre. Pour Sartre, sa vie n’est que l’histoire de cet échec. Et il tentera de faire revivre « de l’intérieur » ce choix d’être le poète maudit, d’être l’Héautontimorouménos, le bourreau de lui-même. Du choix du dandysme à la façon de Barbey d’Aurevilly, à la mise en avant, par provocation, des idées réactionnaires de Joseph de Maistre (mais Baudelaire sera sur les barricades en 1848), de la fréquentation des prostituées les plus viles, jusqu’à la déchéance et la maladie, Baudelaire est dans un long processus d’auto-destruction. Les Fleurs du mal ? ... « Le succès bizarre de mon livre et les haines qu’il a soulevées m’ont intéressé un peu de temps, et puis après cela, je suis retombé ».
Tout ce qu’il écrit est à distance, l’intérêt qu’il y prend est mince. Comme un exercice parnassien, sans plus. Il se sent davantage porté par son identification quasi-mystique à l’œuvre de Poe qu’il traduit. Sartre relève par ailleurs, et c’était déjà la thèse de Walter Benjamin, que pour Baudelaire, la poésie est moins dans les mots que dans la ville, et d’abord Paris. « Fards, parures, vêtements, lumières, manifestent à ses yeux la véritable grandeur de l’homme, son pouvoir de créer » [3].
Baudelaire, ce poète qui se détourne de la magie des mots, psychasthénique de surcroît, cette vie à vau-l’eau qu’il aurait choisi délibérément, ce poète, tel que Sartre comprend son « plan de vie », ne pouvait être accepté par Ferré. Il y voit d’abord quelques vérités, et délaissera Baudelaire quelques temps , s’en détournera, mais finira par y revenir par un biais inattendu, confiant à F. Travelet [4] : « C’est Sartre qui a des problèmes avec Baudelaire, pas moi ». Après le « rejet » passager, Ferré reviendra à Baudelaire en le mettant en musique et en l’enregistrant en 1957.
Le Baudelaire de Sartre est dédié à Jean Genet. Sartre, à qui Gallimard demande une préface pour les œuvres de Genet, en écrira comme on sait une très longue qui occupera tout le tome I des œuvres de Genet (578 p.).
Ferré le lit avec enthousiasme. « Pour moi, son chef-d’œuvre. C’est un livre extraordinaire. Au fond un grand livre sur la morale, qu’il appelle Saint-Genet, poète et martyr. C’est fabuleux, fabuleux. Il faut lire ce livre » [5].
Pourquoi cet emballement alors que par ailleurs il semble a priori apprécier peu l’œuvre de Genet si l’on en croit quelques vers de Ferré bien connus... Là non plus, Ferré ne s’explique pas.
La démarche de Sartre est proche de celle utilisée avec Baudelaire. Comprendre, à partir de l’enfance de Genet, enfant abandonné, placé en nourrice dans le Morvan, bien élevé, enfant de chœur, qui choisit la voie de la délinquance dès treize ans : ce sera Mettray, le bagne d’enfants, puis plus tard la prison pour vol (Genet ne volait que des livres, mais la récidive pouvait conduire à la perpétuité !), le choix de l’homosexualité, mais aussi celui de l’écriture, romans et poèmes (on a souvent relevé la parenté du vers de Genet et du vers baudelairien). Pourquoi parler de livre de morale ? Sans doute par cette oscillation perpétuelle entre la tentation du bien et le mal... Livre contemporain de Le Diable et le bon Dieu qui traite aussi de ce choix.
Ferré commet un lapsus qui ne manque pas d’intérêt : il commet une erreur sur le titre. Il dit « poète et martyr », au lieu de « comédien ». Or, dans le titre de Sartre, « comédien » est le mot essentiel. En effet, Sartre se réfère à la pièce éponyme de Jean Rotrou, tragédie (excellente d’ailleurs) écrite en 1646, mettant en scène le comédien romain Genest, jouant devant l’empereur Dioclétien Le Martyr de saint-Adrien. Et jouant Adrien, Genest entend l’appel de Dieu, se convertit au christianisme, et accède au martyr. Le comédien Genest s’est identifié au rôle qu’il interprète, mais, tourniquet sartrien, l’acteur qui joue le rôle de Genest, lui, ne se convertit pas, il joue le rôle d’un converti : il y a l’acteur, le rôle de Genest, et Genest s’identifiant à Adrien. Jean Genet, selon Sartre, joue de tous les registres à la fois. On ne sait jamais quelle place il occupe. Enfant sage ? Voleur ? Homosexuel ? Écrivain ? Plus tard militant politique... Cet enfant en constant déplacement, on ne sait où l’attendre. La maestria dont Sartre fait preuve rend ce livre difficile passionnant à lire. Et Ferré a été conquis.
Si le Baudelaire éloignera Ferré du poète quelque temps, Genet, après avoir lu Sartre, ne pourra (ou ne voudra) plus écrire de romans, et sera plongé dans une sévère dépression. La littérature est aussi un métier à risque quand un Sartre la démonte. Ferré, n’ayant pas à Genet le même rapport qu’à Baudelaire, a fait à l’évidence une lecture déprise d’affect et apprécié ce livre superbement écrit.
« L’enfer, c’est les autres »
Ferré cite souvent cette formule, par exemple dans les entretiens de 1969 avec M. Lancelot : « L’enfer, c’est les autres, admirable, c’est toute la clef de Sartre » et, dans la préface au roman de M. Frot, Le Roi des rats, il écrit : « L’enfer, c’est les autres, dit Sartre. L’enfer de Frot, c’est lui-même parce qu’il est un Autre. La conclusion de Sartre, mise à jour après la « confrontation », se réduit à un soliloque désespéré, une façon de poursuivre sa tâche malgré les Autres et dans les Autres, alors que le sentiment d’altérité ne trouve son objet qu’en soi, dans sa propre géhenne ». Il ne s’agit pas, concernant Frot, du « Je est un autre » rimbaldien, du « Je nié », où, nous dit Ferré, il y a tout Rimbaud. Ce « Je » distancié, dissocié, dont l’inconscient occupera la faille. Mais plutôt du « Soi-même comme un autre » [6]... Cette objectivation de soi, vu en extériorité, ce regard porté sur soi comme s’il était étranger (soit une transcendance transcendée ! - sic).
Ferré est donc ici au plus proche de Sartre. Si nous nous référons aux critiques, Huis-clos a donné lieu à pas mal de malentendus, que Sartre a dû balayer à de nombreuses reprises.
« L’enfer, c’est les autres a toujours été mal compris, dit Sartre. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres sont toujours empoisonnés... Or, c’est tout autre chose que je veux dire : si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, ALORS, l’autre ne peut être que l’enfer » [7].
Et Sartre nous rappelle que les trois enfermés sont des morts, des consciences mortes, et donc ne peuvent modifier leur destin. « Mort » fonctionne aussi ici de façon symbolique : être mort, c’est « être encroûtés dans une série d’habitudes, de coutumes, qu’on ne cherche même pas à changer… Nous sommes vivants… J’ai voulu montrer par l’absurde l’importance de la liberté... Quelque soit le cercle d’enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c’est encore librement qu’ils y restent, de sorte qu’ils se mettent librement en enfer ». On voit bien ici la proximité de pensée de Sartre et de Ferré. On pourrait évoquer de nombreux passages de Ferré qui sont un rappel de la liberté, un appel à se libérer, à briser le cercle d’enfer des habitudes et des coutumes... Ne serait-ce qu’Il n’y a plus rien.
L’engagement
« Vous savez, moi, je l’ai dit un jour à Sartre : « L’engagement, ça n’existe pas », et il a dit : « Un type qui écrit ne peut plus écrire s’il voit des gens qui meurent de faim »... C’est des mots, tout ça, pourtant Dieu sait si je parle de Sartre et Dieu sait si j’ai une admiration pour ce type. Mais vous savez, l’engagement... l’artiste doit être vraiment très, très, très indépendant » [8] et Ferré dira aussi : « Moi, je ne suis pas engagé, je suis comme je suis ».
Françoise Travelet, à juste titre, reconnaît que Ferré ne nie pas que l’écrivain, l’artiste, comme tout homme, se trouve engagé malgré lui, est en situation d’engagement, qu’il le veuille ou non. Mais Ferré ne parle au nom de personne, ni à la place de personne : « Il n’exprime que sa propre pensée et ses propres choix » [9].
Alors, l’artiste ou l’écrivain ne seraient investis d’aucune responsabilité particulière. Est-ce éloigné de ce que dit Sartre ? Toute liberté étant en situation, jetée au monde, l’engagement n’est que la conséquence logique de cet être-en-situation.
Écoutons Simone de Beauvoir : « Nous sommes donc jetés libres et en situation dans le monde un peu comme Pascal disait : « Nous sommes embarqués »... L’existentialisme dit : « Nous sommes engagés ». C’est avant tout un état de fait ». Ainsi, condamnés à la liberté, nous le sommes aussi à l’engagement : je suis toujours-déjà engagé. Sartre n’a jamais confondu engagement et politisation, ou adhésion à un parti. L’artiste retiré dans sa tour d’ivoire, qui ignore ou méprise le monde comme il va est tout aussi engagé que le militant de base ! Encore faut-il que les conditions matérielles existent afin que chacun puisse choisir sa vie. C’est le cœur du problème : on ne fait pas ce qu’on veut, mais on est en même temps toujours responsable de ce qu’on est ou de ce qu’on a fait de nous.
Pour Sartre, l’écrivain, l’artiste ont donc une mission particulière, car en tant que tels, ils parlent aux autres, écrivent pour les autres. Parler aux autres, oui, mais jamais à leur place ; faire en sorte que chacun, chacune soit porteur dune parole singulière. Penser avec sa propre tête, disait le vieux Kant. Et sur ces points, Sartre et Ferré me semblent d’accord sur l’essentiel : ils laissent les gens libres...
La Cérémonie des adieux
Sartre meurt le 15 avril 1980. Son enterrement sera suivi par une foule immense : soixante mille à cent mille personnes… ? On parle du « peuple de Sartre », de « manif contre la mort de Sartre », de « dernière manif de 1968 ».
Sartre ayant refusé d’être inhumé auprès de son beau-père, il sera enterré dans un coin tranquille, non loin de la tombe d’un certain Charles Baudelaire...
1981 : Simone de Beauvoir publie le dernier volume de ses mémoires, livre dédié « À ceux qui ont aimé Sartre, qui l’aiment et l’aimeront »... La Cérémonie des adieux est le récit des dix dernières années de son compagnonnage avec Sartre. Quoique respectant comme toujours dans ses « mémoires » l’intimité de certaines personnes (allant souvent jusqu’à changer les noms), elle ne cache rien de la maladie de Sartre, de sa déchéance physique progressive, de sa souffrance et de sa mort. Ce livre est un grand livre, d’une intense émotion et d’une grande beauté, un acte d’amour qui est un des chefs-d’œuvre de la fin du XXe siècle. Il est complété par de longs entretiens inédits avec Sartre.
Léo Ferré le lira. Et il réagira très violemment : « Simone de Beauvoir, qui a écrit ce livre abominable : La Cérémonie des adieux... Dégueulasse... » (propos rapporté par R. Kudelka).
Certes, Ferré semble n’avoir jamais eu de grande sympathie pour S. de Beauvoir : il parle de « Sartre et sa copinoscope » (sic), de « Sartre et sa bonne femme » ou de « sa femme de jour »... Encore que ces expressions soient courantes chez lui. Ainsi, il écrivit à Sartre pour qu’il demande à Beauvoir de faire cesser les agressions dont il est l’objet de la part de « troupes » rangées derrière L’Idiot international, dont elle a pris symboliquement la direction, comme Sartre celle de La Cause du peuple. Pourquoi écrire à Sartre ? « Je préfère écrire aux bonhommes qu’aux bonnes femmes ». Ce sont donc des tournures de son langage familier, mais qui sont néanmoins péjoratives, et manquent d’élégance.
Donc, Ferré a détesté le livre. Connaissant son caractère, on peut comprendre sa réaction. Ferré, comme la plupart des poètes, a souvent chanté la mort. La mort, c’est abstrait dans le poème. De la maladie, de la souffrance, il ne parlait jamais. De sa maladie, personne n’en a rien su, ou presque. Cela relevait de son privé, ne concernait pas l’homme public. Ferré était au fond très pudique, et d’une sensibilité exacerbée, lui qui, nous dit F. Travelet, « pleurait en lisant le journal et vomissait à la moindre contrariété… » Il ne pouvait trouver ce livre qu’abominable...
Léo Ferré est passé complètement à côté de La Cérémonie des adieux. Ce livre superbe qu’il faut lire absolument si ce n’est déjà fait.
On voit donc, au travers de ces quelques lignes, que la lecture de Sartre a longtemps accompagné Ferré, même s’il a fait des impasses et des rejets du côté de la philosophie. Sur la longue durée, Sartre influença sans doute davantage Ferré que l’amitié intense mais éphémère avec Breton.
Au Panthéon de Ferré, deux philosophes occupent les places d’honneur : Sartre, toujours sur la brèche de l’écriture, de l’aventure, du voyage. Et Bachelard, le sage faisant son marché place Maubert et tisonnant son poêle... Un Bachelard d’Épinal... Mais Ferré et Bachelard, c’est une autre histoire.
_____________________________
[1]. Voir C. Frigara, p. 70.
[2]. Voir Q. Dupont, p. 352.
[3]. Baudelaire, collection « Idées », p. 52.
[4]. Voir Dis donc, Ferré…de F. Travelet.
[5]. Voir Q. Dupont, p. 353.
[6]. Soi-même comme un autre, livre de Paul Ricœur, Seuil, 1990.
[7]. Enregistrement de Sartre en préface à la captation de Huis-clos (Deutsche G.G).
[8]. Entretien à Europe 1.
[9]. Voir Dis donc, Ferré…de F. Travelet.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (39)
mardi, 30 octobre 2007
« Cent vingt-et-un moins moi » (Léo Ferré, Mon programme, 1969), par Francis Delval
Je remercie Francis Delval qui a bien voulu descendre une nouvelle fois dans l’arène avec un sujet important : il nous propose un texte sur Léo Ferré, la guerre d’Algérie et le célèbre Manifeste des 121.
Été 1960. Léo Ferré reçoit la visite d’Aube, la fille d’André Breton. Elle lui apporte un texte, un manifeste défendant le droit à l’insoumission des militaires en Algérie, texte qui sera connu sous le nom de Manifeste des 121, lui demandant s’il accepte de signer ce texte. Léo Ferré refuse. Les historiens Hamon et Rotman [1] auront une formule lapidaire et sans appel : « L’anar Léo Ferré se défile ».
Cette note a pour but d’essayer de comprendre le sens du refus de Ferré de figurer parmi les signataires : ils seront 121, puis très vite, 140, 180, 220 et plus…
Que penser, avec le recul, des arguments que Ferré avance pour ne pas signer ? C’était son droit, nul n’est tenu à s’engager s’il ne le désire pas... Cette décision a-t-elle modifié, infléchi son rapport en tant qu’artiste à la politique, ou est-ce une péripétie sans conséquence relevant de l’anecdote ? Nous devrons aussi tenter de comprendre certains propos tenus sur les signataires et qui, même avec le recul et le regard froid sont totalement inacceptables ; d’autant plus qu’en 1987, dans un échange avec L.- J. Calvet, il les reprendra sans changer un iota, vingt-sept ans après…
1) Chronologie abrégée de l’année 1960
- 5 janvier : Le Monde publie le rapport de la Croix-Rouge sur la torture en Algérie.
- 20 février : début des arrestations dans le réseau mis en place par le philosophe Francis Jeanson, réseau des « porteurs de valises », ces Français qui aident le FLN en transportant armes ou argent.
- 15 avril : conférence de presse clandestine de Jeanson à Paris.
- 25 avril : arrestation de Georges Arnaud. Publication du livre Le Déserteur de Maurienne, pseudo de l’instituteur et officier déserteur Jean-Louis Hurst.
- 10 mai : arrestation de Laurence Bataille, fille de Georges et belle-fille de Lacan.
- 17 juin : procès de Georges Arnaud [2].
- 29 juin : S. de Beauvoir et G. Halimi révèlent « l’affaire Djamila Boupacha », jeune Algérienne torturée et violée par les paras.
- 5 septembre : ouverture du procès du réseau Jeanson, sans Jeanson qui n’a pu être arrêté.
- 6 septembre : publication dans le magazine Vérité-liberté d’un manifeste, signé de 121 intellectuels. Les journaux sont saisis dans la nuit.
- 3 octobre : manifestation de la droite. Le slogan le plus courant est : « Fusillez Sartre ».
- 9 octobre : manifeste de deux-cents intellectuels de droite pour la défense de « l’Algérie française ».
- 27 octobre : meeting FEN-UNE, et pétition pour la paix en Algérie.
2) Qu’est-ce que le Manifeste dit « des 121 » ?
Face à la répression et aux vagues d’arrestation dans le réseau des porteurs de valises, et envers les déserteurs, face à la banalisation de la torture, quelques intellectuels liés aux éditions Gallimard décident d’agir à leur manière. Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Claude Lanzmann lancent un large appel aux intellectuels pour défendre le « droit à l’insoumission ». Blanchot rédige le texte, revu par Mascolo. Le texte n’appelle nullement à l’insoumission : il la défend comme un « droit ». Droit relevant de la conscience de chacun face aux exactions de l’armée. Le texte de trois pages demande donc de respecter le droit de chacun à aider s’il le désire le peuple algérien, et ainsi de contribuer à en finir enfin avec le système colonial.
Le texte est suivi de 121 signatures, qui dépasseront très vite les 220 et plus… Écrivains et philosophes en nombre (Sartre, Beauvoir, Leiris, Breton, Limbour, Tzara, Guy Debord, presque tout le nouveau roman, Butor, Simon, Sarraute, Duras, Robbe-Grillet, Schwarzbart, J.-L. Bory…), peintres (Pignon, Lapoujade, Reyberolle), musiciens (Boulez, Leibovitz), historiens (Vernant, Vidal-Naquet), cinéastes (Truffaut, Resnais), un grand nombre d’acteurs (Terzieff, Cuny, Roger Blin, S. Signoret). Parmi les amis de Ferré, on retrouvera Ch. Estienne, M. Joyeux et Catherine Sauvage, la seule artiste du monde de la variété à avoir signé !
Très vite, les sanctions tombent : universitaires radiés ou suspendus, spectacles arrêtés pour cause d’interdiction de travail frappant les acteurs, interdits de scènes ou de plateaux (Terzieff sera plusieurs années sans pouvoir travailler), C. Sauvage interdite d’antenne pendant deux ans, d’autres seront agressés, matraqués, plus tard l’appartement de Sartre sera plastiqué par l’OAS, en représailles.
De plus, depuis le 6, la provocation à l’insoumission peut être punie de trois ans de prison ! Face à cette pluie de sanctions, de nombreux intellectuels progressistes étrangers se solidariseront avec les « 121 et plus » : Fellini, Moravia, Sean O’Casey, Heinrich Böll, N. Mailer… Il y aura un « manifeste de soutien » des intellectuels américains.
3) Le contre-manifeste et la pétition FEN-UNEF
Le 3 octobre, les « patriotes » descendent dans la rue ; les vitres de L’Express explosent. L’association des écrivains combattants, dont Aragon vient de démissionner, est au premier rang. Un contre-manifeste sort le 9 dans Carrefour, signé de plus de deux-cents intellectuels de droite, unis derrière le maréchal Juin : Dorgelès, Jules Romains, M. de Saint-Pierre et tous les hussards, Déon, Blondin, Nimier, J. Laurent, groupés autour de Fraigneau...
27 octobre : meeting de la FEN et nouvelle pétition, avec le mot d’ordre « Paix en Algérie », manifeste moins connu où l’on retrouve les signatures des intellectuels que les historiens accusent ordinairement de ne pas avoir signé le 6 : E. Morin, C. Lefort, Merleau-Ponty mais aussi Barthes, Étiemble, Escarpit, Prévert, Jean Rouch, etc. Pétition dont François Maspéro dira qu’elle n’a servi qu’à apaiser les consciences de ceux qui avaient refusé de soutenir le droit à l’insoumission... Session de rattrapage, en quelque sorte...
4) Léo Ferré et le Manifeste
Et l’Algérie est-c’que tu crois que je la porte
Autrement qu’à Sakiet sur un tombeau sans risque
(Écoute-moi, version 1962) [3]
Quelles positions sont les siennes ? Pourquoi ce refus de signer ? Comment comprendre les propos qu’il a tenus ?
Il faut repartir de la lettre de ses dires, notamment des extraits d’entretiens compilés par Q. Dupont dans Vous savez qui je suis, maintenant ?, La Mémoire et la mer, 2003, et de quelques autres sources.
Comme la plupart des Français, il se dit « concerné », il suit les événements de près. Quant au Manifeste, il en trouve l’idée « généreuse », mais pour lui signer ne suffit pas : qui est d’accord pour aider le FLN doit aller sur le terrain, et il salue et respecte le travail de Jeanson et des porteurs de valises. Il est, quant au fond, en accord avec Malraux disant à sa fille Florence, signataire : « Va te faire tuer dans les djebels, mais ne pétitionne jamais ».
C’est le premier argument : si je suis convaincu, alors je vais sur le terrain.
Deuxième argument : « Je fais un métier public »… et je sais bien que si je signe, je ne pourrai plus faire mon métier de chanteur ; plus de radio, plus de télé, Ferré chanteur, ce sera terminé. Je veux continuer, donc je ne signe pas.
Troisième argument : « Une pétition d’intellectuels, c’est prétentieux, on signe parce qu’on a un nom connu » et, dit-il, il aurait fallu « trois millions de signatures, il fallait faire signer les ouvriers de chez Renault ». On peut parler ici d’un aveuglement de Ferré ; outre qu’une pétition de ce type n’eût pas été discrète, Renault est encore une citadelle du PCF et de la CGT. Or, la politique anticoloniale du PC n’est plus celle d’avant-guerre. Le PC est plus nationaliste : participation de nombreux FTP au massacre de Sétif en 1945 (cinquante mille Algériens nationalistes tirés à vue, car assimilés aux fascistes), soutien à la répression de la rébellion malgache de 1947, vote en 1956 des « pouvoirs spéciaux » au gouvernement Mollet... Sa politique anti-coloniale est loin derrière… De plus, de nombreux militants ont quitté le Parti après l’invasion de la Hongrie. Il n’y aura que neuf membres du PC à signer le Manifeste…
Jusqu’ici, rien de bien convaincant dans l’argumentaire de Ferré. Le plus irrecevable est le propos tenu à maintes reprises, encore en 1987 avec L.-J. Calvet : « Les signataires étaient des planqués, dans leurs bureaux, leurs cafés, ils ne risquaient rien ». Or, il ne pouvait ignorer que la plupart l’avaient payé très cher, et ce n’est pas très sympa pour ses amis Ch. Estienne, M. Joyeux ou C. Sauvage !
Calvet suggère dans son livre « expéditif » de 2003 que « Madeleine lui a fortement recommandé de ne pas signer pour ne pas nuire à sa carrière ». Ce qui, en soi, n’est pas un argument : était-il tenu en laisse ? Si l’influence de Madeleine est plus que probable, il pouvait passer outre… Il avait son libre-arbitre [4].
Cela dit,on peut penser qu’il y a eu, au-delà de cette mauvaise foi du discours maintes fois ressassé, une prise de conscience de Léo Ferré. Il ne signe pas, mais il saute le pas d’une autre manière : il va s’engager davantage en tant qu’artiste et prendre parti tout en faisant son métier,mais autrement.
Ferré a chanté dans les années 50 des chansons satiriques, sociales, mais la politique est peu présente : Mon Général n’est pas très agressif, Monsieur Tout-Blanc très allusif, La Vie moderne amusante… Le registre va changer à partir de 1961. Ses chansons prennent une dimension nouvelle. Les Temps difficiles, fin 1961, dénonceront en public la torture en Algérie (il aurait à cette époque commencé à rassembler des documents sur la torture en Algérie et tenu un journal – à vérifier)… Puis il y aura La Gueuse, Miss Guéguerre, Y en a marre, Sans façons (manifeste anti-gaulliste), Franco-la-Muerte, Pacific blues, La Révolution, Ils ont voté… Plus tard Le Conditionnel de variétés, Words… words… words…, Le Tango Nicaragua ou la dédicace de Thank you Satan à Bobby Sands, soutien explicite à la lutte de l’IRA… Et bien d’autres textes, on ne peut tout citer.
Soyons clair : jusqu’en 1968, Ferré est quasiment le seul chanteur à intervenir politiquement en France. Une nouvelle séquence s’ouvre, de 1968 à 1977 environ, où d’autres chanteurs interviendront, en général sur des positions antiparlementaristes. Ferré n’est plus le seul : il y aura F. Béranger, Kerguiduff (bien oublié !), Glenmor et surtout Gilles Servat et Colette Magny. Ils chantent les grèves ouvrières, les luttes paysannes, le soutien aux Bretons, aux Basques, aux Irlandais, aux militants du Black Power. Quand nous réécoutons, la violence des textes nous surprend.On réenregistre les chants de la Commune (Mouloudji, Solleville). Mais cette séquence ne durera pas dix ans. Ferré, lui continuera jusqu’au bout. Enregistrant L’Europe s’ennuyait dans son dernier disque, retour aux sources, hommage aux premiers résistants.
Le refus de signer le Manifeste, malgré la mauvaise foi répétée des arguments, semble (ce n’est qu’une hypothèse) avoir pu servir de déclencheur à un engagement politique jamais inféodé à un parti ou à un syndicat. On pourrait reprendre le terme d’Alain Jouffroy : « individualisme révolutionnaire ».
À chacun de juger selon ses convictions, les éléments sont sous les yeux du lecteur.
Terminons sur une citation de Maurice Joyeux, à qui on posait la question : « Pourquoi avez-vous signé ? » et qui répondit : « [ce manifeste]… cri de révolte contre l’impuissance à mettre fin à la guerre d’Algérie, il est, que ses auteurs le veuillent on non, d’essence anarchiste, et c’est alors moi qui retourne la question : pourquoi n’avez-vous pas signé le Manifeste des 121 ? » (Le Monde libertaire, n° 64, novembre 1960).
_________________
[1]. Bibliographie : Hamon et Rotman, Les Porteurs de valises, Seuil, 1982 ; Droz et Lever, Histoire de la guerre d’Algérie, Seuil, 1982. Deux films à voir : La Bataille d’Alger de Pontecorvo ; Avoir vingt ans dans les Aurès de R. Vautier. De nombreux sites internet existent sur le Manifeste. Un seul donne, outre le texte de Blanchot, la liste complète des signataires et et le texte du manifeste américain ; taper dans Google : « Manifeste des 121. Tinhinane ».
[2]. Georges Arnaud, l’auteur du Salaire de la peur (que Ferré connaît : c’est par lui qu’il aurait rencontré Madeleine) est accusé de non-dénonciation de conférence de presse clandestine à Paris. Défendu par J. Vergès, il aura un fort comité de soutien, réuni autour de Kessel et Armand Gatti. Une pétition de deux-cents journalistes défendant le secret professionnel fera reculer le gouvernement. Il aura deux ans de prison avec sursis et ira vivre en Algérie jusqu’en 1970.
[3]. Sakiet : village tunisien bombardé en 1958, alors que la Tunisie est indépendante depuis 1956.
[4]. L. Ferré, Vous savez qui je suis maintenant ?, notamment pp. 199-200.
[5]. L.-J. Calvet, Léo Ferré, Flammarion, 2003.
N. B. : F. Jeanson sera amnistié en 1967 et Malraux le nommera directeur de la Maison de la Culture de Châlon-sur-Saône.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (192)
vendredi, 28 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 3/3
« L’âge d’or »
Tout au long des années 80 et au tout-début des années 90, Léo Ferré se produisit dans de nombreuses villes situées à moins de cent kilomètres de Toulouse, permettant aux amateurs toulousains de suivre les différents jalons de cet « âge d’or » de l’artiste : le 6 août 1981 à Castres ; le 23 novembre 1985 à Montauban ; le 7 octobre 1986 à la Halle de la Verrerie de Carmaux pour le récital Les poètes ; successivement les 29 et 30 septembre 1988 à Foix et Albi ; le 18 mai 1989 à Auch et le 10 novembre suivant à Moissac pour la fête de la poésie; enfin, les 7 et 9 mai 1992 encore une fois au théâtre de Montauban pour le festival Alors chante. Aucun de ces spectacles ne donna lieu à quelque incident que ce soit et chaque fois, devant des salles pleines, le chanteur remporta de très grands succès. Pendant la même période, on le revit à trois reprises sur des scènes toulousaines.
Chapiteau à Colomiers, 29 septembre 1982
Les articles qui annoncèrent la venue de Léo Ferré aux portes de Toulouse ne firent pas spécialement dans la sobriété et en voulant fuir la banalité, ils n’évitèrent pas toujours la boursouflure : [Léo Ferré] « semble être né de nulle part, d’un mélange alchimique du soleil d’hier et de la nuit de demain. Humble comme un bidonville, écorché comme un abattoir, il ouvre sur le monde les yeux plissés de celui qui s’est usé la vue à regarder, à comprendre. Ses gros mots vont aux épousailles du grand souffle de la poésie… »
Difficile d’évaluer le nombre de spectateurs ayant pris place sous ce chapiteau plein à craquer et que l’on aurait pu croire soulevé par les bravos qui accueillirent l’artiste si au dehors le vent d’autan ne gonflait pas la toile. Très tôt Léo Ferré s’en prit à cet orage qui chahutait le voilier, et demanda au public de pousser à l’unisson un grand coup de gueule pour protester contre les éléments… L’ambiance était à la connivence, mais l’écoute fut intense quand le chanteur déclina selon sa fantaisie, les trente-cinq chansons de son répertoire de cette soirée : Vitrines – Les 400 coups - Thank you Satan – Vingt ans – Y en a marre – Chanson mécanisée – Monsieur Barclay – L’Âge d’or - C’est extra – Les Anarchistes – Madame la Misère – Le Printemps des poètes – Le Chien – La Folie - La Solitude / L’Invitation au voyage – Avec le temps – Préface –Allende – À vendre – Les Celtiques – Géométriquement tien – Words words words – Frères humains / L’amour n’a pas d’âge – La Mort des amants – L’Adieu - La Vie d’artiste – La Mélancolie – Ils ont voté – Cette blessure – Ta source – De toutes les couleurs – En faisant l’amour – Un jean’s ou deux – T’as d’beaux yeux tu sais – Les Poètes de sept ans.

Colomiers, 29 septembre 1982 – D. R.
La Dépêche du Midi du 30 septembre 1982.
Léo « Le Lion ». Hier soir, à Colomiers, le poète était seul. Sans orchestre, avec « sa lucidité » et ses chansons.
Un chapiteau sur une tranche de bitume, au cœur d’une ville frileuse et ouverte aux fantasmes. Et cette pluie qui tombe comme une voix houleuse. Vieux fascisme, défaitisme… Hier soir, à Colomiers, le vieux lion n’a pas pu s’empêcher de rugir contre cet orage qu’il n’avait pas voulu.
Il cogne, il frappe, il cingle, il fonce, il chante…. C’est Léo Ferré, soixante-six ans, traînant ses lambeaux de rêves et gardant « sa lucidité dans son froc ». Il n’a plus d’âge et son public non plus. Sous la tente, ils étaient nombreux venus l’écouter : des anars, des amoureux du lyrisme extasié, des fidèles de la voix faite de soufre et de sang, les branchés de la symphonie rose et noire qui se balance comme du Verlaine, et ceux qui n’ont pas oublié ce mot de Léo : I am un immense provocateur.
Tous ont été gâtés. Ferré seul avec son piano et sa bande magnétique (hélas !) leur a tout servi : des bouffées de violence, des couplets fous de vie et d’humour, des imprécations tout d’un souffle, des chansons murmures et des chansons cris, des chansons qui portent l’élan spontané, les tensions sourdes de la vie, des chansons qui s’ouvrent sur un monde en révolte, un monde sans raison.
Léo sait bien qu’on ne plante plus son vieux drapeau noir sur les barricades, mais il continue de prendre son mal en impatience, et sa vieille carcasse vibre autant avec ses tripes qu’avec sa tête. Vingt ans, Avec le temps, La Solitude, C’est extra… Il ne manquait rien à cet étincelant spectacle. Mais quand la voix fauve et ocre s’est éteinte sous les projecteurs, la pluie était toujours là, tapie dans la nuit.
[non signé].
Halle aux Grains de Toulouse, 29 mai 1985
Revoilà donc Léo Ferré à la Halle aux Grains à Toulouse, six ans jour pour jour après le récital quasi insurrectionnel de 1979. Ce retour se fit apparemment sans tambour ni trompette et un seul article annonça le récital prévu le soir même.
La Dépêche du Midi du 29 mai 1985.
Aujourd’hui à 20 heures 30 à la Halle aux Grains Léo Ferré.
Il fait encore quelques apparitions de temps à autre. De moins en moins : retranché dans sa campagne d’Italie, le vieux maître n’éprouve plus le besoin de paraître, occupé qu’il est de jongler avec les mots, les doubles-croches et les silences, poursuivant une œuvre sans pareille.
Depuis combien d’années maintenant ses mots brûlants comme une lave jaillissent-ils de l’obscurité ? Depuis combien d’années cet homme rongé de solitude est-il le copain, le frangin de notre multitude ? Depuis combien d’années cette fraternité fragile qu’il délivre nous réchauffe-t-elle les jours de pluie ?
Non, Ferré n’a pas changé, il ne changera jamais : il est un torrent de mots sur des flots de musique, il est un homme debout qui ne fait que passer, il est un sourire un peu pâle, lointain, vacillant comme son regard. Une voix surtout.
Ferré l’amour, Ferré la mort, qui chante la folie et les cœurs piétinés, les années disparues et le goût furtif du bonheur, l’injustice et le silence, l’absurdité de toute chose.
Aujourd’hui, Ferré qui voudrait que « tout s’arrête là du temps compté des hommes », nous revient avec la neige de ses cheveux qui accroche la lumière, la grimace d’un sourire comme une blessure, sous le ciel blanc des projecteurs.
Une escale dans la poursuite de l’errance incertaine de « monsieur le poète qui semble venir d’ailleurs ».
[non signé].

Halle aux Grains à Toulouse, 29 mai 1985 – D. R.
Aucun compte rendu de presse n’a décrit cette soirée qui méritait pourtant d’être évoquée, tant le triomphe fut grand dans une Halle aux Grains bondée et ployant sous le charme. Finis les incidents d’avant spectacle pour forcer les portes ou pour revendiquer sur des sujets pour lesquels le chanteur ne détenait pas spécialement la solution.
Il est vraisemblable qu’avant ce spectacle, Léo Ferré avait rencontré des représentants de la mouvance libertaire, car aussitôt achevée l’interprétation de Frères humains, après avoir jeté un coup d’œil sur un tract, il dédia la Ballade des pendus de Villon « aux quatre militants antifascistes emprisonnés à Toulouse… », dédicace ponctuée du vers : « Mais priez Dieu que tous les veuille absoudre ».
Quant à son programme il était composé de cette large trentaine de chansons : La Vie d’artiste – Pauvre Rutebeuf – Graine d’ananar – Le jazz-band – T’es rock coco – Les Copains d’la neuille – Les Amoureux du Havre – La Solitude / L’Invitation au voyage – À celle qui était trop gaie – Mon camarade – La Vie moderne – Thank you Satan – L’Amour – Madame la Misère – Pépée – Marizibill – La Porte – Le Printemps des poètes – Le Chien – Ton style – Préface– Je te donne – Les Artistes – Tu penses à quoi – Allende – Words words words – Frères humains / L’amour n’a pas d’âge – Ta source – Un jean’s ou deux – Le Tango Nicaragua – T’as d’beaux yeux tu sais – Avec le temps.
Halle aux Grains de Toulouse, 12 janvier 1990
Sous l’intitulé « Léo, à certaines heures pâles de la nuit », le traditionnel article destiné à présenter l’artiste qui allait bientôt se produire à Toulouse aurait plutôt découragé le spectateur perplexe si Léo Ferré n’avait pas fait depuis longtemps ses preuves…
Vingt-cinq ans après son premier récital toulousain sur la scène de l’ancien marché aux grains transformé en Palais des Sports, revoilà le poète au même endroit, cette fois-ci devant une Halle aux Grains archicomble. Comme il le disait lui-même, il y a aussi des journalistes qui connaissent leur métier ; c’est vraiment le cas de Marie-Louise Roubaud.
La Dépêche du Midi du 13 janvier 1990.
En concert à la Halle aux Grains, Léo d’enfer.
Il a la passion mimétique. Ses révolutions, certes, ne sont pas de velours, elles ont le goût âcre des orages et du sang, et pourtant, qu’il vienne à chanter la tendresse et « que sont mes amis devenus » de Rutebeuf, et soudain s’installe sous les sunlights une fraternité à couper au couteau. Et la minute suivante qu’il se mette à tempêter et on le croirait vomi par les bouches d’enfer d’un volcan mal éteint. Celui de ses colères fumantes. Avec sa gueule de chimpanzé ou de trappiste triste d’avoir longtemps courbé l’échine sur le même sillon maigre – « en 1956, c’était pas facile de vivre, le téléphone ne sonnait pas, aujourd’hui, il sonne trop » – Léo Ferré reste conforme à son image de toujours. Mais il ne se fige pas. Qu’il se mette à danser un air de jazz-band et le rythme se met au pas et la salle à la mesure.
Cet ancêtre a tous les culots. Celui de nous chanter une messe des morts, un chant des trépassés qui nous ramène tous les vieux fantômes, Lorca, Allende et même Franco. On le croyait bien mort pourtant, celui-là. Et bien non, Ferré a la rancune tenace, et les amours aussi. Il ne faut pas croire que lorsqu’il tient une proie, il va la lâcher pour l’ombre. Alors, dans ses imprécations pas de pardon, mais dans ses amours pas d’oubli.
Son Bateau espagnol descend toujours la Garonne avec une Madone en figure de proue et Aragon et son Affiche rouge flamboient toujours au firmament. D’ailleurs, comme Aragon, Ferré chante pour « passer le temps petit qui lui reste à vivre ». Sans ostentation. Faisant fi de toutes les barrières, celles du temps, de l’âge, des modes, des convenances, Ferré joue les charmeurs de serpents qui sifflent sur sa tête, cette tête d’artiste maudit qui ressemble vingt ans après, au dessin qu’en fit un peintre qui était espagnol et qui s’appelait Carlos Pradal…
Dans toute sa gloire, face aux ovations qui bercent sa tête chenue et qui désaltèrent son cœur exigeant, ce frangin du malheur continue à faire de drôles d’invocations à « l’ange des plaisirs perdus »… Comment, dès lors, ne pas l’aimer comme il le mérite… À la folie.
Marie-Louise Roubaud.

Toulouse, 13 janvier 1990, Éditions Universelles.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 26 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 2/3
« Les temps difficiles »
Retors, rétif, rebelle, tel apparut sans doute le public toulousain à Léo Ferré qui allait connaître localement d’amères déconvenues. En effet, malgré d’incontestables succès, les récitals à Toulouse des années 1969-1979 se sont déroulés à l’enseigne des « temps difficiles »…
Cinéma Le Royal de Toulouse, 15 décembre 1969
Nul besoin d’article avant-coureur pour annoncer ce récital organisé par le Centre culturel de Toulouse, réservé aux seuls adhérents, en principe un auditoire plutôt calme et conquis d’avance. Les salles de spectacles du centre culturel étant trop petites, Christian Schmidt, le directeur fondateur de cet institut, avait loué celle du Royal, un cinéma du centre ville pouvant accueillir un millier de spectateurs. En guise de commentaire à la note Contester Ferré, je me suis efforcé en juin dernier de raconter cette soirée houleuse contre toute attente, et dont Léo Ferré a partiellement fait les frais. En découvrant l’article de La Dépêche relatant ces faits, je me rends compte que ma mémoire m’a trahi à propos de la nouvelle tenue de scène de l’artiste dont j’ai inversé les teintes, en revanche, c’étaient bien plusieurs spectateurs qui avaient pris place sur la scène. Peu importe. Voici donc le point de vue à chaud de Marie-Louise Roubaud publié le surlendemain de cette soirée passionnée.

15 décembre 1969, photo La Dépêche, op. Esparbié.
La Dépêche du Midi du 17 décembre 1969.
Léo Ferré au Centre culturel : le fauteur de troubles…
On sait depuis toujours que là où il passe, Léo Ferré provoque le trouble. Ses pamphlets anarchistes n’écorchent pas que le langage et la bonne morale ; ils dérangent. Car le grand Ferré est un homme en colère qui se sert des mots comme d’autres se servent de grenades.
S’il y a aujourd’hui une poésie qui touche au vif la jeunesse révolutionnaire, c’est bien celle de cet homme de plus de cinquante ans. À la fois insolent et tendre, sincère et roué, irritant et attachant, Ferré est un de ces êtres excessifs qui sèment le vent et récoltent la tempête.
Adoré et haï, il aura connu lundi soir, au Royal, l’encens du triomphe et le vitriol des injures.
La rue d’Alsace embouteillée, des grilles défoncées n’étaient qu’un prélude. À l’intérieur, fauteuils et couloirs étaient pris d’assaut par un public secoué par la fièvre des combats.
Quand Léo Ferré apparaît aux couleurs de l’anarchie – pull noir et pantalon rouge – crinière romantique, ce public se retrouve uni pour lui faire une ovation.
Aux deux premiers rangs, les plus « enragés » de ses admirateurs de jeunes anarchistes venus faire un triomphe à celui qu’ils considèrent, à tort comme à raison, comme leur prophète.
À voix basse d’ailleurs, ils disent les vers qu’ils connaissent sur le bout du cœur pour y avoir trouvé l’écho de leur propre révolte.
Ils n’ont pas porté de drapeaux noirs comme leurs camarades parisiens à Saint-Denis, la semaine passée, mais ils ont tous des tenues qui sont autant de porte-drapeaux de l’anticonformisme.
Ils applaudissent et crient plus fort que les autres pendant que Ferré, seul en scène avec son pianiste aveugle, domine la salle de son inquiétante présence. Il est doué d’une puissance de destruction presque satanique, et d’une vulnérabilité désarmante.
Sa poésie torride, son visage terriblement mobile, qui se craquelle parfois comme ravagé par des peines anciennes, sa voix qui tremble et semble sourdre des entrailles, ses belles mains d’artiste qui implorent et menacent, créent un envoûtement et une magie.
Tout va se gâter dès qu’un jeune du premier rang monte sur scène. Il a une tête de saint-Jean-Baptiste, un chapeau de Chouan : il s’assied tranquillement et il écoute. Cinq minutes après, on voit surgir des coulisses un gorille blond, qui lui intime l’ordre de descendre et joint le geste à la parole.
Il y a eu des protestations dans la salle, un autre jeune bondit sur scène et redescend aussitôt. Léo Ferré, avec un visage de jugement dernier, crie dans le micro : « Je ne peux chanter que dans la solitude de la scène. Ici ce n’est pas un foutoir. » Et il enchaîne sur des couplets engagés.
Les uns applaudissent, les autres contestent. Le charme est rompu et va prendre l’allure d’un réglement de comptes. L’injure est dans l’air de part et d’autre, et quand Léo Ferré entonne Les Anarchistes, ceux du premier rang crient à la trahison, se lèvent en chœur le poing levé, en poussant un cri de guerre et de ralliement : « Anarchie ! »
Ils brûlent l’idole qu’ils ont adorée avec la même sauvagerie. Leur silence est un silence armé, leur hostilité ira crescendo. Leur erreur est d’avoir cru tout frontière abolie entre l’artiste et eux ; leur ressentiment est sans pitié.
L’erreur de Ferré, c’est d’avoir traité de haut un public qui n’était turbulent que par excès de passion et d’avoir contredit par un geste de répression sa légende d’« anar ».
Il s’arrêtera d’ailleurs de chanter pour lancer le mot de Cambronne et inviter ceux qui l’insultent à venir s’expliquer d’homme à homme sur scène.
Il finit son récital par un poème débridé : « Je suis un chien », tout empli de tumulte et de désespoir, et où il donne rendez-vous dans dix siècles aux nouvelles générations pour vivre dans un monde d’amour.
La salle est divisée une fois de plus. Ferré a séduit ses ennemis et déçu ses amis… Il n’y a pas de rappel. La polémique continue dans la loge de l’artiste.
« Ce n’est pas parce que je suis un anarchiste que je dois coucher avec tous les anarchistes à la petite semaine. Il y a vingt ans que je lutte. Bientôt je ne vais plus pouvoir chanter. Dans deux ans, au train où vont les choses, ils vont me demander de marcher sur l’eau. Il n’y a qu’un point sur lequel je triche, c’est que je suis persuadé que nous allons vers un monde effroyable et que je ne le dis pas, et que je chante quand même l’espoir. Je suis un chanteur, un point c’est tout, et pas une idole. On me demande : pourquoi ne chantez-vous pas dans la rue ? Je réponds : parce que c’est interdit. »
M.-L. Roubaud.
Théâtre du Capitole de Toulouse, 13 mai 1970
Sans doute pour estomper le souvenir de cette soirée particulièrement remuante, Léo Ferré était de retour à Toulouse, tout juste cinq mois plus tard, cette fois-ci devant un public non d’invités, mais ayant en majorité acquitté le prix de la place. Pour ce retour, la salle la plus prestigieuse de Toulouse lui ouvrait ses portes : le Capitole, théâtre à l’italienne de mille deux-cents fauteuils et temple du Bel Canto.
Profitant de la circonstance, les échotiers sortirent les superlatifs et parlèrent à son endroit de « poète terrible et virtuose de la scène » ou encore de « semeur de foudre à la présence magnétique ». Les photos communiquées par le service de presse Barclay montraient un Léo Ferré barbu et l’un des laudateurs se demandait si l’artiste ne revenait pas d’une saison en enfer, comme le laisse penser son visage torturé de « Christ des douleurs »…
Je n’ai pu assister à ce récital, tout comme aux deux suivants dont je parle ici. Toutefois, les échos qui me sont parvenus font état d’un Léo Ferré particulièrement las, résigné à laisser ceux qui n’étaient venus que pour le contester prendre le dessus. Le programme, centré sur les nouveaux titres d’Amour Anarchie en fut plutôt gâché.
Si je n’y étais pas, en revanche la journaliste Marie-Louise Roubaud, à son habitude, était tout à fait présente.
La Dépêche du Midi du 15 mai 1970.
Pour le récital Léo Ferré, la révolte avait changé de camp.
Pour Léo Ferré, Toulouse est toujours une étape mouvementée. Elle l’aura été cette fois, un peu plus que de coutume.
À neuf heures du soir, une trentaine de jeunes anarchistes – si du moins il faut en croire le drapeau noir qu’ils ont agité en fin de spectacle comme signe de ralliement – a envahi les galeries du théâtre du Capitole réclamant l’entrée libre et occupant « sauvagement » des lieux dont on ne songeait d’ailleurs pas à leur défendre l’accès.
Le procédé n’est pas nouveau. Les « fans » du Living Theatre le pratiquent couramment ; on est du moins assuré une fois qu’ils sont dans leur place de les voir respecter et le spectacle et les spectateurs.
La non-violence n’était malheureusement pas le fait des jeunes gens de l’autre soir, très soucieux de leur propre liberté mais pas de celle de leurs voisins. Employant des méthodes qu’ils récusent chez les autres, ils justifient le propos désabusé de Léo Ferré : « Les anarchistes de ce soir ? Mais ce sont des fascistes ! C’est clair comme de l’eau de Mao. »
Il est clair aussi que ce sont des gens qui se flattent, pour reprendre un mot d’Henry Miller, d’être différents mais qui ne sont que trop semblables à ceux qu’ils savent si bien condamner.
Ils n’auront, l’autre soir, convaincu personne de leur bon droit, sinon eux-mêmes. Il est vrai que pour eux l’autosatisfaction remplace l’autocritique, et que le chahut leur tient lieu de contestation. C’est se donner à bon compte des brevets de courage et de révolutionnaire, que de prêcher à coup d’injures la révolte à un public d’avance converti aux vertus de l’anticonformisme.
La majorité s’en tint donc au silence par la force des choses, du moins pendant le spectacle, et Léo Ferré, homme de fureur, n’a pas cette fois répondu aux provocations imbéciles, grossières et anonymes d’une minorité ayant visiblement mal digéré les doctrines de la Commune et des idéaux de l’anarchie.
Il est tout de même curieux que sur les vingt spectacles organisés à Toulouse, au Capitole et ailleurs, en cours de saison et qui sont tous régis sur les mêmes principes financiers, les anarchistes aient précisément choisi le récital de Léo Ferré pour contester. On comprendrait si une telle remise en question s’adressait à un spectacle de qualité médiocre, à un poète de peu d’envergure.
« Ferré n’est pas représentatif de notre mouvement », rétorquent les « anars ».
Ferré répond : « Je ne représente que moi-même et je n’ai jamais prétendu représenter un groupe. Il faudrait supprimer le « fric » et c’est utopique. Le premier État à placer son argent en Suisse s’appelle le Vatican, le second c’est la Chine gouvernementale.
Plus je vis, plus je suis convaincu de l’inutilité de l’expression artistique. L’art est une excroissance de la solitude. Le poète converse avec des ombres. Je crois que la poésie a fait plus pour l’humanité que toutes les autres sciences. La poésie c’est une séquelle divine. Je disais, tout à l’heure, la ségrégation c’est l’argent, non c’est l’intelligence. Mais les c… aujourd’hui, sont moins c… qu’avant. Il ne faut pas être trop intelligent pour vivre. »
Léo Ferré va publier à la rentrée, un roman : Benoît Misère, où il raconte l’histoire d’un petit garçon qui devra beaucoup, bien sûr, au collégien qu’il fut :
« J’avais le matricule 38. Je ne veux plus connaître le passé. Ce sont des souvenirs qui font froid au cœur. On ressemble assez peu à celui qu’on a été, on ne peut pas ressembler à celui qu’on sera demain… »
M.-L. Roubaud.
Palais des Sports de Toulouse, 29 octobre 1971
C’est en épluchant les archives de La Dépêche du Midi que je suis tombé sur ce récital dont je n’avais jamais entendu parler. Deux articles non signés étaient censés donner le ton de ce retour au Palais des Sports de Léo Ferré, accompagné par le groupe Zoo qui devait donner une « dimension apocalyptique » à la soirée. On était prévenu des possibles débordements, la présence seule de Léo Ferré suffisant à « engendrer des cataclysmes d’enthousiasme ou de contestation » car « il fait partie de ces êtres qui ont le redoutable privilège de n’avoir que des amis fanatiques… ou des ennemis tout aussi acharnés. » Également appelé en renfort, Maurice Frot annonçait la couleur : «Insurrectionnel le récital ! »
Le groupe Zoo, dont on nous assurait qu’il avait une réputation internationale, était au complet, avec le chanteur Ian Bellamy, Daniel Carlet aux violon et sax ténor, Michel Ripoche, également au violon mais aussi aux trombone et sax, André Hervé à l’orgue, au vibraphone, et à la guitare rythmique, Michel Hervé à la guitare basse, et Christian Devaux à la batterie.

Zoo, La Dépêche du Midi, 1971.
Comme on peut le lire sous la plume de Marie-Louise Roubaud, la soirée qui avait attiré la foule des grands soirs commença violemment à l’extérieur où « ceux qui n’avaient pas de quoi payer » revendiquaient la gratuité de l’entrée. Léo Ferré vint à leur secours en exigeant que les portes du Palais des Sports restent ouvertes toute la soirée. Visiblement, cela contribua à éviter un nouveau sabotage du spectacle.
La Dépêche du Midi du 1er novembre 1971.
Au Palais des Sports, Léo Ferré : « Un immense provocateur ».
Vingt-et-une heures, vendredi soir, le Palais des Sports est en effervescence, au-dedans comme au dehors.
Dedans, il y a déjà trois mille spectateurs assis, des jeunes en majorité écrasante. Dehors, c’est l’affrontement classique entre représentants de l’ordre et ceux qui veulent entrer sans bourse délier (15 francs, étudiants ; 20 francs, entrée générale).
Entre ces deux mondes bouillonnants d’une égale violence et tendresse, Léo Ferré, lèvres serrées, crinière ébouriffée, arpente la coulisse.
« J’en ai marre. Il y a des gens qui veulent me voir et n’ont pas d’argent. Moi, je veux les laisser rentrer, et on m’empêche. Et puis, ça me retombe sur la gueule… »
Il allume une cigarette, parlemente avec véhémence avec les organisateurs, et puis s’avance seul au dehors au milieu du dernier carré de ses fidèles qui s’est reformé après le départ de la police.
L’affaire est entendue. Les grilles s’ouvrent sans coup férir, et elles le resteront jusqu’à la fin du récital.
Les Zoo ont sur la scène précédé la vedette qui arrive un quart d’heure après, chemise noire et pantalon de couleur violet, suivi de son fidèle pianiste aveugle, Paul Castanier, habillé de noir comme à l’accoutumée, mais cette fois avec des cheveux aussi longs que ceux de Léo Ferré.
Dans la salle, l’élan est unanime pour saluer les deux hommes dont les rapports ne sont pas de toute évidence des rapports de convention…
« Je cherchais un bon pianiste qui soit de surcroît un homme intelligent avec qui je puisse parler… J’ai rencontré Paul Castanier, nous ne nous sommes plus quittés. »
Le troisième homme est dans les coulisses. C’est Maurice Frot, lui aussi connaît Ferré depuis quinze ans et lui est resté fidèle. Romancier (il a écrit en 1965 Le Roi des rats ; en 1969 Nibergue, qui a obtenu le prix du roman populiste ; il prépare un autre ouvrage : L’étouffe-chrétien ; il a, par amitié, pris la relève de Madeleine Ferré ! Il assure des fonctions qui vont de celles du régisseur à celles de scénariste.
Il vient d’écrire le scénario du film que Léo Ferré va tourner comme acteur avec Philippe Fourastié (le réalisateur de La Bande à Bonnot) et qui s’appellera Mon frère le chien, ma sœur la mort, sorte de transposition moderne de Saint-François d’Assise qui ne regarde plus voler les oiseaux… mais les « Boeing ». Le pianiste aveugle jouera son propre rôle.
En attendant c’est la tournée dans le sud de la France : Aix, Montpellier, Toulouse, Perpignan, avant la reprise des concerts à la Mutualité, à Paris, à 12 francs (du 22 au 25 novembre, du 12 au 16 décembre, avec les Zoo que Ferré semble avoir définitivement adoptés ainsi d’ailleurs que son pianiste et Maurice Frot, qui n’hésite pas à reconnaître combien le nouveau spectacle doit à « ces jeunes gens qui sont très bien et qui ont secoué nos vieilles habitudes ».
Le fait est que dans le nouveau spectacle qu’il rode en province, Léo Ferré sort grandi de sa confrontation avec la pop music et les jeunes générations.
Léo Ferré artiste cède aujourd’hui le pas à Léo Ferré tribun… Commencé sur L’Âge d’or, le récital s’achève sur un poème en prose de : « Je suis un chien » qui plonge l’assistance dans un état second… Chemin faisant, Léo Ferré s’est mis en colère, dominant le Palais des Sports plein de haut en bas de sa hargne et de sa grogne, de vétéran de la contestation… Il a chanté l’anarchie, l’amour fou, la solitude ; il a tourné en dérision les gouvernements et les étiquettes politiques, les bonnes manières et lui-même, est passé de la fraternité pathétique à un narcissisme impudique.
« Je suis un immense provocateur ». Il frôle et le sublime et l’odieux. Bref, il est lui-même, véritable archange satanique, défiant les règles. À cinquante ans passés, Léo Ferré retrouve le second souffle.
Il y a six ans, son nom déplaçait à Toulouse, tout juste un millier de personnes. Aujourd’hui chacun de ses récitals fait figure d’événement.
M.-L. Roubaud.
Palais des Sports de Toulouse, 9 février 1973

Léo Ferré + Charlebois, tournée 1973.
La presse locale annonçait à la même affiche, « deux monuments de la chanson, deux générations mais la même violence pour crier à la face du monde que seule la folie est raisonnable ». Il s’agissait d’une part de Léo Ferré, « vieux loup redevenu solitaire depuis plusieurs années et qui ne désarme plus », d’autre part de Robert Charlebois qui poursuit, lui aussi, une carrière explosive et « qui progresse en sabots dans la rocaille et les escarpements du folklore québécois. »
Pour ma part, je n’ai pas assisté à ce récital dont j’ai appris les écueils par la presse. Quelques années plus tard les hasards de la vie m’ont conduit à me lier d’amitié avec un des principaux protagonistes des incidents qui ont émaillé la première partie de cette soirée. Alors étudiant, Antoine était proche des groupes maoïstes surnommés les « mao spontex » par leurs voisins trotskistes. C’est donc sa version des faits qui a partiellement inspiré les lignes qui suivent. Cette version est parfois en contradiction avec celle donnée par Maurice Frot dans son livre de souvenirs Je n’suis pas Léo Ferré (Éd. Fil d’Ariane, 2002).
Le moins que l’on puisse dire c’est que la soirée allait être des plus chaotiques, commençant de façon presque banale par des échauffourées entre ceux qui exigeaient la gratuité du spectacle et la police. Ce qui est certain, c’est que beaucoup de militants d’extrême-gauche se trouvaient dans la salle quand Robert Charlebois débuta son tour de chant, et qu’au moins un détail fut perçu par certains comme une provocation : la présence en fond de scène du drapeau québécois largement déployé. Devant un public plutôt sensible aux thèses internationalistes, cet emblème fleurdelisé faisait un peu désordre. L’indifférence de Robert Charlebois aux rudiments de la sociologie française n’a pas non plus simplifié les choses. Les calembours ne marchent pas forcément partout de la même façon et sans doute a-t-il sous-estimé la politisation du public toulousain lorsqu’il a balancé en plaisantant qu’il était « marxiste tendance Groucho ». C’est cette boutade qui faisait simplement partie de son jeu de scène, qui a été le point de départ du « foutoir » qui s’est installé sur la scène du Palais des Sports. Esprit frondeur et rigolard, Antoine, dont la stature est réellement très éloignée de celle d’un lutteur de foire, aurait à ce moment-là bondi sur scène dans le but de s’emparer du micro pour reprendre le leitmotiv bien connu de « laissez entrer nos camarades ». La bourrade qu’il aurait donnée à Robert Charlebois qui tentait d’entraver cette dépossession du micro fit rouler celui-ci à terre, avant que la scène ne soit effectivement livrée à une grande pagaille, ainsi que le décrit Marie-Louise Roubaud dans deux chroniques reproduites ci-dessous. Là aussi cette relation s’écarte de celle de Maurice Frot, concernant l’attitude de Léo Ferré en coulisses qui en réalité aurait été plus lucide et décisif que ce qu’en a dit son ancien factotum. Quant à la quinzaine de titres que le poète chanta au cours de la seconde partie, les voici en respectant l’ordre de leur interprétation : Préface – Les Poètes – Ton style – À toi – Le Crachat – Vitrines – L’Oppression – Les Amants tristes - Avec le temps – Night and day - Comme à Ostende – Ne chantez pas la mort - La Solitude – Ni Dieu ni maître – Il n’y a plus rien.
La Dépêche du Midi du 11 février 1973.
Le Québécois Robert Charlebois a mordu la poussière du Palais des Sports où Léo Ferré a triomphé.
Soirée mouvementée vendredi au Palais des Sports de Toulouse, gorgé de monde et qui a débuté dès les portes ouvertes par l’affrontement classique des forces de l’ordre et des spectateurs désargentés exigeant le droit d’entrée et le prenant.
Pas de blessés, mais des vitres cassées et quelques sévères empoignades qui ont donné le ton de la violence et échauffé les esprits.
Tout semble se calmer lorsque Robert Charlebois et ses musiciens entament leur récital. C’est la première fois qu’on les entend et qu’on les voit, donc qu’on les juge. Leur réputation n’est plus à faire auprès des amateurs de « pop music ». Avec sa chevelure rousse et bouclée de jeune Papou, avec son accent québécois où le français prend une saveur terrienne, avec un folklore puissant et un peu fou qu’il a réinventé à sa propre mesure, et qui tient du rock et de la danse indienne, Robert Charlebois est une hyper-vedette en puissance. Hélas ! il a bien failli laisser son scalp à Toulouse au terme d’un véritable pugilat qui lui a fait mordre la poussière et s’affronter avec les spectateurs. Tout a commencé quand un militant est monté sur scène pour demander le micro, la parole et le droit d’entrée pour ses camarades d’infortune. Des cris de sympathie émanent des gradins pris du frisson des combats politiques, Robert Charlebois arbitre malgré lui du conflit est déconcerté, et puis se fâche rouge lorsque son partenaire impromptu lui jette le micro aux pieds. Le Québécois lève le poing et dans l’instant les spectateurs du premier rang montent en force sur scène, la salle hurle son mécontentement tandis que Charlebois est à terre.
Tout n’est que cris, tumulte et confusion.
L’incident est passé du registre cocasse au registre dramatique.
Charlebois reprend ses esprits et tente de renouer le récital. Mais le charme est rompu, le cœur n’y est plus de part et d’autre. Désormais le récital va prendre l’allure d’un réglement de comptes entre le spectateur anonyme revenu sur scène et les musiciens excédés qui vont quitter la scène en pliant bagages.
L’entracte ne coupe pas court à la contestation. Le micro est à qui veut le prendre. Tout semble aller à la dérive. Léo Ferré est dans les coulisses et attend son tour avec son visage de jugement dernier. Il avance sur scène où l’attend Popaul, son pianiste aveugle avec l’énergie rentrée des vieux capitaines au long cours. Il ne changera pas un iota à son tour de chant : quinze longues chansons dont cinq nouvelles au verbe délirant, au style pamphlétaire et qui placent le vieux lion Ferré au-dessus de la mêlée. La partie est gagnée. La jeunesse médusée écoute ce prophète terrible à cheveux blancs qui réduit en charpie toutes les institutions « Le désordre c’est l’ordre moins le pouvoir » et qui est de la même race qu’elle, avec l’étincelle du génie en plus.
M.-L. Roubaud.
La Dépêche du Midi du 12 février 1973.
À Robert Charlebois les risques du métier, à Léo Ferré les lauriers.
La soirée de vendredi, au Palais des Sports, aura bien sûr dépassé le cadre de l’événement artistique. Les incidents qui ont marqué la première partie où Robert Charlebois officiait, n’ont fait que confirmer l’emprise de Ferré sur un public déchaîné, qui a rendu les armes au talent et à plus contestataire que lui. Le prestige de Ferré avait pourtant été mis à mal il y a trois ans, pour les mêmes raisons qui ont motivé, l’autre soir, l’insuccès personnel de Robert Charlebois. Les rapports qui régissent le dialogue entre le public et les vedettes sont, à Toulouse plus qu’ailleurs, d’ordre passionnel. Le succès n’y est jamais garanti d’avance et pas un faux pas n’est pardonné. Dure leçon pour Charlebois, flamboyant Québécois et jeune idole à la tête fière descendu, pour un soir seulement, de son Olympe.
Pour Ferré, une ferveur accrue et qui est à la mesure de sa propre maturité. Depuis qu’il a déserté sa propriété de Saint-Clair, Ferré, rendu à ses démons, continue de se battre envers et contre tous, revêtu d’une invisible tunique de Némésis qui lui brûle la peau. « Ce qu’il y a de plus profond en nous c’est la peau… »
Ses textes sentent toujours la rue et son langage cru, mais ce n’est plus la même rue, ni tout à fait les mêmes générations qu’on y croise. Aussi ses derniers poèmes en prose sont-ils des tracts fleuve dont la violence frappe comme un boomerang. Et ce n’est pas par esprit d’opportunisme, mais bien parce que Ferré hume le vent de l’Histoire, qu’il vit son temps avec tous ses pores. Poète insurgé, il n’en faut pas douter, bête de scène aussi, Ferré avec son refus nouveau de fioritures et d’artifices un peu déclamatoires, Ferré le nihiliste, poing fermé ou poing levé continue de s’abreuver aux sources de la colère.
M.-L. Roubaud.
Halle aux Grains de Toulouse, 29 mai 1979
Lorsque Léo Ferré revient plus de six ans plus tard à Toulouse, l’appellation « Palais des Sports » s’est effacée depuis quelques mois seulement au profit de celle de « Halle aux Grains », mais il s’agit bien du même lieu, complètement restauré et réaménagé ainsi que mentionné plus haut. Au cours de ces six années, Léo Ferré a lui aussi changé. Désormais il est seul sur scène, avec son piano et ses bandes magnétiques, parfois un grand orchestre, mais ce n’est pas le cas ce soir-là. Sa notoriété de poète, de musicien, d’artiste lyrique, s’est considérablement accrue et dépasse les frontières de la francophonie, si bien que dans ces circonstances, la Halle aux Grains affichant « complet », on s’attend à une grande prestation. Pourtant, selon Robert Belleret dans Une vie d’artiste, dès la veille du récital Léo Ferré avait confié à son entourage qu’il redoutait « qu’il y ait de la merde à Toulouse », et effectivement, cette soirée-là releva une nouvelle fois de la rubrique des faits divers :
La Dépêche du Midi du 30 mai 1979.
Toulouse : bagarres pour le récital Léo Ferré. Plusieurs blessés place Dupuy.
Léo Ferré était, hier soir, à Toulouse. Ses fans voulaient le voir, et ce à tout prix, la Halle aux Grains n’est pas extensible et ceux qui voulaient payer, les resquilleurs aussi, étaient nombreux.
Les choses se sont finalement envenimées lorsque des énergumènes essayèrent de forcer les portes.
Les responsables du spectacle durent alerter Police secours, qui tenta de dégager les abords de la salle. Les manifestants lancèrent alors des pierres et des bouteilles sur les forces de l’ordre qui eurent plusieurs blessés. La police dut alors charger et les manifestants qui s’étaient réapprovisionnés en munitions sur des chantiers en construction voisins, revinrent en force.
La bagarre s’est soldée par de nouveaux blessés. Un des « fans » de la chanson a même dû être hospitalisé.
Il faut souligner que les spectacles de rock avaient déjà été l’objet de semblables « émeutes » et que de ce fait les organisateurs ont décidé de les supprimer dans la Ville « rose » !
[non signé].
Désormais on ne parlait plus d’anarchistes ou de militants d’extrême-gauche, mais plus prosaïquement de resquilleurs, qui ne réservaient plus leurs exigences aux seuls spectacles de Léo Ferré mais aussi aux festivals de rock…
Concernant cette soirée, on sait qu’un commerçant victime des casseurs a adressé directement à Léo Ferré la facture des réparations. Dans l’ironique fin de non-recevoir qu’il lui opposa, l’artiste qualifia les auteurs des dégâts de « jeunes prématurément vieillis »…
Pour ce qui est de ce qui s’est passé à l’intérieur de la Halle aux Grains ce soir-là, le compte-rendu qu’en donne La Dépêche du Midiest particulièrement fidèle. Il faut dire que la grande confusion qui régnait a bien failli tourner à un mouvement de foule en proie à la panique. D’une part, on entendait dans un vacarme assourdissant comme des coups de boutoirs donnés contre les portes mêlés aux sirènes des voitures de police, sans vraiment savoir de quoi il s’agissait. D’autre part certains en avaient après Léo Ferré tandis que d’autres enfin tout aussi véhéments l’assuraient de leur solidarité en lui conseillant d’abandonner la partie, le public ne méritant pas qu’il poursuive son récital. Au bas de la scène, des spectateurs gesticulaient provoquant la colère de l’artiste qui à ce moment-là ne comprenait pas ce qui se passait et croyait que ce tumulte était dirigé contre lui. Quand enfin il s’arrêta pour demander que l’on ouvre les portes, de très longs moments de confusion s’écoulèrent, où la gorge protégée par une serviette, Léo Ferré arpentait la scène, ne laissant aucune prise à l’hostilité persistante d’une partie du public ni à l’insistance de ses proches en coulisse pour qu’il arrêtât là le concert. Sourd à tous ces discours, avec beaucoup d’abnégation, il mena son récital jusqu’au terme qu’il s’était assigné, interprétant dans les pires conditions et « dans l’ordre qui lui a plu », les vingt-trois chansons suivantes : La Mémoire et la mer – Vingt ans – C’est extra – La Solitude / L’Invitation au voyage – Avec le temps – Préface – Muss es sein es muss sein – Les Musiciens – La Vie d’artiste – La Frime – Les Étrangers – Comme à Ostende – Tu penses à quoi – Ton style – La Jalousie – Je te donne – Chanson d’automne – C’est fantastique – La Nostalgie – Ma vie est un slalom – Des mots - Ni Dieu ni maître - Thank you Satan.
La Dépêche du Midi du 30 mai 1979.
Ferré place Dupuy : rude soirée pour le « roi » Léo.
Chemise de soie noire (il y a dix ans, c’était un pull-over) col ouvert, pantalon noir, chaussettes rouges, cheveux en halo blanc et mousseux, Léo Ferré entre en scène devant une salle impatiente. Il est 21 heures 15. Il envoie, du bout des doigts, un baiser au public, et s’assied au piano noir.
Dans le recueillement s’élève cette voix depuis longtemps célèbre, murmurante et rauque de sentiments retenus ; la tendresse. « La marée je l’ai dans le cœur ».
Et la houle, aussitôt après, dans les gradins où l’on manifeste, dès la deuxième chanson. Ferré chante, debout au micro, sur une bande musicale enregistrée.
« À quand le tourne-disques, Ferré ? » « Place aux jeunes ! » Sifflets. Contre protestations. Silence revenu, tandis que sans ciller, « le vieux Léo » qui ne s’est pas interrompu, chante La Nostalgie. « Ils n’ont de noir qu’un faux drapeau de 68… » Début de réponse aux perturbateurs, qui ne s’en contenteront pas, faisant entendre leur mécontentement à chaque fois que Léo Ferré utilisera ainsi le magnétophone.
Quatre fois, avec La Vie d’artiste, L’Allitérature (sic), Avec le temps et Thank you Satan, il reviendra au piano. Quatre fois, sur plus de vingt chansons au total. Alors, les manifestations se faisant de plus en plus pressantes, il fallut bien expliquer, même si très violemment : « J’ai chanté à Paris avec quatre-vingts musiciens et soixante choristes. Alors, quand je ne peux pas les avoir, je chante tout seul ! Tu comprends ? Merde ! »
Climat qui n’était pas favorable à la délectation de textes aussi purement beaux que « l’oreille de Beethoven en train d’imaginer pour la neuvième fois des symphonies muettes », « mon ombre a son soleil qui lui lèche sa trace », « si tu le veux, ta parallèle s’entrianglera avec la mienne » ou « les ailes de l’archange au milieu des pavés », aussi simplement forts que « ces bois que l’on dit de justice et qui poussent dans les supplices », « pour la prise de la Bastille même si ça ne sert à rien » « dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. »
Et des chiens, justement, muselés, et d’aucuns diront démuselés, il y en avait pendant ce temps, aux portes de la Halle aux Grains. Dans notre rubrique « faits divers », nous relatons ce qui s’est passé à l’extérieur de la salle. Dedans, la rumeur des affrontements parvint vite. On crie, pour avertir Léo Ferré de ce qui arrive. Il ne comprend pas. On l’insulte. Il continue de chanter La Musique.
À la fin de cette chanson, une vingtaine de jeunes gens s’approchent de la scène, et, troublé, Ferré les écoute. « Tu ne comprends pas ? Il y a les flics, dehors ! » « Pourquoi les flics ? » « Parce qu’il y avait des types qui voulaient entrer sans payer ! » « Les cons, il n’y a qu’à ouvrir les portes ! » On s’est un peu bousculé, on s’apaise. « Dis-le très fort, Ferré, qu’il faut ouvrir ! » Il le dit.
Le calme revient lentement. Les jugements sur l’incident sont divers. D’aucuns laissent entendre que l’on profite qu’il s’agit d’un chanteur de « gauche » pour s’en prendre à lui. Lui, répète « je ne pouvais pas le savoir, qu’il y avait les flics dehors, comme ça, que les flics partent ! »
Il chantera et dira encore « les violons de l’automne », Marie, Ni Dieu ni maître, qui le fait acclamer, la salle enfin gagnée, et, parce qu’on lui demande un « bis », Thank you Satan.
Mardi à Toulouse, une rude soirée pour le roi Léo.
[non signé].
Quelques années plus tard, lors d’une entrevue avec le poète, nous avons évoqué ce récital de la Halle aux Grains de mai 1979. C’est alors qu’il eut ce commentaire sans appel : « Ce soir-là, c’était vraiment la Halle aux cons ! »

Léo Ferré par Carlos Pradal, La Dépêche du Midi, 1971.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 24 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 1/3
Je remercie une fois encore Jacques Miquel qui a fait pour nous le long panorama des spectacles donnés par Léo Ferré à Toulouse, depuis 1965. Sa note est si fournie qu’elle paraîtra en trois fois, tout au long de cette semaine : aujourd’hui lundi, puis mercredi et enfin vendredi. Bon voyage archivistique et musical en Occitanie.
« On s’aimera »
Il a fallu attendre 1965 pour voir enfin Léo Ferré se produire sur une scène toulousaine, et encore c’est en empruntant des chemins vicinaux qu’il vint à la rencontre de ce public, puisque son premier spectacle eut lieu à Noé, commune rurale située à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. Là, du 2 au 5 juillet se déroulaient les fêtes annuelles de la Belle Gaillarde, c'est-à-dire une vaste fête foraine avec quotidiennement des spectacles de variétés, des jeux, des concours et des animations, bal tous les soirs et grand feu d’artifice de clôture. En outre, le dimanche après-midi se déroulaient l’élection de la Belle Gaillarde, robuste miss labours, puis le tour de chant d’une grande vedette (Enrico Macias en 1964, Léo Ferré en 1965, Johnny Hallyday en 1966, etc.) En réalité, il s’agissait des manifestations festives les plus importantes de toute la région toulousaine, et peut-être que la tenue de ces grandes fêtes dans un si petit village n’était pas étrangère à l’influence de Jean-Baptiste Doumeng, « le milliardaire rouge » dont Noé constituait le fief électoral.
En tout cas, ce dimanche 4 juillet 1965 après-midi, en plein air et sous un soleil radieux, Léo Ferré présenta son récital devant un public fourni prenant ses aises dans l’herbe d’un champ commun. La majorité de ces spectateurs découvrait cet artiste vêtu d’un singulier costume de scène de velours noir et accompagné d’un pianiste aveugle. Si j’en crois les bribes de souvenirs de cette journée que m’a confiées il y a peu une de mes proches qui assista à cet événement artistique, ce fut vraiment un concert exceptionnel dans lequel autant les textes que la musique soutenus par une voix maîtrisée et une présence scénique hors du commun soulevèrent l’enthousiasme de la foule…
Palais des Sports de Toulouse, 27 novembre 1965
Quant à la première apparition de Léo Ferré à proprement parler sur une scène toulousaine, elle allait avoir lieu au Palais des Sports, vaste salle au confort spartiate sur laquelle il convient de dire quelques mots.
Érigée au XIXe siècle pour abriter le négoce du blé, cette halle a surtout servi de marché couvert jusqu’à la Seconde guerre mondiale, quand elle resta un temps désaffectée. En 1952, des gradins en béton furent construits et avec une capacité dépassant largement les trois mille places assises, le lieu fut rebaptisé Palais des Sports et voué aux combats de boxe et de catch mais aussi aux spectacles de cirque, matinées enfantines, festivals de rock, galas de variétés, etc. À la fin des années 70, la salle fut dévolue à l’Orchestre national du Capitole en raison de son acoustique exceptionnelle et en retrouvant son appellation première de Halle aux Grains, bénéficia de modernisations visant à améliorer le confort et à favoriser la représentation de grands spectacles lyriques comme les opéras wagnériens. Devenue un des hauts lieux de la musique toulousaine tous genres confondus, la Halle peut accueillir aujourd’hui jusqu’à deux mille trois-cents spectateurs.
Le gala de Léo Ferré était annoncé d’une part par un encart publicitaire dans Le Monde libertaire de novembre 1965 et d’autre part par deux articles non signés dans les colonnes du journal La Dépêche du Midi et complétés de plusieurs encadrés en page des spectacles. Rappelant qu’il s’agissait là de son premier récital à Toulouse, l’auteur d’un des articles rapportait ce propos récent du poète : « J’espère faire un grand gala, et je compte beaucoup sur le public toulousain que je sais très difficile. » Par ailleurs, le quotidien ne disait pas un mot sur l’organisateur de la soirée, en l’occurrence le Groupe libertaire de Toulouse. C’est sans doute lui qui avait assuré l’affichage publicitaire dont on peut déplorer la discrétion, ce qui explique en partie l’affluence limitée pour cette première toulousaine. Y avait-t-il seulement mille spectateurs ? En tout cas, les gradins et travées semblaient très clairsemés alors que, comme en attestent aussi bien le compte-rendu de La Dépêche que celui du Monde libertaire, la soirée fut de très grande qualité. En première partie, Rosalie Dubois se tailla notamment un très beau succès.
À l’entracte, tandis que la salle prenait des allures de meeting politique, on pouvait apercevoir du côté des coulisses Madeleine Ferré faisant savoir que « l’artiste ne recevait pas », l’artiste qui enfin parut sur scène et dont le premier soin fut de demander aux spectateurs du balcon et des galeries de rejoindre ceux de l’orchestre afin que cela fasse moins vide ! Ce récital dont les articles ci-après mentionnent, parfois de façon approximative, les titres des chansons interprétées, fut pour moi celui de la découverte.
Le Monde libertaire, novembre 1965.
La Dépêche du Midi du 30 novembre 1965.
Pour son unique récital, Léo Ferré toujours égal à lui-même a connu un grand succès.
Il est depuis longtemps inutile de présenter Léo Ferré au public, grand ou petit, chacun l’ayant plus ou moins entendu sur les ondes, plus ou moins applaudi, plus ou moins critiqué, plus ou moins admiré.
On prétend que c’est un intellectuel, un littéraire, un compliqué, un « brave type », etc. Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas yéyé, ce terme n’étant pas a priori péjoratif, et qu’il est un des plus populaires chanteurs actuels, avec « l’ours » Brassens.
Il est franc dans ses chansons comme dans sa vie, et si entre deux sanglots soudain jaillit la pointe d’une ironie amère, c’est probablement cette ironie qui lui ôte les suffrages des « chastes oreilles » et des « bien pensants ».
Samedi soir, au grand gala Léo Ferré, nous avons retrouvé et avec quelle joie, l’un des plus authentiques troubadours de notre époque, et peut-être l’un des moins compris.
En première partie, une équipe de jeunes « chauffa » la salle. Les idoles des jeunes préparaient le terrain pour l’idole des… moins jeunes.
(…) Enfin, venait Léo Ferré, après un interminable entracte qui n’en finissait plus. Salué dès son entrée par un tonnerre d’applaudissements, il devait pendant plus d’une heure, tenir la salle en haleine, en interprétant, accompagné par son pianiste aveugle, Paul Castanier, une bonne vingtaine de chansons.
Ce nouveau récital, puisque nouveau récital il y avait, comportait entre autres, les titres suivants qui seront bientôt célèbres : Espana la vida, La Mélancolie, Bagnard, Le Temps du plastique, La Chanson des amants, Ni Dieu ni maître, etc.
Les titres changent, les chansons se renouvellent, les airs se modifient, mais le « grand Ferré » demeure. Il est toujours là, tendu, révolté, cynique, mélancolique, langoureux. Sous l’éclairage des « sunlights », sa silhouette épaisse et désinvolte projette sur la salle l’ombre d’un « brave type » génial. Il chante la vie et les passions humaines, balayant l’assistance d’un œil humide et doux.
Il fut rappelé plusieurs fois, et finalement, dans une apothéose, il embrassa son pianiste et partit en le tenant par le bras.
Quand on leur demanda leur avis sur ce récital, beaucoup le trouvent bon. Beaucoup plus encore le trouvent excellent. Pour moi, ces critères sont vagues. Si on me demandait mon avis, je répondrai simplement : « C’était du Léo Ferré ». Ce qui se passe de commentaires.
[non signé].
Le Monde libertaire, janvier 1966.
Gala Léo Ferré à Toulouse [27 novembre 1965].
L’immense salle du Palais des Sports nous a appartenu… pour un soir. Pour un soir, le Groupe libertaire de Toulouse a pu donner la pleine mesure de ses moyens. Et quels moyens ? Des copains au contrôle, à la caisse, à la criée du M. L., à la régie… Pour un soir, le Palais des Sports a été l’antre de l’Anarchie.
C’était bien la première fois qu’un groupe libertaire en dehors de Paris organisait un grand gala. Avec l’aide notre amie Suzy, nous avons pu avoir le brave Léo, Léo Ferré et la bonne chanson…
(…) À l’entracte, les livres et les disques furent enlevés par un public avide de savoir, de connaître notre pensée, nos théoriciens. La récolte se fera, amis !
Franco la muerte, Graine d’ananar, voici Léo Ferré, voici notre vedette tant attendue. Madeleine, dans les coulisses, règle les éclairages rouges, blancs, jaunes, qui, tout à tour, viendront nuancer, souligner de leurs effets savamment calculés, la poésie chantée du Ravachol de la chanson. Un applaudimètre aurait explosé ! Quelle chance que tu as eue Léo pour ton premier gala à Toulouse ! et quelle chance nous avons eue nous aussi ! Faut-il dire tout ce que tu as remué dans les esprits et dans les cœurs de ces jeunes gens venus t’écouter ?
Qu’ici soient remerciés tous nos amis connus et inconnus, qui ont participé à la réussite de cette manifestation libertaire, que les artistes le soient encore, ainsi que Suzy à qui nous devons ce beau plateau. N’oublions pas de signaler qu’après l’entracte, une allocution fut lue au public par notre camarade J.-C. Bruno, afin de bien marquer notre position face aux événements sociaux actuels. Elle fut vivement applaudie… et ce n’est pas pour avoir rempli la salle de copains espagnols car ils se sont sagement abstenus ce soir-là.
Des copains de Tarbes, Bordeaux, Agen et d’ailleurs étaient venus nous encourager et nous donner un bon coup de pouce. Merci à tous.
Le Groupe libertaire de Toulouse.
Palais des Sports de Toulouse, 20 mars 1968
J’ai longtemps pensé qu’il m’avait été donné de voir un spectacle de Léo Ferré au Palais des Sports de Toulouse en 1966 ou 1967, mais si j’en crois les archives de La Dépêche du Midi, il n’en a rien été. Peut-être s’agit-il là d’un « concert de rêve » ? En tout cas, c’est réellement à un nouveau récital que j’ai assisté au même Palais des Sports le 20 mars 1968. La soirée était organisée par l’ENSEEIHT, grande école d’ingénieurs de Toulouse et qui produisait alors annuellement le festival N’7, composé d’une série de manifestations culturelles. L’invitation faite à Léo Ferré témoigne au passage de l’intérêt qu’il suscitait dans les milieux estudiantins dès avant mai 1968.
Dans la semaine précédant le spectacle, trois articles de La Dépêche du Midi le chroniquaient en évoquant entre autres la vie idyllique de l’artiste à Saint-Clair auprès de son épouse et entouré d’une horde d’animaux familiers. Histoire de mettre le public en condition, un des articles avançait que « l’on ne va pas à Léo Ferré l’âme sereine [car] il y a chez lui de l’objecteur de conscience ». Le propos était renforcé par quelques citations parmi lesquelles cet aveu assez réaliste : « J’aime l’époque où je vis même si je la critique. C’est l’ère des tyrans au berlingot. »
Depuis sa dernière apparition toulousaine, l’audience s’était nettement élargie et cette fois-ci c’étaient plus des deux-tiers des places du Palais des Sports qui avaient été réservées. Le répertoire de Léo Ferré de ce soir-là, qui était accompagné au piano par Paul Castanier, correspondait à celui présenté à Bobino à l’automne 1967 et, comme là, ce qui surprit sans apparemment heurter qui que ce soit, c’était le recours aux bandes magnétiques orchestrées pour quelques titres : Cette chanson, Spleen, La Marseillaise et la chute à l’accordéon pour À une chanteuse morte (cf. Ce qu’on disait du récital donné à Bobino en 1967 et commentaires.) La sincérité des interprétations du poète semblait atteindre la plus grande profondeur et le succès fut considérable, comme en témoigne l’article de Marie-Louise Roubaud paru le surlendemain dans La Dépêche. En fait, à ce moment-là, ce qu’ignorait la journaliste comme le public toulousain, c’est qu’en ce 20 mars 1968, la vie conjugale du couple mythique formé par Léo et Madeleine était en train de basculer vers la rupture définitive, provoquant la dispersion dramatique de la ménagerie de Perdrigal.
La Dépêche du Midi du 22 mars 1968.

Léo Ferré par Carlos Pradal, La Dépêche du Midi, 1968.
Point de vue – Festival N’7 : Ferré le grand.
Il ne ressemble à personne et personne ne lui ressemble.
Une crinière rousse, un visage de statue de commandeur, des yeux de chat, les gestes pathétiques du mime, une voix qui tonne comme l’orgue ou qui tremble comme l’archet du violon, c’est Léo Ferré, poète terrible et vieux routier du music hall, sorti pour un soir de sa retraite de Saint-Clair pour chanter sous les projecteurs du Palais des Sports.
Avec l’humour en dents de scie qui provoque quelques grincements de dents, avec les mots de la rue auxquels il donne une nouvelle noblesse, Léo Ferré décrit d’après nature une époque qui est la nôtre et sur laquelle il promène un regard sans complaisance. Ce n’est pas sa faute si cette peinture-là tient de la caricature et de la parodie. Qui aime bien châtie bien. Aussi Léo Ferré manie-t-il l’invective avec hardiesse, sans merci.
Il ne mâche pas ses mots. Sa pensée est sans détours et c’est dans l’univers du spectacle où règne une conspiration du silence, la seule voix qui ose réellement dire non. Sa chanson sur Piaf « Bayreuth de trottoir », lui a valu quelques ennuis avec son éditeur. La censure, une fois de plus, nous prive d’un chef-d’œuvre.
Cet homme qui hurle « Thank you Satan » avec une tête de Christ aux douleurs, croit-il en Dieu ou au diable ?
Ce n’est pas par hasard, on s’en doute, qu’il a mis en musique Aragon, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire.
Pour lui aussi « l’art est un vampire » et ne le dirait-on pas né sous le signe fatidique de Saturne, cette « fauve planète » commune aux poètes qu’on appelle maudits ? Cette complicité qui unit d’instinct, au-delà du temps, les poètes de même race explique sans doute les réussites de ces mises en chansons. Si Victor Hugo avait connu Léo Ferré, peut-être n’aurait-il pas défendu qu’on dépose de la musique le long de ses vers.
Qui a, une fois vu et entendu Léo Ferré chanter Le Spleen de Baudelaire avec son visage de revenant et ses belles mains désespérées qui semblent porter le poids de la terre entière, se sent pris à son tour d’un vertige.
Au prix de quelles angoisses Léo Ferré a-t-il payé ce don de sincérité ? Ses propres chansons nous le disent assez bien où il exhale ses plaisirs et ses haines, ses amours aussi. Car cet anarchiste-né, ce fauve solitaire a des accents bouleversants de passion et de tendresse, dont on sait qu’ils s’adressent à une seule femme : Madeleine Ferré, la Muse qui ne le quitte jamais, qui est là, dans les couloirs, à veiller aux nombreux détails de son récital.
Peu d’interprètes et de compositeurs prennent aujourd’hui le risque de chanter seuls pendant près de deux heures comme Léo Ferré l’a fait, l’autre soir, pour un public de deux mille étudiants qui l’ont rappelé par trois fois. Quels artistes d’ailleurs supporteraient la confrontation sur une scène avec ce diable d’homme ? À cinquante ans passés, Léo Ferré, l’irréductible, reste dans le camp des jeunes qui reconnaissent en lui le romantisme de leur propre révolte.
Mais dans la France de Mireille Mathieu, ces pamphlets vengeurs qui sentent le soufre et où Léo Ferré se révèle un prodigieux jongleur de mots, n’ont pas, on s’en doute, la faveur de tous les publics.
Qu’importe à Léo Ferré qui n’est jamais rentré dans le rang. Les modes passeront ; Léo Ferré, lui, restera…
M.-L. R.
Cinéma Le Trianon de Toulouse, 5 décembre 1968
La page des spectacles de La Dépêche du Midi annonçait pour ce 5 décembre au Palais des Sports « Le géant Ferré, champion du monde toutes catégories », mais il s’agissait là d’un combat de catch ! Quant au poète, c’est de façon plus discrète que, moins de neuf mois après sa dernière prestation toulousaine, il était de retour dans la ville rose, investissant cette fois-ci la scène du cinéma Le Trianon, qui pour une soirée retrouvait sa vocation première de théâtre.
Les journalistes signant les articles présentant le spectacle de Léo Ferré se contentaient soit de reproduire des passages entiers de la monographie de Gilbert Sigaux, soit de résumer le dossier de presse concocté par la maison Barclay et dont certaines allusions à Madeleine Ferré dataient cruellement. Aussi, rien ne transparaissait sur les avatars de la vie privée de l’artiste et la plupart des spectateurs qui occupaient les mille trois-cent cinquante fauteuils du Trianon ignoraient tout de cela. Mais le nouveau répertoire, qui préfigurait celui présenté à Bobino à partir du 15 janvier suivant, ressemblait bien à une somme de confidences douloureuses, particulièrement les inédits comme Pépée, Le Testament, ou À toi qui donnaient sa tonalité mélancolique au tour de chant, tonalité renforcée par la nostalgie de pièces anciennes telles L’Étang chimérique et plus encore L’Amour (1956) magnifiquement accompagnées au piano par Paul Castanier. Cette impression était confirmée dès l’entracte pour ceux qui achetèrent le livret Mon programme 1969, un rapide coup d’œil sur le texte Mes enfants perdus ne laissant aucun doute sur les événements qui s’étaient tramés peu de temps auparavant près de Gourdon. Les autres chansons inédites comme L’Été 68, Les Anarchistes ou Madame la Misère, également accompagnées au piano, enflammèrent le public sans toutefois parvenir à dissiper complètement le sentiment de tristesse dans lequel baignait tout le récital.
La Dépêche du Midi du 5 décembre 1968.
Au Trianon, Léo Ferré : « Je suis un bon client de la tristesse ».
Comme à chaque fois Léo Ferré arrive les mains dans les poches, sans sonorisation, sans orchestre, avec pour seul accompagnateur son pianiste aveugle, et cette fois, sans Madeleine. La veille, il était à Bordeaux, et pour venir à Toulouse, il a fait un détour par Saint-Clair, où, il y a huit mois encore, il vivait dans une maison qui était un refuge :
« C’est à présent une maison morte. Il s’est passé dans ma vie, depuis mars dernier, des drames dont je ne veux pas parler… »
On sait seulement que la guenon « Pépée » est morte et que Madeleine est partie.
Voilà Léo Ferré rendu à la solitude, donc à lui-même.
« On ne voyage pas, on bouge. On n’emporte que soi, et c’est lourd à porter.
Sur les routes, en semaine, on ne rencontre que les routiers et les artistes de music hall. Nous faisons, les uns et les autres, de très longues étapes.
Je me suis toujours senti un peu déraciné, n’importe où que je sois. Je ne fais jamais de projets. C’est trop présomptueux. Les autres en font pour moi. Désormais, je me sens bien avec mes compagnons de fortune… et d’infortune.
Je ne me mêle jamais des affaires de mon destin. Je pense que, de toutes manières, on ne choisit pas. Des regrets ? Non je n’en ai pas. En vivant, on fait du passé, et je ne peux pas regretter de vivre.
Je suis un bon client de la tristesse. D’ailleurs, la beauté, c’est toujours triste, c’est les larmes.
Chaque soir, plus je chante et plus je me sens triste, et plus j’ai mal. C’est inexplicable. Chanter n’est pas un devoir, mais c’est quelque chose de plus effrayant. On est tout seul et il faut rester soi. Et puis, toutes les trois minutes, il y a une cassure, le public qui intervient, qui applaudit ou qui n’applaudit pas. Sur scène, chaque soir, je me montre, je vends quelque chose de moi qui est ma voix… et je me demande si, après tout, ce n’est pas pareil que les femmes qui vendent leur corps. »
Des êtres avec qui Léo Ferré a eu plus d’affinités, l’un n’est plus, l’autre s’est éloigné : « Il y avait d’abord André Breton qui était un être magnifique… et puis ma femme Madeleine.
L’absolu mais ça n’existe pas. L’amour absolu c’est Roméo et Juliette. Oui, mais ils sont morts… »
« L’anarchie, un état d’âme ».
Le sentiment angoissant du temps qui passe, du bonheur qui ne dure pas, la fascination morbide du néant ont toujours habité l’âme tourmentée du poète Ferré. « Ce qui nous caractérise nous, Méditerranéens, c’est la sensibilité. L’anarchie, c’est quoi ? C’est un état d’âme. »
Et Léo Ferré sait de quoi il parle, lui qui, dans ses chansons, tire à boulets rouges.
« La poésie est une fureur qui se contient juste le temps qu’il faut. »
Aujourd’hui, ces textes d’hier sonnent si juste qu’ils semblent prophétiques. Sans doute les événements de mai ont apporté de l’eau au moulin de cet homme qui n’a pas cessé de se battre.
Jamais Léo Ferré n’a été aussi vivant dans le cœur de la jeunesse. Ses dernières chansons sur les barricades ont soulevé des vagues de bravos, l’autre soir, dans le Trianon, plein à quatre-vingt-dix pour cent d’étudiants.
L’accueil que ces « enfants de mai » ont fait au chanteur est de ceux qui prouvent avec évidence que la révolution d’il y a six mois était vraiment celle de l’intelligence.
On a assisté l’autre soir, entre le public et le chanteur, à une de ces « communications magnétiques » qui tiennent du miracle.
Et quand Léo Ferré, sur des musiques à donner le frisson, crie : « Tu ne m’as pas dit que les guitares de l’exil sonnaient parfois comme un clairon, toi mon ami l’Espagnol » quand il se livre à une caricature au vitriol de la vie moderne ou bien quand il rend hommage aux « enragés qui dérangent l’histoire », aux anarchistes « qui ont l’âme rongée par de foutues idées » et qui sont, après tout, les mêmes qui « pour tout bagage, ont vingt ans », on n’est pas loin de penser que les générations d’aujourd’hui trouvent dans cet homme de plus de cinquante ans, leur plus impitoyable moraliste.
Cet art de l’invective serait évidemment sans effet si Léo Ferré n’était pas aussi un vieux lion de la scène qui connaît son métier par cœur, qui sait jouer de sa voix avec un art consommé.
« L’essentiel sur scène, c’est de ne pas en faire trop » dit-il.
Et puis, il y a ce visage romantique, tourné comme une figure de proue, un visage auquel les feux de la rampe, donnent parfois une allure spectrale…
M.-L. Roubaud.
1965-1968. Ces quatre rendez-vous avec le public toulousain qui semblait murmurer au poète : « On s’aimera », laissaient bien augurer des récitals à venir. Hélas, les choses ne furent pas toujours aussi faciles et tournèrent parfois à des rapports pour le moins rugueux.

Toulouse, décembre 1968 – D.R.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (9)
samedi, 28 avril 2007
Errata, par Jacques Miquel
Lors de la réunion des éléments devant servir à la rédaction de la notice intitulée Instantanés de la vie de René Baer mise en ligne le 17 mars 2007, plusieurs poèmes de guerre inédits attribués à René Baer ont été cités à tort. En réalité, la poursuite de l’examen de ces textes a permis d’établir ces derniers jours qu’il s’agissait de poèmes écrits par Louis Baer (1886-1984), frère aîné du poète. Jacques Miquel a donc signalé cette erreur à Jacques Layani en le priant de bien vouloir modifier en ce sens la notice consacrée à René Baer. Cette correction a également donné lieu à une actualisation de certains passages, notamment concernant les chansons co-signées René Baer-Léo Ferré, une œuvre manquante ayant pu être identifiée grâce aux indications de Mathieu Ferré, que nous saluons ici. De même des précisions ont pu être apportées sur le recueil de poésie posthume de René Baer, ainsi que sur des points de moindre importance. Jacques Miquel présente ses excuses aux visiteurs du blog Léo Ferré, études et propos et remercie Jacques Layani, son « taulier », de sa patiente et amicale compréhension.
12:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (0)
samedi, 17 mars 2007
Instantanés de la vie de René Baer, par Jacques Miquel
J’ai demandé à Jacques Miquel de nous présenter René Baer dont on ne savait pas grand-chose jusqu’à présent. Cette idée n’était pas mienne : l’ami Patrick Dalmasso me l’avait soufflée il y a quelque temps déjà mais je n’ai pu trouver ni le temps ni, surtout, l’information nécessaire. Jacques Miquel, dont on connaît les notices précises et très intéressantes consacrées à Sabaniev, Jamblan ou Cecco, était tout désigné pour faire revivre pour nous l'auteur de La Chambre. Il a bien voulu se charger de ce travail et, une fois encore, je l’en remercie vivement.
À madame Nadine Baer
Le Banco du diable
« Aussi loin que remonte ma mémoire j’ai joué.
J’ai joué dans des salons aux lambris dorés et dans des bouges infâmes, dans de sévères bibliothèques et au milieu de jazz, dans les bois, sur la plage, dans des salles d’étude et dans des maisons de rendez-vous, dans des casernes, des hôpitaux, des tranchées, en fiacre, en bateau, en chemin de fer, à l’Opéra, en cabinet particulier, dans la cave et à la cuisine, dans des cercles fermés ou largement ouverts, dans des casinos, des bars, des tavernes… J’ai joué partout.
J’ai joué avec de vieux Parisiens et de jeunes Turcs, avec des grands-ducs et des nihilistes, des héros et des déserteurs, des magistrats et des interdits de séjour, des douairières et des filles, des moralistes et des maquereaux… J’ai joué avec tout le monde.
J’ai joué aux cartes, aux dés, aux dominos, à la boule, aux échecs, au billard ; j’ai misé sur des matches de boxe ou de football, j’ai parié aux courses de chevaux, de bicyclettes, de chiens ; j’ai spéculé sur la baisse du coton et la hausse du saindoux ; j’ai acheté des tramways et vendu des mines… J’ai joué à tous les jeux.
Les exquises sensations que j’ai éprouvées, ont suffi à mon bonheur. Que ce bonheur soit ou non de qualité, que m’importe ! Il ne m’a apporté ni la gloire ni la fortune, mais j’y ai gagné d’impérissables souvenirs, qui me consolent de ne plus pouvoir me livrer, aujourd’hui qu’aux joies un peu fades des réussites. »
C’est au seuil de la cinquantaine que René Baer éprouve le besoin de livrer au public cet autoportrait dans les colonnes de Confessions, hebdomadaire à sensation que Georges et Joseph Kessel publient de novembre 1936 à juin 1937 et dont chaque numéro propose un recueil de confidences faites par des personnalités de divers horizons. Ainsi, le sommaire du n° 18 du 1er avril 1937 se compose-t-il, outre l’article de Baer, des souvenirs de la première Miss France, d’une interview des fantaisistes Pills et Tabet, des fadaises d’un député persécuté par le fisc, des révélations d’un malade atteint de satyriasis, des états d’âme d’un Garde républicain, et d’un feuilleton signé Georges Simenon.
Quant à la confession qui nous occupe plus particulièrement, elle est intitulée J’ai joué ! et sous-titrée « Contre tous et même contre moi, J’ai joué ! avoue sans remords René Baer ». Au-delà de la ballade en prose dans laquelle il expose sans détour son dada, l’homme évoque dans ces lignes son enfance choyée et son adolescence étourdissante sur fond de Belle époque. Issu d’un milieu culturellement et matériellement privilégié dans lequel l’oisiveté n’est cependant pas de mise, René Baer grandit à contre-courant des idéaux familiaux, se montrant peu ardent aux études commencées au lycée Carnot à Paris, aussi peu attiré par le piano dont il prend quelques leçons et encore moins par l’équitation qu’il abandonne rapidement. Non, le feu qui dévore le jeune Baer c’est bien le jeu dans toutes ses manifestations et, tout au long de sa jeunesse, il fréquente les lieux de prédilection des joueurs où il côtoie aussi bien des capitaines d’industrie que de grandes courtisanes comme la Belle Otéro.
Le service militaire en 1907 et surtout la mobilisation dans l’infanterie en août 1914 [1] mettent entre parenthèses cette vie étincelante et désormais pour le Poilu Baer, l’enjeu consiste avant tout à sauver sa peau. Pendant ces années de guerre, on peut le suivre notamment en première ligne des fronts de Woëvre et de Champagne. Le journal de marche du 124e Régiment d’Infanterie dans lequel il sert comme mitrailleur à partir de juillet 1916, dans le secteur de Ville-sur-Tourbes, montre toute l’âpreté des heures passées dans la boue des tranchées avec la menace permanente du recours au gaz et le lot quasi quotidien de blessés et de tués. C’est de là que René Baer est évacué en septembre 1916 pour « maladie contractée en service commandé ». Après plusieurs hospitalisations, il est versé dans l’auxiliaire avant d’être définitivement réformé en septembre 1918.
Après l’Armistice, ayant « les moyens de mener cette existence coûteuse » [1] il se remet à fréquenter quotidiennement champs de course et cercles de jeux. Illustrant le propos, une photographie prise au temps des années folles le montre au pesage, en habit et haut-de-forme, en compagnie d’une belle élégante… Curieusement, ce passé de flambeur qu’il évoquait avec beaucoup de complaisance n’est pas resté ancré dans la mémoire familiale comme un trait dominant de sa réputation, peut-être parce que cette passion s’est finalement dissipée à la faveur de son mariage puis de la naissance de son fils au début des années 20. Enfin, si dans les pages de Confessions René Baer se révèle particulièrement disert sur sa marotte, en revanche il ne se livre à aucun étalage de sa vie intime ou de ses autres activités, notamment artistiques, dont certaines découvertes montrent qu’elles n’avaient rien de négligeable.
Du « chevalet d’illusion » au « mirage de l’art »
Homme d’esprit et artiste dans l’âme, les dons de René Baer semblaient pouvoir s’exprimer dans diverses disciplines sans qu’il ait peut-être su privilégier l’une d’entre elles. Bibliophile raffiné, amateur d’art collectionnant notamment des œuvres du dessinateur Pasquin, il était lui-même peintre à ses heures et faisait preuve d’une grande sensibilité comme en témoignait un Sarrazin à tête de radis longtemps accroché aux cimaises familiales. Mais au-delà des arts plastiques, c’est sans conteste l’écriture qui mobilisait sa fibre sensible, et il est certain qu’il s’est toujours plu à écrire des pièces en vers, qu’il s’agisse de parodies enfantines ou de textes marquant les moments les plus sombres de la vie.
Le monde de l’enfance, dont il n’était peut-être jamais complètement sorti, lui inspira plus tard diverses créations musicales. Ainsi signa-t-il, sous le pseudonyme de Vittonet, huit chansons [2] adaptées pour le Théâtre du Petit Monde par Pierre Humble, alors directeur de cette salle de spectacles pour enfants créée à Paris en 1919. Les thèmes de ces ritournelles comme Miss et Nounou ou Qui est mon marquis confirment qu’il évolue dans ce qu’il est convenu d’appeler la « bonne société ». Quelques indices en disent un peu plus sur ses relations sociales du moment : une de ses chansonnettes est dédiée à l’épouse du peintre paysagiste Pierre Jeanniot, directeur du Journal amusant et auteur dramatique pour le Grand Guignol. Une autre adresse est pour l’actrice de cinéma Gisèle Parry… En 1928 les éditions Roubanez publient Les Chansons de Vittonet sous forme de recueil illustré par Étienne Ret [3]. Trois ans plus tard, c’est encore pour le Théâtre du Petit Monde que son nom est associé aux partitions de la comédie musicale Bicot, Suzy et Cie qui met en scène les personnages de comics imaginés par l’Américain Martin Branner.
La crise de 1929 ayant englouti les années folles, le misérabilisme offre à l’occasion de nouvelles sources d’inspiration. C’est dans ce registre bien particulier que s’inscrit la chanson Le Coup dur qu’il écrit sous le nom de Vittonet en 1930 : « J’suis née j’sais pas quand / Je sais pas où, de qui ? / Je n’en sais rien du tout (…) Sans connaître un seul bon moment / J’ai grandi n’importe comment / Sur l’macadam / N’avoir quelle malchance / Comme souv’nirs d’enfance / Qu’ des jours de souffrance / C’est l’ coup dur (…) Probable que c’était mon destin / De finir chez les purotins / Et sans amour (…) Mais y a rien à faire / Moi je n’ai qu’à m’ taire / Mon gros lot sur terre / C’est l’ coup dur ». Lucienne Boyer prêta sa voix aux intonations dramatiques à cette complainte réaliste [4]. À peu près à la même époque, la goualeuse Gaby Montbreuse enregistra Tu vas imaginer des choses, également signée Vittonet pour les paroles et Jean lenoir pour la musique.
Quant à l’origine du pseudonyme Vittonet, Nadine Baer se souvient qu’en famille, son oncle René était surnommé « Vuitton » à cause des valises qu’il portait… sous les yeux ! D’autres œuvres sont susceptibles d’avoir été écrites sous ce sobriquet comme par exemple celle interprétée plus tard par Maurice Chevalier [5]. Toujours dans ces années 20 et 30, René Baer a parfois recours à un autre nom de plume, Teddy, pour publier quelques articles sur la danse ou le cinéma qu’il place auprès de quotidiens comme Le Petit Journal et L’Intransigeant [6]. Il y a fort à parier qu’à l’origine de cet autre pseudo, on trouve une nouvelle facétie de cet éternel enfant, Teddy étant une allusion à peine voilée à l’ours américain Teddy Bear, Teddy Bär en allemand, et dont la phonétique [ber] renvoie à la prononciation du patronyme Baer.
Cette période de l’entre-deux-guerres s’avère particulièrement propice à la diversification d’expériences créatives comme l’illustrent d’une part le scénario et les dialogues que René Baer écrit pour le film Heure d’été [7] et d’autre part la sortie en 1937 de sa première œuvre littéraire, le roman Frédéric [8].
Dédié à l’académicien Pierre Benoit, l’ouvrage tient plus de la pochade que du roman, ainsi que le suggère au premier coup d’œil la couverture illustrée par Dignimont [9]. Sur un ton résolument frivole, l’auteur raconte la vie mouvementée de Frédéric Ribidy, un doux rêveur dépourvu d’ambition, devenu malgré lui un puissant de la terre et, réellement à son corps défendant, l’esclave d’une maîtresse tyrannique. Le cadavre de celle-ci est retrouvé découpé en morceaux, ce qui vaut au héros d’être injustement condamné aux travaux forcés et expédié au bagne de Paprika. Loin de s’y morfondre, paradoxalement il découvre la liberté, se vivifiant au grand air en cassant des cailloux et jouant au bridge avec le gotha pénitentiaire. Ce séjour est prétexte à de nombreux rebondissements plus ou moins cocasses, parfois à la limite du cynisme, et il serait vain de rechercher dans cette farce une quelconque trame autobiographique. Toutefois, les personnages-clés paraissent emprunter aux conceptions intimes de l’auteur notamment en ce qui concerne sa misogynie larvée, peut-être liée à une séparation mal vécue. Ainsi la mère de Frédéric, mégère atrabilaire ennemie des plaisirs et des arts, est présentée comme la « championne incontestée de la Grande Morale Bourgeoise ». Quant à l’homme, il a souvent le beau rôle comme le père de Frédéric, être charmant et pacifique, habitué des fredaines tarifées qui est considéré par l’auteur avec la plus grande indulgence. Il est toutefois un personnage pour lequel Baer semble avoir scruté son miroir avant d’en esquisser les contours, au physique comme au vécu, et qui dans l’histoire s’identifie au meilleur ami de Frédéric, le bien nommé Lesage. Incorrigible parieur né dans l’opulence, ayant perdu au jeu une partie de la fortune héritée de sa famille, « assez doué, mais foncièrement paresseux, il n’a qu’une idée : celle de ne rien faire ». Tirant ses ressources d’une maigre pension allouée par un cousin et complétée par des piges chichement rétribuées, bien que déçu par l’amour et poursuivi par la déveine, il demeure d’un optimisme forcené.
Pas plus que les chansons de Vittonet ou les articles de Teddy, le roman Frédéric n’apporta le succès à René Baer, qui semblait aborder presque avec insouciance la nouvelle décennie sur l’air d’une Java des Poilus [10] qui parlait d’une autre guerre…
Paroles de René Baer, musique de Léo Ferré
Pour ce qui concerne la guerre, on sait que René Baer a déjà largement donné. Il en connaissait l’horreur, il allait en découvrir l’ignominie. Au début des années 40, lorsqu’à l’état-civil on se prénommait René-Salomon, même Français de naissance et ancien combattant, il ne faisait pas forcément bon vivre à Paris ; lorsque de surcroît sa dame de cœur du moment était à la fois juive et allemande, il était plus prudent de mettre de l’espace entre soi et les quais de la Seine. Monaco s’imposa rapidement comme la villégiature la plus acceptable, parce que d’une part le meilleur ami d’enfance de René Baer y vivait, et que d’autre part le Rocher faisant partie de la zone italienne d’occupation, c’était la garantie très relative de ne pas y subir les lois raciales avec les mêmes rigueurs que sur le territoire français. C’est donc dans ce décor pour poupées baignant dans l’ambiance glauque de l’Occupation que René Baer passa ces années. Bien des années après, il a été décrit comme un vieux monsieur lié d’amitié avec le directeur adjoint de la Société des Bains de Mer, offrant au fils de celui-ci, musicien débutant, six de ses textes pour qu’il les mette en musique. Le musicien débutant étant Léo Ferré, il n’est pas superflu de revenir à ce qu’il en a lui-même dit :
« On avait fait six chansons, dont La Chambre et Le Scaphandrier que je chante là. Leurs paroles sont admirables. C’est un type que j'ai connu à Monaco, où il était un peu réfugié. Un type formidable, très gentil. Un peu plus âgé que mon père, donc il est mort depuis assez longtemps. Et, voyez-vous, c’est ça la musique : on ne saurait plus qui c’est, s’il n’y avait pas ces deux chansons-là. » [11]
Dans d’autres entretiens, Ferré reprend l’essentiel de cette déclaration, avec la plupart du temps la référence à l’âge de son père pour situer celui de René Baer [12]. Il semble bien que certains auteurs aient interprété cette identité de génération comme une amitié, si bien que l’artiste prit la peine de préciser que René Baer était un ami à lui et non à son père [13]. On éprouve d’ailleurs quelque difficulté à imaginer le rigoriste Joseph Ferré sympathisant avec le malicieux auteur de Frédéric, mais sait-on jamais ? Autre nuance à apporter, au début de la guerre René Baer était âgé de cinquante-trois ans et pouvait certainement être considéré comme un homme mûr, mais pas vraiment comme un « vieux monsieur ». Enfin, à ce jour aucun autre témoignage sur les circonstances de cette rencontre n’a pu être trouvé, mais on peut avancer qu’elle a eu lieu au plus tard en 1943 puisque les chansons nées de leur collaboration portent ce millésime.
En réalité, le nombre de chansons co-écrites par les deux artistes reste incertain ; en compte-t-on six comme l’a dit et écrit Léo Ferré ? Ou huit chansons comme certains éléments le laissent supposer ? Robert Belleret a déjà exploré ce sujet avec minutie [14] et ce sont ses travaux qui servent de point de départ aux nouvelles recherches et réflexions qui suivent et dont les conclusions s’écartent sensiblement des siennes.
Donc, six chansons attribuées au tandem René Baer et Léo Ferré sont aujourd’hui répertoriées à la Sacem : La Chambre, La Chanson du scaphandrier, Le Banco du diable, Oubli, La Mauvaise étoile et Le Petit faune. Elles sont censées avoir été déposées sous le seul nom de Léo Ferré aux éditions Le Chant du Monde, consécutivement à un contrat d’exclusivité du 29 avril 1947. En réalité, il semble bien que seulement quatre de ces six chansons aient fait l’objet d’un tel dépôt. En effet, de son côté, La Chambre paraît avoir été vendue dans les premiers mois de 1947 aux éditions musicales Hortensia, comme l’indique la reproduction du petit format ci-après.
Quant au titre Le Petit faune, il n’a été exhumé des archives personnelles de Léo Ferré qu’à la fin des années 90, sous forme d’un enregistrement sur disque en pyral pratiquement inaudible. Jusque là, il n’avait fait l’objet d’aucun dépôt à la Sacem [15]. Aujourd’hui, on constate que les Nouvelles éditions Méridian ne possèdent le copyright que de quatre titres signés Baer et Ferré, et non de six comme Léo Ferré dit leur avoir vendu le 5 novembre 1959. Quant aux droits de La Chambre, ils se partagent depuis 1996 entre les éditions Hortensia et La Mémoire et la mer, ce qui indique bien que cette chanson n’ait pas fait partie de l’assignation opérée en 1959. Même si Robert Belleret a retrouvé au Chant du Monde un manuscrit de La Plus belle chambre du monde, la résiliation du contrat du 23 décembre 1958 unissant Léo Ferré à cette maison d’édition ne mentionne que six titres : La Chanson du scaphandrier, Le Banco du diable, Oubli et La Mauvaise étoile ainsi que Petite vertu et Histoire de l’amour. Pour ces deux derniers titres, le biographe incrimine une erreur de transcription imputable au Chant du Monde, estimant que la paternité de ces chansons revient bien à Léo Ferré comme consigné aux Nouvelles éditions Méridian à partir de 1959. À y regarder entre les lignes, plusieurs éléments plaident en faveur d’une hypothèse contraire. D’une part, la thématique particulièrement liée aux amours vénales est récurrente dans l’œuvre de Baer qui raille souvent la fille de petite vertu – la poule – et la considère comme un personnage indispensable de la fête et du bon vivre. Léo Ferré, quant à lui, affiche une certaine propension à s’identifier professionnellement aux « filles publiques », en tout cas à se sentir d’un monde proche du leur, à éprouver une certaine compassion à leur égard… D’autre part, il ne voit pas en elles une menace pour son argent comme c’est le cas par exemple avec le vers « Tu t’offris mon portefeuille » dans Petite vertu. Ce genre d’entôlage par une poule qui fait passer une soirée sinistre à son client et lui « fauche son portefeuille » se trouve déjà dans le roman Frédéric de Baer, précédemment évoqué. De façon tout aussi significative, l’argent est au cœur de la chanson Histoire de l’amour. Trouve-t-on dans Léo Ferré une seule situation comparable ? Le ton lui-même est rarement celui qu’il affecte… Autant de raisons qui inclinent plutôt à penser que ces textes sont bien de René Baer. De toutes façons, on sait que celui-ci n’avait aucunement l’intention de revendiquer la paternité des chansons données à Léo Ferré, lui ayant conseillé de ne pas mentionner son nom. Ferré ayant protesté, Baer aurait insisté : « Mais non, je m’en fous, ça m’est égal ». [16] Mais laissons là ces considérations d’expert pour nous pencher sur le destin de ces chansons.
La Chambre a été créée et enregistrée par Yvette Giraud fin 1947 ou début 1948 sur 78-tours La Voix de son maître. Le fait que ce titre n’ait pas été déposé au Chant du Monde explique sans doute que Léo Ferré ne l’ait pas enregistré sous cette étiquette et qu’il ait attendu 1953 pour le faire sur disques Odéon [17]. Par la suite, Jacques Douai l’enregistra en 1957, suivi par Cora Vaucaire et Lambert Wilson. Ferré quant à lui l’inscrivit souvent à son répertoire jusqu’au milieu des années 60, puis il la reprit une vingtaine d’années plus tard dans ses récitals au TLP-Déjazet de 1986 et de 1988. C’est, à n’en pas douter, le plus beau poème écrit par René Baer.
La Chanson du scaphandrier a été créée et enregistrée en 1950 par Henri Salvador [18]. La même année, Léo Ferré la grava à son tour sur disque Le Chant du Monde [19], suivi dans les années 50 par Eddie Constantine, Jacques Douai et Les Frères Jacques. Claude Nougaro et Marc Ogeret firent de même par la suite. Ce titre particulièrement populaire connut même une version suédoise, Dykaren. Comme pour La Chambre après une assez longue occultation, Léo Ferré la remit en lumière à l’occasion du récital Les poètes en 1986. Il s’agit de la seconde grande chanson cosignée par Ferré et Baer.
« La Chambre et Le Scaphandrier ce sont deux chansons qui me ressemblent…, confia bien des années plus tard Léo Ferré. C’étaient des paroles fantastiques et je chantais ces deux chansons au piano au Bœuf sur le toit… » [20]
Bien différent fut le sort des trois autres chansons complétant de façon indubitable cette collaboration. En l’an 2000, la société Peer Music-Les Nouvelles éditions Méridian, soucieuse de promotionner le répertoire inconnu ou oublié de Léo Ferré, édita un dossier à tirage limité incluant trois cd avec notamment une douzaine de chansons inédites interprétées par Philippe Loffredo dont La Mauvaise étoile, Oubli et Le Banco du diable. Ces deux derniers titres trouvèrent commercialement preneur en 2003 auprès du duo Les Faux Bijoux [21]. Léo Ferré, quant à lui, n’interpréta aucune des trois. Retour sur le passé de joueur de Baer, Le Banco du diable ne semblait pas convenir particulièrement à sa personnalité ; de même, La Mauvaise étoile est sans doute trop encombrée de bourgeois en goguette, de poules, et de payes jouées au pmu pour le laisser envisager d’en donner une interprétation crédible, mais au moins en a-t-il retenu pour plus tard l’allusion aux rédempteurs en paquet [22] ; enfin, pétrie de nostalgie, la chanson Oubli est une confidence de René Baer sur sa vie sentimentale défaite. Léo Ferré aurait pu trouver les accents qui convenaient et l’inscrire à son répertoire.
Dernières plongées
Des années noires, René Baer garda une profonde meurtrissure au cœur, son fils unique étant tombé au champ d’honneur en Alsace en 1944. Une assez vive mésentente s’étant instaurée entre eux au fil des années, Baer resta sans doute définitivement miné par le regret de n’avoir pas su trouver le chemin de la réconciliation tant qu’il était encore temps. À côté de ce drame personnel, dans les années qui suivirent, l’auteur de Frédéric réapprit le goût de vivre auprès de Madeleine Bussy, une journaliste avec qui il convola après la guerre. Celle-ci, qui était alors responsable de la rubrique Publicité et cinéma au quotidien L’Aurore, avait évolué dans le milieu cinématographique dans les années 30 [23].
Quant à Léo Ferré, on peut se demander si, après ses débuts à Paris, il est resté un familier de René Baer. Rien n’est moins sûr selon Nadine Baer, les deux hommes s’étant peut-être brouillés pour d’obscures raisons. Baer, qui se disait volontiers doué d’un tempérament pacifique, savait aussi se révéler coléreux à l’occasion, et pour ce qui est de Ferré, il était loin d’avoir une humeur égale en toutes circonstances. Ce qui demeure établi, c’est qu’en juillet 1948, celui-ci écrivit à la Sacem pour restaurer la paternité de René Baer sur les paroles de La Chambre et de La Chanson du scaphandrier. Au passage, on relèvera que dans sa lettre, il parle de René Baer « dit Vittonet »… [24]
En tout cas, c’est certainement ce refroidissement entre les deux anciens amis qui a conduit Baer à se rapprocher du compositeur Jean Constantin pour musiquer ses nouveaux textes. De cette collaboration, est né en 1953 L’Illusionniste, chanson dans laquelle on croit voir ressurgir les anciens démons du joueur : « De son gilet, de son chapeau / Il fit sortir des rois, des dames / Des valets, des as en troupeau / J’en eus des frissons sous la peau… » Mais les choses se gâtent quand le numéro prend une tout autre tournure : « De mon chapeau, de mon gilet / Il fit jaillir mon portefeuille » (encore !) et ce n’est pas fini puisque les bretelles vont également disparaître et le spectateur ridiculisé, le pantalon sur les chaussures, regagne sa place sous les huées du public… Jean Constantin et Philippe Clay [25] trouvèrent chacun le ton juste pour interpréter cette fantaisie. Deux ans plus tard, le duo Baer-Constantin tenta de réitérer cette réussite avec la chanson Dans l’île : « Il y avait des oiseaux dans l’île (…) / Vivant une éternelle idylle / Dans l’éternelle douceur (…) Mais elle était trop belle notre île / Où le crime était inconnu (…) / Un jour les hommes sont venus.» On est ici dans un décor digne du Douanier Rousseau, mais le ton également très naïf ne parvient pas à convaincre. D’ailleurs, sur scène, Constantin avertissait le public d’un ton goguenard : « Celle-là elle ne marche nulle part, personne n’en veut ! » Anny Gould l’inscrivit quand même à son répertoire [26].
Il s’agit-là des dernières créations publiées du vivant de René Baer, qui vécut paisiblement les dernières années de sa vie auprès de son épouse, comblant les heures de vacuité en écrivant une série de poèmes dédiés à des saintes que ses proches firent paraître à titre posthume conformément aux dispositions testamentaires qu’il avait laissées [27]. Souvent décrit comme un dilettante, René Baer semble aussi être toujours resté un grand enfant, aussi n’est-il presque pas étonnant qu’il se soit éteint un jour de Noël [28]. Aujourd’hui, se souvenant de cet oncle bohème et fantasque, Nadine Baer a cette appréciation un peu énigmatique : « En fait, il ressemblait beaucoup à son Scaphandrier ! », ce qui fait écho à la mention inscrite par Léo Ferré à la coda de la partition de cette chanson : « Profond et mystérieux… »
________________________
[1]. Confessions, n° 18, du 1er avril 1937 – 2e année – tous les jeudis – 2 francs – 32 pages.
[2]. Titres des chansons enfantines de Vittonet : Les Commissions de maman – Recrutement – Le Sportsman – Qui est mon marquis – J’veux pas dire bonjour à la dame – Miss et Nounou – Voyages – Conseils à un nouveau.
[3]. Étienne Ret (1900-1989) artiste peintre français émigré aux États-Unis d’Amérique en 1940.
[4]. Le Coup dur (Vittonet-Lenoir) enregistré sur 78-tours Columbia par Lucienne Boyer le 14 juin 1930.
[5]. En 1955, Maurice Chevalier avait inscrit dans son récital au Lyceum Theatre de New York une chanson signée Vittonet pour les paroles, dont il n’a été possible d’identifier ni le titre ni le compositeur.
[6]. Articles signés Teddy : Des jeunes filles vivent pour la danse (Groupe Rythme & Candeur), in Le Petit journal du 19 février 1927 ; Suzy Laffond, une « sportive » qui danse et chante in Le Petit journal du 25 février 1928 ; De l’écran à la scène (sur le danseur Reri) in L’Intransigeant du 19 février 1933.
[7]. Heure d’été, film français réalisé en 1932 par Robert Bossis, scénario et dialogues de René Baer, interprété par Paul Faivre et Jeanne Fusier-Gir.
[8]. Frédéric, roman de René Baer, 256 p., éditions Albin Michel, 1936.
[9]. André Dignimont (1891-1965), peintre, dessinateur publicitaire, décorateur et illustrateur français.
[10]. C’est la java des Poilus (René Baer-RWP Visciano), enregistré en 1940 par Colette Betty sur 78-tours Polydor 524.599.
[11]. Interview d’octobre 1986 par Serge Blanche à l’occasion du récital Les poètes au tlp-Déjazet.
[12]. René Baer qui a vu le jour le 11 octobre 1887 à Paris était l’aîné de deux mois de Joseph Ferré, né le 10 décembre 1887 à Nice.
[13]. Il n’a pas été possible de retrouver l’interview accordée par Léo Ferré, vraisemblablement dans le cadre de son récital Les poètes de fin 1986, dans laquelle, citant René Baer, il récite les premiers vers de La Chambre et ajoute quelques mots comme : « C’est aussi ça la poésie. » Son interlocuteur lui demande : « Un ami de votre père ? – Non, répond Ferré, un ami à moi. »
[14]. in Léo Ferré, une vie d’artiste, Actes sud-Léméac, 1996.
[15]. Robert Belleret, texte de présentation du double CD de Léo Ferré, La Vie d’artiste, les années Chant-du-Monde, 1998.
[17]. Enregistré le 29 avril 1953 et gravé sur 78-tours Odéon 282.819.
[19]. Enregistré le 26 juin 1950 et gravé sur 78-tours Le Chant du Monde PA 1574.
[20]. Vous savez qui je suis maintenant ?, op. cit.
[21]. Léo Ferré, les inédits, CD La Mémoire et la Mer, 10 088.89.
[22]. « Sa rédemption et tout l’ paquet » in Y’en a marre (1961).
[24]. Léo Ferré, une vie d’artiste, op. cit.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (13)
dimanche, 11 mars 2007
Corbière, Laforgue et Ferré, par Francis Delval
Je remercie Francis Delval de m’avoir adressé ce texte qui présente un point de vue original, inusité, sur Léo Ferré, par rapport à Corbière et Laforgue. Il est ainsi le deuxième à accepter d’être l’« invité du taulier ». J’en suis heureux.
Francis Delval est né en 1944. Professeur de philosophie (École normale, puis université). Centres d’intérêt : Schiller, Hölderlin, Hegel, Marx… Suit de très près les travaux de Rancière et d’Alain Badiou sur philosophie, littérature et politique. Près de cinquante ans de mémoire ferréenne. Un article à paraître sur l’écriture de Ferré.
Mets de la lune dans ton vin
(LAFORGUE, Petits mystères)
De ce qui a eu lieu en poésie dans la France de la seconde moitié du dix-neuvième siècle, les manuels ne retiennent en général, à l’ombre tutélaire du Hugo vieillissant, outre les Parnassiens, que les quatre grands, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Les autres poètes sont cités avec parcimonie, et présentés comme poètes mineurs ou curiosités littéraires : je veux nommer ici Corbière, Laforgue, Nouveau, Cros, Jarry et quelques autres… Et puis ce Lautréamont encombrant dont on ne sait le plus souvent que dire et que faire : aimable canular selon Faurisson, négationniste invétéré, ou sommet de la littérature française selon Pleynet et Sollers. Mais dont, plus sérieusement, Blanchot a ouvert quelques portes…
Si nous les évoquons en ce lieu, c’est qu’il existe des liens avérés entre Léo Ferré et quelques uns de ces poètes.
On sait, par Charles Estienne notamment, que Ferré eut le projet de mettre Les Chants de Maldoror en musique. Il y a renoncé apparemment, même si avec Une saison en enfer et certains de ses textes, il a chanté de la prose.
De Laforgue, il a mis en musique au moins deux textes : le poème dit Le Viveur lunaire (le dernier poème de Locutions des Pierrots), et ce dès les années 40, si on se réfère au disque pyral retrouvé dans les archives, et dont le mauvais état n’a pas permis de sauver l’enregistrement. Mais aussi la Complainte du pauvre jeune homme (en 1952 ?) L’a-t-il enregistré ? C’est de l’ordre du possible. Il y a encore des enregistrements non réapparus, comme celui de La Fille des bois de Mac Orlan, passé plusieurs fois à la radio vers 1960.
De Corbière, Ferré a programmé, lors d’un récital consacré aux poètes, en 1964 ou 1965, et retransmis à la radio, Le Poète contumace, récité (ou lu ?) par Madeleine Ferré. Était-ce le texte intégral (le poème est fort long), Ferré l’accompagnait-il au piano ? C’est probable. C’est un souvenir de plus de quarante ans… Et Estienne signale, sans expliquer, que Corbière a influencé Ferré…
L’œuvre de Tristan Corbière (1845-1875) tient en cent cinquante pages : le recueil Les Amours jaunes, et quelques proses et poèmes divers. Verlaine le placera dans ses Poètes maudits. Breton rappellera son existence dans son Anthologie de l’humour noir, citant de larges extraits des Litanies du sommeil, où il voit une première manifestation de l’écriture non contrôlée. T. S. Eliot et Ezra Pound diront leur admiration pour cet auteur méconnu, et qui le reste, hélas.
L’œuvre de Corbière présente une grande diversité de formes et de thèmes, et semble galoper sur les siècles passés et futurs : des Rondels pour après, où il reprend la vieille forme du rondeau, en en jouant, pervertissant la forme par le contenu, avec malice, à La Chanson en Si qui fait par ses thèmes penser au sonnet de Cecco ; des grands poèmes des Gens de mer où Corbière innove à la fois par un usage nouveau de la ponctuation (tirets systématiques, lignes de points de suspension) et une langue quasi célinienne avant l’heure. Par exemple, ces quelques lignes tirés du Bossu Bitor :
– Ah tortillard!. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Charivari ! – Pour qui ? – Quelle ronde infernale,
Quel paquet crevé roule en hurlant dans la salle ?...
– Ah, peau de cervelas ! ah, tu veux du chahut !
À poil, à poil, on va te caréner tout cru !
ou le texte peu connu La Balancelle, long poème aux mots systématiquement apocopés, qui semble cent ans avant frayer le chemin à Guyotat plutôt qu’à Bruant :
C’est comm’ culots d’gargouss’ gréés en grouins d’chiens
Et pis des pistolets, plein l’ventre d’leurs culottes
Longs comm’canul’à vach’s… paraît q’c’est leur marotte
L’inventivité linguistique de Corbière ne pouvait laisser Ferré indifférent, de par son lexique aux sources très variées : Corbière forge des néologismes, puise aux argots, au langage des marins, injecte à ses textes mots étrangers et localismes bretons, pastiche la grandiloquence hugolienne. Comme Rimbaud, il fait bouger la langue. Comme le fera Ferré.
Ajoutons qu’il est, arthritique et tuberculeux, tentant de se faire un prénom à l’ombre de son père Édouard, romancier maritime célèbre en son temps, et retiré dans sa tour de Roscoff, l’archétype rêvé du « poète maudit » (réalité – ou mythe littéraire qu’il faudra bien démonter un jour).
Les critiques considèrent Le Poète contumace comme un fidèle autoportrait de Tristan le maudit. Sans doute la raison qui fit que Ferré tint à le faire figurer à son programme.
Si « influence » me semble excessif, il y a bien entre Ferré et Corbière une « rencontre », un cousinage qu’il faudrait affiner par comparaison des thèmes et des styles, ce qui excède notre présent propos.
 Jules Laforgue (1860-1887), poète mort jeune également de tuberculose, est davantage connu que Corbière. Il hante parfois les pages de quelques manuels ; outre les proses des Moralités légendaires (savoureux pastiches littéraires), ses poèmes se divisent en cinq recueils : Premiers poèmes (parfois assez convenus) ; Les Complaintes ; L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune ; Des fleurs de bonne volonté ; Derniers vers (les plus audacieux).
Jules Laforgue (1860-1887), poète mort jeune également de tuberculose, est davantage connu que Corbière. Il hante parfois les pages de quelques manuels ; outre les proses des Moralités légendaires (savoureux pastiches littéraires), ses poèmes se divisent en cinq recueils : Premiers poèmes (parfois assez convenus) ; Les Complaintes ; L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune ; Des fleurs de bonne volonté ; Derniers vers (les plus audacieux).
Mettons d’abord au crédit de Laforgue d’avoir osé inventer le premier le vers libre.
L’œuvre va de chansons ou complaintes simples (en apparence) à de grands poèmes charriant un vocabulaire luxuriant. Comme Théophile Gautier, ce poète qui sut se faire aimer de tous, il utilise tout le dictionnaire. Ce n’est pas par hasard que L’Imitation est dédiée à Salammbô… où Flaubert accumule les mots rares.
Nous pouvons donc lire des « chansons », comme certains de ses poèmes lunaires, où il fait rimer, avec une insistance à la limite de l’autoparodie, « lune » maintes et maintes fois avec « fortune », mais aussi avec « brune » : la lune est déclinée sur tout le dictionnaire des rimes en « une » :
Ah ! la belle lune
Grosse comme une fortune
(Complainte de la lune en province)
ou bien :
Hélas ! Des lunes, des lunes
Sur un petit air en bonne fortune
(Avis)
et aussi souvent bien sûr « automne » avec « monotone »… Et Ferré empruntera à la Complainte du pauvre jeune homme le vers « Quand on est mort c’est pour de bon » qui termine la chanson Et des clous, à peu près contemporaine de la mise en musique probable de la Complainte. Cela dit, la formule est tellement courante, passée à l’état de proverbe, qu’on peut difficilement lui assigner un auteur !
Mais on peut lire aussi de grands poèmes denses, (La lune est stérile, Climat, Faune et flore de la lune, etc.), au lexique étonnant, où se bousculent mots précieux ou savants, créations verbales (« crépusculâtre »), mots-valises (« la violupté », « l’omniversel ombelliforme »)… Mais il n’hésite pas à mêler le « trivial » au « recherché » et à faire par exemple rimer « grottes basaltiques » avec « chiques » ! Cette distinction des registres de langue est purement « pédagogique ». Il est manifeste que pour Laforgue comme pour Corbière, il n'y a pas de vocabulaire spécifique de la poésie : tous les mots se valent, ce que Flaubert savait déjà.
Le registre laforguien de ses grands poèmes n’est pas sans évoquer celui du Bateau ivre… Un critique – je ne sais plus qui – avait montré de façon convaincante que l’essentiel du vocabulaire de ce texte majeur de Rimbaud avait été trouvé dans Vingt mille lieues sous les mers. C’est fort possible : Michel Butor a étudié la richesse du vocabulaire vernien, trouvant de véritables poèmes en prose dans certaines pages. Mais qu’il vienne de Verne ou du dictionnaire, c’est de peu d’intérêt : l’essentiel est la transmutation rimbaldienne et non l’origine du matériau.
De surcroît, Laforgue a utilisé tous les types de vers, s’accordant des libertés qui feront école. Ainsi, on ne peut lire certains poèmes de Laforgue sans penser à Apollinaire : de l’un à l’autre, la conséquence est bonne. Apollinaire a repris le vers laforguien pour le relancer, de sa manière inimitable, dans l’autre siècle.
Prenons, par exemple, ces vers extraits de L’Hiver qui vient, un des derniers poèmes en vers libres, un des plus connus :
Les cors, les cors, les cors mélancoliques !...
Mélancoliques !...
S’en vont, changeant de ton et de musique,
Ton ton, ton taine et ton ton !...
Les cors, les cors, les cors !...
S’en sont allés au vent du Nord
Comment ne pas penser à Apollinaire (et je ne puis écouter J’entends passer le temps, de Caussimon, sans penser aussi immédiatement à Apollinaire…) ?
Et si je prends ces deux autres vers dans le même poème :
Que l’autan, que l’autan
Effiloche les savates que le temps se tricote
où nous trouvons autour de « savates » une allitération prolongée avec 6 [t], je ne peux pas ne pas penser à ces deux vers de Ferré :
Mes pieds ont engagé leur pointure marine
Dans des savates s’ulcérant au ciel zonier
(Les Roses de la merde)
où, à partir du même mot (rare en poésie, et que l’on retrouve dans Comme dans la haute), on a une allitération avec 4 [s] et un [z].
Je suis bien conscient que c’est ma mémoire qui opère ces rapprochements. Mais l’intertextualité existe : on ne crée jamais à partir de rien, il y a des traces, il y a des réminiscences pas forcément conscientes, et qui travaillent l’écriture.
Certes, ni Corbière, ni Laforgue n’ont « accroché » Ferré comme Baudelaire, Rimbaud, Verlaine ou Apollinaire. Mais ils sont, je pense, présents dans son œuvre, discrètement. On ne peut pas les compter pour rien. Il ne s’agit pas de trouver des sources à tout prix, mais de mettre en évidence des modalités d’écriture que l’on décèle chez Laforgue et Corbière, et qui se retrouvent souvent chez Ferré (de l’écriture de Ferré, on reparlera en un autre lieu).
À qui connaît Corbière et Laforgue, je n’ai rien appris. Si j’ai donné aux autres l’envie de les lire, cette note n’aura pas été inutile.
Bibliographie :
Jules Laforgue : Les Complaintes. L’Imitation de Notre-Dame-la-Lune (Poésie-Gallimard). Moralités légendaires (Folio).
Tristan Corbière : Les Amours jaunes (Poésie-Gallimard).
Collection « Bouquins » (Laffont) : Œuvres complètes de Rimbaud, Corbière, Cros, Lautréamont (il manque les lettres de Rimbaud).
Pour l'ambiance de l'époque, l'air du temps : Les Poètes du Chat Noir (Poésie-Gallimard).
À chercher d'occasion : Jehan Rictus, collection « Poètes d'aujourd'hui », n° 74, Seghers.
Toujours pour l'air du temps : Alfred Jarry, Œuvres complètes, 3 vol., Pléiade.
Nombreuses éditions des textes essentiels.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (15)
vendredi, 09 mars 2007
Récital Place des Arts à Montréal, mars 1974, par Jacques Miquel
En complément des deux notes que j’ai consacrées à des récitals de l’année 1974, Jacques Miquel m’a adressé des précisions : le même spectacle (ou sans doute, très proche) a été donné au Québec. Voici le programme détaillé, qui a de plus l’avantage de répondre à une question précédemment posée par The Owl. C’est bien dans cet esprit de partage et d’apports mutuels que je comprends ce lieu. Merci à Jacques Miquel.
Après avoir réalisé ses ultimes enregistrements dans les studios Barclay à Paris les 7 et 8 janvier 1974, Léo Ferré part en tournée dans le sud-est de la France (notamment Lyon, Nice, Marseille…) Du 8 février au 1er mars, il donne sa série de récitals à l’Opéra-Comique à Paris, puis retourne en Italie où il se marie le 5 mars avec Marie-Christine Diaz, et enfin part donner une série de récitals au Québec. Les 22, 23 et 24 mars, il se produit à la salle de la Place des Arts à Montréal. Les 30 et 31, à Québec. Comme c’est désormais le cas le plus courant, il est seul en scène, et chante soit sur des bandes orchestrales, soit en s’accompagnant lui-même au piano. Au programme de ce récital québécois, vingt-sept titres qu’il enchaîne dans l’ordre suivant :
Pauvre Rutebeuf – version incomplète a cappella
La Vie d’artiste (F. Claude et L. Ferré) – accompagnement au piano
Préface – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Green (Verlaine) – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
Les Oiseaux du malheur – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Flamenco de Paris – accompagnement au piano
Marie (Apollinaire) – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Damnation – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Petite – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
On s’aimera – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
La Mort des amants (Baudelaire) – accompagnement au piano
Madame la Misère – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
Il est six heures ici… et midi à New York – accompagnement au piano
Night and day – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Les Étrangers – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
L’Oppression – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Avec le temps – accompagnement au piano
Le Chien – a cappella
Les Amants tristes – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Ne chantez pas la mort – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Mémoire et la mer – accompagnement au piano
La Solitude – bande orchestrale Zoo + cordes dir. Léo Ferré
Richard – accompagnement au piano
Je t’aimais bien tu sais – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Folie – accompagnement au piano
Il n’y a plus rien – début accompagné au piano puis le reste a cappella
L’Espoir – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (30)
lundi, 08 janvier 2007
À propos de Cecco, par Jacques Miquel
Après nous avoir présenté Leonid Sabaniev et Jamblan, Jacques Miquel continue à nous faire connaître ces personnages qui passent dans la vie et l’œuvre de Léo Ferré et sont moins célèbres que d’autres. Ces notes biographiques très documentées permettent de cerner mieux encore l’univers artistique de Ferré. Je remercie Jacques Miquel pour son goût de la recherche et pour l’aide qu’il m’apporte.
Vers 1981, Léo Ferré enregistre sous le titre de Cecco, un sonnet d’un poète toscan du XIIIe siècle plaqué sur l’orchestration symphonique de Pauvre Rutebeuf [1]. Le disque sort en Italie avec, au verso de la pochette, la transcription du poème original et l’indication de l’auteur, « Cecco Angiolieri 1260-1312 ? »[2], à propos de qui le chanteur souligne par ailleurs des similitudes existentielles avec Rutebeuf († 1280). Ce single vinyle n’est pas distribué en France où il faut attendre une vingtaine d’années pour que l’on découvre Cecco en CD [3]. Parmi les rares auteurs qui ont mentionné cette chanson, certains [4] ont malencontreusement attribué le texte à un autre poète italien, Cecco d’Ascoli.
Francesco Stabili dit Cecco d’Ascoli [5], cité où il vit le jour en 1269, enseigna l’astrologie à Bologne. À la fois poète et savant, son nom reste attaché à L’Acerba, une somme de vers à résonance scientifique dans laquelle il s’oppose à Dante. Accusé d’hérésie et de sortilèges pour avoir commercé avec des succubes, il fut condamné au bûcher par l’Inquisition en 1327. Si cet opposant à l’oppression religieuse avait de quoi inspirer Léo Ferré, il n’est dit nulle part qu’à l’instar de Rutebeuf il connaissait « des problèmes de femme et d’argent » et il n’est pas le « Cecco » de la chanson.
Né à Sienne vers 1260, Cecco Angiolieri est de la même génération que Francesco Stabili ; comme lui, sa vie s’écoule dans une Italie divisée entre gibelins inféodés à l’empereur et guelfes fidèles au pape, situation localement aggravée par la rivalité politique entre Siennois et Florentins. Dans ce paysage troublé, le parcours d’Angiolieri confine souvent à la légende du poète maudit tour à tour guerrier puis déserteur, rétif aux lois de la cité et impliqué dans une rixe meurtrière, tâtant la paille du cachot et frappé de bannissement. En réalité, sa biographie ressort en filigrane de ses œuvres poétiques, constituées de plus de cent cinquante sonnets rassemblés sous le titre de Canzoniere ou encore de Rime. Au fil de ces vers, il se pose en contempteur sarcastique de son temps, nourrissant une rancœur farouche à l’égard de son père, riche patricien dont l’avarice le réduit à la pauvreté et au dénuement. Avouant cyniquement n’avoir pour seules passions que « la femme, la taverne, et les dés », ses provocations caustiques semblent n’avoir d’autre but que de masquer un profond désarroi et le dépit de voir son talent occulté par le succès de Dante. Allant jusqu’à l’autodérision, il parodie la noblesse des sentiments du Florentin pour Béatrice en lui opposant la trivialité de ses propres déconvenues amoureuses avec la fille d’un savetier, cupide et rouée. L’expression parfois crue de sa poésie est en fait une réaction littéraire au « style nouveau » qui s’affirme alors et qui n’est pas sans évoquer l’amour courtois. Mais les inspirations passionnées et les saillies burlesques qui font de Cecco Angiolieri le principal tenant de la poésie réaliste bourgeoise, ne doivent pas faire oublier la sensibilité à fleur de cœur d’un auteur floué par l’existence. Son œuvre, longtemps négligée, n’obtint une place de choix dans la littérature italienne qu’à l’aube du XXe siècle.
En France, le romancier et poète symboliste Marcel Schwob contribua à sortir le rebelle siennois de l’anonymat en lui consacrant sous le titre de Cecco Angiolieri, poète haineux un chapitre de Vies imaginaires, recueil de contes paru en 1896 décrivant des personnages souvent méconnus, au destin atypique. Dans ce récit picaresque on découvre un Cecco à la bouche tordue, détestant dès son plus jeune âge son père, dont il souhaite ardemment la mort pour récupérer son magot. Fils prodigue désargenté, il gagne Florence où il n’a d’autre alternative que la mendicité. Amoureux transi de la belle et moqueuse Becchina pour laquelle il écrit en pure perte des vers enflammés, il ne cesse d’épancher sa bile sur Dante, son irréductible rival en littérature. « Pauvre et nu comme une pierre d’église » il entre dans les ordres, ce qui ne l’empêche pas de nourrir toujours une aversion viscérale à l’égard de ses semblables exprimée dans le fameux sonnet dont Marcel Schwob propose cette traduction tronquée : « Si j’étais le feu, pensa-t-il, je brûlerais le monde ; si j’étais le vent, j’y soufflerais l’ouragan ; si j’étais l’eau, je le noierais dans le déluge ; si j’étais Dieu, je l’enfoncerais parmi l’espace ; si j’étais Pape, il n’y aurait plus de paix sous le soleil ; si j’étais l’Empereur, je couperais des têtes à la ronde ; si j’étais la mort j’irais trouver mon père… si j’étais Cecco… voilà tout mon espoir… » Après avoir abandonné le froc et s’être joint à une horde de guelfes noirs mettant à feu et à sang le quartier des élites florentines, il apprend avec bonheur la mort de son père. Devenu riche et venant enfin à résipiscence, sans vergogne aucune il exhorte le pape à lancer une Croisade contre tous les fils indignes !
Léo Ferré connaissait-il ce sombre portait de Cecco dû à Marcel Schwob ? On l’ignore… Quoiqu’il en soit, il est probable qu’il ait découvert lui-même cet auteur par d’autres voies. On sait en effet qu’il s’était suffisamment penché sur la littérature italienne du Moyen-Âge pour souligner sa lisibilité à l’époque moderne, contrairement au vieux français devenu hermétique pour le commun des lecteurs. De plus, sa compassion pour Angiolieri dont il rapprochait la situation de pauvreté de celle de Rutebeuf, laisse penser qu’il avait fait une lecture attentive de son œuvre. Quant à la thématique du sonnet considéré, elle est réellement celle d’un « immense provocateur ». Se substituer au XIIIe siècle au pape ou à l’empereur pour assouvir sa misanthropie constitue déjà une grave transgression ; utiliser cet habile procédé pour inférer la cruauté des princes constitue un crime de lèse-majesté. Lorsque l’on agit de même avec Dieu, hier comme aujourd’hui, cela relève du sacrilège et au « Si j’étais Dieu » de Cecco fait écho le « Si j’avais les yeux du Bon Dieu » de L’Opéra du ciel de Ferré, tissant ainsi à travers les siècles une complicité libertaire entre les deux poètes. Peut-être est-ce au nom de cette fraternité intemporelle qu’en 1983, Ferré met en scène le Toscan dans L’Opéra des rats en lui faisant déclamer cette traduction [6] sinon littérale, en tout cas très fidèle à l’esprit du poème de Cecco Angiolieri :
Si j’étais le feu je foutrais le feu au monde
Si j’étais le vent j’y foutrais la tempête
Si j’étais l’eau je le noierais
Si j’étais Dieu je l’enverrais au plus profond
Si j’étais le Pape je serais alors très joyeux
Car je me taperais tous les chrétiens
Si j’étais empereur tu sais ce que je ferais ?
À tous je couperais la tête
Si j’étais la mort j’irais chez mon père
Si j’étais la vie je foutrais le camp de chez lui
Je ferais pareil avec ma mère
Si j’étais moi comme je suis et comme je fus
Je prendrais les femmes jeunes et chouettes
Et je laisserais les vieilles et les laides aux autres.
[1]. Le catalogue des orchestrations réalisées par Léo Ferré dans les années 70 (in Paroles et musique de toute une vie, La Mémoire et la mer, 1998, vol. 7) signale l’enregistrement, le 8 octobre 1973, de la bande orchestrale de Rutebeuf, suggérant que l’artiste avait l’intention de reprendre ce titre avec une partition plus élaborée que celle de 1955. Ce qu’il fera en 1984 sur un album live imputant l’accompagnement à l’orchestre symphonique de Milan. C’est ce dernier accompagnement qui est utilisé pour Cecco.
[2]. 45-tours single, G&G Records, GG 0016 avec, en face B, Allende (en français). Les deux titres sont repris sur un album italien proposant une compilation d’artistes français (Gli intramontabili, G&G Records, RL 8650).
[3]. La musica mi prende come l’amore, La Mémoire et la mer, CD 10.004 (2000).
[4]. Notamment Robert Belleret in Léo Ferré, une vie d’artiste, Actes Sud-Leméac, 1996 (p. 369) et Christophe Marchand-Kiss in Passion Léo Ferré, Textuel, 2003 (p. 162).
[5]. Ascoli Piceno, ville de la région des Marches (Italie).
[6]. Traduction de Léo Ferré extraite de L’Opéra des rats, © La Mémoire et la mer, 2000 - LMMCD004.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (42)
mercredi, 20 décembre 2006
Gourdon, 11 juillet 1985, par Jacques Miquel
Jacques Miquel m’a envoyé ce souvenir, qu’il présente comme un écho à la note Trois amis et les pops.
Ce soir-là, Léo Ferré chante pour la Renaissance du Carillon de Saint-Pierre à Gourdon. Le récital est prévu pour se dérouler sur le parvis de cette église gothique, mais dans l’après-midi il est décidé de changer de lieu et un chapiteau de cirque est dressé à la hâte aux portes de la ville, dans un champ fraîchement fauché. Sous la toile, l’odeur de bâche se mêle à celle des foins coupés. Dans la foule qui lentement prend place, certains aperçoivent Marie-Christine Ferré, l’enfant du pays, et l’interpellent familièrement : « Marie ! Mimi ! » Souriante, elle s’arrête pour échanger quelques mots avec les uns, embrasser les autres. Les gens semblent ravis qu’elle les ait reconnus et leur parle devant tout le monde. Il y a une sorte de fierté et de gentillesse dans l’air…
L’obscurité envahit l’espace et Léo Ferré paraît dans son halo et sous les applaudissements complices. La brise est favorable, les voiles hissées, le chapiteau appareille pour une traversée onirique sur des flots de poésie et de musique. À un moment, l’artiste s’amuse qu’on ait fait appel à lui pour faire renaître le carillon de l’église, se trouvant tout de même un point commun avec les cloches qui, comme lui, savent se faire entendre. « Les mains battent des sourires… » Peu après, le propos est plus amer. De Gourdon, il ne garde pas que des souvenirs heureux… cette femme… il lève les yeux semblant chercher dans les lointains les tours de Perdrigal. On devine à quoi il pense… Avec le temps… qu’il enchaîne par Pépée. Les derniers accords de la bande-orchestre tombent plus lourds de sens que jamais. « On couche toujours avec des morts ». Léo s’incline légèrement, les bras tendus vers une Pépée imaginaire qui lui saute au cou. Le public pétrifié assiste en silence à cette scène pleine de tendresse, quand des premiers fauteuils fuse l’outrage : « Ferré au zoo ! ». Hors de lui, le chanteur descend des tréteaux, tonnant dans le micro : « Qui a dit ça ? Qui a dit ça ? » tandis que le projecteur fouille les rangs d’où est partie l’invective. Décontenancé, tassé au fond de son siège, un spectateur finit par se désigner implicitement en risquant d’une voix mal assurée : « On est en République, non ? » Dans un grondement amplifié par la sono, la réponse cingle : « République mon cul ! T’es chez moi ici ! Fous l’camp ! Fous l’camp ! Fous l’camp ! » – ces derniers mots martelés jusqu’à ce que l’importun finisse par déguerpir piteusement. Le chanteur regagne l’estrade et se concentre quelques secondes avant de renouer le fil du récital au moment où, du fond des travées, s’élève la même voix. La poursuite lumineuse se braque aussitôt sur le personnage qui, regrettant sa bévue, balbutie quelques excuses. Ferré n’a pas l’intention d’insister et il s’adresse à l’éclairagiste pour qu’il ramène le projecteur sur lui : « Laisse tomber, Maurice… » Bien sûr, Maurice Frot n’est plus aux manettes depuis belle lurette. Visiblement ému, Léo balaie le lapsus d’un geste vague et poursuit le concert. La fin du voyage est éblouissante alors que, dans la coupole du chapiteau, les fantômes continuent à bousculer les étoiles.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (4)
dimanche, 17 décembre 2006
Œuvres de Léonid Sabaniev (1881-1968), par Jacques Miquel
À l’automne 2005 paraissait dans Les Copains d’la neuille l’article « Léonid Sabaniev, maître de musique de Léo Ferré ? » retraçant le parcours singulier de ce musicologue et compositeur avant-gardiste russe, disciple de Scriabine. Victime de l’ostracisme des artistes prolétariens soviétiques, en 1926 Sabaniev s’expatria en France où il vécut surtout de ses ouvrages de musicologie et de cours dispensés à des compositeurs en devenir comme le Français Lucien Delrieu. C’est dans l’exercice de cette activité de maître de musique que Léo Ferré le rencontra à Nice pendant l’Occupation. Au fil des entretiens, il a évoqué laconiquement ces cours et les conseils que lui avait prodigués Sabaniev, comme l’illustrent ses propos recueillis par Marc Robine à l’été 1992 : « J’ai pris des cours, oui, avec un musicien russe qui était l’élève de Scriabine. Et puis j’ai travaillé beaucoup… »
Lors de la parution de l’article sur Sabaniev, confrontés à des impératifs de mise en page et d’espace disponible, le responsable de la publication et l’auteur ont convenu en plein accord d’écarter les annexes qui sont proposées ci-dessous :
1 – Œuvres musicales de Léonid Sabaniev (aperçu)
Pièces pour piano (Collection américaine).
Quatre préludes Op. 2.
Deux préludes Op. 3.
Impromptu Op. 5 n° 2.
Prélude Op. 5 n° 2.
Poème Op. 6 n° 1.
Étude Op. 6 n° 2.
Étude Op. 8 n° 2.
Feuillet d’album Op. 9 n° 1.
Esquisse Op. 9 n° 2.
Poème Op. 9 n° 3 .
Prélude Op. 9 n° 4.
Huit préludes Op. 10.
Six poèmes Op. 11.
Quatre fragments Op. 13.
Quatre préludes (sans n° d’Op.)
Deux trios avec pianos (1907-1924).
Sonate à la mémoire de Scriabine (1915).
Deux sonates pour violon et piano (1917-1924).
L’Aviatrice, ballet (1928).
Flots d’azur, poème symphonique (1936).
L’Apocalypse, oratorio (1940).
Suite pour Quintette à vent.
Plus de quarante mélodies.
Transcriptions d’œuvres symphoniques de Scriabine.
Prométhée, poème du feu (1913) transcription pour deux pianos à quatre mains.
Poème en forme de sonate (1926), transcription pour piano de Poème divin.
2 – Bibliographie sommaire de Léonid Sabaniev
Prometheus von Scriabine (étude), Der blaue Reuter, Munich, 1912.
Scriabine, Moscou, 1916.
Claude Debussy, Moscou, 1922.
Lettres de Scriabine, 1923.
The music of speech, 1923.
Mes souvenirs de Scriabine, Musikalaniye Sektor, Moscou, 1925.
Histoire de la musique russe, Moscou, 1924 (traduction allemande, Leipzig, 1926).
Modern russian composers (traduit du russe par Judah A. Joffre), Ayer Co. Pub., New York, 1927.
Musical tendencies in contemporary Russia (traduit du russe par S.W. Pring), Londres, 1930.
Taneiev, Paris, 1930 (en russe).
Music for the films (Aspects of films), Londres, 1935.
3 – Note à l’intention des chercheurs
La Bibliothèque Nationale de France conserve différents manuscrits et documents de Scriabine légués par les héritiers de Léonid Sabaniev. Ce fonds est susceptible de recéler d’autres pièces ayant appartenu à celui-ci, ainsi que les coordonnées de ses ayants-droit.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 décembre 2006
Jamblan « le doux chansonnier », par Jacques Miquel
J’accueille aujourd’hui Jacques Miquel qui inaugure la catégorie « Les invités du taulier » avec un sujet qu’il a lui-même choisi et auquel il a donné la forme qui lui a plu.
Jacques Miquel est né en 1948. Il intervient régulièrement sur le thème « poésie et chanson » dans l’émission hebdomadaire de Christian Saint-Paul, Les Poètes, sur Radio Occitanie. En 1999, il a publié, en collaboration avec Jacques Lubin et Marc Monneraye, « Discographies de Jacques Brel et de Léo Ferré » dans Sonorités – Cahiers du patrimoine sonore et audiovisuel.
« J’ai fait un seul grand voyage dans ma vie, en Martinique. C’est très loin, très, très loin. J’en ai rapporté une allergie au rhum, au ti punch comme ils disent, et la certitude qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil… » [1]. Si l’image surréaliste d’un Léo Ferré en smoking, tapant du piano dans l’étuve tropicale, a maintes fois été évoquée, en revanche, on ne sait que peu de choses sur la tête d’affiche de cette tournée désastreuse, dont le nom de scène reste cependant attaché à l’œuvre de Ferré au travers de quatre chansons qu’ils ont co-signées. Il s’agit bien sûr de Jamblan, « charmant garçon » dont Léo accompagne le tour de chant en 1947 à l’autre bout du monde et qu’il évoque bien des années plus tard comme son camarade.
De son vrai nom Jean, Marie Blanvillain, il voit le jour en 1900 à Bressuire, qu’il quitte à vingt-cinq ans pour tenter sa chance à Paris, préférant l’incertitude de la bohème au singulier métier de tailleur de soutanes qui est alors le sien. Ses débuts sont incertains et difficiles et si, en 1927, son nom est associé à celui du peintre abstrait Jean Hélion dans la fondation d’une éphémère revue avant-gardiste, ce sont plutôt ses prestations de chansonnier dans des boîtes de seconde zone qui lui assurent tant bien que mal l’ordinaire. Conjointement, il écrit des paroles de chansons sans prétentions et l’une d’elles, Béguin biguine,mise en musique par Michel Emer, est enregistrée en 1932 par Jean Sablon, dont le nom commence à scintiller dans la galaxie du music hall.
Le filon semble bon et Jamblan parvient à placer quelques titres auprès d’artistes en vogue, comme Berthe Sylva [2] ou le duo Pills et Tabet [3]. Le guitariste Django Reinhardt ne dédaigne pas de poser ses notes sous ses paroles [4] tandis que, dans un registre tout différent, la sulfureuse Suzy Solidor inscrit la chanson Obsession d’amour [5] à son répertoire. Jamblan lui-même enregistre certaines de ses propres œuvres et notamment une romance plutôt naïve, Ma mie [6], avec laquelle il ne fait toutefois pas ce qu’il est convenu d’appeler un tabac… Mais, d’une façon générale, les années 30 lui sont plutôt favorables, que ce soit comme parolier d’interprètes de renom, ou chansonnier se produisant sur des scènes aussi prestigieuses que le Théâtre des Deux-Ânes et Bobino, ou encore second rôle de cinéma dans Le petit chose [7].
Malgré l’Occupation, la décennie suivante se présente tout aussi bien avec, une nouvelle fois, Jean Sablon pour tremplin. Devenu vedette internationale, celui-ci passe les années noires sur le continent américain. Le 28 mai 1942, il entre aux studios Decca à New York pour une séance d’enregistrements qu’il débute par les versions française et anglaise de Ma mie, le titre déjà ancien de Jamblan et Herpin. Cette fois la chanson est remarquée et recréée sous le titre de All of a sudden my heart sings [8] dans la comédie musicale Anchors Aweigh [9] bientôt portée à l’écran. Le succès est considérable ; rebaptisée My heart sings, elle devient au fil des années un des plus grands standards américains repris par Duke Ellington, Nat King Cole, Errol Garner, Paul Anka, Dany Kaye pour ne citer que les plus célèbres. L’engouement atteint la France où Jamblan adapte de nouvelles paroles et la chanson, devenue En écoutant mon cœur chanter, est enregistrée dès 1946 par Charles Trenet et Lys Gauty.
Lorsqu’au printemps 1947, la tournée pour la Martinique est mise sur pied, cela fait plus de vingt ans que le chansonnier montmartrois bat les planches et, avec plusieurs succès populaires à son actif de parolier, il fait figure de professionnel accompli ; de seize ans son cadet, Léo Ferré, quant à lui, n’a fait ses premiers pas sur une scène parisienne que quelques mois plus tôt. Mais ce qui semble les différencier le plus, ce sont les sources d’inspiration de leurs répertoires respectifs. On sait qu’à cette époque L’Opéra du ciel est déjà écrit et que Mon Général va faire partie du tour de chant antillais du poète. Pour sa part, Jamblan chante des couplets gentillets entrecoupés de monologues humoristiques, dont la mesure lui vaut le surnom de « doux chansonnier ». Il n’en demeure pas moins qu’une certaine complicité s’instaure entre les deux artistes, et que c’est vraisemblablement au cours de ce séjour dans « l’Amérique des Îles, des pluies, du rhum » [10] où ils ont beaucoup de temps à tuer, qu’ils écrivent les quatre chansons qui marquent leur collaboration. En 1950, Léo Ferré intègre deux d’entre elles dans son récit radiophonique De sacs et de cordes. Il s’agit de C’est la fille du pirate et Les Douze, cette dernière interprétée par les Frères Jacques. Les textes des deux autres titres, Le Marin d’eau douce et Zingare, figurent en 1952 dans le recueil de vers de Jamblan Ordre alphabétique [12], avec la mention de leur mise en musique par Léo Ferré. À cette époque, Suzy Solidor [13] enregistre la première de ces deux chansons, et il faut attendre 2003 pour que Zingare le soit à son tour par les Faux Bijoux [14]. On ne connaît à ce jour aucune interprétation par Léo Ferré de ces quatre titres dont il a signé la musique et qui restent somme toute anecdotiques au regard de son œuvre. En réalité, si prolongement de ce bref compagnonnage il y a, il est sans doute à rechercher dans la manière des chansonniers adoptée par Ferré pour des chansons telles que La Vie moderne, T’as payé et plus encore Les Temps difficiles, dans lesquelles il fait montre d’une réelle maîtrise du genre, peut-être en partie acquise en accompagnant Jamblan au piano. En tout cas, la collaboration concrète entre les deux hommes prend fin à l’orée des années 50.
Dans les temps qui suivent, Jamblan s’affirme comme un pilier du Caveau de la République et, régulièrement, on retrouve sa gouaille et sa bonhomie dans l’émission de radio Le Grenier de Montmartre. Parallèlement, il continue à écrire des paroles de chansons dont certaines se taillent un succès appréciable, comme La Bague à Jules [15] défendue par Patachou [16]. Une de ses dernières collaborations notables a lieu avec Jean Ferrat, qui met en musique et enregistre sa chanson Ma fille [17]. À la fin de sa carrière de chansonnier, Jamblan se retire dans son Bressuire natal, où il tire accidentellement sa dernière révérence en 1989.

_________________________________
[1]. Texte pour une émission sur Europe 1 en janvier 1960 et publié dans le quotidien Libération en juillet 2003.
[2]. Viens danser quand même (musique de Jean Delettre, 1933), repris par Lucienne Boyer en 1939.
[3]. Gwendoline et Femmes (années 30).
[4]. La rumba da boum (paroles de Jamblan, musique de Django Reinhardt, T. Waltham et P. Olive, 1934), interprétée par Éliane de Creus et ses boys.
[5]. Paroles de Jamblan, musique de Laurent (Henri Herpin), 1935.
[6]. Musique de Henri Herpin, 1934.
[7]. Film réalisé par Maurice Cloche (1938).
[8]. Paroles américaines de Harold J. Rome.
[9]. Titre français : Escale à Hollywood. Film réalisé par George Sidney (1945) avec Gene Kelly, Frank Sinatra et Kathryn Grayson, qui y interprète All of sudden my heat sings.
[10]. Jamblan in Ordre alphabétique (cf infra).
[11]. De sacs et de cordes, Jean Gabin, Léo Ferré, CD, Le Chant du Monde, 874 1165 (2004).
[12]. Jamblan, Ordre alphabétique, Les Éditions du Scorpion, Paris, 1952. Couverture illustrée par Peynet.
[13]. Le Marin d’eau douce, 33-tours, 25-cm, Decca, 133.618.
[14]. Léo Ferré, les inédits, CD, La Mémoire et la mer, 10 088.89.
[15]. Musique d’Alec Siniavine.
[16]. 33-tours, 25-cm, Philips, 76.097 (1959).
[17]. 33-tours, 25-cm, Decca, 123.991 (1961).
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (1)