lundi, 10 novembre 2008
Deux ans d’échanges
 Ainsi, ce lieu a aujourd’hui deux années d’existence. Son fonctionnement a été considérablement ralenti depuis un certain temps. J’ai toujours dit, en effet, que je ne publierais pas pour publier. Il se trouve que je n’ai plus grand-chose à dire : je ne peux pas ad aeternam écrire des textes à propos de Léo Ferré, même si mon admiration, ancienne, est constante et non démentie.
Ainsi, ce lieu a aujourd’hui deux années d’existence. Son fonctionnement a été considérablement ralenti depuis un certain temps. J’ai toujours dit, en effet, que je ne publierais pas pour publier. Il se trouve que je n’ai plus grand-chose à dire : je ne peux pas ad aeternam écrire des textes à propos de Léo Ferré, même si mon admiration, ancienne, est constante et non démentie.
Deux ans. Comme d’habitude, il me semble que... c’était hier, comme on dit. Tout va trop vite.
Il m’a décidément été impossible, en dépit de mes demandes réitérées, de trouver de nouveaux auteurs, d’autres « invités du taulier ». Je le conçois fort bien : ce n’est pas parce que j’ai un jour ouvert un blog que tout le monde doit se précipiter pour m’aider. Donc, aucune amertume, pas d’acrimonie. Simplement, le rythme change, les parutions s’espacent. Mais on continue.
Amicalement à tous.
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)
samedi, 18 octobre 2008
Un documentaire de Sandrine Dumarais
 Je connais Sandrine Dumarais depuis quelques années. C’est une documentariste dont j’ai vu un film consacré à Mitterrand et à la Nièvre ; un autre, à Trintignant disant Apollinaire ; un, sur un village d’enfants ; un, enfin, dévolu à Albertine Sarrazin, auquel elle a cru bon de donner à ma misérable personne le rôle d’un fil conducteur.
Je connais Sandrine Dumarais depuis quelques années. C’est une documentariste dont j’ai vu un film consacré à Mitterrand et à la Nièvre ; un autre, à Trintignant disant Apollinaire ; un, sur un village d’enfants ; un, enfin, dévolu à Albertine Sarrazin, auquel elle a cru bon de donner à ma misérable personne le rôle d’un fil conducteur.
Je viens de découvrir, encore inédit, Brel, Brassens, Ferré, trois hommes sur la photo, son plus récent film : cinquante-deux minutes. Je me demandais ce qu’elle allait pouvoir tirer de cet entretien ultra-connu, paru dans Rock et Folk, republié dans Chorus, édité en album chez Fayard, diffusé à Europe 1, bref, battu et rebattu. J’ai été très heureusement surpris. Fidèle à sa manière d’écrire, elle met tout sur la table dès le début puis, d’un doigt délicat et sans en avoir l’air, trie et ordonne. Dira-t-on jamais suffisamment l’importance du montage ? Ici, il fait vivre effectivement la rencontre devenue légendaire, la situe dans son contexte de 1969 et fait très bien comprendre en quoi elle peut encore faire rêver en 2008. Ne serait-ce qu’en cela, le documentaire de Sandrine Dumarais, discret, respectueux, est intéressant. Mais le morceau de bravoure est constitué par les réactions de Juliette Gréco à l’enregistrement des voix des trois hommes. J’avais suggéré à la réalisatrice de la rencontrer. Elle a tiré de l’interview que la chanteuse lui a accordée le meilleur, le plus fin. Avec des remarques que seule la Gréco peut faire au sujet des trois chanteurs : « Ils auraient voulu baisser leur culotte qu’ils n’auraient pas fait autrement ».
Je ne sais pas quand ce film sera diffusé par FR 3. Il faudra patienter : il vaut d’être vu.
16:28 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (41)
vendredi, 03 octobre 2008
Monsieur Tout-Chant
Je continue à espérer d’un musicologue qu’il s’attache à étudier l’influence de la musique sacrée chez Léo Ferré, ainsi que les aspects de son chant qui se rapprochent de la cantillation, la psalmodie, la prédication… Évidemment, Céline Chabot-Canet pose cette question de loin en loin, mais ne la développe pas, en tout cas pas suffisamment du tout. Il y a longtemps que ce sujet m’intéresse, mais je ne suis pas compétent pour le traiter. Pourtant, il faut être sourd pour n’entendre pas, dans sa musique, son phrasé, sa diction parfois incantatoire, ce registre si reconnaissable, tellement identifiable, mais pour en traiter, il faut des connaissances spécialisées, un vocabulaire, que je ne possède pas.
16:28 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (48)
mercredi, 17 septembre 2008
La relève
Enfin, il semblerait que les vieux briscards dans mon genre puissent commencer à passer la main. Sur le site de l’Harmattan, est mis en vente le livre de Céline Chabot-Canet, Léo Ferré, une voix et un phrasé emblématiques.
Je précise dès l’abord que, conformément à mon attitude habituelle, je ne parlerai pas de ce livre que j’ai commandé et pas encore reçu. Simplement, je relève ici la notice concernant l’auteur, qui figure en quatrième de couverture, telle qu’on peut la lire sur le site : « Céline Chabot-Canet est née en 1983. Après des études de chant et de musicologie, elle est actuellement attachée temporaire d’enseignement et de recherche au département « Musique et musicologie » de l’université Lumière-Lyon 2. Elle termine une thèse sur l’analyse de la voix et de l’interprétation dans la chanson française depuis 1950 ».
1983… Mes filles sont nées en 1981 et 1984. Céline Chabot-Canet pourrait donc être ma fille. Elle avait un an lorsque j’ai commencé à rédiger Léo Ferré, la mémoire et le temps. Ouf ! Les jeunes nous succèdent enfin, prennent la plume et publient. Et, apparemment du moins, pas n’importe quoi, pas la millième biographie erronée et mal torchée. Je précise que je ne connais pas cette jeune femme, ne l’ai jamais rencontrée, ne lui ai jamais écrit ni téléphoné. Je suis simplement ravi que quelque chose se produise enfin dans un domaine moins exploré et que cela provienne d’une personne jeune.
Que vaudra le livre ? Je n’en sais rien. Je me méfie un peu des ouvrages issus de masters, mais il ne faut évidemment pas se braquer sur ce point. Au dos du livre, on peut entre autres lire ceci : « Analyser la chanson, c’est souvent se trouver confronté à la dialectique texte-musique, privilégier l’un ou l’autre, et sous-estimer l’importance de l’interprétation, de la pratique vive et des variantes induites par la performance dans un genre qui relève pourtant de l’oralité, et, à ce titre, se caractérise par sa « mouvance », selon la formule de Paul Zumthor ».
Cela mérite au moins qu’on aille voir de quoi il retourne. Il ne faudrait pas oublier, en effet, ce que la voix de Léo Ferré a d’extraordinaire, ni ce que sa manière de chanter apporte de personnel. J’espère seulement être à même de comprendre ce que Céline Chabot-Canet a à nous dire.
09:34 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (10)
vendredi, 12 septembre 2008
Il y a quinze ans, II
Un bref complément à ma note du 17 juillet dernier. Aux parutions du quinzième anniversaire de la disparition de Léo Ferré, sont à ajouter le livre de Perraudeau et celui de Céline Chabot-Canet. Cependant, l’ouvrage de cette dernière était déjà annoncé en 2007 (lire ma note Aspects de la recherche musicale). J’ai commandé ces ouvrages dont la diffusion n’est pas gigantesque, ne les ai pas encore reçus.
14:26 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (0)
jeudi, 24 juillet 2008
Banlieue-sur-Love
Je crois l’avoir déjà dit, une des chansons qui m’« épatent » le plus est La Banlieue. J’ai découvert ce texte – sans le comprendre totalement et avec le trouble qu’on imagine – à dix-sept ans, en 1969, l’année même où s’ouvrait à moi l’œuvre ferréenne. C’est dire que je ne connaissais pas la première version, celle, en studio, de 1967. Longtemps, pour moi, La Banlieue, ce fut celle-là, enregistrée en public à Bobino dans le double 30-cm Barclay de 1969. Un peu plus tard, découvrant le disque de 1967, j’entendis la première version, que j’appellerai ici La Banlieue I, la chanson en public devenant évidemment La Banlieue II.
Cette convention purement chronologique établie, voyons.
Pour dire ce qui lui plaît « chez les filles », Léo Ferré use comme souvent de l’anaphore. Cette construction est par ailleurs établie sur une suite d’images – là aussi, c’est fréquent chez lui. Cette fois, une troisième donnée est à prendre en compte : à l’anaphore et à la suite métaphorique s’ajoute l’élimination, puisque l’auteur prend soin de toujours décrire la femme en précisant que « c’est pas » cela qui lui plaît chez elle. Ce n’est qu’au refrain – s’agit-il d’un refrain à proprement parler ? – qu’il énonce ce qui le touche le plus dans le corps féminin : « C’est la banlieue ». Je ne pense pas me tromper en avançant que ce genre d’image, en 1967, est foncièrement nouveau, tout au moins au disque ou sur une scène de music-hall. Peut-être trouverait-on l’équivalent chez Sade ou Bataille, voire dans certaines poésies jargonnantes de Villon – ce n’est pas certain – mais cela ne dépasserait pas alors le cadre de publications littéraires, ni l’audience d’un public lettré ou seulement curieux. Ici, nous sommes au spectacle ou chez le disquaire, l’image est portée à l’avant-scène, voire à domicile, elle revêt un caractère plus populaire.
Ce qui est plaisant, c’est que le procédé de l’élimination employé par l’auteur aboutit à une série de peintures brèves des différentes parties du corps féminin, qui sont à leur manière d’authentiques blasons. Mieux : le poète s’applique tant à nous dire que, non, ce n’est pas ça qui lui plaît vraiment, qu’on devine que cela, justement, lui plaît beaucoup, même si c’est un peu moins que « la banlieue ». Car tout est fort beau ici.
Autre point, à présent. Le final de La Banlieue I dit ceci : « Quand je brûl’ pour les filles / Au feu de Dieu / C’est pas pour leur p’tit’ gueule / Que j’irai vendr’ mon âme / Et quand j’me r’trouv’rai seul / Pour mes dernières gammes / Moi j’crèv’rai sans un’ fille / Dans un’ banlieue ». Chute simple et grave, touchante. Un peu classique même, puisque alors, le mot « banlieue » reprend son sens tout simple, géographique : un endroit plus ou moins annexé par la cité qu’il borde, isolé, peu riant et indéfini : une banlieue.
Deux ans plus tard, la fin de la chanson est modifiée : « Moi quand j’vais chez les filles / C’est pour pas cher / Quant à brûler ma gueule / Au feu du nom de Dieu / Comm’ je n’suis pas bégueule / Je fais tout c’que je peux / Quand j’descends chez les filles / C’est en enfer ». Le propos est plus violent, comme l’est d’ailleurs l’interprétation chantée (encore faut-il prudemment nuancer ce dernier point : La Banlieue II, en public, est forcément plus forte que La Banlieue I, à cause des effets de scène). On ne parle plus du « feu de Dieu » mais du « feu du nom de Dieu » : l’imprécation, le blasphème sont présents. On ne brûle plus « pour les filles » mais « [s]a gueule ». Même si on se retrouve seul, on fait « tout ce qu’[on] peut » (l’année suivante, Avec le temps reprendra en partie ce propos : « tout seul peut-être mais peinard »). Surtout, les filles dont il était question deviennent uniquement des prostituées : « C’est pour pas cher ». On « descend » chez elles comme on fait une descente dans des quartiers réservés… mais cela va plus loin, et c’est peut-être le plus intéressant de cette deuxième version. Car on descend aussi vers le sexe, qui est en bas. On descend vers la banlieue… Or, l’on retrouvera dans Et… basta !, en 1973 : « Foutez-m’en vingt litres, camarade ! Je descends à la proche banlieue, celle qui se défait doucement vers le XVe, cette banlieue de mes défaites et de votre vertu, camarade ». Il s’agit sans doute d’autre chose encore mais dans l’imaginaire de l’auteur, pour aller en banlieue, il semble qu’il faille descendre. Il apparaît qu’il descend en banlieue, de la même manière qu’on monte à Paris : par familiarité de langage. On descend cette fois « en enfer », ce qui est intuitif : l’enfer est en bas, certes, on y descend – mais pas seulement, car il y a, comme toujours, polysémie chez Léo Ferré. C’est « la banlieue » qui est devenue « l’enfer ». Le sexe de la femme s’est mué en enfer : on peut toujours comprendre qu’il s’agit ici de chaleur, d’érotisme, de péché, de ce qu’on voudra. On peut aussi imaginer que les femmes lui sont (au moins en théorie) devenues infernales, insupportables, une malédiction : il se trouve alors au lendemain de sa rupture sentimentale de mars 1968. Il ne faudra certes pas y voir une prémonition : celle des banlieues d’aujourd’hui devenues un enfer, celui des « violences urbaines » ; ce serait commettre un contresens par anachronisme : en 1969, ce n’est pas le cas (les interprétations a posteriori constituent toujours un piège dangereux). Enfin, je propose pour le vers « C’est pour pas cher » une dernière piste interprétative : une femme légitime coûterait cher (dans l’esprit de l’auteur, évidemment, et à ce moment-là seulement), surtout lorsque rien ne va plus ; on va donc « chez les filles ».
Enfin, on observe qu’à la fin de La Banlieue I on trouve la mort, alors que, dans celle de La Banlieue II, on se heurte à la damnation. La damnation fera l’objet d’une chanson lorsque l’artiste aura constaté que « tout ce qui est mal, c’est bon ; tout ce qui est bon, c’est mal » et en aura tiré la leçon : « Alors, damne-toi ! »
Me trouvant à la campagne, je ne dispose pas des textes en ce moment. J’ai donc été obligé de citer de mémoire. Je vous remercie de bien vouloir excuser les erreurs éventuelles.
14:05 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (3)
jeudi, 17 juillet 2008
Il y a quinze ans
Je redoutais le quinzième anniversaire de la disparition de Léo Ferré, craignant une exploitation commerciale difficilement supportable, mais, finalement, les parutions auront été modérées, bien plus que pour le dixième anniversaire, en 2003. Je veux parler, naturellement, des publications de circonstance, celles, parfaitement inutiles, dont sont spécialistes les marchands.
Sans – naturellement – porter le moindre jugement sur leur contenu, je rappelle les trois livres mis en vente : le Valade, le Perrin, la réédition du Frot. Encore le Valade était-il annoncé depuis plusieurs mois. Barclay a sorti un double CD de compilation, toujours le même, estampillé « 15e anniversaire ». Les Copains d’la neuille ont donné leur quatorzième livraison, mais elle n’est pas liée à la date en question. Quant aux publications et rééditions de La Mémoire et la mer, elles auraient eu lieu de toute façon. Au total, on est loin du déluge éditorial de 2003 où, si ma mémoire est bonne, on avait dû accueillir pas moins de vingt-trois parutions.
Sur un plan plus personnel, j’ai reçu sur mon lieu de vacances, à deux reprises, des appels d’une journaliste de La Vie quercynoise, hebdomadaire lotois, qui devait rédiger un article sur un sujet dont elle ignorait manifestement tout. Je reconnais volontiers qu’elle avait le désir de savoir et de prendre l’attache de personnes susceptibles de la renseigner sur Léo Ferré et le Lot. La mairie de Gourdon la renvoya vers Bernard Legendre qui l’orienta vers moi. Je l’ai ensuite aiguillée sur d’autres personnes.
Les anniversaires ne me touchent guère. L’absence de Léo Ferré n’est pas plus forte la quinzième année que la première et, qui plus est, j’aimerais autant qu’on célébrât le 24 août plutôt que le 14 juillet… À ce propos, 2013 approche à grands pas (« Vingt ans déjà » sera le leitmotiv) et, surtout, 2016 (« Léo Ferré aurait cent ans »). Espérons que, d’ici là, des initiatives non liées aux anniversaires auront su prendre date, marquer durablement l’histoire de l’artiste.
14:35 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (9)
mardi, 24 juin 2008
Le samouraï
15:10 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (6)
lundi, 09 juin 2008
Léo Ferré et les philosophes, par Francis Delval
Je remercie Francis Delval de voler à mon secours et de redonner vie à ce lieu que des questions de santé et d’autres travaux m’empêchent en ce moment d’animer – mais ça reviendra.
(Cette note peut être lue comme une suite de la note Léo Ferré lecteur de Sartre. Une troisième note consacrée à Ferré, Stirner et Bakounine verra peut-être le jour, mais le sujet a déjà été traité à plusieurs reprises, en des lieux divers… L’implicite de cette note est aussi le problème de l’abondance des noms propres dans l’œuvre de Léo Ferré).
« car , tout ça, vraiment, l’être, le néant, l’en-soi, le pour-soi... Ta gueule, Philo ! » (in La Queue).
En octobre 1933, Léo Ferré revient à Monaco pour faire sa « classe de philo », le collège de Bordighera n’assurant les cours que jusqu’en première. Il semble s’être tout particulièrement intéressé à la philosophie, au point d’être surnommé « Philo » par ses camarades. Le fait d’avoir eu Armand Lunel comme professeur y fut certainement pour beaucoup, Lunel sur lequel on passe trop vite, voire pas du tout, dans les biographies de Ferré. Passer des « Chers frères » à Lunel est quand même un sacré changement !
Armand Lunel (1892-1977), normalien, agrégé, mais aussi poète et romancier (il fut le premier lauréat du prix Renaudot en 1926 pour son roman Nicolo Peccavi), grand ami de Darius Milhaud pour qui il écrivit quelques livrets, spécialiste de l’histoire et de la langue de la communauté juive du Comtat Venaissin, qui se fit l’ethnologue du pays niçois et fut le dernier locuteur vivant du judéo-provençal, ne put laisser le jeune Ferré indifférent. Lunel n’ayant pas quitté Monaco, qui n’est pas très grand, il est vraisemblable qu’ils se rencontrèrent par la suite...
De l’enseignement de Lunel, Ferré semble avoir particulièrement apprécié les cours de philosophie des sciences. Il y découvrit (bien sûr de façon sommaire, étant donnée la complexité de ces questions) Einstein (« le plus grand des poètes »), la relativité générale, les géométries non- euclidiennes, Lobachevski, Riemann , les espaces courbes…
« Le théorème de Thalès quelle foutaise du moment que je vous dis que tout est courbe Misère » (Benoît Misère, p. 273)… Étant donné le contexte, on attendait le postulat d’Euclide plutôt que le théorème de Thalès !
Le relatif, la parallèle, le courbe, la courbure, etc., feront désormais partie du vocabulaire poétique de Ferré, notamment dans La Mémoire et la mer, par exemple :
Emme C2 EmmeC2
Aime moi donc ta parallèle
Les métaphores reposant sur le courbe et la parallèle sont fort nombreuses, mais elles relèvent de la poésie, jamais de la science. Les mots de la science, des mathématiques deviennent des images récrites au poème.
Notons que le hasard a fait que l’autre grand poète et écrivain anarchiste né à Monaco en 1924, Armand Gatti, heureusement toujours bien vivant et hyperactif, a la même passion que Ferré pour la relativité, les géométries nouvelles, la théorie des quanta, et est à la recherche d’une écriture neuve, d’une écriture quantique, et construit ses pièces de théâtre, poèmes, voire chansons, avec les mots de la science. N’ayant connu que l’école primaire avant de rejoindre le maquis à seize ans, il est , lui, autodidacte.
Ferré et les philosophes... Rentrons dans le vif du sujet. À lire Ferré, on voit bien que pour lui certains philosophes sont des personnages parfois ridicules, de même qu’il y a un ridicule de certaines prétentions de la philosophie dans sa quête de vérité.
Le ton est donné dès la préface de Benoît Misère : « Bossuet vissé à Confucius, siamoisement, Aristote lunettes ouvertes sur la Série Noire, Monsieur Sartre dans un claque avec Bergson à mesurer le poids d’un clitoris tarifé… » Même Sartre, qu’il admire, n’échappe pas aux sarcasmes. Quant à Bergson, dont le public au Collège de France était essentiellement féminin, on l’imagine mal dans la posture où Ferré le met. Nous sommes dans la blague, et on pense à ce que Voltaire disait de Marivaux, qu’« il pesait des œufs de mouche dans des balances de toiles d’araignées »... Les philosophes discutent sur des riens , de Confucius à Sartre (notons que Marx sera un des rares philosophes que Ferré ne critique (presque) jamais…)
Entrons dans l’œuvre de Ferré, où nous rencontrerons Aristote, Kant et Freud. Puis, dans un autre registre, Nietzsche et Bachelard.
a) Aristote.
On trouve dans la brochure de 1969, Mon programme, la reproduction d’une gravure anonyme sur bois du XVIe, reprise en petit format dans Testament phonographe (p. 307). Dans les deux cas, Ferré l’a sous-titrée « Toutes des salopes »... Formule que selon lui répétait un de ses camarades d’études.
On sait que Ferré fut grand amateur de gravures, qu’il admirait Dürer, et on peut penser qu’il a parfaitement identifié le sujet : il s’agit – légende ou fait historique peu importe – d’« Aristote chevauché par la courtisane ». Il sert de monture à Phyllis, marchant à quatre pattes et la portant sur son dos, le mors entre les dents. Phyllis a un fouet dans une main. Il existe au Louvre une gravure sur le même thème, œuvre de Hans Baldung Grien, élève de Dürer. Selon les versions qui ont couru surtout au Moyen-Âge (Le lai d’Aristote était fort répandu), c’est tantôt Hermias, tantôt Alexandre, dont Aristote était le précepteur, qui auraient « prêté » Phyllis à Aristote, à condition qu’il lui serve de monture. D’autres versions disent qu’Aristote voulait montrer à Alexandre le piège dangereux que représentaient les femmes, et qu’il a été pris à son propre stratagème. On trouve souvent cette scène sculptée sur de nombreux porches d’églises et de cathédrales gothiques.
Voilà donc Aristote, initiateur avec Platon de la philosophie occidentale, le philosophe le plus influent du Moyen-Âge, dont les concepts ont façonné le christianisme et l’islam, ici réduit à l’état de bête de somme. Animal à quatre pattes. Un âne. Il est probable que c’est moins Aristote qui intéressait ici Ferré que la possibilité de mettre le sous-titre... En 1969, il a quelques comptes à régler, sur lesquels on ne s’étendra pas.
b) Freud et Kant. Ici associés car il en est question dans le même texte : L’Imaginaire.
Freud : « L’angoisse se parlera avec des paroles nouvelles et venues des magasins surpris, ces magasins PSYCHIAD’HORREUR où s’entassent depuis des lustres le style et la phrase de ces dérivés de l’autrichienne FREUD’SEXY ». Formule pour le moins sibylline. Mais voici la psychanalyse clouée au pilori, et Sigmund Freud curieusement féminisé... À travers cette féminisation insolite, on sent la réticence, voire le refus ferréen des idées freudiennes. Il n’argumente pas, il « féminise » : l’analyse, les rêves, voire l’inconscient, des histoires de « bonnes femmes »... ? Il nous dit quelque part (je n’ai pas retrouvé la source, donc je cite de mémoire) que « l’inconscient a longtemps été confondu avec une maison de tolérance, la Maison Libido ». Et dès la chanson L’Esprit de famille, il épingle le complexe d’Œdipe, nous en avions discuté en ce lieu il y a fort longtemps, à propos de J.-F. Revel qui donnait la chanson de Ferré comme exemple de contresens sur l’Œdipe, alors qu’il s’agit d’une plaisanterie.
Kant : « Les banques échangeront quelques coups d’œil, quelques idées subversives, enfin ! et diront à Emmanuel Kant de se taper une fille au lieu de se masturber, chaque vendredi, au pied du même arbre. Elles lui placeront, s’il le désire, « LA CRITIQUE DE LA RAISON MANDRAGORE »... Quant à la pureté, il pourra toujours aller à son arbre » et déjà, dans un entretien de 1971 (À bout portant) il racontait les vendredis de Kant, avec un regard plus compréhensif : « Il avait besoin d’une communication sexuelle. Et il l’avait trouvée au pied d’un arbre ».
Que penser de cette anecdote ? On a la belle formule « Critique de la raison mandragore »... Quel titre de livre cela ferait ! On retrouve ici l’obsession ferréenne du gibet, du pendu, qui traverse son œuvre de Graine d’ananar à En Angleterre a long time ago, la mandragore, plante aux vertus prétendument aphrodisiaques, était censée naître du sperme des pendus. Machiavel a écrit une comédie fort amusante sur le thème de la séduction par la mandragore.
Qu’en est-il en réalité de cette histoire des vendredis kantiens ? J’ignore où Ferré a trouvé cela, mais rien, à ma connaissance, ne permet d’avérer cette anecdote, ni dans l’œuvre et la pensée de Kant, ni dans les rares textes biographiques. Elle ne figure pas dans le petit livre de Thomas de Quincey, Les Derniers jours d’Emmanuel Kant, ni dans la seule biographie existant de Kant, écrite par Arsenij Goulyga, en 1981, et traduite du russe en français en 1985 seulement. Quincey a compilé quelques souvenirs d’amis du Kant vieillissant, avec son humour habituel, petit livre très juste dont le cinéaste Philippe Colin a tiré en 1993 un excellent téléfilm produit par Arte. La biographie de Goulyga est très savante et complète. Rappelons que Kant a été élevé dans la religion protestante dans son courant le plus austère, le piétisme, qui prônait notamment l’égalité d’humeur en toute circonstance (on en trouve un bon exposé dans le Wilhem Meister de Goethe). Que dans son ouvrage Métaphysique des mœurs (tome 1, doctrine du droit), il condamne toute sexualité hors mariage, notamment la masturbation, et que Kant n’était pas homme à désobéir à ses propres principes. Cela dit, il ne fut pas insensible au beau sexe et envisagea, étant tombé amoureux, le mariage par deux fois. Mais, écrit-il : « Lorsque je pouvais avoir besoin d’une femme, je ne pouvais en nourrir une. Lorsque je pus en nourrir une, je n’en avais plus besoin ». Il eut même, à l’approche de la soixantaine, des propositions d’une jeune femme mariée de vingt-trois ans, insatisfaite, qui lui écrit : « Nous vous attendrons donc et ma montre sera remontée »… Cette étrange formule vient du livre de Sterne, Tristram Shandy. C’est la formule qu’emploie le père Shandy pour dire à sa femme qu’il est l’heure d’aller accomplir son devoir conjugal du dimanche après-midi. Le livre de Sterne fut en 1760 un best-seller européen, et « remonter sa montre » est devenu une formule courante… Kant, apparemment, ne donna pas suite. Si quelqu’un connaît la source des dires de Ferré, l’information sera la bienvenue.
(Pause : signalons pour le fun les livres de Jean-Baptiste Botul, philosophe créateur du botulisme, dont plusieurs textes ont été publiés aux éditions Mille et une nuits : Nietzsche et le démon de midi, Landru précurseur du féminisme et La Vie sexuelle d’Emmanuel Kant… En fait, l’œuvre de Botul est un aimable canular, créé par un collectif de six ou sept personnes dont G. Mordillat, Frédéric Pagès, l’oulipien H. Le Tellier et quelques autres...)
c) Nietzsche et Bachelard.
Il y a chez Ferré plusieurs passages (chansons, poèmes, entretiens) où Nietzsche apparaît. Mais de la même façon que pour le poète-philosophe Dante, dont il cite presque toujours les mêmes vers, toutes les occurrences de Nietzsche se rapportent au même épisode : l’effondrement de Turin. Ceci dès la chanson Les Poètes :
Ils marchent dans l’horreur la tête dans les villes
Et savent s’arrêter pour bénir les chevaux
Le nom de Nietzsche n’apparaissant pas, ce n’était pas évident quand, comme moi, on était encore lycéen, de comprendre l’allusion. L’allusion devient claire avec le poème Le Chemin d’enfer, publié en 1969 dans Mon programme :
Ô Nietzsche agrippé naseaux de Turin
Ce fiacre roulant dans le fantastique
Et la Folie te prenant par la main
J’entends dans la rue une hippomusique
Ô Nietzsche l’entends-tu ? C’est du chagrin
Avec le mors au cœur, c’est une clique…
L’allusion se fait plus précise, sans être explicative pour autant. Il suffit dès lors de chercher la source. Belleret voit une énigme dans l’absence de « aux » entre « agrippé » et « naseaux ». Alors que cette absence renforce l’identification de Nietzsche au cheval battu, et qu’en mettant « aux », Ferré aurait dû renoncer au « Ô » vocatif, très rimbaldien. On retrouve ce poème dans les recueils ultérieurs, l’histoire racontée à P. Wiehn en 1971, reprise dans la plupart de ses récitals à partir de 1983.
Rappelons brièvement les faits : Nietzsche, malade, est en 1888 aux portes de la folie. Il réside alors à Turin. Fin 1888, il n’écrit plus guère, improvisant des heures entières au piano. Le 3 janvier 1889, sortant de sa maison, il voit à la station de fiacre (je cite le Dr Podach, auteur d’un excellent petit livre : L’Effondrement de Nietzsche, Gallimard) : « Une vieille rosse éreintée sur laquelle s’acharne un cocher brutal. La pitié l’envahit... Il se jette au cou de la bête martyrisée. Il s’écroule ». À son réveil, Nietzsche se prend à la fois pour Dionysos et pour le Crucifié. Il a sombré dans la folie, il est désormais de l’autre côté et mènera jusqu’à sa mort en 1900 une vie végétative.
Je ne connais pas d’autre évocation de Nietzsche chez Ferré que cet épisode tragique, et qui semble pour lui fortement symbolique, si nous nous référons à la chanson Les Poètes.
Quant à Bachelard, nous voici dans un contexte très différent. Ferré avait très envie de le rencontrer, de le connaître, il avait même pensé l’inviter à Perdrigal ! Ayant une grande estime pour le philosophe et son œuvre, même si nous ignorons ce qu’il en a lu, il lui envoya un exemplaire de Poète.. vos papiers !, dédicacé. Des destinataires de ces envois rituels, Bachelard fut le seul à répondre, réponse amicale et pleine d’humour. La lettre de Bachelard a été reproduite plusieurs fois, par exemple dans le Belleret. Bachelard réapparaît dans L’Opéra du pauvre, curieusement dans la monologue de la baleine bleue : la baleine connaît le philosophe et sait qu’il préfère rater sa leçon de philo que l’allumage de son poêle le matin. Ici encore, Ferré met en avant l’anecdote, le lieu commun, alors qu’il avait sûrement bien d’autres choses à dire sur Bachelard. On comprend mal que Ferré n’ait pas cherché à le voir. Ferré était-il un timide, bien qu’extraverti ? Bachelard, qui se disait l’ami de tous les vagabonds, qui discutait avec les clochards... Il était d’un abord facile, mais sans doute le Bachelard philosophe, le scientifique, l’impressionnait-il. Bachelard le « liseur » insatiable, vivant au milieu de piles de livres entassés à la diable, l’érudit... Notons que Ferré semble avoir pris la fille de Bachelard, Suzanne, philosophe des sciences, pour la sœur de Gaston... Une rencontre manquée...
Ainsi, Sartre mis à part, qu’il a lu en grande partie, ainsi que Marx, Stirner, Bakounine, Kropotkine, il semblerait que Ferré ait eu une connaissance impressionniste de la philosophie, et qu’il se focalise volontiers sur des détails ou des anecdotes. Mais nous ne savons pas tout sur ses lectures.
Peut-on parler comme on l’a fait de « textes philosophiques » pour certains textes en prose ? Est-ce légitime, est-ce un abus de langage, les extraits du Traité de morale anarchiste que nous connaissons sont trop elliptiques pour porter un jugement. Ses textes dits « théoriques » demeurent d’abord de grands textes de prose poétique, et c’est bien comme cela.
Ferré-Philo, Ferré et la philosophie, il y aurait presque matière à faire un livre.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (89)
samedi, 17 mai 2008
Gala pour Popaul
Dans mon journal de l’année 1992, je retrouve ces quelques passages concernant l’hommage qui fut rendu à Paul Castanier à l’Olympia, le dimanche 9 février. C’est la dernière fois que j’ai vu Léo Ferré en scène.
« J’ai réservé une place par téléphone à l’Olympia, pour la soirée Paul Castanier. Pauvre Popaul, incinéré. Passe le temps. (…)
Dimanche, je vais aller à l’Olympia pour ce concert en hommage à Popaul, il y aura Léo évidemment, et Rufus et Font et Val, mais aussi Higelin et Moustaki, le tout présenté par José Artur. Un soir unique, boulevard des Capucines, au profit de la compagne de Popaul, Kasuko Castanier. (…)
Le spectacle pour Popaul était très bien, avec beaucoup d’émotion et de présence. En plus des grands noms, il y avait des inconnus, amis de Popaul, c’était très touchant, tout cela – et puis des photos de lui projetées, et des extraits d’une interview de lui et d’un spectacle de Léo avec lui… Ses morceaux au piano, enregistrés dans un disque, étaient diffusés – et puis des moments touchants, quand Moustaki parlait avec José Artur. Très bien, tout cela, à part Higelin que, vraiment, je ne peux pas supporter, c’est plus fort que moi. Il y avait Léo, naturellement immense, dont la seule apparition grandit encore l’émotion, méduse la salle. De plus en plus, on lui fait des ovations debout, dès son entrée en scène. Je n’ai pas connu personnellement Popaul, mais j’ai toujours eu l’impression que oui, justement. Et je ne peux pas accepter sa mort. Qu’est-ce que ça veut dire, “je ne peux pas accepter ?” Rien, n’est-ce pas ? »
00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (18)
vendredi, 28 mars 2008
En écho
On l’a dit ici à plusieurs reprises : si l’on peut n’être pas d’accord pour mettre sur le même plan Léo Ferré et les noms illustres qu’habituellement on lui associe, il n’en demeure pas moins qu’il est nourri de ces auteurs. Ce qui est amusant, au-delà de leur présence effective dans son œuvre (lorsqu’il les chante, par exemple) ; au-delà de leur influence stylistique indéniable (il n’est pas le seul, la prosodie de Jean Ferrat doit beaucoup à Aragon) ; c’est le « détournement » qu’il se plaît à faire de certaines de leurs œuvres, de leurs tournures, de leur climat.
À La Mort des amants, il donne une introduction nouvelle qu’il reprend en conclusion : « L’amour sans la mort, ce n’est pas tout à fait l’amour », c’est-à-dire un des aspects du poème lui-même qu’il a mis en prose et isolé, en épigraphe comme en clausule.
Lorsqu’il écrit Le Bateau espagnol, on ne risque rien à affirmer que Le Bateau ivre vogue non loin dans son esprit : « J’étais un grand bateau descendant la Garonne » répond directement à « Comme je descendais des fleuves impassibles » et « Porteur de blés nouveaux avec des coups de trique » est un écho à « Porteur de blés flamands et de cotons anglais ». Dans cette même chanson, « Le bonheur ça vient toujours après la peine » répond à « La joie venait toujours après la peine ».
L’Âme du vin, encanaillée chez Odéon, éclot soudain en L’Âme du rouquin.
Il est d’autres rapprochements possibles comme les « citations » dans le corps des textes. « On passe à l’examen d’ minuit » de Vingt ans provient de L’Examen de minuit, expression consacrée depuis 1857. « Avec nos magnétophones qui se souviennent de ces voix qui se sont tues » est une « citation » de « L’inflexion des voix chères qui se sont tues ».
On remarque par ailleurs que les poésies dont on retrouve chez lui l’écho, il les a aussi chantées, bouclant ainsi la boucle des influences intellectuelles (le terreau nourricier, le lieu fondateur), des tournures stylistiques (la prosodie brodée au chiffre des grands poètes) et de l’interprétation dans tous les sens du terme (les choix artistiques de la mise en musique d’une part et le chant proprement dit d’autre part).
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (1)
lundi, 17 mars 2008
Pause de printemps
Le taulier part à la campagne pour un mois environ, pour raisons de santé. Ce lieu reste ouvert, les commentaires avec, s’il vous plaît d’en faire quelquefois.
Dans la mesure où il lui sera loisible de disposer d’internet, le taulier suivra tout cela avec attention.
La réouverture est prévue pour mi-avril, mais il se peut que de nouveaux textes soient publiés dans l’intervalle. Ne perdez pas l’adresse : ce lieu est le vôtre.
Amicalement.
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (6)
mercredi, 12 mars 2008
La the môme
Il existe chez Léo Ferré un côté « témoin de son temps », peut-être involontaire d’ailleurs. Je ne pense pas ici aux textes « de chansonnier » qui fustigent l’époque, mais à de petites notations contenues dans les chansons, ici et là, dont voici un exemple qui, personnellement, me paraît frappant. Il s’agit de l’image d’une femme délurée en attendant d’être libérée et de ses métamorphoses successives.
En 1961, l’époque n’a plus la rigidité des années 50, la Ve République est jeune encore mais porteuse de promesses de stabilité et, si la guerre d’Algérie empêche d’être serein, une légère – oh, très légère – évolution des mœurs se fait jour. La femme jeune et un peu délurée d’alors s’appelle « jolie môme ». L’appellation en elle-même vaut d’être commentée. « Môme » est une survivance de l’argot des années 40 et 50, qui fait de la femme « la môme » (fût-elle Piaf), éventuellement « la môme vert-de-gris » (Peter Cheyney), « bébé », « la petite », « fillette ». La femme est alors tenue pour perpétuellement mineure. Quand elle ose, pourtant, avec l’insolence altière de sa jeunesse, elle ne porte pas de soutien-gorge, mais uniquement lorsqu’un solide pull-over la barricade et la protège : elle est « tout’ nue / Sous [s]on pull ».
Rapidement, viendra 1968 qui changera tout. Deux ans plus tard, en 1970, la jolie môme a grandi, elle s’appelle « la the nana » et porte une jupe extrêmement courte, « à ras l’bonbon », qui a remplacé « [s]a barrièr’ de frous-frous ». Si l’on écoute attentivement, on retrouve cette même fille juste après, qui croise dans Les Pops. Cette fois, elle a « la jupe en trop ».
On mesure le chemin parcouru : le pull-over a disparu, la jupe a raccourci puis elle a été enlevée. C’est l’époque de la révolution sexuelle et de l’amour libre ; profitant de l’évolution des mœurs, de la maîtrise de son corps due à la contraception et de l’air du temps qui permet aux « enfants » de s’inventer « la vraie galaxie de l’amour instantané », l’éternelle jolie femme, pleine de vie et de joie, à présent est « pop et [est] tout’ nue » et le poète « [l’]attend ». Autrefois, il lui disait : « Viens chez moi », cette fois il l’attend et l’on devine que c’est « dans la rue » puisque – il l’a dit ailleurs – « ces enfants dans la rue sont tout seuls » et que l’amour et le sexe sont devenus « des soucis de chien ». Ne nous exhorte-t-il pas, d’ailleurs, à faire l’amour « dans le quartier des chiens où l’on n’fait que passer » ?
La liberté sexuelle n’aura qu’un temps, hélas. Le sida survenu se chargera de l’interdire pour longtemps. Un temps, Léo Ferré se moquera de la peur qui s’empare de la société, en raillant le sida dans quelques plaisanteries de fin de récital. Rapidement, il prendra conscience de la réalité de l’épidémie et ne dira plus rien à ce sujet. La jolie femme passe la main et disparaît (sous cette forme) de ses écrits.
Bien entendu, faire ici un relevé de l’image des femmes chez Ferré n’est certes pas le sujet. Je voulais simplement souligner la permanence d’une notation des mœurs dans ses chansons. J’espère ne pas avoir trop sollicité les textes dans ce bref rapprochement que je viens d’opérer et que je crois justifié.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 07 mars 2008
Mme Ferré mère parle
J’avais indiqué, dans un commentaire apporté à la note Lucienne Ferré, épouse Bergeron : « Le 28 juin 1975, Mme Ferré mère a répondu à des questions que lui posait le journal Nice-Matin. Je serais curieux de savoir de quel type d’interview il s’agissait et ce qu’elle a pu répondre. Si quelqu’un possède cette coupure de presse et veut bien me l’envoyer... » L’ami Patrick Dalmasso s’est mis en quête de cet entretien et l’a trouvé. Il est plus bref que ce que je pensais mais permet, il me semble, de tirer quelques conclusions qui dépassent le stade anecdotique. Je livre tout d’abord l’article en question, qui était illustré d’une photographie de Mme Ferré, signée Briano.
« Après l’émission TV Le Grand échiquier
Qui est Léo Ferré ? « C’était un enfant facile, mais farceur » répond sa mère (85 ans) à Monaco.
Qui est donc Léo Ferré ? Pour tenter de le savoir et de le faire savoir à des millions de téléspectateurs, Jacques Chancel lui a consacré, jeudi soir, un Grand échiquier. Mais Chancel qui est pourtant loin d’être un novice, s’y est cassé les dents. Il doit cependant y avoir une clé. Léo Ferré se découvrant pour la première fois, à moins que ce ne soit une boutade, l’a donnée à Chancel : « Allez donc le demander à ma mère ».
Ce que j’ai fait. Ce n’est un secret pour personne à Monaco : Léo Ferré est Monégasque. Mme Charlotte Ferré coule des jours paisibles dans une résidence proche de la principauté que la princesse visite régulièrement.
« Un bon fils »
« À la mort de mon mari, il y a deux ans, Léo m’a proposé de vivre avec lui et les siens. Je n’ai pas voulu. Il vient me voir souvent. C’est un bon fils ».
Le voile est déjà levé. Alors Léo le terrible, une légende ?
« Il est simplement vif comme l’était son père. C’était au contraire un enfant facile qui avait toujours de bonnes notes ».
Et là, Mme Ferré, 85 ans, l’œil vif, malicieux, éclate de rire :
« Il effaçait ses mauvaises notes et il les remplaçait par de bonnes évidemment. Un jour, son père l’a su… après il s’est mis à travailler ».
Car le jeune Léo était aussi un farceur :
« À l’époque à Monaco, il y avait encore des tramways. Léo s’amusait souvent à enfermer le wattman dans sa cabine. Pendant un certain temps il fut interdit de tramways ».
Et la musique ?
« À la maison, il chantait, comme tout le monde. Je savais seulement qu’il s’y intéressait. Il lui est arrivé de travailler pour le journal. Il a fait une interview de Paul Paray qui était déjà très connu, et Paul Paray l’avait félicité ».
Jeudi soir, Mme Charlotte Ferré et ses amies ont suivi le Grand échiquier jusqu’au bout.
Comment avez-vous trouvé votre fils ?
« Comme toujours, comme il y a quinze jours quand il est venu me voir ».
Mme Charlotte Ferré marque un temps, et dit sur le ton de la confidence : « Ses deux premiers mariages ne furent pas une réussite, mais je sais que depuis le troisième, il a un garçon et une fille, il est vraiment heureux ».
Jean Bomy ».
Que peut-on déduire de ces quelques questions et de la tendresse d’une mère ? Tout d’abord, deux petites histoires qui raviront certainement les futurs biographes de Léo Ferré : les notes trafiquées et les wattmen emprisonnés. Cela a sa place dans une biographie bien menée et d’ailleurs, dans une interview accordée à la télévision dans ses dernières années, l’artiste avait évoqué cet épisode du tramway, qui est donc deux fois attesté. Surtout, cette blague d’enfant nous révèle un garçon espiègle, qui n’est pas forcément – ou pas en permanence – le mélancolique poète qu’il est réputé avoir toujours été. Au-delà de l’historiette, se trouve un élément nouveau qui devrait éviter aux biographes à venir de se cantonner au roman Benoît Misère comme source unique à propos des jeunes années.
Ce qui est plus important, c’est que Léo Ferré était « vif comme l’était son père ». Ce qui nous donne tout de même un éclairage nouveau. On a trop eu tendance à faire de Joseph Ferré le Pierre Misère du roman. C’est certainement trop simple. Son fils nous a toujours brossé de lui un portrait plutôt négatif : un homme autoritaire qui ne le comprenait pas, lui interdisait le piano réservé à sa sœur, l’inscrivait comme pensionnaire au collège des Frères des écoles chrétiennes, le faisait rentrer à la maison alors qu’il dansait avec une jeune fille, voulait faire de lui un juriste, lui avait imposé le droit et les sciences politiques, ainsi qu’un stage chez un avocat… Dans la note Lucienne Ferré, épouse Bergeron, j’écrivais : « Il est utile de se poser la question dans un autre sens : était-il facile d’être le père de Léo Ferré ? » Cette question n’a pas soulevé de réactions, mais je la pense importante. À l’opposé, Léo Ferré n’a jamais eu pour sa mère que des mots tendres et des sourires. Eh bien, ce fils qui en voulait tant à son père lui ressemblait au moins sur un point : le tempérament vif. C’est l’épouse et la mère qui le certifie.
Mme Ferré mère atteste encore la fameuse interview de Paul Paray par son fils, document qui n’a toujours pas été retrouvé, la date exacte de sa parution dans la presse demeurant inconnue pour le moment.
Voici donc cet entretien avec la mère de l’artiste, qui est, à ma connaissance, le seul exemple du genre. J’ai signalé dans la note déjà citée que sa sœur Lucienne n’avait, je crois, jamais rien déclaré au sujet de son frère. Il y a vraiment trop peu de sources sur son enfance et son adolescence. Il faudrait pourtant, à l’avenir, pouvoir dépasser la source unique de Benoît Misère. C’est important pour l’exactitude historique.
Remerciements : Patrick Dalmasso
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 27 février 2008
Une chanson à variantes
Ils ont voté (1967) est une chanson dont la « plasticité » ne laisse pas de m’étonner. Je ne suis pas certain qu’aucune autre ait tant été adaptée, au fil du temps, aux circonstances. Les Temps difficiles est certes un texte qui connut trois versions, mais celles-ci étaient entièrement différentes. Au contraire, Ils ont voté a été retouché ixe fois, avec toujours beaucoup d’humour et de sens de l’à propos.
Le couplet ajouté, tout d’abord : « À leur chanter des tas d’chansons… », tiré de Poète… vos papiers ! est enté à la chanson dont il constitue la nouvelle ouverture.
« À porter ma vie sur mon dos / J’ai déjà mis cinquante berges » a été remplacé, le temps passant, par « soixante berges », mais Ferré n’est jamais allé au-delà.
« Le général Frappard » qui désignait de Gaulle et son attachement à la force de frappe (l’arme atomique pour la France) a cédé la place, après la disparition du Général, à « Ces Vespasien de l’isoloir », reprenant ainsi une comparaison, chère à Léo Ferré, entre l’isoloir et la vespasienne. Il y eut, je crois, une pique contre Pompidou également, du genre « Et Pompidou dans un placard », ou quelque chose comme ça, mais je ne m’en souviens plus.
« Dans une France socialiste », est devenu « Dans une France [longue hésitation mimée] socialiste » à la fin de 1980, quand la victoire de Mitterrand à la présidentielle de mai 1981 s’annonçait comme possible. Le refrain est alors : « Ils vont voter et puis après ». Cette victoire survenue, le vers est immédiatement transformé par l’irréductible artiste : « Et dans une France anarchiste ». Aucune récupération possible.
« Le jour de gloire est arrivé » a été tourné en « Le jour de gloire est arri… Ouais ! » assorti d’un bras d’honneur, toujours à la fin de l’année 1980. En 1988, le public du TLP-Déjazet entend : « Et Madonna est arrivée », final suivi d’une mimique évoquant la culotte de ladite madone, qu’elle avait coutume de jeter dans la salle.
Bien sûr, on peut penser que Léo Ferré possédait assez les mots et leur usage pour assortir ainsi son texte à toutes les couleurs du moment. Cependant, si l’on réécoute l’enregistrement initial de 1967 avec ses sages orchestrations, il n’est absolument pas évident qu’Ils ont voté soit alors une chanson satirique, moins encore humoristique. Rien, dans le ton initial, ne laisse supposer que l’auteur jouera ensuite avec. C’est plutôt, à ce moment-là, une chanson grave, désabusée. En 1969, à Bobino, elle se mue en cri de revendication bien que le texte premier soit conservé. C’est par la suite que viendra l’ironie. On peut dire finalement que ce n’est qu’après coup que son côté « humour de chansonnier » s’est révélé, dans le même temps que Léo Ferré s’amusait plus facilement en scène, donnant libre cours à sa fantaisie (à ce propos, les deux interprétations différentes de Marizibill d’Apollinaire sont un bon exemple).
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (22)
samedi, 23 février 2008
« La rue c’est bath c’est bath c’est bath »
Dans son édition du 22 février 2008, Libération a publié cet article, au sujet d’une rue baptisée Léo Ferré à Paris. Cela donne l’occasion de faire le point sur cette question.
Léo Ferré, on le sait, a toujours refusé les honneurs et les embrigadements. Il n’a accepté de « récompenses » que d’organismes professionnels comme la Sacem ou l’académie Charles-Cros. La différence est d’importance : une distinction décernée à titre professionnel est la reconnaissance d’une activité, d’un métier bien fait. Elle n’est pas fondamentalement différente d’un diplôme de meilleur ouvrier de France, par exemple. Mais aucun « honneur » ne fut jamais accepté par lui : ni la Légion d’honneur que personne, bien évidemment, ne songea à lui offrir (il n’en aurait d’ailleurs jamais fait la demande, qui doit être volontaire), ni même les Arts et lettres que Lang lui proposa, par l’intermédiaire de Maurice Fleuret, alors directeur de la Musique et de la Danse au ministère de la Culture.
Baptiser Léo Ferré une artère ou un lieu, dans une ville, qu’est-ce que cela signifie ? Si c’est une « récupération » – voire une manœuvre électorale – comme on disait en des temps reculés où chacun devait en permanence se remettre en question et se méfier de tous les miroirs et de toutes les alouettes, il n’en est évidemment pas question. À l’opposé, s’il s’agit de poursuivre dans l’optique de la Révolution puisque, faut-il le rappeler, c’est elle qui instaura l’usage de donner aux voies des noms d’hommes célèbres – comme, d’ailleurs, elle a dévolu aux grands hommes la basilique Sainte-Geneviève dont elle fit le Panthéon – c’est autre chose. Cela perpétuera son souvenir de manière durable.
Reste à savoir quel endroit de la capitale pourra, si les démarches aboutissent, porter le nom de Léo Ferré. Honnêtement, je ne pense pas qu’il faille faire la moue si, d’aventure, on lui donne une rue obscure, un coin reculé ou peu prestigieux. Ces endroits doivent aussi être nommés et leurs habitants sont les mêmes qu’ailleurs. L’idéal, naturellement, serait que soit désigné un lieu parisien qui rappelle son histoire ou son œuvre. Ce serait cohérent, même si c’est le parking pour autocars de tourisme qui occupe l’ancien emplacement de l’immeuble du boulevard Pershing. Richard Martin, à Marseille, est parvenu à faire appeler Léo Ferré le passage qui mène au théâtre Axel-Toursky. Dans les programmes du théâtre, cependant, le passage est devenu « Promenade », ce qui rend peut-être mieux, mais ne manquera pas de faire rire ceux qui ont connu le passage en question autrefois.
Puisqu’on parle ici de lieux publics portant le nom de l’artiste, voici une liste rapide et certainement non exhaustive des établissements scolaires : les collèges du 16, rue Paul-Pourhiet à Scaër, de l’avenue du Languedoc à Saint-Lys et de la route de Oisseau à Ambrières-les-Vallées, ainsi que la cité scolaire (lycée et collège) de Gourdon-en-Quercy et la résidence universitaire d’Orly.
Des salles d’édifices publics également. Par exemple, l’espace Léo Ferré à la bibliothèque municipale de Quétigny, à Bagneux, à Annemasse, à Aubenas, à Bédarieux, la salle Léo Ferré au théâtre du Chêne-Noir d’Avignon, à la MJC-théâtre du Vieux-Lyon, à la médiathèque de Montigny-le-Bretonneux, à Douvres-la-Délivrande, à Francheville, à l’espace Aragon d’Ollainville, à l’espace Jean-Jaurès de Tomblaine, à Chevilly-Larue, à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Malakoff, à Berre-l’Étang, à Brest, le Forum Léo Ferré à Ivry, la salle des fêtes Léo Ferré à Longwy...
00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (4)
mardi, 19 février 2008
Les visiteuses
Marseille, janvier 1974. L’un des trois jeunes gens que nous avons souvent croisés ici, travaille dans une librairie sise 21, rue Paradis. Quelquefois, sa compagne vient l’attendre à la sortie du magasin, le soir, à dix-neuf heures. Elle se tient devant la devanture peinte d’un rouge sombre. « Librairie Fueri-Lamy », dit l’enseigne.
Ce soir-là, il trouve, qui l’espère, la jeune fille manifestement émue. Il s’en inquiète, demande ce qui se passe, et elle : « J’ai passé l’après-midi avec Léo Ferré ». Comme on l’imagine, le jeune homme n’y croit pas un instant. Il s’abstient pourtant de répondre : « Et moi avec Napoléon », ce n’est pas son genre, mais enfin, son visage ne dissimule aucunement son incrédulité. Toujours aussi émue, la jeune fille brune dit : « Regarde, ça, ce sont les morsures de son chien Tristan », et elle montre sa main. De fait, il y a quelques marques légères sur la peau. Elle aime beaucoup les animaux, elle a dû jouer avec un chien qui l’a gentiment mordillée. « Morsures », c’est beaucoup dire. Mais encore ?
Elle raconte. Avec une amie à elle, complice de longue date, elle est allée à l’hôtel La Résidence du Vieux-Port où descendent tous les artistes qui doivent se produire au théâtre Axel-Toursky (il est annoncé là, du mardi 22 au samedi 26 janvier). À la réception, les deux ingénues ont purement et simplement demandé à voir Léo Ferré. On a appelé l’intéressé dans sa chambre, il a accepté de les recevoir, elles sont montées.
Il y a des choses qui ne se passent décidément qu’à Marseille. Tout de même, c’est un peu gros et le garçon est plutôt du genre sceptique. Alors tombent les arguments définitifs : « Il m’a fait écouter la cassette de son prochain disque, qui n’est pas encore sorti. Il y a une chanson, magnifique, où il parle de Manuel de Falla, avec une chanteuse à la fin, je ne sais pas qui c’est. Il y a aussi Les Amants tristes, mais avec l’orchestre et quand il dit : Crie, crie, crie, il y a le cri de la chanteuse, quelle voix ! Et puis La Damnation, et Les Oiseaux du malheur, et Les Étrangers avec un solo de violon. Il y a d’autres choses aussi ».
Bref, il n’y a plus guère de doute, ce doit être vrai puisqu’elle lui décrit par le menu un disque qui n’existe pas encore et qu’elle n’a pu par conséquent découvrir qu’auprès de l’auteur lui-même (il l’a effectivement enregistré quelques jours plus tôt, les lundi 7 et mardi 8 janvier). Les titres qu’elle cite, on les connaît depuis le disque Seul en scène et même, on les avait entendus avant sur la scène du Toursky, justement, mais les détails de l’orchestration, ça ne s’invente pas. Et ce texte inconnu, avec la présence de Manuel de Falla, de quoi s’agit-il ?
Pour dire quelque chose, il demande si la chanteuse est Danièle Licari, celle qui chante dans le film L’Albatros et dans le 30-cm Il n’y a plus rien. Elle répond que non, qu’elle ne croit pas, mais que cette chanteuse-là a une voix formidable. On ne connaît pas encore Janine de Waleyne.
Et notre jeune couple de s’en aller vers l’arrêt d’autobus, emprunter la ligne 4 ; lui, ébahi par le culot de sa compagne, se dit que, décidément, il n’a pas fini d’en voir avec elle. Ils iront au Toursky, découvriront que Léo Ferré n’est plus accompagné par Paul Castanier, ce qu’ils ignoraient encore. En février, ils achèteront le nouveau 33-tours intitulé L’Espoir et découvriront Mathieu Ferré sur la pochette.
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (0)
mercredi, 13 février 2008
Lucienne Ferré, épouse Bergeron
Le mardi 29 octobre 1940, Lucienne Ferré (1913-1997), dentiste, épouse Joseph Bergeron, pharmacien. L’abbé Trouguet les marie à 11 h, puis une messe est dite par le révérend-père Laurens. Ils vont s’installer à Varennes-sur-Allier. Léo Ferré compose pour le mariage un Ave Maria pour orgue et violoncelle, joué à l’église Saint-Charles de Monaco, chanté par Mme Orsoni. Le couple aura un fils, Michel.
Lucienne Bergeron s’est toujours montrée d’une discrétion exemplaire pour ce qui touche à son célèbre petit frère. Les quelques photographies, prises à différents âges de leur vie, où ils figurent ensemble, ont été publiées, pour la plupart, de façon posthume. Encore ne s’agit-il que de photos de famille. Le frère et la sœur s’entendaient je crois fort bien. Elle n’a jamais évoqué publiquement leur enfance, par exemple, ce qui eût constitué un témoignage de première importance, contrebalançant la narration, légèrement romancée, de Benoît Misère. On eût aimé, également, connaître son sentiment sur leurs parents, notamment sur leur père, Joseph Ferré, qu’on ne connaît que par ce que son fils en a dit, et par une lettre de 1957 reproduite par lui. Car si l’on sait que Léo Ferré regretta toujours de n’avoir pas été compris par son père, qui le rêvait grand avocat, on peut se dire aussi que M. Ferré père n’était pas seulement le personnage de Pierre Misère et qu’il est utile de se poser la question dans un autre sens : était-il facile d’être le père de Léo Ferré ?
On peut supposer que, dans l’entourage de Mme Bergeron, on savait qu’elle était la sœur de cet énergumène qui tutoyait Villon et interpellait publiquement le pape, le général de Gaulle ou Franco. Certains artistes ont vu naître une importante littérature à leur sujet, émanant de membres de leur famille ou de personnes plus ou moins proches. Ce n’est pas le cas de Léo Ferré. Pour l’historiographe, c’est dommageable. Doit-on cependant regretter, chez sa sœur, une discrétion de bon aloi ?
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (3)
jeudi, 07 février 2008
Léo Ferré et les surréalistes, encore une découverte
« Les hommes qui pensent en rond ont les idées courbes. Les sociétés littéraires, c’est encore la société. La pensée mise en commun est une pensée commune ». On connaît ces extraits de la préface de Poète… vos papiers ! et la façon qu’avait Léo Ferré de les donner en rafale, quand il interprétait ce texte en scène.
Or, Martine vient de me faire remarquer une chose qui m’avait toujours échappé. Peut-être ces trois aphorismes assénés avec force par leur auteur sont-ils autre chose que des formules-choc. L’un d’entre eux, au moins.
C’est dans le André Breton, quelques aspects de l’écrivain, de Julien Gracq (Corti, 1948) qu’on peut lire, p. 37 : « Plus que tout autre, le groupe surréaliste, irradié par Breton du début à la fin, encore qu’avec humilité celui-ci lui demande de s’effacer « devant les médiums qui, bien que sans doute en très petit nombre, existent » – tient à porter à son actif d’avoir « fait surgir une curieuse possibilité de la pensée, qui serait celle de sa mise en commun » ».
Gracq donne comme référence le Second manifeste du surréalisme.
Alors ? Il est de plus en plus évident que Breton, lisant le texte de Ferré, ait pu crier à la trahison. Sa mise en cause est immédiate, concrète. Qui plus est, la série d’aphorismes, prise dans sa continuité, tend à faire du surréalisme une simple « société littéraire », c’est-à-dire très exactement le contraire de ce qu’il est.
Que doit-on interpréter ? Il est peu probable, à mon avis, que Ferré ait voulu égratigner Breton, aussi directement. Même compte tenu du dépit qu’il éprouva en n’obtenant pas la préface demandée, je n’y crois guère. Léo Ferré n’a rien d’un exégète, il fonctionne au sentiment, au coup de cœur. Je ne serais pas étonné – je n’affirme rien, bien sûr – que cette « mise en commun » soit restée inscrite dans sa mémoire lors de sa lecture du Second manifeste et qu’elle soit ressortie inconsciemment au moment de l’écriture du texte polémique, comme une tournure qui l’aurait frappé.
J’avoue sans nulle honte que, jusqu’à ce jour, je n’avais nullement fait le lien entre le texte de Breton et cette « pique » particulière. Quelqu’un s’en était-il aperçu ? Si oui, si je découvrais brusquement l’eau chaude, j’en demande excuse par avance.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)
samedi, 02 février 2008
Joseph Ferré
Samedi 10 décembre 1887, a lieu la naissance de Joseph, Bénézel, Marius Ferré, à Nice. Il est le fils de Charles, Joseph, Évasus Ferré, lui-même né dans le Piémont, à Casale-Monferrato, cocher de fiacre et maréchal-ferrant à Nice, marié à Irma, Apollonie Poucel, vendéenne arrivée un jour en Provence. Il perd son père à l’âge de douze ans, en 1899.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler ici les principales étapes de sa vie et le déroulement de sa carrière.
Le vendredi 1er mai 1908, Joseph Ferré entre au casino de Monte-Carlo. Il commence comme conducteur des travaux au service de l'architecture, à raison de cent soixante-quinze francs par mois. C'est un homme très pieux, qui préside la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul. En janvier 1912, il est détaché au secrétariat général des services extérieurs, puis secrétaire au même endroit. Le samedi 8 juin, il épouse Marie, Charlotte Scotto, née le jeudi 24 octobre 1889 à Monaco, fille de Mathieu Scotto. Charlotte Ferré est couturière. Elle fabrique des robes à partir de patrons que lui donne une amie, première main chez Patou. Le jeudi 1er mai 1913, Joseph Ferré est augmenté : deux cents francs par mois. En décembre, leur fille, Lucienne Ferré, naît. Le vendredi 1er mai 1914, Joseph Ferré est augmenté : deux cent cinquante francs par mois. En 1916, Mme Ferré attendant un second enfant, la famille déménage villa Les Œillets, 9, avenue Saint-Michel, à Monaco, où elle s’installe au troisième étage. Jeudi 24 août 1916, à 16 h, naissance de Léo, Albert, Charles, Antoine Ferré. Le jeudi 15 mai 1919, Joseph Ferré reçoit une nouvelle augmentation : trois cents francs par mois. Le mercredi 1er octobre, il est admis à l'école de roulette. Le dimanche 16 mai 1920, quatre cent soixante quinze francs par mois. Le mardi 16 novembre, il est attaché au secrétariat général. Le samedi 1er janvier 1921, cinq cents francs par mois. Le jeudi 1er février 1923, six cents francs par mois. Samedi 5 juillet 1924, il est nommé secrétaire principal au service du personnel. Dimanche 16 novembre, sept cents francs par mois. Mardi 28 avril 1925, il est nommé sous-chef de la première section du personnel et augmenté : sept cent cinquante francs par mois. Lundi 16 novembre, huit cents francs par mois. Le vendredi 1er octobre 1926, mille cinq cent soixante quinze francs par mois. Samedi 2, il est réintégré au service des jeux. Mardi 16 novembre, mille six cents francs par mois. Le lundi 1er avril 1929, mille six cent soixante quinze francs par mois. Samedi 4 juillet 1936, il est détaché au service du personnel et nommé adjoint au directeur du personnel. Samedi 1er août, mille huit cent vingt-cinq francs par mois. Jeudi 1er avril 1937, deux mille trois cent francs par mois. Mercredi 1er septembre, deux mille trois cent cinquante francs par mois. Mercredi 1er décembre, deux mille six cents francs par mois. Mercredi 29 décembre, à cinquante ans, il est nommé directeur du personnel. Au fil des années, il est devenu sourd. Au cours de l’année 1938, ses augmentations sont les suivantes : deux mille six cent cinquante, deux mille six cent soixante-dix, puis deux mille huit cents francs par mois. Le dimanche 1er avril 1945, il est nommé directeur du personnel.
Joseph Ferré meurt le vendredi 6 avril 1973. Son épouse s’installe alors dans une résidence pour personnes âgées, non loin de Monaco : elle n’a pas voulu venir vivre chez son fils, comme il le lui avait proposé. Elle est décédée le lundi 20 février 1978. Mercredi 14 juillet 1993, à 10 h, décès de Léo Ferré à Castellina-in-Chianti (Italie), un peu avant ses soixante dix-sept ans. Sa sœur Lucienne a disparu en janvier 1997.
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (1)
vendredi, 25 janvier 2008
Une opinion de Gracq sur Breton
L’histoire de Léo Ferré et des surréalistes a été reconstituée dans son déroulement factuel. J’ai fait mon possible pour en mieux cerner la chronologie complète. À ce jour, en croisant et refondant mon récit des Chemins de Léo Ferré, les deux notes complémentaires parues sur ce blog il y a quelque temps et la Lettre à l’ami d’occasion, il est possible de relire cette histoire et de mieux apprécier les raisons de Breton qui, lorsqu’on dépasse l’« interdiction » de publication qu’il formula à l’encontre de son ami, paraissent maintenant bien plus claires et compréhensibles. On n’y reviendra pas ici.
La succession des faits mise à part, il reste, pour moi, un point obscur. Breton n’aime pas Poète… vos papiers ! qu’il vient de lire sur manuscrit. On ne sait d’ailleurs pas si l’état du texte correspondait exactement à ce qui fut publié peu après par La Table Ronde. Vraisemblablement, oui. Quoi qu’il en soit, cela ne change rien au fond.
Mais voilà : Breton, homme d’une très grande culture et d’une forte lucidité, ne nous a pas habitués à se tromper sur les œuvres de tel ou tel auteur. Ce qui me frappe, c’est qu’il n’ait pas su voir, lire dans ce manuscrit confié un soir par Ferré, les évidentes promesses qu’il contenait. Car si l’on n’aime pas Poète… vos papiers !, ce qui est parfaitement admissible, évidemment, il reste que ce recueil est attachant et contient en germe bien des choses. Il me paraît incroyable qu’un homme comme Breton n’ait pas su (voulu ?) voir cela, lui qui discernait en tous lieux la petite flamme de la beauté.
C’est en lisant cette phrase de Julien Gracq sur le jugement de Breton, qu’il a connu et admiré – et l’on sait que Gracq n’admirait pas facilement – que je me suis fait les réflexions qui précèdent. Voici cet extrait de Gracq (En lisant, en écrivant, Corti, 1980) : « Ce qu’il y avait de vibrant – pour reprendre son vocabulaire – dans les refus de Breton, venait, j’en ai eu souvent le sentiment, de ce qu’ils étaient conquis plus d’une fois sur une secrète complaisance, non tout à fait abolie, à ce qu’il refusait, ou plutôt se refusait. Plus que son opposé Valéry, si dédaigneusement étranger à ce qu’il rejette, il était riche, comme presque tous les bons gouvernements de combat, de quelques utiles et secrètes intelligences avec l’ennemi ».
Breton s’est-il refusé toute secrète complaisance envers son ami Léo Ferré ? A-t-il conquis sur elle son propre refus ? Ce n’est pas impossible. Cette comparaison que fait Gracq avec l’attitude de Valéry me rappelle que, jeune homme, Ferré lui avait envoyé un poème et n’avait jamais obtenu de réponse. Ce qui se comprend facilement : Valéry devait certainement recevoir chaque jour un très grand nombre de textes d’apprentis écrivains et ne pas s’en soucier outre-mesure. Mais Breton ? Cette opinion de Gracq serait-elle une clef permettant de comprendre pourquoi Breton n’a rien vu de prometteur dans le recueil incriminé ?
Peut-être suis-je en train de faire fausse route, mais ce lieu est aussi un chantier de réflexion.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (10)
lundi, 21 janvier 2008
Trois jeunes timides
Marseille, février 1971. Les trois amis déjà évoqués ici se dirigent vers le théâtre Axel-Toursky où Léo Ferré va chanter pour la première fois. C’est l’après-midi, ils vont, au hasard, voir s’il se passe quelque chose.
Le Toursky est alors une école désaffectée. Richard Martin a récupéré les anciens fauteuils, réformés, de l’Opéra de Marseille : des sièges de bois. Il a vingt-huit ans, les cheveux aux épaules et de l’enthousiasme. Il a commencé l’année précédente à faire vivre ce nouveau lieu de spectacle. C’est Ferré qui, cinq soirs de suite (dont quatre sans cachet), va lancer véritablement la salle et faire découvrir aux Marseillais le chemin du 22, rue Édouard-Vaillant (téléphone 50 75 91), où s’ouvre un passage qui sera, longtemps plus tard, baptisé Passage Léo Ferré. Pour le moment, des cartons d’œufs tapissent les murs et servent à l’insonorisation. Dans sa loge, la gardienne vend les billets. Un jour, l’éclairagiste, Michel Tzicuris, voulant réparer ou régler un projecteur, tombera du haut des cintres sur les fauteuils et se tuera. Longtemps, son portrait demeurera dans la salle.
Sur la droite, les issues dites de secours sont des portes donnant directement dans le passage en question, sans le moindre couloir. Elles sont ouvertes. L’un des trois, timidement, entrouvre le battant et passe le bout du nez dans la salle : « Il est là ».
Ils se concertent, hésitent, sont littéralement mangés par la timidité mais ils décident d’entrer et se tiennent debout, près de la porte, tentant de se confondre avec le mur. Oui, « il » est là et la candeur des dix-neuf ans (même pas, dix-huit et des poussières) des trois camarades n’en revient pas. Un type à moustaches, cheveux longs, portant beau, règle les lumières : « Envoie-moi un peu de rouge », « Tu m’envoies du bleu, par là ». C’est Frot. Puis Léo Ferré, sans lâcher sa cigarette allumée, vient, les bras croisés, faire « la balance ». Il chante uniquement quelques vers des Poètes, puis, à quelqu’un de la régie : « Ça va, comme ça ? »
Ils s’enhardissent encore, nos trois gamins. Ils vont s’asseoir dans une rangée de fauteuils, au milieu, bien dans l’axe de la scène. Oh, du bout des fesses, et encore. Ferré reçoit un journaliste à qui il déclare, lors de la conversation : « J’ai de jeunes amis dans la salle. Il est quatre heures de l’après-midi, ils sont venus me voir… » Tiens, ils ne sont donc pas passés inaperçus, les trois qui se pensaient discrets.
Quelqu’un, ensuite, arrive du fond de la salle : « Léo, téléphone ! » Soit. L’artiste, docile, descend de scène et se dirige vers le récepteur. Il passe dans la rangée située juste derrière les trois jeunes qui, spontanément, se lèvent. L’artiste, très gentiment : « Ne vous dérangez pas ». Ils n’avaient pas à se lever puisqu’il passait derrière eux, mais ce fut instinctif.
Dans l’entrée – un minuscule bout de couloir où, avant le spectacle, le public s’entasse – une affiche est dédicacée : « À Richard Martin, le Dullin de la Belle-de-Mai. Fraternellement, Léo Ferré ».
Un souvenir encore émerge de ce moment. Sur la scène, Ferré est debout devant le piano. Il joue quelques mesures puis, définitif : « Il est faux ». Il est encore tôt et l’accordeur, sans doute, était-il en chemin.
Très impressionnés par cette après-midi, les trois garçons remettront ça l’année suivante, quand Ferré sera annoncé les 9 et 10 mars 1972 au Palais des Congrès, mais cela a déjà fait l’objet de la note Trois amis et les pops.
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (14)
samedi, 12 janvier 2008
Gilbert Sigaux
 Dans les années 60, j’étais adhérent d’un club de livres, les éditions Rencontre à Lausanne. Plus exactement, ma mère m’avait abonné. Un club de livres intelligent : j’ai découvert, dans ses collections, Baudelaire, Stendhal, Poe, Hemingway, Lamartine, Swift, excusez du peu. Et aussi Dumas et Daninos. Ces deux derniers étaient préfacés par Gilbert Sigaux. C’est ainsi que j’ai connu ce nom. Sigaux avait aussi été l’éditeur, au sens anglo-saxon du terme, de Simenon, entre autres. Et, pour le Cercle du Bibliophile, de Mac Orlan. J’en passe. La seule consultation de Google fait ressortir la très grande quantité d’éditions et de commentaires qui lui sont dus.
Dans les années 60, j’étais adhérent d’un club de livres, les éditions Rencontre à Lausanne. Plus exactement, ma mère m’avait abonné. Un club de livres intelligent : j’ai découvert, dans ses collections, Baudelaire, Stendhal, Poe, Hemingway, Lamartine, Swift, excusez du peu. Et aussi Dumas et Daninos. Ces deux derniers étaient préfacés par Gilbert Sigaux. C’est ainsi que j’ai connu ce nom. Sigaux avait aussi été l’éditeur, au sens anglo-saxon du terme, de Simenon, entre autres. Et, pour le Cercle du Bibliophile, de Mac Orlan. J’en passe. La seule consultation de Google fait ressortir la très grande quantité d’éditions et de commentaires qui lui sont dus.
 Noël 1970. Je passe, avec deux camarades, une semaine à Paris. Nous logeons à trois dans une chambre pour un, louée quinze francs la nuit dans un hôtel minable de la montagne Sainte-Geneviève, face à ce qui était alors Polytechnique et qui est devenu une des implantations du ministère de l’Éducation nationale. Il neige. Incorrigible méridional, je n’ai rien prévu, je suis vêtu d’un petit blouson de skaï, d’une écharpe synthétique et chaussé de mocassins. Mais j’ai dix-huit ans et je n’ai pas froid. Le train du retour sera bloqué par la neige, dans la nuit, à hauteur de Montélimar. Nous n’avons plus un sou, rien à manger, plus de cigarettes – juste un paquet d’un immonde scaferlati que nous brûlons dans nos pipes (j’en ai acheté une quelques jours auparavant à un éventaire, boulevard Saint-Michel). Mon royaume pour une gauloise. Il n’y a ni lumière ni chauffage dans le compartiment. Dormir, que faire d’autre ? Le train arrivera à Marseille à quatre heures du matin, au lieu de minuit, soit onze heures de voyage au lieu de sept. En attendant, nous sommes à Paris.
Noël 1970. Je passe, avec deux camarades, une semaine à Paris. Nous logeons à trois dans une chambre pour un, louée quinze francs la nuit dans un hôtel minable de la montagne Sainte-Geneviève, face à ce qui était alors Polytechnique et qui est devenu une des implantations du ministère de l’Éducation nationale. Il neige. Incorrigible méridional, je n’ai rien prévu, je suis vêtu d’un petit blouson de skaï, d’une écharpe synthétique et chaussé de mocassins. Mais j’ai dix-huit ans et je n’ai pas froid. Le train du retour sera bloqué par la neige, dans la nuit, à hauteur de Montélimar. Nous n’avons plus un sou, rien à manger, plus de cigarettes – juste un paquet d’un immonde scaferlati que nous brûlons dans nos pipes (j’en ai acheté une quelques jours auparavant à un éventaire, boulevard Saint-Michel). Mon royaume pour une gauloise. Il n’y a ni lumière ni chauffage dans le compartiment. Dormir, que faire d’autre ? Le train arrivera à Marseille à quatre heures du matin, au lieu de minuit, soit onze heures de voyage au lieu de sept. En attendant, nous sommes à Paris.
Le 29 décembre, à la librairie du Monde libertaire, dite « Publico », alors sise rue Ternaux dans le onzième arrondissement, je découvre les premiers numéros de la revue La Rue, publiée par le groupe Louise-Michel de la Fédération anarchiste. Et, sur un rayon, je trouve un album de 1962, le Léo Ferré de Sigaux, publié à Monte-Carlo par les éditions de l’Heure, dans la collection « Les albums de la chanson » (n° 4), ouvrage qui devait être là depuis huit ans peut-être. C’est un peu comme si deux mondes s’étaient rejoints. Il coûtait initialement 6 NF 90 et je crois me souvenir qu’on me le vendit au même prix. De très nombreuses années plus tard, je découvrirai qu’il existe aussi une édition cartonnée. À la lecture du livre – énormément illustré pour l’époque et d’une qualité technique alors peu courante dans la reproduction des photographies – je m’aperçois que, selon toute vraisemblance, Sigaux a connu Ferré et les siens. Ce n’est pas un travail « extérieur ». Il dit même avoir entendu l’artiste chanter le poème Madeleine (Rappelle-toi), qui n’a jamais été enregistré ni, je crois, chanté en scène. Il ne peut donc s’agir que d’une audition privée. Or, et c’est curieux, le nom de Sigaux n’apparaît plus jamais dans l’histoire de Léo Ferré, à l’exception d’une mention dans Les Mémoires d’un magnétophone, où il est question d’un roman de lui, intitulé Fin, qui fut publié en 1951. J’ai lu un jour ce livre, qui ne m’a pas passionné. Autrement, plus rien.
 Sigaux est mort en 1982 et sa bibliothèque a été acquise. Je n’ai jamais su dans quelles circonstances il avait approché Léo Ferré, ni ce qui avait décidé de la rédaction de son livre. Une idée de sa part ? Une commande de l’éditeur ? Je n’ai aucune lumière sur la question et c’est pourtant le genre de chose que j’aime bien comprendre.
Sigaux est mort en 1982 et sa bibliothèque a été acquise. Je n’ai jamais su dans quelles circonstances il avait approché Léo Ferré, ni ce qui avait décidé de la rédaction de son livre. Une idée de sa part ? Une commande de l’éditeur ? Je n’ai aucune lumière sur la question et c’est pourtant le genre de chose que j’aime bien comprendre.
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (20)
vendredi, 04 janvier 2008
Dĕkuji ti, Ferré ! (ou Ferré traduit en tchèque), par Daniel Dalla Guarda
J’accueille aujourd’hui un nouvel « invité du taulier », Daniel Dalla Guarda, qui nous propose un ample travail consacré aux versions tchèques des chansons de Léo Ferré. Je le remercie de s’en être chargé.
Dès 1961-1962, Daniel Dalla Guarda fait montre d’un esprit rebelle : lecteur assidu de Hara-Kiri (mensuel), (télé)spectateur des Raisins verts d’Averty, il se complaît à écouter une musique de voyous, le rock ‘n’ roll, et surtout Vince Taylor. Cela aurait pu durer longtemps, mais 1968 est arrivé, qui lui a grand ouvert les yeux. Avoir eu dix-huit ans dans ces années a été jubilatoire : outre Hara-Kiri hebdo (le vrai), il redécouvre la chanson française et… Léo Ferré : c’est un énorme choc, au Théâtre Montansier de Versailles. Avec un doute : était-ce avant ou après le spectacle de Bobino 1969 ? Presque sexagénaire, informaticien de profession, l’humour et la poésie lui permettent de belles échappées. Ses rencontres avec Léo Ferré ont bouleversé sa vie. Collaborateur du site Thank You Ferré (leo.ferre.org), hélas disparu avec Julien, puis des Cahiers d’Études Léo Ferré, il souhaite partager cette passion.
C’est à la suite de son article « De par le monde », paru dans les Cahiers d’études Léo Ferré n° 4 (Écoute-moi) que j’ai pris contact avec Jacques Layani pour la première fois. À l’époque, je désirais apporter quelques petites précisions à cet article. Depuis, de nombreuses traductions ont été publiées (ou simplement retrouvées). C’est le propos de ces notices que je proposerai sur ce site.
Chaque notice traitera d’un pays, plus précisément d’une langue, et citera l’article de Jacques pour le compléter. J’apporterai également les éléments discographiques dont je pourrai disposer.
Remarques générales : j’emploierai le terme de « traduction » pour les simples traductions (plus ou moins littérales) et le terme « adaptation » quand il s’agit de traductions destinées à être chantées. Ces adaptations pouvant être de simples modifications de contexte (cf. les traductions d’Enrico Médail en italien), mais pouvant être de véritables transpositions comme Die dame, adaptation en hollandais de L’Homme.
Seront également citées comme traductions de chansons de Ferré, les poèmes qu’il a mis en musique (bien sûr, uniquement quand elles ont un lien direct avec Ferré).
Les traductions en langue tchèque
Pour cette première note, je traiterai des traductions en langue tchèque. Pourquoi ? Pour la simple raison que cette langue n’apparaissait que partiellement dans l’article de Jacques. Il y citait un livret qu’il avait feuilleté et qu’il pensait être polonais. Il s’agissait en fait d’un encart publié avec le disque 33-tours de Léo Ferré édité par Supraphon, la maison de disques tchécoslovaque, laquelle avait des liens étroits avec la société Barclay (c’en était une filiale selon Éric Lipmann, ancien directeur financier de Barclay).
Les disques tchèques de Léo Ferré
Une remarque qui concerne tous les disques tchèques présentés dans cette notice : ils ne sont accompagnés d’un livret que s’ils sont co-édités par Supraphon et un club d’auditeurs, à l’image de clubs de lecteurs en France. C’est le cas du seul disque entièrement consacré à Léo Ferré et publié en Tchécoslovaquie et dans les pays dits de l’Est.
Le 33-tours « Léo Ferré »
Ce disque est accompagné d’un livret de vingt-quatre pages contenant les textes français et les traductions en tchèque de toutes les chansons du disque. Il est richement orné de photographies, dont trois en couleurs, représentant Léo Ferré, bien sûr, mais aussi Madeleine, leur fille Annie, Léo et Pépée...
Titre du disque : Léo Ferré.
Coédité par Supraphon et Hudby Gramofonového.
Référence : 0 13 0908 (version mono) ou 1 13 0908 (version stéréo).
Date de la première publication : 1971.
Le livret donne le nom du traducteur en couverture : Jaroslav Mysliveček, qui détient les droits sur tout le livret.
Chansons :
Cannes-la-Braguette : Cannes-la-Braguette.
Nous deux : My dva.
À Saint-Germain-des-Prés : Saint-Germain-des-Prés.
Rotterdam : Rotterdam.
Les Poètes : Básníci.
Les Assis : Sedici.
Si tu t’en vas. Až odejdeš.
Paname : Paname.
Jolie môme : Holka milá.
Tu sors souvent [la mer] : Často vycháziš.
Les Tziganes : Cikáni.
La Marseillaise : Marseillanka.
Les traductions semblent littérales, elles sont bien évidemment destinées à expliquer la chanson au public tchèque, sans visée poétique apparente. Elles sont présentées en vis-à-vis du texte français. Pour Cannes-la-Braguette, le jeu de mot n’est pas indiqué, la traduction donnant tout simplement Cannes-la-Braguette.
Les textes des Assis et Nous deux sont bien attribués à leurs auteurs respectifs.
Les 33-tours collectifs tchèques
Deux autres disques, collectifs, avaient précédé le Léo Ferré cité plus haut. Le public tchèque avait pu découvrir Léo Ferré dès 1962, toujours grâce à Supraphon.
Le 33 tours Sous les toits de Paris.
En 1962 donc, Supraphon-Artia publiaient un disque collectif intitulé Sous les toits de Paris (référence SUA 14 472). Quatre artistes Barclay y sont présentés, Ferré étant le premier par ordre d’apparition :
Léo Ferré : Blues, Elsa, Je chante pour passer le temps, Je t’aime tant.
Charles Aznavour : Plus heureux que moi, L’amour et la guerre, Fraternité.
Lucienne Delyle : Bistrot, Les Bleuets d’azur.
Jacques Brel : Les Biches, Zangra, Une île, Madeleine.
Mais les textes y étant donnés uniquement en français, je n’en parlerai pas plus, sauf à remarquer que pour le premier disque de Ferré édité dans un pays « du bloc soviétique » ou « du bloc de l’Est » comme on les désignait à l’époque, il s’agit de quatre chansons dont le texte est de Louis Aragon.
Les 33 tours Paris, Paris et Pařĭźskŷ šanson.
Le deuxième disque collectif, paru en 1966, est intitulé selon les éditions Paris, Paris ou Pařĭźskŷ šanson. Trois chanteurs (Barclay) y sont présentés : Aznavour et Brel se partagent la première face, Léo Ferré occupe à lui seul toute la deuxième face :
Charles Aznavour : Donne tes seize ans, Au clair de mon âme, Jolies mômes de mon quartier, Trop tard.
Jacques Brel : Les Bourgeois, Jeff, Les Bonbons, Mathilde.
Léo Ferré : T’es chouette, Thank you Satan, Paname, Merde à Vauban, Les poètes, Franco la Muerte.
Ces deux disques ont des pochettes et des labels différents.
L’édition Paris, Paris est publiée par Supraphon-Artia (référence SUA 14 716). Elle était probablement destinée au marché étranger (notamment à l’Allemagne). Les textes des chansons sont donnés en français sans traduction.
Plus intéressante à mes yeux, l’édition Pařĭźskŷ šanson publiée par Supraphon-Gramophonovŷ Klub (référence DVD 10197) est destinée au public tchèque et contient les traductions de toutes les chansons (sans les textes français !). Certaines traductions de chansons de Ferré sont accompagnées de courts commentaires explicatifs. Les traductions sont d’Alena Čapková. Elles semblent plus littéraires que celles de Jaroslav Mysliveček, publiées avec le disque Léo Ferré. Cela apparaît sur les deux chansons communes à ces deux disques (Paname et Les Poètes). De plus, les commentaires sur Vauban, sur le mot « Paname », sur la chanson Les Poètes, montrent un réel souci d’explication. En voici la liste :
T’es chouette : Jsi půvabná.
Thank you Satan : Dĕkuji ti, Satane.
Paname : Paříž.
Les Poètes : Básníci.
Franco la Muerte : Smrt Francovi.
Hana Hegerova et « Maestro tango »
Hana Hegerová est une artiste tchèque (d’origine slovaque, comme il convient de le préciser depuis la partition de la Tchécoslovaquie en 1993) qui jouit d’une réelle ferveur du public tchèque. J’ai pu le constater à Prague où les disquaires la connaissent très bien et parlent d’elle comme d’une Piaf tchèque (personnellement, je la rapprocherais plutôt de Juliette Gréco, pour la qualité de ses textes).
Commentaires de Radio Praha : En octobre 2001, Hana Hegerova fête ses 70 ans devant la salle archi-pleine du Théâtre na Vinohradech. Deux ans après, elle récidive avec un concert tenu, cette fois-ci, dans un espace on ne peut plus prestigieux de Prague, au Théâtre national. Pendant deux heures, la salle vibre sous ses fameuses chansons, qui jalonnent une quarantaine d'années de sa trajectoire artistique. Certaines sont empruntées aux célèbres chansonniers français...
Cet été, était annoncé un concert au centre-ville de Prague.
Tous ses disques ont été réédités en CD, qui figurent dans les meilleures ventes. Enfin un DVD est paru récemment.
Le titre qui nous intéresse ici est Maestro tango, publié en 1973 sur l’album Récital 2 par Supraphon-CS Hifi-Klub (référence 1 13 1310 ZB). Il en existe une version, sans livret, éditée par la seule compagnie Supraphon.
Contrairement à ce que son titre pourrait laisser croire, il ne s’agit pas d’un enregistrement en public. Il contient des chansons originales et quelques adaptations du répertoire français. En voici le détail :
Face 1 : Penzión na pŕedmĕsti, Tak to na tom svĕtĕ chodi, Svatebni piseń, Maestro tango (Mister Giorgina), Rāmusy blues, Váňa.
Face 2 : Bože můj, já chci zpĕt (Ma jeunesse fout l’camp), Bud’to ty, anebo já (Giroflée girofla), Surabaya Johnny, Rýmováni o životĕ (It Hurts To Say Good Bye, en français : Comment te dire adieu), Rozvod.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à l’adaptation de Mister Giorgina qui devient Maestro Tango.
L’adaptation est de Pavel Kopta, qui restera son parolier privilégié pendant toute sa carrière.
Le texte en est publié dans le très beau livret qui accompagne le disque original (version CS Hifi-Club). On la trouve également sur Internet, c’est pour cela que je me permets de la citer in extenso :
Maestro tango
Byl jednou jeden kabaret,
vám býlo sotva dvacet let.
Pod rampou hnĕdý klavir stál
a vy jste na nĕj z hecu hrál
svý prvni tango.
Ten večer mĕ jste trochu vztek,
když jedna z mistnich baletek
vás libala
a řikala : Maestro Tango !
A když vás přešla prvni zlost,
tak byl jste každodenni host.
Sál celý na vĕdomi vzal,
Že jste si pseudonym dal :
Maestro Tango
Když uslyšel to direkto,
tak řek vám : To je dobrej fơr !
Dal na plakát :
Dnes bude hrát,
dnes bude hrát,
MAESTRO TANGO !
Nĕkdo se ptal :
Ale co dál ?
Co bude dál ?
To ptal se doma každý den
Pod vrstvou prachu Beethoven.
A Chopinovi šeptal Litz
že neni si tak zcela jist
tim, co je tango.
To nechápal by jaktĕživ,
Že za pár korun, za pár piv,
Jde nĕkdo hrát
a k tomu rád,
a k tomu rád, Maestro Tango !
Proč dennĕ čistit od rána
falešný zuby piána
Nač etudy, nač prstoklad ?
I bez nich dá se přece hrát
vášnivý tango
Ted’ zni to jako špatný žert,
že pomýšlel jste na koncert
a kde a jak
vzit černý frak,
ach, černý frak, Maestro Tango
Nĕkdo se ptal,
co bylo dál ?
co bylo dál...
Když přeletĕlo roků pár,
tak stal se z kabaretu bar.
To tam je hrani za pár piv,
jen zni tam stejnĕ jako dřiv
půlnočni tango.
A nikdo se vám nedivi,
že smutný jste a šedivý
Jak starý snih,
Jak vdovcův smich,
Jak vdovcův smich, Maestro Tango
Když s ūpornosti pijanů
se naklánite k piánu
a hledáte co odvál čas,
tak ozývá se zas a zas
pliživý tango.
Tam dole na dnĕ pamĕti,
v tom zasypaném podsvĕti
je hrstka not.
Ted’ přijde vhod,
ted’ přijde vhod, Maestro Tango !
Tam dole přece nĕco muselo zůstat...
Alespoň trochu hudby...
Byla tak krásná !
Vzpominejte !
Johann Sebastian Bach.
Poznáváte ?
L’interprétation qu’en fait Hana Hegerová est très vivante, et fidèle à celle de Léo Ferré, y compris le final musical, qu’elle laisse se prolonger.
« Muj dik, Hana !» (Merci beaucoup, Hana !)
Pour ceux que cet album intéresserait, il a été pressé en CD en 2006 (référence Supraphon SU 5722-2), avec un booklet réduit, sans le texte.
À défaut, le titre Maestro tango a été repris en CD sur deux compilations :
Všechno nejlepší, double CD Supraphon SU 5726-2 ;
Můj dík, CD Supraphon SU 5633-2 ;
et bien sûr sur l’intégrale Zlata kolekce, coffret de six CD B&M Music BM0047 (paru en 1996).

Adresse URL du site Internet d’Hana Hegerova : http://www.hanahegerova.cz/
Malheureusement, si ce site est riche d’illustrations, il est assez pauvre en informations.
Autres traductions en langue tchèque
Les institutions culturelles.
Le Lycée Français de Prague et Eva Kriz-Lifková.
Eva Kriz-Lifková enseigne la musique au Lycée Français de Prague.
Elle a également publié de nombreux CD dont un consacré à la chanson française :
Eva Kriz-Lifková : Sous les toits de Paris (Pod střechami Paříže). CD PRAG-DATA, 2001 (épuisé).
Eva Kriz-Lifková y interprète Paname (c’est aussi le titre tchèque) dans une adaptation très poétique de Stuka. Pour avoir conversé avec elle, elle pourrait très bien la chanter en français !

Adresse URL du site d’Eva Kriz-Lifková :
http://www.kriz-lifkova.cz/ (site bilingue français-tchèque)
Un grand merci aussi à Eva Kriz-Lifková pour son accueil sympathique !
L’Alliance Française à Prague.
L’Alliance Française organise des spectacles. On peut penser que des traductions figurent dans le programme de ces soirées, comme c’est souvent le cas (voir la notice Traductions en allemand, pour paraître). C’est peut-être le cas de la chanson Y a une étoile, qu’y a chantée Fabiola Toupin en mars 2006.
Les enseignants du Français en Tchécoslovaquie.
Ces enseignants organisent des soirées de chanson française. On y entend quelques chansons de Ferré dont Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, devenue Cožpak takhle lidé žijí dans le programme, apparemment consacré principalement à Édith Piaf (Program koncertu Pod krídly Edith Piaf).
Divers.
Uvod do poetiky.
Je rappellerai la traduction que Jacques Layani citait dans son article : Préface : Uvod do poetiky (traduction en tchèque) de Sergej Machonin publiée dans Litterarni noviny du 6 août 1993.
Sergej Machonin est une personnalité éminente de la vie culturelle tchèque : cinéaste, poète, traducteur et j’en oublie... Cela est significatif de l’importance que la revue accordait à Ferré.
Marta Balejová.
Dans son spectacle Édith & Frank, elle interprète Les Amants de Paris, titre qu’elle ne reprend pas sur son CD. Je n’en sais donc pas plus.
Paris-Canaille.
C’est une des chansons de Léo Ferré les plus reprises. En Tchéquie, elle est interprétée par Duo Canto, duo formé de Tomáš Krejèí et Zuzana Pálenská.
On peut aussi l’entendre par Yves Montand sur un disque 33-tours Supraphon (référence SUA 14846).
Mais sans traduction à ma connaissance.
Conclusion
Si l’on s’en tient aux seules traductions avérées, nous arrivons à un total de quinze titres traduits en tchèque dont deux dans des traductions différentes : deux pour Les Poètes et trois pour Paname.
Dix-huit traductions : c’est énorme pour ce pays finalement pas très grand, surtout si l’on compare avec le nombre très réduit de traductions dans l’ensemble des autres pays de l’Est. Il est vrai qu’il n’y a pas de disques de Ferré pressés dans ces pays à l’exception, donc, de la Tchécoslovaquie.
Il faut en remercier principalement Supraphon et les clubs coéditeurs qui accompagnaient leurs disques de livrets, démarche que l’on ne retrouvera qu’au Japon (ce sera l’objet d’une notice à venir).
Faut-il y voir un des nombreux exemples d’ouverture sur le monde qu’offrait alors la Tchécoslovaquie ? Je le pense.
Bien évidemment, cette notice ne prétend pas à l’exhaustivité : d’avance, un grand merci à ceux qui pourraient m’aider à la compléter.
Hodně štěstí a zdraví v novém (Bonne année et bonne santé).
Fiche synthétique :
| À Saint-Germain-des-Prés | Saint-Germain-des-Prés |
| Cannes-la-Braguette | Cannes-la-Braguette |
| Franco la Muerte | Smrt Francovi |
| Jolie môme | Holka milá |
| La Marseillaise | Marseillanka |
| Mister Giorgina | Maestro tango |
| Nous deux | My dva |
| Paname | Paname |
| Paname (texte différent) | |
| Paříž | |
| Les Poètes | Básníci |
| Básníci (texte différent) | |
| Rotterdam | Rotterdam |
| Si tu t’en vas | Až odejdeš |
| T’es chouette | Jsi půvabná |
| Thank you Satan | Dĕkuji ti, Satane |
| Tu sors souvent [la mer] | Často vycháziš |
| Les Tziganes | Cikáni |
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (1)
mardi, 01 janvier 2008
La forme épistolaire, l’adresse, l’apostrophe, la dédicace
On avait déjà évoqué la forme épistolaire à propos des Lettres non postées.
Léo Ferré va encore l’utiliser, cette fois en chanson, de Mon Général (« Je vous écris du paradis… ») ou Cloclo-la-Cloche (« Mais aujourd’hui je vous écris… ») à La Lettre et Lorsque tu me liras, qui sont de toute évidence deux lettres authentiques adressées à Marie.
Toutefois, il va aussi user d’une forme légèrement différente : l’adresse. Certains textes ne sont pas des lettres à proprement parler – pas dans leur forme – mais constituent des adresses à des personnes vivantes. Après tout, rien ne commandait qu’une chanson contre Franco ait l’allure d’interpellation directe qu’il lui a donnée (Franco-la-Muerte). Rien non plus n’indiquait qu’une chanson contre Pie XII ait la tournure qui est la sienne dans Monsieur Tout-Blanc. Il n’était pas obligatoire, sur le plan du style, qu’une chanson contre de Gaulle prenne la forme d’une adresse immédiate, comme dans Sans façons.
L’adresse est également utilisée dans Monsieur mon passé ou Madame la misère, envers qui l’auteur use de la forme impérative : « Laissez-moi passer », « Écoutez le silence ».
On remarque donc que, dans ces deux derniers cas, l’interpellation conduit à une mise en cause ou à un ordre. L’artiste prend les choses de haut, il a un compte à régler avec la misère comme avec le pape, avec Franco comme avec son temps jadis. Il ne s’agit pas de leur répondre mais bien de les prendre à parti. Peu lui importe la dimension sociale ou politique de ses « correspondants », l’auteur les interpelle et, d’égal à égal, leur dit leur fait. Cela tient du « Hep, vous là-bas » au ton comminatoire.
L’adresse est décidément partout : invocatoire (Cloches de Notre-Dame, Marseille), ironique (Martha la mule, Judas, La Poisse), agressive (Miss Guéguerre, T’es rock, Coco !), amicale (Mister Georgina, Salut Beatnick, Gaby, Tu chanteras, Michel), satirique et sociale (La Maffia, La Gueuse, T’as payé, Vous les filles, La Grève, Le Conditionnel de variétés, L’Oppression), mélancolique (Madame Angleterre, La Chanson triste, Paname, Le Vent, Tu sors souvent, Beau saxo, Pépée, Paris, je ne t’aime plus, Mister the Wind)…
L’adresse est plus distante dans Merci mon Dieu. Plus détournée. Si Ferré dresse en quelque sorte la liste de ce qu’il reproche à Dieu – ou plus simplement de ce qui l’étonne ou le bouleverse – ce n’est qu’au refrain que la mise en cause trouve sa place et encore, sous la forme d’une modeste (même si elle est ironique) résignation (« Nous te disons merci mon Dieu ») ou d’une interrogation finale : « Nous te disons pourquoi mon Dieu ». Elle est enfin complice dans Thank you Satan, qui constitue une « prière inversée » avant l’heure.
Il empruntera également aux poètes quelques adresses : Si tu ne mourus pas, Tu n’en reviendras pas, Âme, te souvient-il ? et beaucoup d’autres encore, comme La Chanson du scaphandrier ou Notre-Dame-de-la-Mouise. Il en trouvera un certain nombre chez Caussimon qui, on le voit ici, emploie souvent cette tournure : Monsieur William, À la Seine, Mon Sébasto, Mon camarade, Nous deux, Avant de te connaître…
Il faudrait par ailleurs considérer d’un œil particulier toute une série d’adresses très spécifiques, puisqu’elles sont constituées de chansons d’amour et là, la liste n’est certainement pas close (La Vie d’artiste, Ma vieille branche, Jolie môme, Si tu t’en vas, Chanson pour elle, T’es chouette, Ça t’va, Plus jamais, La Gauloise, Le Testament, À toi, L’Amour fou, Ton style, Tu ne dis jamais rien, La Fleur de l’âge, Je t’aimais bien, tu sais, La Damnation, Je te donne, Tu penses à quoi ?, À vendre, Ta source, Je t’aime, Les Ascenseurs camarades, En faisant l’amour, Tout ce que tu veux, Notre amour, La Femme adultère, Suzon…)
On peut enfin nuancer en fonction du contenu des chansons. De Franco-la-Muerte à À toi, le registre change. La première adresse est plus une apostrophe, la seconde davantage une dédicace, un envoi.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (27)
lundi, 24 décembre 2007
Contourner l’obstacle
Au collège des Frères des écoles chrétiennes, Léo Ferré découvre les poètes et les auteurs interdits en arrachant les pages de leurs ouvrages et en les cachant dans son livre de messe. Délicieux plaisir de la transgression mêlé à celui de la découverte et de l’enchantement de découvrir des textes et des univers qui le satisfont. Mais pas seulement. Car cette façon de faire – une forme de résistance instinctive qui s’organise d’elle-même et solitairement – va conditionner son esprit pour longtemps, en cette période de formation, puis d’apprentissage. Interdiction, désormais, égale moyen à trouver pour tourner l’interdit.
Certainement, les études de droit qu’il suivra, même de loin, même distraitement, même s’il passe plus de temps au Dupont-Latin qu’à la faculté, contribueront à ancrer en lui cette manière que je résume ici en trois mots : contourner l’obstacle.
Durant toute sa carrière, chaque fois qu’il sera en butte à un événement extérieur l’empêchant de s’exprimer ainsi qu’il l’entend, Ferré va contourner l’obstacle. C’est-à-dire ne jamais insister outre-mesure, ne pas persister dans la voie bloquée, ne pas avancer dans le brouillard, ne pas foncer obstinément la tête la première, mais, tout simplement, s’y prendre autrement. Comme font les avocats qui se servent du droit pour obtenir gain de cause, en cherchant la faille, interprétant, plaidant, avec les ressources de leur art – si c’en est un – ainsi que leurs études les ont formés avant qu’ils accèdent au barreau.
Une première manifestation de résistance organisée se situe en 1957, quand Ferré, qui ne parvient pas à faire jouer son oratorio lyrique depuis sa création à Monte-Carlo en 1954, cet oratorio qui a été refusé par la radio, a l’idée d’« échanger » des droits que lui doit la maison Odéon contre deux disques : La Chanson du mal-aimé et Les Fleurs du mal dont il sait pertinemment qu’il ne trouvera pas d’éditeur pour réaliser un disque entier – au moins pour le moment. Pour faire bonne mesure, il réclame et obtient l’orchestre de la Radiodiffusion française pour son œuvre consacrée à Apollinaire. À l’obstacle de l’édition et de l’exécution impossibles, il oppose un contournement : le renoncement à ses droits.
Lors de l’affaire d’À une chanteuse morte, face au refus de diffusion de la chanson enregistrée, il utilise son moyen d’action favori : l’interprétation publique. À Bobino, les spectateurs de 1967 découvrent la chanson et, toujours pour faire bon poids, se voient distribuer une copie de l’assignation faite à la Compagnie phonographique française. Ferré perdra son procès en janvier 1968, mais la question n’est pas là. Il y a eu de nouveau contournement d’un obstacle.
En 1969, quand il rencontre Brel et Brassens, la question est posée par Brel, quant à l’attitude à adopter si l’on se trouve face à un mur. Les réponses que chacun apporte sont très fidèles à leur tempérament respectif. Sans hésiter, Léo Ferré dit : « Moi, je le contourne ».
Lorsque, au moment de sa contestation par son jeune public, il finit par se rendre compte que les discussions d’après spectacle au cours desquelles il est sommé de se justifier en permanence, ne mènent à rien, le mécanisme se met en marche. Comment éviter ces demandes de comptes qui l’ennuient et ces explications qui ne solutionnent rien ? En contournant l’obstacle. Lorsqu’il entame sa dernière chanson, sa voiture est devant la porte, prête à partir. Au dernier mot de la dernière œuvre, il sort de scène et, tandis que s’élèvent les applaudissements, il est en coulisses où on lui tend son blouson ou son manteau, une cigarette déjà allumée, puis il s’engouffre dans l’auto. Lorsque les lumières se rallument dans la salle, il est parti depuis un moment déjà. Solution de fuite, certes, mais aussi contournement de l’impossible obstacle, contournement d’une situation refusée par lui. Cela, d’ailleurs, n’aura qu’un temps, et il recommencera ensuite à recevoir les spectateurs avec la gentillesse qu’on lui connaît.
En 1975, le disque Ferré muet dirige Ravel et Léo Ferré est le couronnement de la méthode en question. Il ne peut pas, par une clause de son contrat expiré, enregistrer ses chansons dans une autre maison, durant deux années. Soit. Il enregistre donc ailleurs… la musique. Et, chez ce même éditeur (CBS), un disque jumeau où, sur sa partition, Pia Colombo chante pour lui les chansons qui, autrement, auraient été retardées de deux ans. Toujours un coup de griffe supplémentaire : les deux pochettes, manifestement conçues dans le même esprit, proposent deux textes brefs qui informent le public de ce qui se passe. Juridiquement imparable, cette réaction de « survie » artistique se manifeste encore dans un cas d’expression entravée.
J’ai choisi ces quelques exemples mais, certainement, la liste n’est pas close. Ce qui est intéressant, c’est de remarquer que cette façon d’agir devient constitutive de l’artiste, qui ne renoncera jamais à sa libre expression. Elle entre en jeu chaque fois qu’il refuse une situation donnée, qu’il n’a pas choisie et dont il estime qu’elle l’enferme. Et dans Thank you Satan, en 1961, on entend bien, parmi la litanie des raisons que l’artiste donne à son remerciement, la formule explicite : « Le moyen de tourner la loi ».
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 18 décembre 2007
Léo Ferré lecteur de Sartre, par Francis Delval
Je remercie une fois encore Francis Delval pour cette nouvelle et riche contribution au fonctionnement de ce lieu.
Cette note se limitera à ce que le titre annonce. On ny trouvera pas de propos sur Saint-Germain-des-Prés ou la mode existentialiste, brocardée par quelques chansons de Ferré, comme Complainte pour Popaul que Belleret a bien expliquée, ou par Stéphane Golmann (Les Prés à Germain, La Petite existentialiste), ou les romans de Vian. De même, on laissera de côté les démêlés avec L’Idiot international, ainsi que la rencontre avec Sartre en 1973, au lancement de Libération. Tout ceci est bien connu, et a été souvent conté. Ce n’est pas davantage une note visant à développer la philosophie sartrienne, qui défie le résumé.
Je prendrai les lectures de Ferré dans l’ordre chronologique de la bibliographie sartrienne (du moins celles dont il a parlé). Puis je m’attarderai sur deux thèmes : la fameuse formule « L’enfer, c’est les autres », que Ferré cite et utilise souvent. Et le problème de l’engagement de l’artiste, de l’écrivain. Nous verrons que Ferré, malgré ses propos souvent critiques envers l’engagement est, au fond, d’accord avec Sartre sur l’essentiel.
Léo Ferré n’a guère d’atomes crochus avec les écrits des philosophes, en général. Il a certes lu Stirner et Bakounine. Il a lu Marx. Nous savons qu’il admirait fort Bachelard, qui lui a écrit après avoir lu Poète... vos papiers !, et il évoquera toujours Bachelard avec ferveur et émotion. Si dans ses textes nous trouvons bon nombre de noms de philosophes (ou de mathématiciens...), il est peu probable qu’il en ait lu beaucoup... Le langage technique des philosophes le rebute. Ayant rencontré Lacan à l’époque où il fréquentait Breton, Ferré le trouve « incompréhensible ». S’étant plongé dans la lecture de L’Être et le néant, Ferré critiquera vertement le discours sartrien qui, pour lui, ne veut pas dire grand-chose, du moins certaines phrases seraient dépourvues de sens !
« Dans L’Être et le néant, je vous demanderai ce que ça veut dire, je n’ai jamais compris, et puis je ne tiens pas à comprendre, il y a, c’est d’une connerie rare, la « transcendance transcendée ». Et vas-y... » [1], et en 1980, dans Apostrophes : « L’Être et le néant, hein, c’est vrai, non, il faut être raisonnable. Qu’est-ce que ça veut dire ? C’est une chose qui m’inquiète ».
Cette allergie déclarée à la langue philosophique devrait mettre en garde ceux qui veulent à tout prix faire de Ferré un penseur, un philosophe. Le concept n’est pas son domaine de prédilection. À la décharge de Ferré, il faut reconnaître que L’Être et le néant est un ouvrage difficile, avec peu de références explicites, qui s’appuie sur Descartes, Hegel, Husserl ou Heidegger sans toujours les nommer ou les citer. Sartre fait confiance au lecteur. Ce n’est pas un livre de débutant, bien que ce fut souvent celui-là que les étudiants lisaient d’abord dans les années 50-60, notoriété de Sartre oblige. On peut conjecturer que Ferré ne lira pas les livres philosophiques qui suivront, Critique de la raison dialectique, par exemple, plus difficile d’accès que le précédent.
Mais en 1969, Léo Ferré dit à Michel Lancelot : « Sartre, il restera, c’est le plus intelligent. Il est d’une intelligence foudroyante, c’est le type qui a tout trouvé, qui a trouvé l’homme d’aujourd’hui », à la suite de quoi il évoque ses lectures : « Le premier livre de Sartre que j’ai lu, c’était Le Mur... J’ai lu La Nausée après, et puis tout le reste... Je le lis souvent, je le lis toujours. C’est un grand mec ».
Qu’entendre par « tout le reste », si nous laissons de côté les sommes philosophiques par principe de précaution ? Vraisemblablement les autres romans, le théâtre, les volumes de Situations, etc. Mais Ferré ne cite nommément que le Baudelaire et Saint-Genet, comédien et martyr. Des approches biographiques. Probablement aussi Les Mots. Quant à L’Idiot de la famille, ce livre-monstre de trois mille pages sur Flaubert, il est peu probable que Ferré l’ai lu, en raison de ses très nombreuses occupations dans les années 70.
Nous ne pouvons parler ici que de ce qui est certain, ce sur quoi Ferré s’est exprimé : le Baudelaire, le Genet, le théâtre (du moins Huis-clos), certains textes sur l’engagement, nombreux chez Sartre. Ferré, à l’évidence, en a lu, mais difficile de les identifier. Et la précision na jamais été son point fort, il n’a ni la mémoire des noms, ni celle des titres ou des dates... !
Avançons donc avec prudence.
Sartre, on l’a souvent fait remarquer, s’intéressait peu à la poésie. Encore qu’il fut un des premiers à montrer l’importance et la nouveauté de l’œuvre de Ponge (Situations, 1).Dans sa conférence de 1946, à l’Unesco, La Responsabilité de l’écrivain, Sartre distingue le poète et le prosateur : « Le prosateur utilise les mots pour nommer », donc pour constituer des significations, des idées, le poète, lui, « utilise les mots dune autre manière… Ils sont des objets dont l’assemblage produit certains effets, comme des couleurs sur une toile en produisent ». Pour Sartre, dès lors, on ne peut demander à un poète de s’engager « en tant que tel » dans une lutte sociale. S’il ne le fait pas, on ne peut le lui reprocher qu’en tant qu’homme.
Et pourtant, Sartre consacrera plusieurs ouvrages à des poètes, des approches « biographiques » d’un type nouveau. À Baudelaire, à Genet, à Mallarmé (inachevé), même à Leconte de Lisle (plus de cent pages dans le tome III de L’Idiot de la famille), et aussi à des peintres (Le Tintoret, également inachevé).
Avec les poètes, Sartre est dans le même projet qu’il tentera vis-à-vis de lui-même dans Les Mots : comprendre, expliquer, le devenir-poète, le devenir-écrivain. Par quelle alchimie personnelle, sociale, langagière, tel ou tel enfant devient l’homme (ou la femme) qui écrit, qui se construit en construisant une œuvre singulière ?
Ferré a lu le Baudelaire, paru en 1947. Il raconte : « Un jour, j’ai lu un livre de Sartre sur Baudelaire, avec certaines vérités bien sûr, mais très méchant. C’était très méchant, et il m’a convaincu un moment. Un moment, je ne pouvais plus le voir, Baudelaire. Je n’aime pas que Sartre ait parlé comme ça d’un tel poète » [2] ... et aussi : « Avec Baudelaire, je suis passionné et passionnément critique ». Contrairement à son rapport à Verlaine ou Rimbaud, Ferré gardait donc toujours un regard critique sur Baudelaire.
Sartre, dans son livre, ne parle que de l’enfant et de l’homme Baudelaire, mettant le poète entre parenthèses. On a souvent donné comme raison de ce choix la similitude de situation familiale : Sartre, comme Baudelaire, est orphelin de père, et a un beau-père qu’il détestera toujours. Mais cette similitude de situation n’explique en rien les thèses du livre.
Pour Sartre, Baudelaire, c’est l’homme qui a choisi de se voir comme s’il était un autre. Pour Sartre, sa vie n’est que l’histoire de cet échec. Et il tentera de faire revivre « de l’intérieur » ce choix d’être le poète maudit, d’être l’Héautontimorouménos, le bourreau de lui-même. Du choix du dandysme à la façon de Barbey d’Aurevilly, à la mise en avant, par provocation, des idées réactionnaires de Joseph de Maistre (mais Baudelaire sera sur les barricades en 1848), de la fréquentation des prostituées les plus viles, jusqu’à la déchéance et la maladie, Baudelaire est dans un long processus d’auto-destruction. Les Fleurs du mal ? ... « Le succès bizarre de mon livre et les haines qu’il a soulevées m’ont intéressé un peu de temps, et puis après cela, je suis retombé ».
Tout ce qu’il écrit est à distance, l’intérêt qu’il y prend est mince. Comme un exercice parnassien, sans plus. Il se sent davantage porté par son identification quasi-mystique à l’œuvre de Poe qu’il traduit. Sartre relève par ailleurs, et c’était déjà la thèse de Walter Benjamin, que pour Baudelaire, la poésie est moins dans les mots que dans la ville, et d’abord Paris. « Fards, parures, vêtements, lumières, manifestent à ses yeux la véritable grandeur de l’homme, son pouvoir de créer » [3].
Baudelaire, ce poète qui se détourne de la magie des mots, psychasthénique de surcroît, cette vie à vau-l’eau qu’il aurait choisi délibérément, ce poète, tel que Sartre comprend son « plan de vie », ne pouvait être accepté par Ferré. Il y voit d’abord quelques vérités, et délaissera Baudelaire quelques temps , s’en détournera, mais finira par y revenir par un biais inattendu, confiant à F. Travelet [4] : « C’est Sartre qui a des problèmes avec Baudelaire, pas moi ». Après le « rejet » passager, Ferré reviendra à Baudelaire en le mettant en musique et en l’enregistrant en 1957.
Le Baudelaire de Sartre est dédié à Jean Genet. Sartre, à qui Gallimard demande une préface pour les œuvres de Genet, en écrira comme on sait une très longue qui occupera tout le tome I des œuvres de Genet (578 p.).
Ferré le lit avec enthousiasme. « Pour moi, son chef-d’œuvre. C’est un livre extraordinaire. Au fond un grand livre sur la morale, qu’il appelle Saint-Genet, poète et martyr. C’est fabuleux, fabuleux. Il faut lire ce livre » [5].
Pourquoi cet emballement alors que par ailleurs il semble a priori apprécier peu l’œuvre de Genet si l’on en croit quelques vers de Ferré bien connus... Là non plus, Ferré ne s’explique pas.
La démarche de Sartre est proche de celle utilisée avec Baudelaire. Comprendre, à partir de l’enfance de Genet, enfant abandonné, placé en nourrice dans le Morvan, bien élevé, enfant de chœur, qui choisit la voie de la délinquance dès treize ans : ce sera Mettray, le bagne d’enfants, puis plus tard la prison pour vol (Genet ne volait que des livres, mais la récidive pouvait conduire à la perpétuité !), le choix de l’homosexualité, mais aussi celui de l’écriture, romans et poèmes (on a souvent relevé la parenté du vers de Genet et du vers baudelairien). Pourquoi parler de livre de morale ? Sans doute par cette oscillation perpétuelle entre la tentation du bien et le mal... Livre contemporain de Le Diable et le bon Dieu qui traite aussi de ce choix.
Ferré commet un lapsus qui ne manque pas d’intérêt : il commet une erreur sur le titre. Il dit « poète et martyr », au lieu de « comédien ». Or, dans le titre de Sartre, « comédien » est le mot essentiel. En effet, Sartre se réfère à la pièce éponyme de Jean Rotrou, tragédie (excellente d’ailleurs) écrite en 1646, mettant en scène le comédien romain Genest, jouant devant l’empereur Dioclétien Le Martyr de saint-Adrien. Et jouant Adrien, Genest entend l’appel de Dieu, se convertit au christianisme, et accède au martyr. Le comédien Genest s’est identifié au rôle qu’il interprète, mais, tourniquet sartrien, l’acteur qui joue le rôle de Genest, lui, ne se convertit pas, il joue le rôle d’un converti : il y a l’acteur, le rôle de Genest, et Genest s’identifiant à Adrien. Jean Genet, selon Sartre, joue de tous les registres à la fois. On ne sait jamais quelle place il occupe. Enfant sage ? Voleur ? Homosexuel ? Écrivain ? Plus tard militant politique... Cet enfant en constant déplacement, on ne sait où l’attendre. La maestria dont Sartre fait preuve rend ce livre difficile passionnant à lire. Et Ferré a été conquis.
Si le Baudelaire éloignera Ferré du poète quelque temps, Genet, après avoir lu Sartre, ne pourra (ou ne voudra) plus écrire de romans, et sera plongé dans une sévère dépression. La littérature est aussi un métier à risque quand un Sartre la démonte. Ferré, n’ayant pas à Genet le même rapport qu’à Baudelaire, a fait à l’évidence une lecture déprise d’affect et apprécié ce livre superbement écrit.
« L’enfer, c’est les autres »
Ferré cite souvent cette formule, par exemple dans les entretiens de 1969 avec M. Lancelot : « L’enfer, c’est les autres, admirable, c’est toute la clef de Sartre » et, dans la préface au roman de M. Frot, Le Roi des rats, il écrit : « L’enfer, c’est les autres, dit Sartre. L’enfer de Frot, c’est lui-même parce qu’il est un Autre. La conclusion de Sartre, mise à jour après la « confrontation », se réduit à un soliloque désespéré, une façon de poursuivre sa tâche malgré les Autres et dans les Autres, alors que le sentiment d’altérité ne trouve son objet qu’en soi, dans sa propre géhenne ». Il ne s’agit pas, concernant Frot, du « Je est un autre » rimbaldien, du « Je nié », où, nous dit Ferré, il y a tout Rimbaud. Ce « Je » distancié, dissocié, dont l’inconscient occupera la faille. Mais plutôt du « Soi-même comme un autre » [6]... Cette objectivation de soi, vu en extériorité, ce regard porté sur soi comme s’il était étranger (soit une transcendance transcendée ! - sic).
Ferré est donc ici au plus proche de Sartre. Si nous nous référons aux critiques, Huis-clos a donné lieu à pas mal de malentendus, que Sartre a dû balayer à de nombreuses reprises.
« L’enfer, c’est les autres a toujours été mal compris, dit Sartre. On a cru que je voulais dire par là que nos rapports avec les autres sont toujours empoisonnés... Or, c’est tout autre chose que je veux dire : si les rapports avec autrui sont tordus, viciés, ALORS, l’autre ne peut être que l’enfer » [7].
Et Sartre nous rappelle que les trois enfermés sont des morts, des consciences mortes, et donc ne peuvent modifier leur destin. « Mort » fonctionne aussi ici de façon symbolique : être mort, c’est « être encroûtés dans une série d’habitudes, de coutumes, qu’on ne cherche même pas à changer… Nous sommes vivants… J’ai voulu montrer par l’absurde l’importance de la liberté... Quelque soit le cercle d’enfer dans lequel nous vivons, je pense que nous sommes libres de le briser. Et si les gens ne le brisent pas, c’est encore librement qu’ils y restent, de sorte qu’ils se mettent librement en enfer ». On voit bien ici la proximité de pensée de Sartre et de Ferré. On pourrait évoquer de nombreux passages de Ferré qui sont un rappel de la liberté, un appel à se libérer, à briser le cercle d’enfer des habitudes et des coutumes... Ne serait-ce qu’Il n’y a plus rien.
L’engagement
« Vous savez, moi, je l’ai dit un jour à Sartre : « L’engagement, ça n’existe pas », et il a dit : « Un type qui écrit ne peut plus écrire s’il voit des gens qui meurent de faim »... C’est des mots, tout ça, pourtant Dieu sait si je parle de Sartre et Dieu sait si j’ai une admiration pour ce type. Mais vous savez, l’engagement... l’artiste doit être vraiment très, très, très indépendant » [8] et Ferré dira aussi : « Moi, je ne suis pas engagé, je suis comme je suis ».
Françoise Travelet, à juste titre, reconnaît que Ferré ne nie pas que l’écrivain, l’artiste, comme tout homme, se trouve engagé malgré lui, est en situation d’engagement, qu’il le veuille ou non. Mais Ferré ne parle au nom de personne, ni à la place de personne : « Il n’exprime que sa propre pensée et ses propres choix » [9].
Alors, l’artiste ou l’écrivain ne seraient investis d’aucune responsabilité particulière. Est-ce éloigné de ce que dit Sartre ? Toute liberté étant en situation, jetée au monde, l’engagement n’est que la conséquence logique de cet être-en-situation.
Écoutons Simone de Beauvoir : « Nous sommes donc jetés libres et en situation dans le monde un peu comme Pascal disait : « Nous sommes embarqués »... L’existentialisme dit : « Nous sommes engagés ». C’est avant tout un état de fait ». Ainsi, condamnés à la liberté, nous le sommes aussi à l’engagement : je suis toujours-déjà engagé. Sartre n’a jamais confondu engagement et politisation, ou adhésion à un parti. L’artiste retiré dans sa tour d’ivoire, qui ignore ou méprise le monde comme il va est tout aussi engagé que le militant de base ! Encore faut-il que les conditions matérielles existent afin que chacun puisse choisir sa vie. C’est le cœur du problème : on ne fait pas ce qu’on veut, mais on est en même temps toujours responsable de ce qu’on est ou de ce qu’on a fait de nous.
Pour Sartre, l’écrivain, l’artiste ont donc une mission particulière, car en tant que tels, ils parlent aux autres, écrivent pour les autres. Parler aux autres, oui, mais jamais à leur place ; faire en sorte que chacun, chacune soit porteur dune parole singulière. Penser avec sa propre tête, disait le vieux Kant. Et sur ces points, Sartre et Ferré me semblent d’accord sur l’essentiel : ils laissent les gens libres...
La Cérémonie des adieux
Sartre meurt le 15 avril 1980. Son enterrement sera suivi par une foule immense : soixante mille à cent mille personnes… ? On parle du « peuple de Sartre », de « manif contre la mort de Sartre », de « dernière manif de 1968 ».
Sartre ayant refusé d’être inhumé auprès de son beau-père, il sera enterré dans un coin tranquille, non loin de la tombe d’un certain Charles Baudelaire...
1981 : Simone de Beauvoir publie le dernier volume de ses mémoires, livre dédié « À ceux qui ont aimé Sartre, qui l’aiment et l’aimeront »... La Cérémonie des adieux est le récit des dix dernières années de son compagnonnage avec Sartre. Quoique respectant comme toujours dans ses « mémoires » l’intimité de certaines personnes (allant souvent jusqu’à changer les noms), elle ne cache rien de la maladie de Sartre, de sa déchéance physique progressive, de sa souffrance et de sa mort. Ce livre est un grand livre, d’une intense émotion et d’une grande beauté, un acte d’amour qui est un des chefs-d’œuvre de la fin du XXe siècle. Il est complété par de longs entretiens inédits avec Sartre.
Léo Ferré le lira. Et il réagira très violemment : « Simone de Beauvoir, qui a écrit ce livre abominable : La Cérémonie des adieux... Dégueulasse... » (propos rapporté par R. Kudelka).
Certes, Ferré semble n’avoir jamais eu de grande sympathie pour S. de Beauvoir : il parle de « Sartre et sa copinoscope » (sic), de « Sartre et sa bonne femme » ou de « sa femme de jour »... Encore que ces expressions soient courantes chez lui. Ainsi, il écrivit à Sartre pour qu’il demande à Beauvoir de faire cesser les agressions dont il est l’objet de la part de « troupes » rangées derrière L’Idiot international, dont elle a pris symboliquement la direction, comme Sartre celle de La Cause du peuple. Pourquoi écrire à Sartre ? « Je préfère écrire aux bonhommes qu’aux bonnes femmes ». Ce sont donc des tournures de son langage familier, mais qui sont néanmoins péjoratives, et manquent d’élégance.
Donc, Ferré a détesté le livre. Connaissant son caractère, on peut comprendre sa réaction. Ferré, comme la plupart des poètes, a souvent chanté la mort. La mort, c’est abstrait dans le poème. De la maladie, de la souffrance, il ne parlait jamais. De sa maladie, personne n’en a rien su, ou presque. Cela relevait de son privé, ne concernait pas l’homme public. Ferré était au fond très pudique, et d’une sensibilité exacerbée, lui qui, nous dit F. Travelet, « pleurait en lisant le journal et vomissait à la moindre contrariété… » Il ne pouvait trouver ce livre qu’abominable...
Léo Ferré est passé complètement à côté de La Cérémonie des adieux. Ce livre superbe qu’il faut lire absolument si ce n’est déjà fait.
On voit donc, au travers de ces quelques lignes, que la lecture de Sartre a longtemps accompagné Ferré, même s’il a fait des impasses et des rejets du côté de la philosophie. Sur la longue durée, Sartre influença sans doute davantage Ferré que l’amitié intense mais éphémère avec Breton.
Au Panthéon de Ferré, deux philosophes occupent les places d’honneur : Sartre, toujours sur la brèche de l’écriture, de l’aventure, du voyage. Et Bachelard, le sage faisant son marché place Maubert et tisonnant son poêle... Un Bachelard d’Épinal... Mais Ferré et Bachelard, c’est une autre histoire.
_____________________________
[1]. Voir C. Frigara, p. 70.
[2]. Voir Q. Dupont, p. 352.
[3]. Baudelaire, collection « Idées », p. 52.
[4]. Voir Dis donc, Ferré…de F. Travelet.
[5]. Voir Q. Dupont, p. 353.
[6]. Soi-même comme un autre, livre de Paul Ricœur, Seuil, 1990.
[7]. Enregistrement de Sartre en préface à la captation de Huis-clos (Deutsche G.G).
[8]. Entretien à Europe 1.
[9]. Voir Dis donc, Ferré…de F. Travelet.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (39)
dimanche, 16 décembre 2007
À propos du souvenir
On peut observer chez Léo Ferré un fréquent usage du verbe se rappeler. Souvent employé à l’impératif : « Rappelle-toi mon ange » (Madeleine, devenu Rappelle-toi), « Rappelle-toi ce chien de mer » (La Mémoire et la mer), « Rapp’lez-vous bien c’est moi Cloclo » (Cloclo-la-Cloche), « Rappelle-toi là bas chez les hippies » (Michel), il l’est aussi quelquefois à l’indicatif et à la forme interrogative dans sa tournure familière : « Lochu tu te rappelles ? » (Les Étrangers).
Chaque fois, l’amicale injonction, faite à un proche, a pour but de revivre un moment de sentiment privilégié, un instant volé de bonheur, de complicité, d’estime, d’amitié. On peut peut-être dire que le souvenir est ici source d’inspiration, tant qu’il est volontaire : l’artiste se rappelle et engage l’autre à en faire autant.
L’injonction est quelquefois faite par l’artiste à lui-même : « Souviens-toi des bonbons et puis du pèr’ Noël / D’la toupie qui tournait qui tournait qui tournait / Qui tournait qui tournait qui tournait / Qui tour… » (L’Enfance). Là encore, le souvenir est suscité, on peut même comprendre que l’auteur s’accroche à lui volontairement, énergiquement. Comment comprendre autrement l’utilisation de l’impératif, souligné par l’anaphore, quand il aurait pu écrire plus simplement : « Je me souviens des bonbons… »
À l’inverse, le souvenir qui s’impose, remontant du fond de la mémoire et du cœur, possède un goût de marée noire et n’est pas toujours bien accueilli. Au minimum, il est reçu avec mélancolie : « Les souvenirs de ceux qui n’ont plus de maison / Se traînent dans les bars ou sur les autoroutes / À cent soixante à l’heure ils se tire(nt) et s’en vont / À cent soixante à l’heur’ tu choisis pas ta route », ou encore : « Ils s’en vont ils s’en vont les souvenirs cassés / Ils s’en vont ils s’en vont les souvenirs allez / Comme des chiens perdus qu’on ne reconnaît plus » (Les Souvenirs). Et d’ailleurs, La Mélancolie, « C’est dix ans d’purée / Dans un souvenir ». Au pire, il engendre une souffrance : « Cette cruelle exhalaison / Qui monte des nuits de l’enfance / Quand on respire à reculons / Une goulée de souvenance » (La Mémoire et la mer, version complète).
Dans le cas de la forme interrogative, une exception à l’appel de l’amitié s’entend dans Et… basta ! : « Tu te rappelles ? C’est moi, l’ordure ». Et encore, on peut considérer que la réponse : « Qui ça ? L’ordure ? Je vous demande excuse, monsieur. Je ne connais, quant à moi, que des anges » est un « adoucissement » du souvenir, effectué par la volonté expresse de l’artiste.
Il existe évidemment d’autres occurrences du verbe se rappeler et du souvenir. Comme toujours, le but, ici, n’est pas d’établir une liste mais de se demander si, effectivement, le souvenir, chez Ferré, peut se distinguer ainsi : le souvenir « positif » suscité et aimé ; le souvenir « négatif » imposé ou reçu, dont on souffre. L’exemple de l’enfance, choisi plus haut, paraît révélateur de cette distinction : dans L’Enfance, il est choisi ; dans la version complète de La Mémoire et la mer, il est subi.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (8)
jeudi, 13 décembre 2007
Comme dirait Léo Ferré
J’ai toujours été amusé par les expressions qui, créées par un auteur, passaient un jour dans la langue courante jusqu’à devenir universelles, jusqu’à ce que l’on oublie parfois le nom de l’auteur. Il y a aussi le cas où le nom d’un personnage imaginaire devient un archétype (« un gavroche », par exemple).
Sans aller jusqu’à cet anonymat qui est la forme suprême de la célébrité, que peut-on observer qui soit issu de l’œuvre de Léo Ferré ou des poètes qu’il fit connaître ? Voici quelques documents amusants dont je garantis l’authenticité. Tous ont été en vente dans le commerce, distribués gratuitement ou ont paru dans des journaux.

Exposition photographique, Gentilly.

Roman de Francisco Casavella.

Roman d’Yves Navarre.

Carnets de Jean Daniel.

Concours de poésie.

Carte postale.

Carte postale.

Prospectus d’une compagnie théâtrale.

Carte postale.

Encart dans la presse.
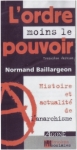
Ouvrage de Normand Baillargeon.

Roman de Zoé Valdès.
Ce n’est pas tout. On peut ajouter à cette liste illustrée de nombreux titres scrupuleusement relevés au fil des ans, dont je ne possède pas les images. Ainsi, Comme un cheval fourbu, roman de Jean Contrucci ; À mes oiseaux piaillant debout…, poèmes par Ahmed Kalouaz ; Au détour d’un regard, photographies par Gérard Luthi ; Et il ventait devant ma porte, nouvelles par Christiane Baroche ; Thank you Satan, film d’André Farwaggi ; Avec le temps, va…, numéro de la revue Taille réelle ; Je connais gens de toute sorte, par Philippe Labro. Et la manifestation annuelle Le Printemps des poètes.
Certes, il peut s’agir, je le reconnais, de formes d’hommage, de dettes reconnues, et des expressions comme « la vie moderne » ne revêtent pas un caractère d’originalité suffisant pour prétendre que Ferré les a créées. « Comme un cheval fourbu » est déjà plus personnel, ainsi que « Du vent et des bijoux » ou « Dieu est nègre ». « L’ordre moins le pouvoir », s’agissant d’une publication consacrée aux anarchistes, constitue bien sûr une référence explicite. Je note, sans autre commentaire, que, très souvent, aucune allusion n’est faite à l’emprunt du titre dans le corps du livre, au verso de la carte ou dans le cadre de la manifestation.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (43)
samedi, 08 décembre 2007
Ferré dans les anthologies de poésie
Léo Ferré entre très tôt dans une anthologie, et pas n’importe laquelle, celle effectuée par Benjamin Péret. Ferré a alors l’estime et l’appui des surréalistes. Dans Anthologie de l’amour sublime (Albin Michel, 1956 ; rééd. collection « Bibliothèque Albin Michel », n° 6), Péret publie donc L’Amour. Ferré a quarante ans, son texte clôt le volume car les poètes sont présentés par année de naissance et il est le plus jeune des auteurs retenus. Après une notice d’ordre biographique, Péret conclut que cette chanson « pourrait être le chant de l’amour sublime ». Il fait suivre le texte imprimé d’un fac-similé de la partition manuscrite.
Deux années plus tard, Max-Pol Fouchet, dont on retrouvera le nom dans l’œuvre de Ferré, fait paraître une Anthologie thématique de la poésie française (Seghers, 1958 ; rééd. 1980). Il propose Paris dans la section « Paris » et Madame la Misère dans la section « Pauvreté » et ne présente pas individuellement les poètes choisis.
Dans la continuité de son célèbre Livre d’or de la poésie française, Pierre Seghers donne un Livre d’or de la poésie française contemporaine (Marabout-Université, n° 174, 1972), volume dans lequel il choisit Dieu est nègre. Je cite intégralement son introduction : « Saura-t-on un jour pourquoi André Breton, après avoir dit à Léo Ferré qu’il était un grand poète, lui fit le lendemain des réserves ? Toute la question de la « chanson poétique » est dans cette volte-face. Poésie de l’écriture, de la réflexion, du mystère d’une part, et d’autre part la parole portée par le chant, l’élaboré devenant populaire, la recherche débondant des tonneaux de vrai vin. Des nourritures spirituelles aux agapes terrestres, de l’intellect au cœur des hommes. Les princes, mais ils sont de plus en plus isolés, « n’aiment pas ça ». Par discrétion, je ne citerai pas un poème que je tiens pour admirable, Madeleine, publié dans Poète... vos papiers ! (La Table Ronde, 1956), ne retenant cette fois que Dieu est nègre. Je vous le dis « tel quel », bouchez-vous le nez ! De toute manière, Rutebeuf et Aragon ne seraient pas les poètes qu’ils sont, sans Ferré. Cf. Léo Ferré, par Charles Estienne (Poètes d’aujourd’hui, n° 99 [sic]).
Gallimard lance une collection de poésie destinée à la jeunesse, qui comprend, entre autres titres, La Nuit en poésie (collection « Folio-Junior », n° 206, 1980). On y trouve un extrait de Rappelle-toi. Il s’agit d’un simple quatrain, celui qui commence par « Cette neige de nuit avec mes cheveux gris ». La notice indique : « Poète, musicien et chanteur dont les textes traduisent les prises de position personnelles. Son état est celui de la révolte – un anarchisme viscéral ».
Cette même collection va sélectionner, pour Le Rêve en poésie (collection « Folio-Junior », n° 198, 1981), le poème Dieu est nègre. La notice sur l’auteur est identique à la précédente. C’est la seconde fois que ce texte est remarqué dans une anthologie.
Ce ne sera pas la dernière. Quatre ans plus tard, on retrouve Dieu est nègre dans Cent poèmes contre le racisme choisis par Claire Etcherelli, Gilles Manceron et Bernard Wallon que procure la Ligue des Droits de l’homme, avec une préface d’Élie Wiesel (Le Cherche-Midi, 1985). Dans la notice d’introduction, il est précisé que Léo Ferré « est allé à l’encontre de bien des préjugés péjoratifs et méprisants en rendant hommage dans ce poème au jazz et aux musiciens noirs ».
Enfin, Pierre Delanoë inclut Les Poètes dans De Charles d’Orléans à Charles Trenet, anthologie et portraits de la poésie française (Éditions du Layeur, 1996). Ferré est présenté ainsi : « Il a si bien parlé des poètes Léo / Qu’il mérite à son tour un bon coup de stylo / Poète lui aussi, chanteur, compositeur / Baladin, Cabotin, peut-être, mais Seigneur / Il a mis en chansons Guillaume Apollinaire / Et puis Louis Aragon, Rimbaud et Baudelaire / Il était fou, anar et comme sa guenon / Vieux singe très malin et habile en chanson / « C’est extra » ce parcours un peu trop tourmenté / Fini en désaccord avec la Société, / Celle du show-bizness, loin de la vie d’artiste / Des poètes d’abord, ce qui le rendait triste / Lui l’auteur à succès passait en Italie / Des nuits à bricoler dans son imprimerie / Léo « Avec le temps » du « Tango » jusqu’au rap / Il a fait sa valise et il a mis le cap / Sur les vert pâturages de l’autre côté / Du miroir de Cocteau, Léo « Le mal aimé » ».
Ce panorama est volontairement limité aux anthologies de poésie stricto sensu, à l’exclusion des livres thématiques très illustrés, du genre « Chansons sur Paris de 1852 à 1963 » ou « Les 35847 plus belles chansons d’amour pour la fête des mères choisies par Jules Les Églises et préfacées par Ly Nreno », tous ces albums parfaitement inutiles et coûteux dont l’édition française nous abreuve. Il donne, après les recensions du Who’s who in France et celles des dictionnaires et encyclopédies, encore un aperçu de ce que les auteurs – quelquefois poètes eux-mêmes comme Péret, Fouchet, Seghers – ont pu retenir de Léo Ferré.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (10)
jeudi, 06 décembre 2007
Ferré dans les dictionnaires et les encylopédies
Après l’inventaire du Who’s who in France, il peut n’être pas inutile d’en établir un autre.
« Auteur de chansons dont il écrit le plus souvent texte et musique (…), il a composé une Symphonie interrompue et un oratorio pour quatre soli, chœurs et orchestre sur La Chanson du mal-aimé d’Apollinaire ainsi que deux concertos et un opéra », écrit entre autres le Dictionnaire illustré des musiciens français (Seghers, 1961), à propos de Léo Ferré.
« Chanteur et compositeur monégasque (…). Il écrit les textes et la musique de ses chansons. Est également l’auteur d’un oratorio et d’une Symphonie interrompue », relève Frank Onnen dans Encyclopédie de la musique (collections « Références », n° 6, Séquoia, 1964), ouvrage d’un éditeur belge que l’inspection générale de l’éducation musicale offrait comme prix aux élèves de la ville de Paris.
« Révolté, tendu, vengeur, L. Ferré a traité la chanson avec rigueur (…). Il est aussi l’auteur d’un opéra (La Vie d’artiste, 1950), d’un oratorio sur le poème d’Apollinaire La Chanson du mal-aimé (créé en 1954) » conclut le Dictionnaire de la chanson française de France Vernillat et Jacques Charpentreau (collection « Les dictionnaires de l’homme du XXe siècle, n° D 27, Larousse, 1968).
En 1969, le Grand Larousse encyclopédique en 12 volumes consacre à Ferré une notice dans son supplément, tome 1. Il y est question de « chansons amères et grinçantes, cruelles et anarchistes, qui ne manquent ni d’humour ni de poésie » et le recueil Poète… vos papiers ! est mentionné.
L’Encyclopedia Universalis, dans son volume 18, publie, en 1974, une notice dans laquelle on peut lire : « Son œuvre est sans cesse tiraillée entre la poésie pure (L’Étang chimérique, par exemple) et la mise en musique des poètes (…) d’une part, la chanson politique d’autre part (…). Il va, en 1968, alors qu’il se trouve au sommet de sa gloire, effectuer un étonnant virage et contribuer sans doute à la rénovation de la chanson française. (…) Ses œuvres, qui ne doivent alors plus rien à la conception classique de la chanson, deviennent une sorte de poésie orale, parlée, qui frappe par sa sincérité d’inspiration, sa beauté formelle et sa violence ».
Frank Lipsik écrit, lui : « Il se remet en cause totalement sans la moindre humilité et c’est en 1969 Le Chien, qui claque comme un coup de fouet et qui marque définitivement la nouvelle carrière de Léo Ferré, plus engagé, plus difficile, plus solitaire, mais encore plus grand, plus riche et plus exigeant » (Le Dictionnaire des variétés, Mengès, 1977).
Sobrement, le Petit Larousse en couleurs de 1980 note : « Chanteur français, né à Monte-Carlo en 1916, auteur de chansons amères, grinçantes, parfois anarchistes et pamphlétaires ».
Le Dictionnaire universel des noms propres de Robert, dans son tome 2, indique, toujours en 1980 : « Ses chansons prennent la forme de pamphlets, de professions de foi ou de poèmes, sur des orchestrations utilisant souvent des genres populaires (musiques de danse) ».
Le Grand Larousse universel de 1983, dans son volume 6, parle de nouveau de ces « chansons amères et grinçantes, cruelles et anarchistes, qui ne manquent ni d’humour ni de poésie » en précisant que Ferré « reste un auteur quelque peu marginal, qui contribuera néanmoins, plus que d’autres, au renom de la chanson française ».
L’Encyclopedia Universalis, dans le Thesaurus-Index 1, A-Friedländer, en 1985, avance : « Établi en Italie depuis 1972 [sic], il se produit moins souvent aujourd’hui. Il a cependant publié deux ouvrages (Le [sic] Testament phonographe, 1980 et Dis donc, Ferré…, 1980 [sic]) et a enregistré plusieurs beaux albums comme Et… basta !, La Violence et l’ennui, Ludwig, L’Imaginaire, Le Bateau ivre, etc. »
« Sa façon de chanter, pour particulière qu’elle soit, émeut souvent. Les yeux fermés, les jambes écartées, Ferré se pose en grand prêtre, illuminé et revendicateur », écrit Pascal Sevran dans Le Dictionnaire de la chanson française (Lafon-Carrère, 1986).
Le Grand Larousse en 5 volumes, publié en 1987, reprend, dans son volume 2, les notices précédemment publiées par la maison, en supprimant la mention « qui ne manquent ni d’humour ni de poésie ».
« Un grand monsieur que cet anarchiste de cœur », conclut Alain-Pierre Noyer dans son Dictionnaire des chanteurs francophones de 1900 à nos jours (Conseil international de la langue française, 1989), après une notice exclusivement biographique.
Christian Dureau relève « une incursion dans la pop-music (il travaille avec le groupe Zoo) » dont il estime qu’elle « précède un retour à un style plus pur, plus proche de sa vraie nature, répondant mieux à ce qu’attendent ses inconditionnels. Aujourd’hui encore, il demeure le vieil anarchiste que l’on sait, le lion à la crinière blanche toujours prêt à choquer et à dire ce qu’il a sur le cœur. Il vit en Toscane avec sa seconde [sic] épouse » (Dictionnaire mondial des chanteurs, Vernal-Philippe Lebaud, 1989).
L’Universalia 1994, la politique, les connaissances, la culture en 1993, que publie en 1994 l’Encyclopedia Universalis, écrit, sous la signature de Michel P. Schmitt : « désenchanté, lassé peut-être à certains moments d’être statufié dans le personnage de l’« anar » qu’on apprécie tant que son anticonformisme ne met pas la propriété en danger, Ferré se retire en Toscane avec Marie, sa nouvelle compagne et, reddition ou provocation supérieure (« I am un immense provocateur »), fait des enfants. (…) Ce « vieux mec de trois jours et de dix mille ans » (L’amour meurt) se place de façon inédite au carrefour de la chanson de variétés, de l’anarchie de cœur, d’un romantisme intimiste et visionnaire à la fois et même d’une forme d’« écriture du désastre », quand la poésie est réduite au constat qu’Il n’y a plus rien ».
Voici donc un panorama, certes non exhaustif, des notices dévolues à Léo Ferré dans les dictionnaires et les encyclopédies (à l’exclusion de celles contenues dans les innombrables histoires de la chanson, ou dans plusieurs anthologies de poésie). Dans ces ouvrages, la neutralité de l’ordre alphabétique interdit de le mettre plus qu’un autre en avant. Bien entendu, je n’ai pu citer que des extraits de ces présentations, souvent longues. J’ai ignoré la quasi totalité des éléments biographiques, les listes de titres, pour m’attacher à ne relever que des fragments pouvant composer le portrait le moins inexact possible.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (7)


