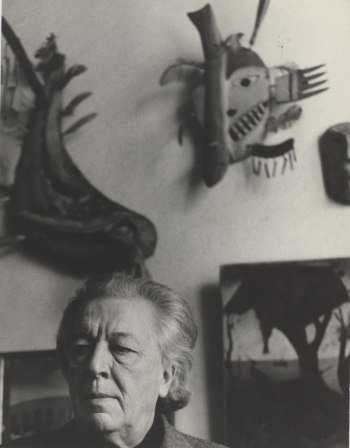lundi, 03 décembre 2007
Ferré au Who’s who
On sait que les notices du Who’s who sont remplies selon un canevas préalable, mais toujours par les intéressés. Il peut, par conséquent, être intéressant de relever de quelle manière ils désirent se présenter, au fil du temps. On passera bien sûr sur la naissance et la filiation, immuables, comme sur les études suivies ou la liste des œuvres, pour examiner les éléments mouvants.
Léo Ferré entre au Who’s who dans l’édition datée 1959-1960, achevée d’imprimer au mois d’avril. Il se définit comme : « Compositeur. Artiste de variétés » et se dit : « Marié en 1950 avec Mlle Madeleine Rabereau (un enfant : Annie) ». Il donne pour adresse professionnelle : « 9, avenue Saint-Michel, Monte-Carlo, principauté de Monaco » et pour adresse privée : « 28, boulevard Pershing, Paris (17e) ». Il se présente donc comme marié au moment de sa rencontre avec Madeleine, qu’en réalité il n’épousera que le 29 avril 1952. Il présente la fille de Madeleine comme leur enfant. Il fournit l’adresse de ses parents comme domiciliation professionnelle.
Dans l’édition 1971-1972 du célèbre annuaire, il donne comme profession : « Compositeur. Artiste lyrique ». La mention de son mariage, de sa femme et de la fille de celle-ci n’a pas changé bien qu’ils soient séparés depuis 1968. C’est que son divorce n’est pas encore prononcé. Mathieu, lui, n’est pas encore connu. L’adresse professionnelle est toujours celle de l’appartement monégasque de ses parents. Il n’y a plus d’adresse privée, bien qu’il soit fixé en Italie.
Pour l’édition de 1973-1974, pas de changement dans la profession ni dans la situation de famille. Sans doute, la notice a-t-elle été rendue avant que le divorce soit prononcé, le 28 mars 1973 et, de toute façon, avant qu’il épouse Marie-Christine Diaz, le 5 mars 1974, avant, également, la naissance de Marie-Cécile, le 20 juillet 1974. L’adresse professionnelle est : « 54, rue Mazarine, Paris (6e) ». Aucune modification en ce qui concerne l’adresse privée : toujours Monaco.
Dans sa livraison de 1983-1984, après la profession, identique, on peut lire : « Marié (trois enfants : Mathieu, Marie, Manuela) ». L’adresse donnée est unique, c’est celle de « Castellina-in-Chianti, Italie (provincia di Siena) ». Sa première fille, Marie-Cécile, est encore appelée Marie.
Le Who’s who de 1984-1985 ne présente, sur les points qui nous intéressent, aucune modification.
Bien entendu, je ne possède pas toutes les notices et il aurait fallu disposer de celles, intermédiaires, pour établir un panorama complet. On voit cependant combien les dictionnaires biographiques peuvent, d’une manière générale, être sujets à interprétation, même lorsqu’ils sont mis à jour annuellement.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (15)
jeudi, 29 novembre 2007
Léo Ferré et les surréalistes, encore de nouveaux éléments
Après la parution des Chemins de Léo Ferré en 2005, Patrick Dalmasso m’a envoyé un extrait d’émission radiophonique malheureusement non référencé, qui avait sa place dans le livre. Il était trop tard. Puisque l’on revient sur le sujet à la faveur des lettres découvertes il y a peu, je donne ici le texte de ce fragment. Il s’agit d’un entretien avec Marie-Hélène Estienne, compagne de Charles Estienne, ami commun de Breton et de Ferré. Voici la transcription exacte, hésitations comprises, de ses propos.
 « Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.
« Marie-Hélène Estienne : J’ai rencontré Léo Ferré avec Charles, tout de suite. Dès que j’ai connu Charles, Léo m’a dit, ou plutôt sa femme m’a dit : « Méfie-toi, il est beaucoup plus âgé que toi, ça ne va pas marcher ». J’ai dit : « Ça va très bien marcher ». Voilà. On était très amis avec eux, ils avaient un singe qui s’appelait Pépée, un chimpanzé. Ça, c’était toute la période… Ferré était pour moi avec la dénommée Pépée qui était absolument extraordinaire.
La journaliste : Comment ont réagi les gens des galeries, du monde parisien quand il s’est lié avec Léo Ferré ? Est-ce que ça ne paraissait pas un petit peu étrange, un petit peu curieux ?
Marie-Hélène Estienne : Je crois, il me semble – enfin, je ne veux pas parler pour les autres, mais il me semble que certaines personnes pensaient que Charles était cinglé. Que Charles, qui était un bon critique, qui aurait pu faire une carrière raisonnable, gagner de l’argent, etc., se mette à faire des chansons et à aller fréquenter Léo Ferré. Je crois que oui, les gens pensaient qu’il était drôle. Il y avait une drôle d’histoire aussi, c’est que Léo Ferré était très, très, très passionné par André Breton. Il y avait un… et je ne crois pas que ça ait vraiment marché. Au bout d’un certain temps, je ne sais pas, il y a eu une polémique assez triste. Charles, qui était, lui, ami avec Breton, était toujours hésitant entre les deux, mais c’était assez ambigu ».
On observe la permanence des étiquettes que l’on colle : Charles Estienne, critique d’art, romancier, ne peut pas écrire de chansons et fréquenter Ferré sans être « cinglé » ou « drôle ». Cela, semble-t-il, n’était pas compatible avec « une carrière raisonnable ». C’est la plus stupide des caractéristiques françaises : la mise en casiers. Heureusement, Estienne se moquait bien de cela, sa femme également.
Je me suis toujours demandé pourquoi Estienne n’avait jamais rien tenté pour rapprocher Breton et Ferré. Peut-être d’ailleurs l’a-t-il fait et n’a-t-il pas réussi ? Il est important cependant de remarquer que sa propre épouse lui prête un sentiment partagé, hésitant et ambigu. Je livre ces réflexions pour ce qu’elles sont. Elles témoignent, il me semble, d’un certain trouble, d’une gêne manifestée par Estienne. D’autres surréalistes le partagèrent-ils ?
Remerciements : Patrick Dalmasso.
(Marie-Hélène et Charles Estienne en 1965,
photo Jean Messagier)
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (6)
dimanche, 25 novembre 2007
Léo Ferré et les surréalistes : nouveaux éléments
De nouveaux documents provenant des archives d’André Breton ont été récemment rendus publics, en particulier une partie de sa correspondance « passive » (« reçue », dans le jargon des archivistes) émanant de Léo Ferré ou d’autres personnes qui font référence à Léo Ferré. Ces documents éclairent d’un jour nouveau toute l’histoire qui eut lieu entre les deux hommes. Il s’agit bien évidemment de sources de première main, absolument indubitables puisque reproduites intégralement et en fac-similé, ce qui évite d’éventuelles erreurs de transcription. J’ai pris connaissance de l’ensemble de ces lettres rigoureusement inédites et il m’est apparu qu’elles permettaient d’approfondir le sujet sur trois points : la nature de l’amitié qui exista entre Breton et les Ferré ; l’histoire du ballet La Nuit ; l’affaire de Poète… vos papiers ! et son écho chez les surréalistes. Je me propose par conséquent d’établir une synthèse appuyée sur des extraits de ces échanges, étant bien entendu que l’intégralité des documents cités est consultable en ligne sur le site officiel L’atelier d’André Breton ou sur celui de Patrick Dalmasso, Léo on the web.
Je dois, avant de commencer, supposer connus la chronologie générale de l’histoire et les faits matériels, tels que j’ai tenté de les reconstituer précédemment dans un livre, Les Chemins de Léo Ferré, notamment au travers des deux récits intitulés Léo Ferré et les surréalistes et De La Nuit à L’Opéra du pauvre [1]. Il ne s’agit évidemment pas, ici, d’auto-promotion, mais seulement de ne pas redire toujours les mêmes choses. En effet, les nouveaux documents ne modifient pas le déroulement factuel de mes textes. En revanche, ils vont permettre d’aller plus loin.
L’amitié
Une carte de visite non datée – mais manifestement la plus ancienne dans la collection qui est offerte – indique : « Cher monsieur André Breton, je ne veux pas que vous achetiez mon nouveau disque. C’est pour cela que tout simplement et de tout cœur je vous l’envoie. Léo Ferré ». C’est ainsi que commencent les choses. On imagine, selon toute vraisemblance, que cette carte et le disque furent envoyés après l’entrevue de 1955 à l’Olympia avec Jean-Claude Tertrais, missionné par Breton pour signifier à Ferré son désir de le rencontrer. Le « cher monsieur » indique encore une distance polie.
Au début de l’année 1956, a lieu la rencontre physique. Breton vient dîner boulevard Pershing. Ferré a souvent fait allusion à cette première rencontre. On apprend aujourd’hui, grâce à ce fonds, qu’il était accompagné d’Élisa, son épouse, et de sa fille Aube, et que Ferré les a ensuite raccompagnés. Il n’était pas encore revenu que, déjà, Madeleine prenait la plume : « Jeudi, 2 h [du matin] » est la date de la lettre dans laquelle elle se félicite de cette rencontre, de cette amitié nouvelle, et remercie le poète avant de s’inquiéter de ce que, peut-être, son mari et elle ont trop parlé d’eux-mêmes durant la soirée. Dès son retour, Ferré lui-même écrit une autre lettre : « Jeudi matin… avant l’Aube… Cher André, vous voyez, je ne tarde pas à vous appeler André… ça m’est très facile… et je vous remercie de me l’avoir demandé. Je rentre et Madeleine m’a devancé ! C’est bien la première fois que cela lui arrive, d’avoir le besoin d’écrire à pareille heure… Considérez sa lettre comme une lettre d’amour… Nous désespérions de trouver des amis. Nous laissons croire aux fâcheux que nous sommes très occupés ! Pour vous, à partir de cette minute, nous sommes toujours libres. Je suis votre ami et votre frère, André… et nous n’avons qu’une famille : celle de la lumière et de l’intelligence du cœur. Dites à votre femme mon amitié et à votre fille qu’elle est un peu notre fille. Je vous embrasse bien bien volontiers. Léo Ferré ».
J’ai toujours pensé que Breton était un des rares – le seul, peut-être – à avoir vraiment impressionné Léo Ferré, qui a dû s’émerveiller d’avoir connu un personnage aussi exceptionnel. Les lettres dont on dispose maintenant confirment ce sentiment. En les lisant dans l’ordre chronologique (quelques unes, non datées, peuvent, par leur contenu, être situées au plus près), on observe une véritable fascination qui n’est pas courante chez Léo Ferré. Il a souvent dit son amitié pour telle ou telle personne, il n’en a jamais écrit comme ici.
À tel point qu’on se demande – je me le demande de plus en plus – si un rapport père-fils, évidemment inconscient, ne s’est pas créé. Ce n’est absolument pas péjoratif et ce n’est pas déprécier l’un ou l’autre que d’estimer qu’une différence d’âge de vingt ans (Breton est né en 1896) a pu jouer en faveur d’une compréhension recherchée par Ferré, dont on sait qu’il en a toujours voulu à son père de ne l’avoir pas compris. Selon Céline Caussimon, Ferré lui aurait confié que, sur son lit de mort, en 1973, Joseph Ferré avait encore demandé à son fils, alors au sommet de sa popularité, pourquoi il n’était pas devenu avocat. Or, voici que, brusquement, un aîné combien prestigieux et talentueux s’intéresse à lui et lui parle d’amitié passionnée (le mot et le soulignement sont de Breton, on le sait, dans sa dédicace de la carte du ciel de Ferré, établie avec sa fille Aube et datée du 18 février 1956).
Madeleine se met à lire Breton à fond. Trois livres à la fois. Léo Ferré et elle écrivent une lettre commune datée « Samedi 11 h soir » [6 février, date de la poste]. Ferré note entre autres : « Je ne veux pas que vous me disiez « Soyons simples » quand je vous parle d’Arcane 17. Je veux que vous m’y regardiez enfoui jusqu’au cou et que vous soyez heureux de la joie que vous me donnez car je ne lis que très peu, André, et tout m’indiffère, sinon une certaine bonté de l’homme ; et vous êtes la première intelligence bonne que je rencontre ». Le mardi 14 (la lettre indique « Mercredi soir 14 février 1956 » par erreur – ou bien alors, il s’agirait du mercredi 15), Ferré écrit de Bruxelles où il chante au cabaret et propose d’organiser « une grande conférence sur le Surréalisme avec textes dits par Madeleine », lui-même chantant « par ci, par là ». Cela n’aura jamais lieu, mais il est intéressant d’observer que, chaque fois qu’il se trouve avec des artistes qu’il estime, Ferré ne tarde pas à évoquer des réalisations communes. La proposition qu’il fera en 1969 à Brel et Brassens d’un récital à trois perd en cela beaucoup de l’originalité qu’on lui a toujours supposée – et ce qu’il expose à Breton est d’une autre mesure.
Une certaine intimité est vite perceptible. Breton initie les Ferré à la fréquentation des salles des ventes : « L’autre jour à l’hôtel Drouot où nous sommes allés « regarder » quelques vacations, il y avait votre admirable double entre nous, ce double que vous avez eu la bonté de déposer au 28, boulevard Pershing, avant de prendre le train pour vos vacances », lui écrit Ferré « vendredi soir 22 juin 1956 », ajoutant un peu plus loin : « De cette vente à Drouot, Madeleine a rapporté deux énormes vases en bronze, de Chine. Elle dit que c’est barbare… moi, je ne m’y suis pas encore habitué et si je les trouve barbares aussi, ce n’est peut-être pas dans le même esprit. Ils sont très envahissants. Madeleine les imagine pareils à ce qu’elle croit être des récipients à laisser macérer des têtes (cf. les réducteurs !) » Il semble qu’il y ait eu invitation lancée par Breton pour séjourner chez lui, à Saint-Cirq-Lapopie (Lot) : « Chère Élisa, attends un peu pour aller chez les antiquaires du Lot. Nous ne manquerons pas le rendez-vous promis ! » Cette même lettre apprend qu’il y eut entre eux des discussions sur le Moyen-Âge. En conclusion de cette missive de deux grandes pages, Ferré écrit : « Vous êtes gâté ! Je n’écris JA-JA-JAMAIS… qu’à vous. Ou alors, c’est la barbe et le pensum ». Madeleine ajoute, quant à elle, deux autres pages datées « La maison, ce soir, 10 h » dans la même enveloppe. On y lit une chose ahurissante : « J’en étais même venue à haïr « l’Idée » de vous avoir donné cette veste (tant je vous voulais du velours flatteur près de vos cheveux gris !). Je me disais : « André n’a pas été content que je l’habille de force et à ma guise ! » » Elle paraît ici complètement séduite par celui qu’elle appelle au début de sa lettre « André chéri » et pour qui elle va jusqu’à acheter des vêtements selon son goût à elle. Et puis, voici un télégramme déposé à Paris le 27 juin à 16 h 22, parvenu à Saint-Cirq-Lapopie à 18 h 15 : « L’objet est à la maison. Envoyez 97. 000 francs à maître Rheims. Lettre suit. On vous embrasse. Madeleine ». D’évidence, il est ici question d’un achat en salle des ventes, fait au nom de Breton en son absence. Intimité, comme, encore, ce carton qui a dû être punaisé sur une porte : « On arrive. Madeleine. Léo », message non daté écrit de la main de Léo Ferré, témoignant de rapports libres, simples. Breton est attendu, les Ferré doivent s’absenter, ils lui laissent un mot, sachant qu’il patientera et ne s’offusquera pas.
Le « feuilleton lyrique » La Nuit
La lecture de cette correspondance permet de se rendre compte de l’importance que le ballet La Nuit a eu pour Ferré et son épouse. La première fois où Ferré évoque ce travail se situe le lundi 16 juillet, dans une lettre à Breton qu’il rédige au château de Costaérès, bâti sur une île, sur la commune de Trégastel-Ploumanac’h, château qu’il loue pour les deux mois d’été : un château construit au XIXe siècle dans un faux style médiéval par l’auteur de Quo Vadis ? Il est venu là parce que son épouse aime la mer et parce qu’il lui fallait un piano. Pour toutes ces raisons, ils n’ont pas choisi le chalet des Alpes où, jusque là, ils passaient leurs vacances. Ferré doit en effet livrer La Nuit le 15 septembre. Il donne à Breton quelques indications sur ce que sera ce « feuilleton lyrique » et ajoute : « Je souhaite que cela vous plaise ! » Il invite ensuite Breton à venir les retrouver, l’assurant qu’il viendra le chercher à la gare de Lannion, s’il consent à abandonner le Lot où il se trouve alors. Le 30 juillet, Madeleine insiste, dans une carte postale représentant le château : « Espérons que vous allez crever de chaleur et vous décider à venir ». Ironie du sort, c’est dans le Lot, qu’ils ne connaissent pas encore, que les Ferré s’installeront eux-mêmes sept ans plus tard.
Une lettre de Madeleine, datée « Verneuil [2], 14 septembre, 2 h… La Nuit » précise à Breton et à son épouse que Léo Ferré « passe jour et nuit à orchestrer La Nuit. C’est plein de chansons, de texte… magique, sans compromissions (vous connaissez votre Léo) et chaque soir il me dit : « Ça plaira à André », c’est tout ». L’idée qu’ils se font tous deux de cette œuvre est grande : « Nous y avons mis notre âme (!), une sorte d’espoir monstrueux à notre époque ». Madeleine regrette de n’avoir pas à réserver aux Breton « la place d’honneur à la première » puisqu’ils ne seront pas de retour à Paris. Elle enchaîne sur l’argument de La Nuit. Puis Ferré, qui a « une barbe de huit jours et dort trois heures par nuit pour que sa musique « sonne » ! » ajoute un mot en fin de lettre : « Dès que j’en aurai terminé avec ce travail de bagnard, je vous écrirai une très longue lettre. J’ai une très grande hâte de vous voir, de vous parler, d’entendre votre chère voix que bien des nuits je sentais passer sur ma musique ».
On mesure l’allégresse de Léo Ferré et de son épouse, une allégresse doublée d’inquiétude quelquefois. Mais ils sont persuadés que La Nuit sera un beau succès. On sait que ce sera un échec et qu’au lendemain de la première, la presse lui ayant tiré dessus à boulets rouges, elle sera retirée de l’affiche. J’ai raconté cette histoire en détail. Ce qui est nouveau à présent, c’est ce télégramme du 2 octobre : « La Nuit vous aurait beaucoup plu. Malheureusement, on la retire de l’affiche après les assauts conjugués de toute la presse et sans que le public y ait participé. Baisers. Léo. Madeleine ». Cette dépêche montre deux choses : les Ferré sont meurtris par l’abandon de l’œuvre ; ils ne peuvent s’empêcher de raconter immédiatement à Breton ce qui s’est passé. Étonnant réflexe d’enfants meurtris se confiant à un adulte comme pour lui demander justice. C’est en tout cas ce qui transparaît dans la lettre non datée mais qui suit évidemment le télégramme. C’est une lettre commune. Madeleine dit à Breton qu’elle lui adresse par courrier séparé les coupures de presse, une mise au point de Ferré qui devait paraître dans Paris-Presse et n’y parut pas, un enregistrement de La Nuit avec leurs deux voix et la musique, la jaquette du livret correspondant qui doit paraître à La Table Ronde, l’article qu’écrivit Louise de Vilmorin dans Marie-Claire (elle devait en faire paraître un autre dans Arts, dit-elle). L’auteur et sa femme n’acceptent pas cet échec et n’acceptent pas, surtout, que les commanditaires du ballet n’aient pas choisi de le défendre davantage. Ce courrier est très intéressant car il confirme beaucoup de choses : il n’y eut qu’une représentation et le bruit selon lequel Ferré aurait par la suite chanté lui-même depuis les coulisses est une légende ; il existe ou a existé un enregistrement personnel ; Madeleine a demandé à Breton d’intervenir : « Pour moi, la coupe est pleine. Que devons-nous faire, André ? Je crois qu’il faudrait peut-être aider Léo… sous la forme que vous jugerez utile pour lui, la polémique, le sourire ou l’admiration mais quelque chose venant de vous nous laverait de toutes ces souillures ».
Cette demande a une importance car elle éclaire enfin le passage de cette Lettre à l’ami d’occasion que Ferré écrira plus tard et qui ne sera jamais publiée de son vivant : « Si l’on m’attaque dans un journal pour un fait qui m’est personnel, vous ne levez pas le petit doigt sur votre petite plume même si c’est ma femme qui vous le demande, sans vous le demander tout en vous le demandant ». Breton, en effet, n’a rien écrit à ce sujet. En cette occasion, il faut le dire, ce sont les Ferré qui se trompent. Breton n’était pas obligé de faire quelque chose et d’ailleurs, qu’aurait-il pu faire ? Un échec artistique est un échec artistique et aucune polémique littéraire – comme Breton savait les créer, certes – n’aurait pu faire que l’œuvre soit reprise, eût-il engagé sa réputation. De plus, les Ferré supposent que Breton aurait aimé La Nuit. Mais la seule trace qu’on en relève dans un écrit surréaliste – datant d’après la brouille, il est vrai, et non signé expressément par Breton mais par la rédaction tout entière du Surréalisme, même en son second numéro – est : « Un « feuilleton lyrique » assez médiocre précisa ainsi son esthétique : « Un amoncellement d’argot ! Avec de la musique ! Un ramassis de vieux clichés ! (…) Le bottin de l’ordure ! » Outrances verbales, pensions-nous ». Qu’a répondu Breton à l’envoi de l’enregistrement ? A-t-il écrit, téléphoné ? On l’ignore. Les Ferré comptaient sur une reconnaissance d’office, une admiration automatique, toutes deux dues à l’amitié et entraînées par elle. C’était plutôt contraire à ce qu’était Breton mais, apparemment, ils ne le savaient pas. Léo Ferré croyait que Breton était comme lui : « Je ferai n’importe quoi pour un ami, vous m’entendez, cher ami, n’importe quoi ! Je le défendrai contre vents et marées – pardonnez ce cliché, je n’ai pas votre phrase acérée et circonspecte – je le cacherai, à tort ou à raison, je descendrai dans la rue, j’irai vaillamment jusqu’au faux témoignage, avec la gueule superbe et le cœur battant », se décrit-il dans Lettre à l’ami d’occasion. Je crois pouvoir dire qu’il n’y a pas là d’exagération : Ferré était ainsi. Breton était autrement : la raison littéraire et artistique l’emportait certainement sur le sentiment, la rigueur sur l’affectivité, et c’est ce qui va se produire dans l’épisode suivant.
En attendant, on relève encore dans cette lettre la présence, extrêmement importante pour Ferré, de la musique : « Léo a envie de casser la figure à ceux qui l’appellent « mélodiste » (un monsieur qui trouve des airs mais ne sait pas les écrire et donne ses idées à… rédiger). Tout cela relève de l’injure la plus grossière. (…) Je dois vous dire que, musicalement, il avait beaucoup travaillé, jours et nuits, que sa partition est admirable, je crois que c’est de ce côté-là qu’il est blessé », explique encore Madeleine à Breton. Et Ferré, dans le mot qu’il ajoute à la lettre de sa femme, écrit : « Les fumiers courent toujours… comme des lièvres aux oreilles rognées… et jamais un chasseur pour les arrêter ! À quand l’ouverture de la chasse à l’homme ?… dans une prochaine planète ! » La blessure est béante, décidément.
Le fait que Breton se soit abstenu de défendre La Nuit ne laissera pas de trace, en tout cas dans l’immédiat. En effet, une lettre de Madeleine, simplement datée « Jeudi » [15 novembre 1956], adressée à « André, Élisa chéris », transmet à Breton l’opinion de Ionesco, parue dans un journal hollandais dont la date n’a pas été conservée, mais qu’un ami de La Haye, Solar, a transmis aux Ferré, traduite, par une lettre du 2 novembre. Ionesco déclare : « Qui je hais et méprise le plus ? Staline, Hitler, Luis Mariano, Gilbert Bécaud, Léo Ferré et beaucoup d’autres, mais je ne puis me les rappeler sur le champ ». À juste titre, elle ajoute : « Hitler et Léo, tout de même ! » Ionesco sera épinglé par Ferré dix ans plus tard dans la troisième version des Temps difficiles.
Mais… lorsque Breton refusera de préfacer Poète… vos papiers ! et conseillera à Ferré de ne pas le publier, cette vexation et cette incompréhension viendront très certainement s’ajouter au silence de Breton lors de l’échec de La Nuit. Inconsciemment peut-être, mais il est très vraisemblable que Ferré y verra une seconde défection, se manifestant pratiquement après la première. Ce qui expliquerait les débordements de la préface qu’il signera lui-même.
La préface de Poète… vos papiers !
On connaît – on n’y reviendra pas – l’origine de ce texte, initialement paru dans Arts du 9 au 15 janvier 1957 sous le titre En France la poésie s’est sabordée, qui a été véritablement ressenti comme une trahison par Breton et ses amis surréalistes. Ce qu’apporte cette correspondance enfin sortie des archives, c’est l’étendue de la déception.
Breton téléphone, Madeleine répond, il hurle à la trahison. Georges Goldfayn qui avait loué Léo Ferré dans un article, « La fleur qui est sur les lèvres », paru dans la première livraison du Surréalisme, même, est consterné. Il écrit une lettre à Breton, le vendredi 11 janvier 1957 (c’est par erreur qu’il écrit « 1956 », bien sûr ; par erreur aussi qu’il écrit « Jeudi »). On y lit : « Je n’ai certainement pas été moins bouleversé que toi par cette sale histoire de Léo Ferré. L’article lu attentivement, je me suis bien persuadé qu’il était d’une grande canaillerie de formulation. Mais, en raison de cette affection particulière que j’avais pour Léo, je n’ai pas pu m’empêcher de vouloir des raisons personnelles pour le détester ». À cette lettre manuscrite, il joint un double de celle qu’il adresse le même jour à Ferré, dactylographiée celle-là, et par pneumatique. Le courrier pneumatique était un système de tubes introduits et propulsés dans des tuyaux à air comprimé, qui transportaient des lettres d’un bureau de poste à un autre, à l’intérieur d’une même ville. À l’arrivée, un postier apportait le « pneu » au domicile du destinataire. C’était la rapidité du télégramme associée à la possibilité d’envoyer une lettre véritable. L’envoi coûtait très cher et n’était utilisé que dans les cas d’urgence ou pour signifier une réelle importance. Un pneumatique de deux pages dactylographiées, c’était pour Goldfayn un signe d’urgence dans l’expression. Il dit à Ferré ne pas comprendre que, s’il s’agit d’un malentendu, il n’ait pas tenté de le dissiper. On sent bien que Goldfayn n’y croit pas et le regrette. D’où cette sommation : « Tu me connais assez Léo pour savoir que sans nouvelles immédiates de toi je me verrais dans la déchirante obligation de penser que l’étalage de ton affection était l’hypocrite manœuvre d’une abominable canaille ». L’expression est très dure, et certainement à la mesure de la déconvenue de Goldfayn.
Cette longue lettre confirme l’appel téléphonique de Breton à Madeleine et le cri à la trahison dont seul Ferré avait témoigné, jusqu’à présent. Elle révèle surtout que Breton avait déjà entretenu Léo Ferré des problèmes du vers classique, rimé et du vers libre. Aucun document n’avait jamais livré cette information (même si l’on pouvait se douter qu’inévitablement, leurs conversations avaient dû amener le sujet). On comprend mieux, alors, combien Poète… vos papiers ! a pu lui paraître une preuve de trahison. Mais Ferré, déjà, créait la langue de tous les registres et le vers libre, conspué dans l’article devenu préface et qui, cependant, sera plus tard utilisé, était présent antérieurement dans Cloches de Notre-Dame (1953) et même, plus anciennement, dans À la Villette (1950).
Le texte de Ferré a été fort mal ressenti, y compris par des gens qui ne le connaissaient pas personnellement, en tout cas moins que Breton. C’est encore un avantage de cette correspondance découverte, que de montrer combien les surréalistes ont pu être touchés par ce libelle.
Par exemple, Adrien Dax, le vendredi 1er février, écrit à Breton, de Toulouse : « J’ai, bien sûr, parcouru le livre de Léo Ferré. Un curieux titre… « pas mal » sans doute (vocabulaire maison) mais je ne vous cache pas que je préfère – et de beaucoup – les chansons aux poèmes. Ces mots coupés en deux par des apostrophes, ces lettres entre parenthèses… aussi cette préface où l’on s’en prend, en roulant des épaules – pourquoi diable ! – à l’écriture automatique, tout cela m’agace un peu ».
De Londres, le 10 février, Mesens raconte : « Je lis de temps en temps un hebdomadaire littéraire français comme on avale une potion amère et, parmi ceux-ci, assez régulièrement Arts qui me tient au malcourant des expositions pharisiennes… C’est ainsi que le texte de Léo Ferré, qui est paraît-il la préface à un livre de ses poèmes que l’on vient de publier, m’est tombé sous les yeux. Impossible, bien entendu, de trouver ce livre à Londres ; non plus d’ailleurs que l’anthologie de Benjamin (jadis ce dernier m’envoyait ses livres avec de belles dédicaces…) Mais que signifie, au juste, ce texte de Ferré (curieux par quelques tournures) dont certaines phrases m’ont étonné et d’autres m’ont abasourdi. « … aux dictats de l’hermétisme et de l’écriture dite « automatique » ». « L’art abstrait est une ordure magique [souligné trois fois] où viennent picorer les amateurs de salons louches qui ne reconnaîtront jamais Van Gogh dans la rue ». Mais de quel abstrait s’agit-il ? Le cubisme, Chirico ? Chagall ? Klee ? Le tachisme ? L’abstrait « lyrique » ? Ce qui milite pour la « plus libre expression » ou pour l’« académisme » modernes ? Pourrais-tu m’expliquer ? »
Renée Beslon, le dimanche 10 février, écrit : « Nous avons lu avec surprise et quelque indignation l’article de Léo Ferré dans Beaux-Arts [sic]. On lui pardonnerait son accent passionné s’il s’accompagnait d’une pensée plus sérieuse, et s’il n’était gâté par trop d’humeur. C’est une bien étrange contradiction que d’appeler à l’Anarchie pour mettre la poésie à la laisse du vers. Il semblerait que la révolte précisément puisse s’accorder toute licence et l’allure même la plus effrénée. En parcourant le volume de Léo Ferré me revint en mémoire une opinion de Jules Monnerot qui alors m’avait blessée dans mes sympathies et pourtant assez troublée pour que je ne l’aie depuis oubliée tout à fait. À savoir que l’anarchiste serait un esprit à qui manquerait hauteur et profondeur ? »
Dans un courrier daté « Jeudi » [vraisemblablement le 12 mai 1957, selon la date de la poste très difficilement lisible sur l’enveloppe], Jacques B. Brunius note : « J’ai acheté sur la recommandation de Benayoun un disque de Léo Ferré. Il y a en effet quelques très belles chansons, sur un ton assez inusité. Le Monsieur en Blanc [sic] est très remarquable. Je n’avais pas assez d’argent pour acheter beaucoup de disques, très chers à Paris en comparaison de Londres, mais il m’a semblé qu’il y avait pas mal de chansons d’un style assez neuf ». Ici, pas d’allusion à la préface. Il semblerait que Brunius découvre seulement Ferré. Et l’on ne sait pas à quand remonte la recommandation de Robert Benayoun à laquelle il fait allusion.
On mesure, au lu de ces lettres – et peut-être en existe-t-il d’autres encore – combien le pamphlet de Léo Ferré a déçu des artistes et des auteurs qui l’avaient accueilli et lui avaient ouvert les bras. Mais on mesure également combien ils n’avaient pas compris que Ferré était un homme indépendant, qui ne serait jamais adhérent d’un parti ou affilié à un quelconque coterie littéraire. Or, comme le sous-entendait Goldfayn dans la lettre déjà citée, le surréalisme était tout, sauf une coterie : « Voilà donc Léo que tu écris un manifeste dans lequel tu mets en cause l’écriture automatique en la rapprochant de l’hermétisme de coteries littéraires ». Le malentendu est total, de chaque côté. Léo Ferré n’a pas saisi les surréalistes (du reste, seuls Breton et Péret l’intéressaient, pas ceux qui les entouraient) ; les surréalistes ont pris pour des contradictions ce qui était des complémentarités de la part d’un auteur qui ne s’est jamais interdit aucun moyen d’expression.
Plusieurs années plus tard, Breton recevra une lettre datée du mercredi 27 mars 1963, de Marie-Josèphe, auteur du recueil Les Yeux cernés paru chez Debresse en 1955, qui lui valut le prix Max-Jacob. D’elle, Pierre Béarn disait : « C’est par le sarcasme que ce petit démon de l’expression dépeint ses sentiments intimes. Elle est la révolte de la chair à l’état brut ; elle est nature ; elle s’amuse et nous amuse ». Et Jean Rousselot : « Marie-Josèphe, sous le parrainage de Tristan Corbière et de Renée Vivien, écrit – Les Yeux cernés – des alexandrins fouaillés, énervés, audacieux ». Elle sollicite un entretien pour montrer à Breton son nouveau manuscrit et écrit : « Je vous rappelle que nous nous sommes déjà rencontrés, ce chez un « ami » qui pour moi n’est plus qu’un souvenir (assez déprimant) à savoir, le narcissiste [sic] Léo Ferré aujourd’hui vedette alimentaire sur les murs de la Capitale dite des douleurs ». Le moins qu’on puisse dire est que se rappeler au souvenir de Breton en débinant celui chez qui ils se sont rencontrés est plutôt indélicat, ou, si elle était au courant de leur brouille, relevant de la flagornerie. On ne comprend guère, non plus, le jugement qu’elle porte sur la célébrité de Ferré, avec une étonnante allusion à un titre d’Éluard, sinon par une espèce de rancœur : Marie-Josèphe est alors oubliée, Ferré au contraire a connu le succès. Il n’y aurait guère d’intérêt à citer cette lettre, si l’on n’en pouvait tirer un enseignement. La poétesse a connu Ferré enregistrant chez Odéon. Il est aujourd’hui chez Barclay. Son ressentiment est révélateur d’une réaction alors fréquente : en changeant de maison de disques, Ferré se serait compromis. Ce que produit Barclay serait plus commercial, les disques de Ferré seraient moins bons qu’autrefois… C’est très amusant car, lorsque Léo Ferré quittera Barclay, il se trouvera beaucoup de gens pour regretter – et aujourd’hui encore – ce catalogue, supposé indépassable. C’est un autre sujet.
Pour ne pas conclure
À l’histoire telle que je l’avais reconstituée en son temps, sont donc venus s’ajouter la Lettre à l’ami d’occasion et tous les documents aujourd’hui disponibles. La Lettre à l’ami d’occasion reste un exercice de style : jamais envoyée, incorporée au recueil inachevé des Lettres non postées, elle est un texte de Ferré avant tout. Son ton est radicalement différent de la correspondance réellement échangée avec Breton. Parmi les passages de ce texte qu’éclaire désormais le fonds d’archives, on trouve : « Je ne vous avais jamais lu, parole d’honnête homme, je ne l’ai guère fait depuis à quelques pages près. Les compliments qu’il m’a été donné de vous faire à propos de ces quelques pages étaient sincères, je le souligne ». Ces phrases sont sans nul doute à rapprocher de l’allusion faite à Arcane 17 dans la lettre du 6 février 1956.
Il manque évidemment, à ce jour, les lettres adressées par Breton à Léo Ferré. Elles permettraient que l’éclairage soit complet et ne s’exerce pas d’un seul côté. Lorsqu’on disposera de ces pièces indispensables, il faudra revoir ces réflexions pour les compléter à nouveau.
Cette aventure s’avère de plus en plus complexe. Au-delà de l’aspect outrancier de la phrase de Breton (« En danger de mort, ne faites jamais paraître ce livre »), on commence à mieux comprendre. Breton n’aime pas le recueil Poète… vos papiers !, ce qui est son droit, et sa phrase est pour lui un conseil d’ami. Il veut éviter à Léo Ferré la publication de ce qui lui paraît un mauvais livre. Disons qu’il s’y prend mal : c’était mal connaître Ferré. Cette rupture signe finalement des différends littéraires plus profonds, si l’on en croit Goldfayn. Les deux hommes s’étaient déjà entretenus du vers libre et du vers classique. Avec le recul et sachant ce que Ferré écrira par la suite, on peut se dire que c’était un faux problème : Ferré voulait utiliser toutes les formes d’expression sans rien s’interdire, et son vers classique ne l’est pas toujours, notamment lorsqu’il mêle à la préciosité ou à la simple délicatesse le trivial, le scabreux ou l’humour. Les apocopes qu’on a critiquées (lettre d’Adrien Dax), lui en use et s’en moque puisqu’il admet d’écrire avec ou sans, éventuellement dans le même texte.
Je pense que l’erreur – je veux dire le raté de l’amitié – vient de la sensibilité de l’un et de l’autre. Breton ne peut pas admettre le manuscrit qu’on lui a fait lire et pour lequel on lui a demandé une préface. Ce recueil est trop contraire, dans sa forme, à ce qu’il défend depuis 1924 et le pire est qu’il vient d’un ami, reconnu et encensé dans une publication qu’il dirige. Maladroitement peut-être, il use d’une formule que Ferré ne comprend pas réellement parce qu’il se place sur le terrain affectif et que les prises de position « techniques » ne sont pas son fait. Léo Ferré transforme ce refus littéraire en peine personnelle. Je crois que c’est cela : un motif littéraire se mue en coup affectif et le désordre s’installe.
Remerciements : Patrick Dalmasso.
________
[1]. Jacques Layani, Les Chemins de Léo Ferré, Christian Pirot, 2005.
[2]. La maison de Normandie se trouve à Notre-Dame-des-Puys, près de Nonancourt, près de Verneuil. Les Ferré disent indifféremment « Nonancourt » ou « Verneuil » pour désigner l’endroit comme, plus tard, ils diront « Cahors » ou « Gourdon » pour désigner Saint-Clair, où se trouve le château de Perdrigal.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (32)
vendredi, 16 novembre 2007
Relâche
 Le taulier ferme son cabaret durant les quelques jours de vacances qu’il a l’impudeur de s’octroyer. La réouverture aura lieu dimanche 25 novembre à zéro heure, avec des spectacles nouveaux qu’il part rechercher dans la campagne lotoise, spectacles dont il espère vivement qu’ils intéresseront son fidèle public. Une coupe de champagne virtuelle sera offerte à chacun.
Le taulier ferme son cabaret durant les quelques jours de vacances qu’il a l’impudeur de s’octroyer. La réouverture aura lieu dimanche 25 novembre à zéro heure, avec des spectacles nouveaux qu’il part rechercher dans la campagne lotoise, spectacles dont il espère vivement qu’ils intéresseront son fidèle public. Une coupe de champagne virtuelle sera offerte à chacun.
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)
lundi, 12 novembre 2007
Léo Ferré acteur et musicien du cinéma : nouveaux éléments
Dans le livre Les Chemins de Léo Ferré, j’avais évoqué les quatre films courts auxquels il a participé par le commentaire, la musique. Voici quelques précisions complémentaires, tant il est vrai qu’un livre n’est jamais achevé, une quête toujours infinie, une vague renouvelée sans cesse à l’horizon documentaire.
Tout d’abord, un retour sur Paris-Taxis, et non Paris-Taxi comme je l’avais indiqué fautivement, le pluriel faisant bien partie du titre. Voici ce que j’écrivais dans mon livre.
Plus anciennement, Ferré écrivit quelques musiques de films courts, et c’est ce domaine qu’il faut explorer le mieux possible, car il est le moins connu. En tout état de cause, c’est sur lui que les tentatives de reconstitution documentaire, le plus souvent, achoppent. En ces années, une séance de cinéma ne se concevait pas sans première partie, laquelle comprenait des actualités, un dessin animé, l’annonce des prochains spectacles et un documentaire ou un court-métrage, dit aussi « petit film ». Quand ne s’ajoutaient pas à tout cela quelques attractions, durant l’entracte !
Le premier de ces films est Paris-Taxi, court-métrage d’Édouard Logereau, en 1949, dont la chanson, interprétée par Zizi Jeanmaire, fut enregistrée, longtemps plus tard, dans Zizi Paris, un 25-cm Philips assez rare [1] ; curieusement, aucun autre interprète ne l’a inscrite à son répertoire ; le titre du film était très exact, puisqu’on y montrait quelques aspects de la vie à Paris, d’après des scènes vécues par des chauffeurs de taxi ; la chanson, traitée en une très jolie valse, est bien dans la manière de Léo Ferré, puisqu’elle se rattache finalement à l’esprit des Amants de Paris, des Forains et de L’Île Saint-Louis. On peut en juger par ces quelques extraits : « Les beaux taxis / Font la cour à Paris / À la nuit / Mais les amants / Font l’amour à Suresnes / Je t’aimais tant / Sur les bords de la Seine / Qu’il n’est plus temps / De finir ma rengaine (...) / Mais à Paris / On s’aime davantage (...) / L’amour ça n’a pas de prix / Ça se fait sans bagages / Combien d’amoureux / Ont usé leur tendresse / Oublié leur adresse / Dans les taxis (...) / Qu’importe où vont les taxis / Puisqu’ils vont où l’on s’aime... »
On peut ajouter à présent que le commentaire est de Pierre Dac et que Léo Ferré a signé la chanson, mais aussi la musique qu’on peut entendre tout au long du film, musique hélas couverte par la voix du commentateur, toujours haut perchée ainsi qu’il était d’usage dans ces courts-métrages un peu parodiques, au rythme accéléré, dont on produira de nombreux exemplaires jusqu’à l’arrivée de la Nouvelle vague, ou à peu près. Cette partition, a priori, s’apparente à Musique byzantine. La chanson est interprétée par Jacqueline François – il y eut donc deux interprètes et non une seule comme je le croyais – qui ne chante que deux couplets : le premier disparaît. Zizi Jeanmaire, elle, ne chantait pas le dernier. Cette valse, finalement, ne fut donnée intégralement que par Ferré lui-même, lors de son récital au Vieux-Colombier, en janvier 1961.
Voici ce que j’écrivais encore.
Le second, Au temps du cinématographe, autre court-métrage, de Pierre Céris cette fois, date de 1950. À ce jour, malheureusement, il n’a pas été possible d’apprendre quoi que ce soit concernant cette réalisation, mais les recherches se poursuivent.
Il s’agit finalement d’une évocation du cinématographe débutant, faite avec les caractéristiques ci-dessus énoncées : choix du burlesque, commentaire dit d’une voix haut perchée, musique un peu « écrasée » par le texte. On note que celui-ci fut établi par Paul Guimard et dit par André Var. Le générique mentionne : « Accompagnement musical de Léo Ferré ». Cet accompagnement est fait au piano et l’on y entend notamment quelques mesures de Paris-Canaille (alors que la chanson n’était pas encore écrite) et de Martha la mule. La seconde partie est soutenue par une partition orchestrale, mais elle ne paraît guère relever de Ferré, tout au moins dans les conditions d’écoute possibles.
Remerciements : Daniel Dalla Guarda et Donatella Nebbiai.
___________________________
[1]. Zizi Paris, 33-tours, 25-cm, Philips, B 76523 R.
00:00 Publié dans Études | Lien permanent | Commentaires (16)
samedi, 10 novembre 2007
Un an d’échanges
Ce blog a donc aujourd’hui un an et, pour l’occasion, il s’orne d’une nouvelle bannière due aux soins de Patrick Dalmasso.
Je ne sais pas ce qu’il faut dresser comme bilan de cette année d’activité et d’échanges. Le faut-il seulement ? Je pensais, en ouvrant ce lieu, que davantage de participants accepteraient de m’aider à le faire vivre, afin qu’il ne devienne pas le blog du taulier mais celui de tous ; afin, surtout, pour conserver le maximum d’authenticité aux textes, de ne pas sacrifier à l’obligation de publier, ce que je n’ai encore jamais fait.
Je ne sais pas si le niveau espéré a bien été atteint, si le cap d’exigence a été maintenu. Chacun appréciera.
Merci, une fois encore, à ceux qui m’ont donné des notes… et merci d’avance à ceux qui voudront en rédiger à l’avenir. Merci enfin à ceux qui ont bien voulu participer aux discussions.
Amicalement à tous.
(photo Alain Bontemps)
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (9)
jeudi, 01 novembre 2007
Aspects de la recherche universitaire, II
Il y a peu, a paru chez Textuel un coffret de deux livres, Aragon et la chanson, travail dû à Nathalie Piégay-Gros, maître de conférences à l’université Paris 7 – Denis-Diderot. Le premier tome, La Romance inachevée, situe l’œuvre entière d’Aragon sous l’éclairage particulier de la mise en musique, certes, mais aussi de l’intérêt de l’auteur pour la chanson et de tout ce qui a pu inciter les compositeurs à écrire des musiques pour ses poèmes. Le second volet, Poèmes manuscrits mis en chansons, présente donc les manuscrits du poète qui ont été chantés. Pas tous, certes, mais un choix intéressant, avec le détail des coupes et autres « montages » effectués pour parvenir au texte des chansons.
Comme on l’imagine, plusieurs pages de cet ouvrage sont consacrées à Léo Ferré. On n’y apprend rien de vraiment nouveau mais au moins, rien n’est faux à part la date, stupide, annoncée en légende de la reproduction du 25-cm original : 1957 au lieu de 1961. Cette erreur ne se produit pas dans le texte : elle n’est pas imputable à l’auteur, mais aux services éditoriaux. L’auteur connaît le sujet (en d’autres temps, cette remarque aurait paru stupide mais, aujourd’hui, elle n’est pas superflue). Toutefois, les éditeurs n’ont encore pas compris, semble-t-il, que les universitaires et les journalistes – qui signent la plus grande partie de l’actuelle production imprimée – ne sont pas des écrivains, en tout cas pas nécessairement. La prose de Nathalie Piégay-Gros est correcte, c’était bien le moins, mais lourde en de nombreux endroits et les redondances sont légion. Passons. Si l’on n’apprend rien de neuf, que nous apporte cet ouvrage sur Aragon et Ferré, puisque c’est évidemment cette partie du sujet qui nous intéresse ici ?
Tout d’abord, il confirme l’existence d’une lettre envoyée par Léo Ferré à Aragon le 23 juin 1970, après le décès d’Elsa Triolet qu’il a appris avec retard. Il confirme également qu’il y eut une autre lettre, datée du 29 mars 1975, proposant à Aragon une nouvelle série de mises en musique. À ma connaissance, cette dernière information n’avait été donnée que par Jacques Vassal, dans son livre de 2003. Ici, la source est officielle, puisque la lettre est incluse dans le fonds Aragon déposé à la Bibliothèque Nationale de France. Il confirme enfin l’existence de trois chansons d’Aragon totalement inédites : L’Encor, Une fille au bord du Xenil et Gazel au fond de la nuit, tirées du recueil Le Fou d’Elsa. L’auteur dit tenir ces informations directement de Mathieu Ferré.
Enfin, Nathalie Piégay-Gros estime que les relations entre les deux hommes étaient ambivalentes : « Les relations qu’Aragon a entretenues avec les artistes qui l’ont chanté ont été parfois marquées par l’ambivalence (c’est sûrement le cas avec Ferré) » écrit-elle, page 22. On veut bien l’admettre mais elle ne donne aucune raison à cela, du moins immédiatement. Il faut attendre la page 79 pour lire ces lignes où elle évoque « les réserves du Parti communiste, sans doute partagé entre l’effet de popularité que Ferré apporte à celui qui est le poète officiel, le grand chantre, l’icône du Parti… et l’anarchie du chanteur. Le succès des chansons de Ferré (et tout particulièrement celui de L’Affiche rouge) est tel que la perception que l’on a de lui est amenée à changer : alors qu’il est mal vu des communistes, comme le rappelle Pierre Hulin – au point qu’il n’y ait pas une fête de l’Humanité sans qu’un membre du Parti vienne couper ou baisser la sono qui diffuse, par exemple, Jolie môme – il est toléré, voire admiré, lorsqu’il popularise Aragon ».
Elle ajoute : « Les relations entre les deux hommes étaient ambivalentes pour une autre raison : quelle que soit la reconnaissance qu’Aragon a toujours manifestée envers les chanteurs, il lui arrivait de se sentir dépossédé de certains de ses textes par leur travail. Les chansons médicores peuvent être redoutables, parce qu’elles trahissent le poème et l’affaiblissent en le plombant ou, au contraire, en le délestant d’une gravité qui lui est essentielle. Mais les chansons merveilleuses, talentueuses font accéder la poésie à une autre dimension, par laquelle, en un sens, elle échappe à son auteur. Et cela, d’autant plus que Ferré se pensait et se voulait poète : la rivalité entre les deux hommes recoupe celle de la poésie et de la chanson, où se mêlent la fascination et la méfiance, l’attirance et la suspicion. Quoi qu’il en soit, Ferré semble avoir conservé une grande tendresse pour Aragon, certes toujours mâtinée chez lui d’insolence, mais sincère sans aucun doute ».
L’attitude des communistes envers Léo Ferré n’est peut-être pas aussi simple que l’expose Nathalie Piégay-Gros. Il a participé à des ventes du Comité national des écrivains (CNE), a eu les honneurs des Lettres françaises à plusieurs reprises : il est vrai que tout cela se faisait sous la houlette d’Aragon. Il a participé à des fêtes de l’Humanité, a invité Georges Marchais à lui rendre visite chez lui (il n’y est pas allé), a connu Jack Ralite, maire d’Aubervilliers qui fut ministre communiste au début du septennat de Mitterrand. En 1982, à la cérémonie funèbre d’Aragon, place du Colonel-Fabien, j’ai entendu les mélodies de Ferré parfaitement audibles à côté de celles de Ferrat…
Le deuxième volume est construit d’une manière constante. Il présente le titre original du poème d’Aragon ; la source bibliographique ; le nom de quelques interprètes ; le manuscrit lorsqu’il existe (manuscrit de travail ou mise au net) ; le texte imprimé avec les repentirs indiqués entre crochets et où figurent, en rouge, les passages effectivement chantés, en noir, ceux qui ont été coupés par le compositeur ; enfin, une glose, plus ou moins longue, de Nathalie Piégay-Gros, intéressante et documentée. Il ne s’agit pas de génétique des textes à proprement parler, mais d’une présentation détaillée, montrant le cheminement du poète dans son écriture d’une part, du compositeur dans la construction de la chanson d’autre part. Là encore, qui a lu les livres d’Aragon a forcément vu les différences mais, pour qui ne connaît pas les parutions originales, il y a matière à connaissance nouvelle.
Les chansons présentées sont au nombre de trente-deux (sur quelques deux-cents poèmes d’Aragon mis en musique). S’agissant de Léo Ferré, six sont retenues : Est-ce ainsi que les hommes vivent ?, L’Étrangère, Je chante pour passer le temps, Elsa, Il n’aurait fallu et L’Affiche rouge. On observe que, quel que soit le propos, ces titres sont les plus systématiquement cités, retenus, examinés, interprétés, étudiés. C’est bien dommage pour Blues et Je t’aime tant, par exemple, mais c’est subjectif.
On regrettera seulement la présentation « gadget » de cet ouvrage. Il y a deux tomes alors qu’un seul aurait suffi, avec deux parties bien distinctes. L’avantage des deux volumes est pour l’éditeur uniquement : il autorise un coffret. Or, la présentation sous coffret est très à la mode, en ce qui concerne les DVD, les disques ou les livres. Dans la perspective de Noël, les magasins en regorgent. D’où celui-ci, élégant quoique sans imagination aucune et parfaitement inutile. On se demande encore pourquoi les titres de chapitres ou de sections ont été imprimés verticalement, seule et stupide fantaisie typographique, entièrement gratuite. Ce qui est une façon de parler pour un coffret vendu cinquante euros.
00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (16)
mardi, 30 octobre 2007
« Cent vingt-et-un moins moi » (Léo Ferré, Mon programme, 1969), par Francis Delval
Je remercie Francis Delval qui a bien voulu descendre une nouvelle fois dans l’arène avec un sujet important : il nous propose un texte sur Léo Ferré, la guerre d’Algérie et le célèbre Manifeste des 121.
Été 1960. Léo Ferré reçoit la visite d’Aube, la fille d’André Breton. Elle lui apporte un texte, un manifeste défendant le droit à l’insoumission des militaires en Algérie, texte qui sera connu sous le nom de Manifeste des 121, lui demandant s’il accepte de signer ce texte. Léo Ferré refuse. Les historiens Hamon et Rotman [1] auront une formule lapidaire et sans appel : « L’anar Léo Ferré se défile ».
Cette note a pour but d’essayer de comprendre le sens du refus de Ferré de figurer parmi les signataires : ils seront 121, puis très vite, 140, 180, 220 et plus…
Que penser, avec le recul, des arguments que Ferré avance pour ne pas signer ? C’était son droit, nul n’est tenu à s’engager s’il ne le désire pas... Cette décision a-t-elle modifié, infléchi son rapport en tant qu’artiste à la politique, ou est-ce une péripétie sans conséquence relevant de l’anecdote ? Nous devrons aussi tenter de comprendre certains propos tenus sur les signataires et qui, même avec le recul et le regard froid sont totalement inacceptables ; d’autant plus qu’en 1987, dans un échange avec L.- J. Calvet, il les reprendra sans changer un iota, vingt-sept ans après…
1) Chronologie abrégée de l’année 1960
- 5 janvier : Le Monde publie le rapport de la Croix-Rouge sur la torture en Algérie.
- 20 février : début des arrestations dans le réseau mis en place par le philosophe Francis Jeanson, réseau des « porteurs de valises », ces Français qui aident le FLN en transportant armes ou argent.
- 15 avril : conférence de presse clandestine de Jeanson à Paris.
- 25 avril : arrestation de Georges Arnaud. Publication du livre Le Déserteur de Maurienne, pseudo de l’instituteur et officier déserteur Jean-Louis Hurst.
- 10 mai : arrestation de Laurence Bataille, fille de Georges et belle-fille de Lacan.
- 17 juin : procès de Georges Arnaud [2].
- 29 juin : S. de Beauvoir et G. Halimi révèlent « l’affaire Djamila Boupacha », jeune Algérienne torturée et violée par les paras.
- 5 septembre : ouverture du procès du réseau Jeanson, sans Jeanson qui n’a pu être arrêté.
- 6 septembre : publication dans le magazine Vérité-liberté d’un manifeste, signé de 121 intellectuels. Les journaux sont saisis dans la nuit.
- 3 octobre : manifestation de la droite. Le slogan le plus courant est : « Fusillez Sartre ».
- 9 octobre : manifeste de deux-cents intellectuels de droite pour la défense de « l’Algérie française ».
- 27 octobre : meeting FEN-UNE, et pétition pour la paix en Algérie.
2) Qu’est-ce que le Manifeste dit « des 121 » ?
Face à la répression et aux vagues d’arrestation dans le réseau des porteurs de valises, et envers les déserteurs, face à la banalisation de la torture, quelques intellectuels liés aux éditions Gallimard décident d’agir à leur manière. Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Claude Lanzmann lancent un large appel aux intellectuels pour défendre le « droit à l’insoumission ». Blanchot rédige le texte, revu par Mascolo. Le texte n’appelle nullement à l’insoumission : il la défend comme un « droit ». Droit relevant de la conscience de chacun face aux exactions de l’armée. Le texte de trois pages demande donc de respecter le droit de chacun à aider s’il le désire le peuple algérien, et ainsi de contribuer à en finir enfin avec le système colonial.
Le texte est suivi de 121 signatures, qui dépasseront très vite les 220 et plus… Écrivains et philosophes en nombre (Sartre, Beauvoir, Leiris, Breton, Limbour, Tzara, Guy Debord, presque tout le nouveau roman, Butor, Simon, Sarraute, Duras, Robbe-Grillet, Schwarzbart, J.-L. Bory…), peintres (Pignon, Lapoujade, Reyberolle), musiciens (Boulez, Leibovitz), historiens (Vernant, Vidal-Naquet), cinéastes (Truffaut, Resnais), un grand nombre d’acteurs (Terzieff, Cuny, Roger Blin, S. Signoret). Parmi les amis de Ferré, on retrouvera Ch. Estienne, M. Joyeux et Catherine Sauvage, la seule artiste du monde de la variété à avoir signé !
Très vite, les sanctions tombent : universitaires radiés ou suspendus, spectacles arrêtés pour cause d’interdiction de travail frappant les acteurs, interdits de scènes ou de plateaux (Terzieff sera plusieurs années sans pouvoir travailler), C. Sauvage interdite d’antenne pendant deux ans, d’autres seront agressés, matraqués, plus tard l’appartement de Sartre sera plastiqué par l’OAS, en représailles.
De plus, depuis le 6, la provocation à l’insoumission peut être punie de trois ans de prison ! Face à cette pluie de sanctions, de nombreux intellectuels progressistes étrangers se solidariseront avec les « 121 et plus » : Fellini, Moravia, Sean O’Casey, Heinrich Böll, N. Mailer… Il y aura un « manifeste de soutien » des intellectuels américains.
3) Le contre-manifeste et la pétition FEN-UNEF
Le 3 octobre, les « patriotes » descendent dans la rue ; les vitres de L’Express explosent. L’association des écrivains combattants, dont Aragon vient de démissionner, est au premier rang. Un contre-manifeste sort le 9 dans Carrefour, signé de plus de deux-cents intellectuels de droite, unis derrière le maréchal Juin : Dorgelès, Jules Romains, M. de Saint-Pierre et tous les hussards, Déon, Blondin, Nimier, J. Laurent, groupés autour de Fraigneau...
27 octobre : meeting de la FEN et nouvelle pétition, avec le mot d’ordre « Paix en Algérie », manifeste moins connu où l’on retrouve les signatures des intellectuels que les historiens accusent ordinairement de ne pas avoir signé le 6 : E. Morin, C. Lefort, Merleau-Ponty mais aussi Barthes, Étiemble, Escarpit, Prévert, Jean Rouch, etc. Pétition dont François Maspéro dira qu’elle n’a servi qu’à apaiser les consciences de ceux qui avaient refusé de soutenir le droit à l’insoumission... Session de rattrapage, en quelque sorte...
4) Léo Ferré et le Manifeste
Et l’Algérie est-c’que tu crois que je la porte
Autrement qu’à Sakiet sur un tombeau sans risque
(Écoute-moi, version 1962) [3]
Quelles positions sont les siennes ? Pourquoi ce refus de signer ? Comment comprendre les propos qu’il a tenus ?
Il faut repartir de la lettre de ses dires, notamment des extraits d’entretiens compilés par Q. Dupont dans Vous savez qui je suis, maintenant ?, La Mémoire et la mer, 2003, et de quelques autres sources.
Comme la plupart des Français, il se dit « concerné », il suit les événements de près. Quant au Manifeste, il en trouve l’idée « généreuse », mais pour lui signer ne suffit pas : qui est d’accord pour aider le FLN doit aller sur le terrain, et il salue et respecte le travail de Jeanson et des porteurs de valises. Il est, quant au fond, en accord avec Malraux disant à sa fille Florence, signataire : « Va te faire tuer dans les djebels, mais ne pétitionne jamais ».
C’est le premier argument : si je suis convaincu, alors je vais sur le terrain.
Deuxième argument : « Je fais un métier public »… et je sais bien que si je signe, je ne pourrai plus faire mon métier de chanteur ; plus de radio, plus de télé, Ferré chanteur, ce sera terminé. Je veux continuer, donc je ne signe pas.
Troisième argument : « Une pétition d’intellectuels, c’est prétentieux, on signe parce qu’on a un nom connu » et, dit-il, il aurait fallu « trois millions de signatures, il fallait faire signer les ouvriers de chez Renault ». On peut parler ici d’un aveuglement de Ferré ; outre qu’une pétition de ce type n’eût pas été discrète, Renault est encore une citadelle du PCF et de la CGT. Or, la politique anticoloniale du PC n’est plus celle d’avant-guerre. Le PC est plus nationaliste : participation de nombreux FTP au massacre de Sétif en 1945 (cinquante mille Algériens nationalistes tirés à vue, car assimilés aux fascistes), soutien à la répression de la rébellion malgache de 1947, vote en 1956 des « pouvoirs spéciaux » au gouvernement Mollet... Sa politique anti-coloniale est loin derrière… De plus, de nombreux militants ont quitté le Parti après l’invasion de la Hongrie. Il n’y aura que neuf membres du PC à signer le Manifeste…
Jusqu’ici, rien de bien convaincant dans l’argumentaire de Ferré. Le plus irrecevable est le propos tenu à maintes reprises, encore en 1987 avec L.-J. Calvet : « Les signataires étaient des planqués, dans leurs bureaux, leurs cafés, ils ne risquaient rien ». Or, il ne pouvait ignorer que la plupart l’avaient payé très cher, et ce n’est pas très sympa pour ses amis Ch. Estienne, M. Joyeux ou C. Sauvage !
Calvet suggère dans son livre « expéditif » de 2003 que « Madeleine lui a fortement recommandé de ne pas signer pour ne pas nuire à sa carrière ». Ce qui, en soi, n’est pas un argument : était-il tenu en laisse ? Si l’influence de Madeleine est plus que probable, il pouvait passer outre… Il avait son libre-arbitre [4].
Cela dit,on peut penser qu’il y a eu, au-delà de cette mauvaise foi du discours maintes fois ressassé, une prise de conscience de Léo Ferré. Il ne signe pas, mais il saute le pas d’une autre manière : il va s’engager davantage en tant qu’artiste et prendre parti tout en faisant son métier,mais autrement.
Ferré a chanté dans les années 50 des chansons satiriques, sociales, mais la politique est peu présente : Mon Général n’est pas très agressif, Monsieur Tout-Blanc très allusif, La Vie moderne amusante… Le registre va changer à partir de 1961. Ses chansons prennent une dimension nouvelle. Les Temps difficiles, fin 1961, dénonceront en public la torture en Algérie (il aurait à cette époque commencé à rassembler des documents sur la torture en Algérie et tenu un journal – à vérifier)… Puis il y aura La Gueuse, Miss Guéguerre, Y en a marre, Sans façons (manifeste anti-gaulliste), Franco-la-Muerte, Pacific blues, La Révolution, Ils ont voté… Plus tard Le Conditionnel de variétés, Words… words… words…, Le Tango Nicaragua ou la dédicace de Thank you Satan à Bobby Sands, soutien explicite à la lutte de l’IRA… Et bien d’autres textes, on ne peut tout citer.
Soyons clair : jusqu’en 1968, Ferré est quasiment le seul chanteur à intervenir politiquement en France. Une nouvelle séquence s’ouvre, de 1968 à 1977 environ, où d’autres chanteurs interviendront, en général sur des positions antiparlementaristes. Ferré n’est plus le seul : il y aura F. Béranger, Kerguiduff (bien oublié !), Glenmor et surtout Gilles Servat et Colette Magny. Ils chantent les grèves ouvrières, les luttes paysannes, le soutien aux Bretons, aux Basques, aux Irlandais, aux militants du Black Power. Quand nous réécoutons, la violence des textes nous surprend.On réenregistre les chants de la Commune (Mouloudji, Solleville). Mais cette séquence ne durera pas dix ans. Ferré, lui continuera jusqu’au bout. Enregistrant L’Europe s’ennuyait dans son dernier disque, retour aux sources, hommage aux premiers résistants.
Le refus de signer le Manifeste, malgré la mauvaise foi répétée des arguments, semble (ce n’est qu’une hypothèse) avoir pu servir de déclencheur à un engagement politique jamais inféodé à un parti ou à un syndicat. On pourrait reprendre le terme d’Alain Jouffroy : « individualisme révolutionnaire ».
À chacun de juger selon ses convictions, les éléments sont sous les yeux du lecteur.
Terminons sur une citation de Maurice Joyeux, à qui on posait la question : « Pourquoi avez-vous signé ? » et qui répondit : « [ce manifeste]… cri de révolte contre l’impuissance à mettre fin à la guerre d’Algérie, il est, que ses auteurs le veuillent on non, d’essence anarchiste, et c’est alors moi qui retourne la question : pourquoi n’avez-vous pas signé le Manifeste des 121 ? » (Le Monde libertaire, n° 64, novembre 1960).
_________________
[1]. Bibliographie : Hamon et Rotman, Les Porteurs de valises, Seuil, 1982 ; Droz et Lever, Histoire de la guerre d’Algérie, Seuil, 1982. Deux films à voir : La Bataille d’Alger de Pontecorvo ; Avoir vingt ans dans les Aurès de R. Vautier. De nombreux sites internet existent sur le Manifeste. Un seul donne, outre le texte de Blanchot, la liste complète des signataires et et le texte du manifeste américain ; taper dans Google : « Manifeste des 121. Tinhinane ».
[2]. Georges Arnaud, l’auteur du Salaire de la peur (que Ferré connaît : c’est par lui qu’il aurait rencontré Madeleine) est accusé de non-dénonciation de conférence de presse clandestine à Paris. Défendu par J. Vergès, il aura un fort comité de soutien, réuni autour de Kessel et Armand Gatti. Une pétition de deux-cents journalistes défendant le secret professionnel fera reculer le gouvernement. Il aura deux ans de prison avec sursis et ira vivre en Algérie jusqu’en 1970.
[3]. Sakiet : village tunisien bombardé en 1958, alors que la Tunisie est indépendante depuis 1956.
[4]. L. Ferré, Vous savez qui je suis maintenant ?, notamment pp. 199-200.
[5]. L.-J. Calvet, Léo Ferré, Flammarion, 2003.
N. B. : F. Jeanson sera amnistié en 1967 et Malraux le nommera directeur de la Maison de la Culture de Châlon-sur-Saône.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (192)
jeudi, 25 octobre 2007
Une leçon de ferrémuche, II
Le premier cours de ferrémuche se fondait essentiellement sur la chronique Je donnerais dix jours de ma vie. Pour cette seconde leçon, on utilisera Mes enfants perdus contenu dans la plaquette Mon programme, auto-éditée fin 1968 et datée 1969 sur la couverture. Ce texte a une particularité : il est composé à la première personne du singulier et le narrateur, Ferré lui-même, cède brusquement la place à la narratrice : Pépée. On ne s’étonnera pas que Pépée parle ferrémuche.
Elle s’adresse à Léo Ferré : « Allez, Léo, file-moi un toscan, que je m’enliane un peu la fesse à mézigue ». Ça, c’est de l’argot simple : le toscan est un cigare, Pépée en fumait quelquefois. Quant à l’usage qu’elle veut ici en faire, il se comprend sans difficulté. Un peu plus loin, on peut lire : « Moi, quand le poutachou a oublié le toscamuche à la cagna, eh bien je ne fume que des Celtiques ». La traduction est facile : « Moi, quand Léo a oublié les cigares à la maison, je ne fume que des Celtiques ». Un aspect du ferrémuche concerne les noms propres et sobriquets. Ainsi, Léo Ferré avait été surnommé « Pouta » par la fille de Madeleine, lorsqu’elle était enfant. « Pouta » devint « Poutachou », sans doute par adjonction du vocable « chou » considéré comme un mot tendre. Par extension, la famille entière devint « les Poutachoux », avec la marque du pluriel en X. Un diminutif naquit aussi à l’intention du poète, « Poutachounet ». Cela ne dépasserait pas la sphère intime que cela ne nous concernerait pas. Mais « les Poutachoux » se trouve dans le texte et, par conséquent, intègre de droit le ferrémuche : « Ils ont pleuré les poutachoux, quand vous êtes passé de l’autre côté », déclare encore Pépée à André Breton, évoquant son décès. Ici, « le poutachou » ou « les poutachoux » perdent leur capitale, comme on l’a observé dans le cours précédent.
Pépée continue, quelques pages plus loin avec de l’argot courant : « régulière » pour « épouse », « belle-doche » pour « belle-mère », « charrette » pour « landau ». Puis elle use de l’adjectif comme Ferré l’affectionne : « la buanderie saint-sulpesque » (pour « saint-sulpicienne », naturellement). Et soudain, il y a changement de narrateur, sans prévenir : ce n’est plus Pépée qui parle mais, de nouveau, Léo Ferré. Curieux texte, parfaitement incohérent du point de vue de la narration, très émouvant, authentique.
Pépée, intelligente et rusée, comme on le sait, fut un temps surnommée Ysengrine, nom du renard, ici féminisé. Elle fut aussi dite « Pichtagrune » et, par un diminutif, « Pichtagrunette », mais je ne connais pas exactement l’origine de ce nom et me demande – sans en être sûr du tout – s’il a un rapport avec le « pichetegorne », nom donné au vin.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (24)
lundi, 22 octobre 2007
Une leçon de ferrémuche
On a dit ici plusieurs fois que la langue de Léo Ferré était celle de tous les registres : langage châtié, langage parlé, préciosité, argot « commun », argot personnel, incidentes en langues étrangères, poésie classique mêlée de prose et de vers libres… En bref, il revendique toutes les cordes de l’instrument. Ce n’est pas fondamentalement nouveau. Ce qui l’est davantage, c’est que ces registres sont très souvent mêlés dans un seul et même texte – et cela est intéressant car là, l’outil est neuf et affûté.
Parlons aujourd’hui de l’argot personnel, dit aussi « ferrémuche ». De quoi est-il constitué ? Entre autres, d’une forme cédant au langage parlé en de nombreux endroits. Cela paraît relever de Céline qui, on le sait toutefois, travaillait énormément ses effets « parlés ». En réalité, ce n’est pas la même chose. Cette forme de langage apparemment bâclée – apparemment seulement – est déjà dans la correspondance de Verlaine, particulièrement celle échangée avec Delahaye. Pot-pourri de prose relâchée, de mots d’esprit, d’associations d’idées, de complicité avec le correspondant – ici, le lecteur – d’allusions, de tournures anglaises…
Ferré écrit dans Je donnerais dix jours de ma vie, qu’il publie dans la revue La Rue, n° 1, mai 1968 : « J’ai commandé deux wagons-lits pour toumoronaïte… ». Ne cherchez pas « toumoronaïte» dans un atlas. Ce n’est pas un lieu dans l’espace, mais un lieu dans le temps : tomorrow night. Demain soir. Ferré poursuit : « Pas vrai, papa Étiemble ? » René Étiemble qu’il admirait et dont le Parlez-vous franglais ? [1] plut très certainement à l’auteur de la chanson La Langue française. On ne se moque que de ceux qu’on aime. Il ajoute : « Celui-là, j’aimerais bien lui serrer la pince un de ces quatre… »
Certes, si « toumoronaïte » avait été un nom de lieu, il eût appelé un T majuscule. Mais précisément, le ferrémuche se joue parfois des capitales obligatoires, comme s’il voulait réduire à un nom commun ce qui est un nom propre. Cet affranchissement de règles simples et communément admises est une caractéristique de cet argot personnel, qui comprend un jeu constant avec les mots.
« Dégueulasse » devient « dégueultarte », ce qui est peu courant dans l’argot usuel (tout en ne perdant pas de vue que l’argot évolue sans cesse). Plus classique, « elle est émue » se métamorphose en « elle chavire du battant » – le battant étant naturellement le cœur, à ceci près qu’on le nomme habituellement « palpitant ». Toujours classique, « pacsons » pour « paquets ». Plus nouveau, la métaphore ferréenne se glissant dans le ferrémuche : le chemin de la ferme, dans les bois de Perdrigal, est qualifié de « golgotha chimpanzifié ». L’image, c’est le Golgotha (sans majuscule) parce qu’il s’agit d’une épreuve, à la fois parce que le chemin est dur et parce qu’il mène aux chimpanzés dont il faut prendre soin. Le ferrémuche, c’est le néologisme en forme d’adjectif : « chimpanzifié ». Arracher les tuiles devient « détuiler ».
Si Ferré use de l’anglais, il ne se prive pas, au contraire, de franciser certains mots. Ainsi, son chien Madame est un « coquère ». À l’opposé, il écrit quelques lignes plus loin : « Je retourne at home (…) On mange purée d’pois and saucisses ». On trouve ici une expression anglaise, une apocope et un mot anglais. Cette forme curieuse est suivie de « C’est fou, la cuistance », c’est-à-dire une expression familière et un mot d’argot commun. Deux lignes plus loin, un mot italien, morbidezza.
Plus loin, « coinstot » pour « coin » est un mot d’argot courant mais, quelques lignes après, on retrouve la disparition des capitales usuelles : « blédine », « butagaz »… et, de plus, « butagaz » devient « butachose ». « Dans le coco », « partir en couillosof » sont des tournures aisément compréhensibles. Plus curieux, le « nestelé », évidemment sans majuscule, est la transformation en nom commun d’un nom propre, plus précisément d’une marque : le lait Nestlé, bien sûr. Survient la mise en mot d’un sigle (je ne crois pas qu’on ait déjà parlé d’acronyme, à l’époque) : oèretéèfe pour ORTF, l’Office de radio-télévision française. Transformation d’un nom propre en périphrase : Pépée devient « mademoiselle Ferré-Chimp’s ». Les informations deviennent les « informes », ce qui n’est pas extraordinaire mais l’amusant est que le mot est écrit entre guillemets, comme s’il s’agissait pour l’auteur de s’excuser pour une simple abréviation, alors que tout le texte est empli de libertés prises avec la langue, la grammaire et la syntaxe.
Zaza garde sa capitale et, quatre lignes plus loin, la perd en devenant « la zazounette ». « Dans la voiture » se mue en « in the char », soit deux mots anglais et un québécisme. « Barbiturique » devient « barbicontu ». « Au matin » se transforme en un anglicisme… phonétiquement francisé : « to morninge ». Le chargeur de batterie est qualifié de « biduloscop » (heureusement, le contexte permet de comprendre) et l’EDF devient un sigle en bas de casse : edf. Brusquement, toutes les majuscules des noms propres disparaissent : « La sibérie, zaza, la lame de bise, pépée frissonnante ».
L’imprimerie installée dans la ferme de Baradesque est nommée « ma carrée d’imprime », ce qui est classique : « carrée » pour « chambre » est connu, comme sont connues, un peu après, les tournures : « une petite lichette de rouquin » pour « un petit verre de vin rouge », « sèche au bec » pour « cigarette aux lèvres », « un chouya de mou aux minets » pour « un peu de mou aux chats ».
S’agissant d’imprimerie, il faut évidemment comprendre « je m’en balance le garamond » comme « je m’en tape le coquillard », « je m’en fiche ». Quant à « la cafetière est sur la table », il faut se souvenir que ce n’est nullement du ferrémuche, mais le titre d’un pamphlet de Pierre de Boisdeffre contre le nouveau roman [2]. Mais ici, la phrase est à comprendre stricto sensu, Léo Ferré ayant tout préparé la veille afin de reprendre le lendemain son travail d’imprimeur après son petit déjeuner. C’était son roman Benoît Misère qu’il comptait initialement publier lui-même.
Un jeu de mots en forme d’allitération se profile dans le récit : « l’Austin est à l’hosteau » (il s’agit évidemment d’une voiture en réparation). Encore un sigle devenu acronyme mais là, Ferré n’invente rien, Citroën l’avait voulu ainsi : « ma déesse » pour « ma DS », bien entendu. Un néologisme : « si je m’enverglasse », du verbe imaginé « s’enverglasser », qui se comprend très aisément.
Encore une mise en mot d’un sigle : « céèneèreèsse » pour CNRS. On note que, comme dans le cas, déjà cité, de l’ORTF, cette transcription orthographique est toujours, dans le contexte, ironique. Comme, s’agissant d’Étiemble, l’expression « ses sorbonnes etecétéra », la Sorbonne perdant sa capitale et se retrouvant au pluriel, lequel pluriel paraît ne pas être suffisant puisqu’il est augmenté d’un et caetera revu et corrigé.
Pompidou devient Pompadouche (pompe à douche, naturellement) et Ferré ajoute : « et ça s’explique… et ça te le met dans le baba en extrême profondeur et comme s’il te rentrait un berlingot extra dans ton thème astrologique », ce qui se comprend parfaitement ; cela dit, le « thème astrologique » pour le « fondement » est amusant. On retrouvera plus tard, dans la chanson À mon enterrement, cette acception particulière : « Des cartes perforées me perforant le thème ».
Le sujet n’est pas du tout épuisé. Il y aura d’autres leçons de ferrémuche, ultérieurement.
____________________________
[1]. René Étiemble, Parlez-vous franglais ?, Gallimard, 1964.
[2]. Pierre de Boisdeffre, La cafetière est sur la table ou Contre le « nouveau roman », collection « Les Brûlots », n° 4, La Table Ronde, 1967.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (17)
lundi, 15 octobre 2007
La blessure et la source
L’amour du sexe féminin a été chanté par Léo Ferré en de multiples occasions, de Cette blessure à Ta source avec, naturellement, Alma Matrix qui est un long texte sur le sujet. Il a dit aussi combien la menstruation le fascinait.
Ta source est une chanson qui présente immédiatement l’imaginaire ferréen – « Elle naît tout en bas d’un lieu géométrique / À la sentir couler je me crois à la mer / Parmi les poissons fous c’est comme une musique / C’est le printemps et c’est l’automne et c’est l’hiver » – par le choix des mots : géométrique, couler, mer, fous, musique, litanie des saisons… avec reprise de la litanie interrompue au quatrain suivant : « L’été ses fleurs mouillées au rythme de l’extase », qui n’est pas sans rappeler la structure interrompue de la chanson On s’aimera, où l’été, par une brisure de la construction, est traité différemment des autres saisons.
Il y a, dans le courant du texte de Ta source, un changement de direction dans le propos. La chanson commence par la désignation d’une « source », disons : non définie ; au troisième quatrain, le propos s’élargit, s’étend aux « sources » en général, avec, encore, une allusion aux règles. Les quatrième, cinquième et sixième quatrains, eux, constituent une adresse à une femme en particulier. En particulier… bien qu’elle soit inconnue : il s’agit d’une personne faisant partie du public de l’artiste, une femme qui pose un jour, sur le plateau de son électrophone, un disque – le chanteur ne le sait pas – et se retrouve séduite par sa voix. Cette séduction intellectuelle conduit cependant à l’amour charnel clairement décrit, le texte s’achevant sur un hexamètre célébrant les caresses buccales et l’amour de Ferré pour la cyprine. On voit qu’en six quatrains, le poème a dit plusieurs choses, comme souvent chez l’auteur.
Cette blessure, évocation de la même partie du corps, tenait un propos plus régulier : on y évoquait simultanément l’amour physique et la naissance de la vie, d’une manière indissociable. Inéluctablement, la chanson s’achevait sur la présence de la mort, célébrant l’extase et scellant ainsi, comme toujours chez les poètes lyriques, le couple amour-mort – avec, toutefois, un ultime octosyllabe : « Cette blessure dont je meurs » qui, ambigu, peut être compris de plusieurs manières : « dont je meurs d’envie », « dans laquelle je meurs » (extase) et « dans laquelle je meurs » (parce que j’en suis né et que la vie et la mort, c’est pareil).
La dimension métaphysique de Cette blessure n’est pas présente dans Ta source où les allusions à la musique, par contre, ont leur place entière, comme si, au fil du temps, elle avait su remplacer l’inquiétude.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (19)
mercredi, 10 octobre 2007
Chez le disquaire
Les trois camarades dont, souvent, il a été question ici, regardaient régulièrement la vitrine du disquaire Raphaël, sur la Canebière. Un disquaire disparu depuis longtemps déjà, comme la quasi-totalité de cette profession. On n’allait pas acheter un disque, on allait chez Raphaël comme, pour faire l’acquisition d’un livre, on allait chez Flammarion (ou chez Tacussel, ou chez Maupetit, ou chez Laffitte, mais surtout chez Flammarion), juste un peu plus haut sur l’avenue. Des mythes.
Le magasin Raphaël – un temple de trois niveaux – employait entre autres personnes une jolie fille dont on a « oublié le visage et la voix » comme dit la chanson, et cette charmante personne se trouvait « sortir avec » un ami des trois camarades. Lesquels, dans leur candeur juvénile, ne firent ni une ni deux et s’en allèrent, quelque jour, chez le dit Raphaël prier la jeune femme de leur faire écouter un disque de Léo Ferré.
L’époque était aux cabines d’écoute individuelles à portes battantes de bois clair. La vendeuse disposait le disque sur une table de lecture située où ? et on l’écoutait, sans gêner personne, dans la cabine, avec un matériel d’une qualité évidemment bien supérieure à celle des tourne-disques des parents. Ils se tinrent à trois dans l’étroit logement, tandis que la chanson s’élevait. De quel disque s’agissait-il ? Oublié, comme le reste. Mais l’adorable les avait prévenus : elle ne pouvait pas faire durer l’audition au-delà de quelques instants. Pas question de demander le disque complet. Ce furent des instants pris, comme ça, au vol, par les trois jeunes gens.
Est-il possible aux jeunes d’aujourd’hui de comprendre cela ? En un temps où l’on achète des « intégrales », comment faire admettre que les disques étaient précieux parce que chers, qu’on n’en possédait pas beaucoup et qu’une chanson ainsi écoutée, c’était formidable ?
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (6)
lundi, 08 octobre 2007
Chanter Baudelaire
On sait que Léo Ferré posait le volume de vers sur son piano et cherchait. Si cela ne marchait pas très vite, il tournait la page et passait à un autre poème. C’est lui-même qui, à plusieurs reprises, a expliqué ainsi (en substance) sa manière de composer sur les textes des poètes. Dans la note Des musiques pour Verlaine, j’avais fait quelques observations sur l’origine des poèmes retenus, recueil par recueil. Dans le cas de Baudelaire, si l’on exclut L’Étranger, seule pièce du Spleen de Paris à avoir été chantée, tous les autres titres proviennent des Fleurs du mal, et pour cause. On ne peut donc tirer d’enseignement du choix de tel ou tel livre : il n’en existe qu’un.
Pourtant, quelques remarques peuvent être formulées, dont je ne suis pas sûr qu’elles aient une signification.
Au total, si je ne me suis pas trompé, Léo Ferré a mis en musique, au fil des années, cinquante-six poèmes extraits des Fleurs (je compte ici, bien sûr, la livraison de 1957, celle de 1967, les titres épars dans le disque de 1986 et les vingt maquettes de travail dont on ne connaît que les douze que Murat vient d’enregistrer). Sauf erreur, le recueil comprend cent cinquante-cinq poésies. C’est dire que Ferré a mis en musique plus du tiers du livre, ce qui est considérable. Il ne s’agit pas, toutefois, de calculer des pourcentages mais de rapprocher ces chiffres de ce qu’il disait de sa méthode de travail. Car au vrai, la table des matières des Fleurs, si l’on vient y cocher les poèmes mis en chansons, met en lumière quelques évidences. Un certain nombre de titres sont isolés, mais de grands pans se détachent. Ainsi, on s’aperçoit que :
Le Guignon et La Vie antérieure se suivent.
« Avec ses vêtements… », Le Serpent qui danse et Une charogne se suivent.
Harmonie du soir et Le Flacon se suivent.
Ciel brouillé et Le Chat se suivent.
À une Malabaraise, Bien loin d’ici, Moesta et errabunda et Le Revenant se suivent.
Les Hiboux, La Pipe, La Musique et Sépulture se suivent.
L’Examen de minuit et L’Héautontimorouménos se suivent.
Le Soleil et À une mendiante rousse se suivent.
Recueillement et À une passante se suivent.
« Je n’ai pas oublié… », « La servante au grand cœur… » et Brumes et pluies se suivent.
Ces « ensembles » sont de deux à quatre titres. Comme on le sait, il reste encore une huitaine de poèmes dans les maquettes de Léo Ferré et peut-être cela modifiera-t-il encore ces relevés de titres.
Cela implique-t-il que Ferré, qui pouvait « tourner la page » quand la musique ne lui venait pas, parvenait quelquefois, a contrario, à mettre en musique plusieurs textes consécutifs, peut-être dans un élan d’inspiration et de travail ? Mais ces mises en musique n’ont pas été faites au même moment. Alors ? On observe cependant que Ciel brouillé et Le Chat figurent dans la même livraison ; À une Malabaraise et Moesta et errabunda également ; Les Hiboux et La Pipe aussi ; Recueillement et À une passante encore. Ou bien, justement, revenait-il parfois, feuilletant le volume, à des endroits déjà chantés et, à ce moment-là, tournait-il la page dans un sens ou dans l’autre et trouvait-il une musique pour le poème précédent ou suivant ?
Peut-on déduire quelque chose de tout cela ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (88)
mercredi, 03 octobre 2007
De la durée comme sens
Les récitals de Léo Ferré ont toujours été parmi les plus longs. Dans les années 80, ils le seront davantage encore et s’établiront à trois heures (le spectacle de 1984 au Théâtre des Champs-Élysées, par exemple), parfois un peu moins : deux heures et demie (le spectacle Léo Ferré chante les poètes au TLP-Déjazet, en 1986). Il en ira ainsi jusqu’au bout.
Existe-t-il une signification particulière à cette durée très rare – au moins dans ce qu’il est convenu d’appeler « variétés » ? Dans ces années, Ferré n’est plus contesté, il chante dans un silence complet et une attention soutenue. Puis le public l’applaudit debout, à la fin du récital. Progressivement, il va même être applaudi debout dès son entrée en scène (par exemple, au TLP-Déjazet en 1990, entre autres). C’est dire qu’il dispose, pour chanter, du meilleur accueil et d’un public qui est a priori dans d’excellentes dispositions.
À ce moment de sa vie, il n’a vraisemblablement rien à craindre, artistiquement parlant. Il pourrait aussi bien ne se produire qu’une heure et demie, comme le font la plupart des chanteurs. Il chante deux fois plus longtemps. Pour le spectacle consacré aux poètes, il aurait pu chanter une demi-heure de plus, ne serait-ce que parce que son répertoire comprenait encore beaucoup de poèmes mis en musique, qui n’ont pas été retenus pour ce programme : il se limite cette fois-là à deux heures et demie, ce qui est de toute manière exceptionnel.
Cet allongement de la durée des spectacles se produit, paradoxalement, dans ces années où il chante le plus et où il parcourt, même si ce n’est pas lui qui conduit, le plus de kilomètres. Autant de raisons qui pourraient l’amener à chanter moins longtemps. Il n’en est rien. Sa résistance physique est un moyen, un outil, mais elle n’est pas une réponse à la question que je me pose : quelle est le sens de cette importante durée, ce à quoi rien ne l’obligeait ? Existe-t-il une réponse d’ordre artistique ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 01 octobre 2007
Aznavour
On sait que Léo Ferré débuta au cabaret Le Bœuf sur le toit, fin novembre 1946, en même temps que Charles Aznavour qui se produisait alors en duo : le tandem Roche-Aznavour. La tournée en Martinique, qui eut lieu en 1947, fut refusée par Aznavour et Ferré l’accepta.
En 1967, dans le Jean-Roger Caussimon qu’il rédige pour les éditions Seghers, Ferré traite Aznavour de la façon suivante : « Ne voit-on pas le « poète » Aznavour, perclus de dollars et « d’engagements » haut le pied, tel une locomotive lancée sur les rails de l’indifférence générale ? Chaque époque a le poète qu’elle mérite : parolier subtil, musicien « à l'écoute » qui touche plus de droits d’auteur que Debussy, et que Ravel, et que Stravinsky, Hugo du tout-venant qui a mis l’octosyllabe dans l’escalier de France-Dimanche en précisant qu’il revient tout de suite ». Il ajoute une longue note : « Je tiens à préciser que mon propos est ici de Poésie et de chanson d’Aujourd'hui. Ce n’est pas en tant que confrère que je parle d’Aznavour mais en tant qu’introducteur à Caussimon. Une élégance tacite, d’ordinaire, nous interdit, à nous autres les artistes de « variétés », de parler de l’un ou de l’autre et souvent l’on nous fait dire ce que nous n’avons jamais dit. Le cas d’Aznavour est assez significatif pourtant, il se met d’ailleurs lui-même assez en vedette pour qu’il n’ait pas à s’offusquer de se voir au « pinacle » une fois de plus, sans que j’aie à prendre plus de précautions oratoires qu’il ne convient. Si ses activités « littéraires et musicales » me paraissent en défaut, son talent « commercial », par contre, est sans égal et je n’apprendrai rien ni à lui, ni à quiconque dans ce sens. Cependant, comme on l’a intitulé, lui aussi, « Poète d’Aujourd’hui », il m’eût paru malhonnête de ne pas aller au bout de mon sujet et de prendre un chemin de traverse. La critique de hasard est ainsi faite qu’elle n’admet pas les règles de « fair play » que certains critiques de métier admettent eux, parfois, pour des raisons extra-professionnelles. Qu’Aznavour se rassure ! J’ai autant de mésestime pour ce qu’il écrit que j’en ai pour ce qu’écrit un autre « Poète d’Aujourd’hui », qui s’est plu à se sanctifier lui-même sous le nom de Saint-John Perse, ancien diplomate et Prix Nobel de Littérature. C’est dire que je laisse Aznavour en bonne compagnie. C’est ce que ne manqueront pas de lui faire savoir bon nombre de « littéraires » en renom. Bien entendu, je prends l’entière responsabilité de tout cela et Pierre Seghers, promoteur de cette brillante collection, serait en droit de me demander « d’alléger » ma pensée... mais je sais qu’il ne le fera pas et l’en remercie » [1]. La charge est très dure. Elle ne me gêne pas, car je tiens Aznavour pour ce qui se fait de pire : prétention abominable, thèmes empreints de démagogie dégoulinante (La Mamma, La Bohême, Comme ils disent...), « effets » appuyés, interprétation qui « en fait des tonnes », prosaïsme, musique inexistante…
En 1969, lorsque Ferré chante durant vingt jours à partir du vendredi 3 octobre au cabaret parisien Don Camilo, 10, rue des Saint-Pères (Littré 65-80 ou 71-61) dans un dîner-spectacle, Gainsbourg, qui habite à quelques mètres, vient le voir souvent, mais il n’est pas le seul. Aznavour se rend le samedi 4 au Don Camilo et les journalistes photographient les deux hommes dans l’escalier, comme on peut le voir ci-dessous.

Leur rencontre paraît plutôt cordiale. En tout cas, Paris-Jour des 11 et 12 octobre 1969 en fait l’unique illustration de l’article consacré à Ferré (ci-dessous).

Le samedi 29 avril 1978, Aznavour, à qui TF 1 consacre un Numéro un, invite Ferré à l’accompagner au piano dans son émission, tandis que lui-même chante La Chambre. Léo Ferré accepte. L’extrait correspondant a été ajouté récemment aux archives de l’INA. Souriants, les deux hommes s’embrassent ensuite. On pensera ce qu’on voudra de cette interprétation du poème de Baer par Aznavour. Il reste que les rapports entre les deux hommes sont très étonnants.
Le jeudi 22 mars 1990, Ferré fait un séjour de très courte durée à Paris pour un spectacle privé, destiné à RTL. Une soirée exceptionnelle qui se déroule en présence, entre autres, d’Aznavour.

Publiquement au moins, Aznavour n’a jamais dit que du bien de Léo Ferré, à ma connaissance. Il s’est toujours montré bon camarade, je le reconnais volontiers. Ferré, lui, semble être revenu sur son opinion, en tout cas être à même de dissocier l’auteur Aznavour et l’individu.
___________________________
[1]. Léo Ferré, Jean-Roger Caussimon, collection « Poètes d’aujourd'hui », n° 161, Seghers, 1967.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (13)
vendredi, 28 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 3/3
« L’âge d’or »
Tout au long des années 80 et au tout-début des années 90, Léo Ferré se produisit dans de nombreuses villes situées à moins de cent kilomètres de Toulouse, permettant aux amateurs toulousains de suivre les différents jalons de cet « âge d’or » de l’artiste : le 6 août 1981 à Castres ; le 23 novembre 1985 à Montauban ; le 7 octobre 1986 à la Halle de la Verrerie de Carmaux pour le récital Les poètes ; successivement les 29 et 30 septembre 1988 à Foix et Albi ; le 18 mai 1989 à Auch et le 10 novembre suivant à Moissac pour la fête de la poésie; enfin, les 7 et 9 mai 1992 encore une fois au théâtre de Montauban pour le festival Alors chante. Aucun de ces spectacles ne donna lieu à quelque incident que ce soit et chaque fois, devant des salles pleines, le chanteur remporta de très grands succès. Pendant la même période, on le revit à trois reprises sur des scènes toulousaines.
Chapiteau à Colomiers, 29 septembre 1982
Les articles qui annoncèrent la venue de Léo Ferré aux portes de Toulouse ne firent pas spécialement dans la sobriété et en voulant fuir la banalité, ils n’évitèrent pas toujours la boursouflure : [Léo Ferré] « semble être né de nulle part, d’un mélange alchimique du soleil d’hier et de la nuit de demain. Humble comme un bidonville, écorché comme un abattoir, il ouvre sur le monde les yeux plissés de celui qui s’est usé la vue à regarder, à comprendre. Ses gros mots vont aux épousailles du grand souffle de la poésie… »
Difficile d’évaluer le nombre de spectateurs ayant pris place sous ce chapiteau plein à craquer et que l’on aurait pu croire soulevé par les bravos qui accueillirent l’artiste si au dehors le vent d’autan ne gonflait pas la toile. Très tôt Léo Ferré s’en prit à cet orage qui chahutait le voilier, et demanda au public de pousser à l’unisson un grand coup de gueule pour protester contre les éléments… L’ambiance était à la connivence, mais l’écoute fut intense quand le chanteur déclina selon sa fantaisie, les trente-cinq chansons de son répertoire de cette soirée : Vitrines – Les 400 coups - Thank you Satan – Vingt ans – Y en a marre – Chanson mécanisée – Monsieur Barclay – L’Âge d’or - C’est extra – Les Anarchistes – Madame la Misère – Le Printemps des poètes – Le Chien – La Folie - La Solitude / L’Invitation au voyage – Avec le temps – Préface –Allende – À vendre – Les Celtiques – Géométriquement tien – Words words words – Frères humains / L’amour n’a pas d’âge – La Mort des amants – L’Adieu - La Vie d’artiste – La Mélancolie – Ils ont voté – Cette blessure – Ta source – De toutes les couleurs – En faisant l’amour – Un jean’s ou deux – T’as d’beaux yeux tu sais – Les Poètes de sept ans.

Colomiers, 29 septembre 1982 – D. R.
La Dépêche du Midi du 30 septembre 1982.
Léo « Le Lion ». Hier soir, à Colomiers, le poète était seul. Sans orchestre, avec « sa lucidité » et ses chansons.
Un chapiteau sur une tranche de bitume, au cœur d’une ville frileuse et ouverte aux fantasmes. Et cette pluie qui tombe comme une voix houleuse. Vieux fascisme, défaitisme… Hier soir, à Colomiers, le vieux lion n’a pas pu s’empêcher de rugir contre cet orage qu’il n’avait pas voulu.
Il cogne, il frappe, il cingle, il fonce, il chante…. C’est Léo Ferré, soixante-six ans, traînant ses lambeaux de rêves et gardant « sa lucidité dans son froc ». Il n’a plus d’âge et son public non plus. Sous la tente, ils étaient nombreux venus l’écouter : des anars, des amoureux du lyrisme extasié, des fidèles de la voix faite de soufre et de sang, les branchés de la symphonie rose et noire qui se balance comme du Verlaine, et ceux qui n’ont pas oublié ce mot de Léo : I am un immense provocateur.
Tous ont été gâtés. Ferré seul avec son piano et sa bande magnétique (hélas !) leur a tout servi : des bouffées de violence, des couplets fous de vie et d’humour, des imprécations tout d’un souffle, des chansons murmures et des chansons cris, des chansons qui portent l’élan spontané, les tensions sourdes de la vie, des chansons qui s’ouvrent sur un monde en révolte, un monde sans raison.
Léo sait bien qu’on ne plante plus son vieux drapeau noir sur les barricades, mais il continue de prendre son mal en impatience, et sa vieille carcasse vibre autant avec ses tripes qu’avec sa tête. Vingt ans, Avec le temps, La Solitude, C’est extra… Il ne manquait rien à cet étincelant spectacle. Mais quand la voix fauve et ocre s’est éteinte sous les projecteurs, la pluie était toujours là, tapie dans la nuit.
[non signé].
Halle aux Grains de Toulouse, 29 mai 1985
Revoilà donc Léo Ferré à la Halle aux Grains à Toulouse, six ans jour pour jour après le récital quasi insurrectionnel de 1979. Ce retour se fit apparemment sans tambour ni trompette et un seul article annonça le récital prévu le soir même.
La Dépêche du Midi du 29 mai 1985.
Aujourd’hui à 20 heures 30 à la Halle aux Grains Léo Ferré.
Il fait encore quelques apparitions de temps à autre. De moins en moins : retranché dans sa campagne d’Italie, le vieux maître n’éprouve plus le besoin de paraître, occupé qu’il est de jongler avec les mots, les doubles-croches et les silences, poursuivant une œuvre sans pareille.
Depuis combien d’années maintenant ses mots brûlants comme une lave jaillissent-ils de l’obscurité ? Depuis combien d’années cet homme rongé de solitude est-il le copain, le frangin de notre multitude ? Depuis combien d’années cette fraternité fragile qu’il délivre nous réchauffe-t-elle les jours de pluie ?
Non, Ferré n’a pas changé, il ne changera jamais : il est un torrent de mots sur des flots de musique, il est un homme debout qui ne fait que passer, il est un sourire un peu pâle, lointain, vacillant comme son regard. Une voix surtout.
Ferré l’amour, Ferré la mort, qui chante la folie et les cœurs piétinés, les années disparues et le goût furtif du bonheur, l’injustice et le silence, l’absurdité de toute chose.
Aujourd’hui, Ferré qui voudrait que « tout s’arrête là du temps compté des hommes », nous revient avec la neige de ses cheveux qui accroche la lumière, la grimace d’un sourire comme une blessure, sous le ciel blanc des projecteurs.
Une escale dans la poursuite de l’errance incertaine de « monsieur le poète qui semble venir d’ailleurs ».
[non signé].

Halle aux Grains à Toulouse, 29 mai 1985 – D. R.
Aucun compte rendu de presse n’a décrit cette soirée qui méritait pourtant d’être évoquée, tant le triomphe fut grand dans une Halle aux Grains bondée et ployant sous le charme. Finis les incidents d’avant spectacle pour forcer les portes ou pour revendiquer sur des sujets pour lesquels le chanteur ne détenait pas spécialement la solution.
Il est vraisemblable qu’avant ce spectacle, Léo Ferré avait rencontré des représentants de la mouvance libertaire, car aussitôt achevée l’interprétation de Frères humains, après avoir jeté un coup d’œil sur un tract, il dédia la Ballade des pendus de Villon « aux quatre militants antifascistes emprisonnés à Toulouse… », dédicace ponctuée du vers : « Mais priez Dieu que tous les veuille absoudre ».
Quant à son programme il était composé de cette large trentaine de chansons : La Vie d’artiste – Pauvre Rutebeuf – Graine d’ananar – Le jazz-band – T’es rock coco – Les Copains d’la neuille – Les Amoureux du Havre – La Solitude / L’Invitation au voyage – À celle qui était trop gaie – Mon camarade – La Vie moderne – Thank you Satan – L’Amour – Madame la Misère – Pépée – Marizibill – La Porte – Le Printemps des poètes – Le Chien – Ton style – Préface– Je te donne – Les Artistes – Tu penses à quoi – Allende – Words words words – Frères humains / L’amour n’a pas d’âge – Ta source – Un jean’s ou deux – Le Tango Nicaragua – T’as d’beaux yeux tu sais – Avec le temps.
Halle aux Grains de Toulouse, 12 janvier 1990
Sous l’intitulé « Léo, à certaines heures pâles de la nuit », le traditionnel article destiné à présenter l’artiste qui allait bientôt se produire à Toulouse aurait plutôt découragé le spectateur perplexe si Léo Ferré n’avait pas fait depuis longtemps ses preuves…
Vingt-cinq ans après son premier récital toulousain sur la scène de l’ancien marché aux grains transformé en Palais des Sports, revoilà le poète au même endroit, cette fois-ci devant une Halle aux Grains archicomble. Comme il le disait lui-même, il y a aussi des journalistes qui connaissent leur métier ; c’est vraiment le cas de Marie-Louise Roubaud.
La Dépêche du Midi du 13 janvier 1990.
En concert à la Halle aux Grains, Léo d’enfer.
Il a la passion mimétique. Ses révolutions, certes, ne sont pas de velours, elles ont le goût âcre des orages et du sang, et pourtant, qu’il vienne à chanter la tendresse et « que sont mes amis devenus » de Rutebeuf, et soudain s’installe sous les sunlights une fraternité à couper au couteau. Et la minute suivante qu’il se mette à tempêter et on le croirait vomi par les bouches d’enfer d’un volcan mal éteint. Celui de ses colères fumantes. Avec sa gueule de chimpanzé ou de trappiste triste d’avoir longtemps courbé l’échine sur le même sillon maigre – « en 1956, c’était pas facile de vivre, le téléphone ne sonnait pas, aujourd’hui, il sonne trop » – Léo Ferré reste conforme à son image de toujours. Mais il ne se fige pas. Qu’il se mette à danser un air de jazz-band et le rythme se met au pas et la salle à la mesure.
Cet ancêtre a tous les culots. Celui de nous chanter une messe des morts, un chant des trépassés qui nous ramène tous les vieux fantômes, Lorca, Allende et même Franco. On le croyait bien mort pourtant, celui-là. Et bien non, Ferré a la rancune tenace, et les amours aussi. Il ne faut pas croire que lorsqu’il tient une proie, il va la lâcher pour l’ombre. Alors, dans ses imprécations pas de pardon, mais dans ses amours pas d’oubli.
Son Bateau espagnol descend toujours la Garonne avec une Madone en figure de proue et Aragon et son Affiche rouge flamboient toujours au firmament. D’ailleurs, comme Aragon, Ferré chante pour « passer le temps petit qui lui reste à vivre ». Sans ostentation. Faisant fi de toutes les barrières, celles du temps, de l’âge, des modes, des convenances, Ferré joue les charmeurs de serpents qui sifflent sur sa tête, cette tête d’artiste maudit qui ressemble vingt ans après, au dessin qu’en fit un peintre qui était espagnol et qui s’appelait Carlos Pradal…
Dans toute sa gloire, face aux ovations qui bercent sa tête chenue et qui désaltèrent son cœur exigeant, ce frangin du malheur continue à faire de drôles d’invocations à « l’ange des plaisirs perdus »… Comment, dès lors, ne pas l’aimer comme il le mérite… À la folie.
Marie-Louise Roubaud.

Toulouse, 13 janvier 1990, Éditions Universelles.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (2)
mercredi, 26 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 2/3
« Les temps difficiles »
Retors, rétif, rebelle, tel apparut sans doute le public toulousain à Léo Ferré qui allait connaître localement d’amères déconvenues. En effet, malgré d’incontestables succès, les récitals à Toulouse des années 1969-1979 se sont déroulés à l’enseigne des « temps difficiles »…
Cinéma Le Royal de Toulouse, 15 décembre 1969
Nul besoin d’article avant-coureur pour annoncer ce récital organisé par le Centre culturel de Toulouse, réservé aux seuls adhérents, en principe un auditoire plutôt calme et conquis d’avance. Les salles de spectacles du centre culturel étant trop petites, Christian Schmidt, le directeur fondateur de cet institut, avait loué celle du Royal, un cinéma du centre ville pouvant accueillir un millier de spectateurs. En guise de commentaire à la note Contester Ferré, je me suis efforcé en juin dernier de raconter cette soirée houleuse contre toute attente, et dont Léo Ferré a partiellement fait les frais. En découvrant l’article de La Dépêche relatant ces faits, je me rends compte que ma mémoire m’a trahi à propos de la nouvelle tenue de scène de l’artiste dont j’ai inversé les teintes, en revanche, c’étaient bien plusieurs spectateurs qui avaient pris place sur la scène. Peu importe. Voici donc le point de vue à chaud de Marie-Louise Roubaud publié le surlendemain de cette soirée passionnée.

15 décembre 1969, photo La Dépêche, op. Esparbié.
La Dépêche du Midi du 17 décembre 1969.
Léo Ferré au Centre culturel : le fauteur de troubles…
On sait depuis toujours que là où il passe, Léo Ferré provoque le trouble. Ses pamphlets anarchistes n’écorchent pas que le langage et la bonne morale ; ils dérangent. Car le grand Ferré est un homme en colère qui se sert des mots comme d’autres se servent de grenades.
S’il y a aujourd’hui une poésie qui touche au vif la jeunesse révolutionnaire, c’est bien celle de cet homme de plus de cinquante ans. À la fois insolent et tendre, sincère et roué, irritant et attachant, Ferré est un de ces êtres excessifs qui sèment le vent et récoltent la tempête.
Adoré et haï, il aura connu lundi soir, au Royal, l’encens du triomphe et le vitriol des injures.
La rue d’Alsace embouteillée, des grilles défoncées n’étaient qu’un prélude. À l’intérieur, fauteuils et couloirs étaient pris d’assaut par un public secoué par la fièvre des combats.
Quand Léo Ferré apparaît aux couleurs de l’anarchie – pull noir et pantalon rouge – crinière romantique, ce public se retrouve uni pour lui faire une ovation.
Aux deux premiers rangs, les plus « enragés » de ses admirateurs de jeunes anarchistes venus faire un triomphe à celui qu’ils considèrent, à tort comme à raison, comme leur prophète.
À voix basse d’ailleurs, ils disent les vers qu’ils connaissent sur le bout du cœur pour y avoir trouvé l’écho de leur propre révolte.
Ils n’ont pas porté de drapeaux noirs comme leurs camarades parisiens à Saint-Denis, la semaine passée, mais ils ont tous des tenues qui sont autant de porte-drapeaux de l’anticonformisme.
Ils applaudissent et crient plus fort que les autres pendant que Ferré, seul en scène avec son pianiste aveugle, domine la salle de son inquiétante présence. Il est doué d’une puissance de destruction presque satanique, et d’une vulnérabilité désarmante.
Sa poésie torride, son visage terriblement mobile, qui se craquelle parfois comme ravagé par des peines anciennes, sa voix qui tremble et semble sourdre des entrailles, ses belles mains d’artiste qui implorent et menacent, créent un envoûtement et une magie.
Tout va se gâter dès qu’un jeune du premier rang monte sur scène. Il a une tête de saint-Jean-Baptiste, un chapeau de Chouan : il s’assied tranquillement et il écoute. Cinq minutes après, on voit surgir des coulisses un gorille blond, qui lui intime l’ordre de descendre et joint le geste à la parole.
Il y a eu des protestations dans la salle, un autre jeune bondit sur scène et redescend aussitôt. Léo Ferré, avec un visage de jugement dernier, crie dans le micro : « Je ne peux chanter que dans la solitude de la scène. Ici ce n’est pas un foutoir. » Et il enchaîne sur des couplets engagés.
Les uns applaudissent, les autres contestent. Le charme est rompu et va prendre l’allure d’un réglement de comptes. L’injure est dans l’air de part et d’autre, et quand Léo Ferré entonne Les Anarchistes, ceux du premier rang crient à la trahison, se lèvent en chœur le poing levé, en poussant un cri de guerre et de ralliement : « Anarchie ! »
Ils brûlent l’idole qu’ils ont adorée avec la même sauvagerie. Leur silence est un silence armé, leur hostilité ira crescendo. Leur erreur est d’avoir cru tout frontière abolie entre l’artiste et eux ; leur ressentiment est sans pitié.
L’erreur de Ferré, c’est d’avoir traité de haut un public qui n’était turbulent que par excès de passion et d’avoir contredit par un geste de répression sa légende d’« anar ».
Il s’arrêtera d’ailleurs de chanter pour lancer le mot de Cambronne et inviter ceux qui l’insultent à venir s’expliquer d’homme à homme sur scène.
Il finit son récital par un poème débridé : « Je suis un chien », tout empli de tumulte et de désespoir, et où il donne rendez-vous dans dix siècles aux nouvelles générations pour vivre dans un monde d’amour.
La salle est divisée une fois de plus. Ferré a séduit ses ennemis et déçu ses amis… Il n’y a pas de rappel. La polémique continue dans la loge de l’artiste.
« Ce n’est pas parce que je suis un anarchiste que je dois coucher avec tous les anarchistes à la petite semaine. Il y a vingt ans que je lutte. Bientôt je ne vais plus pouvoir chanter. Dans deux ans, au train où vont les choses, ils vont me demander de marcher sur l’eau. Il n’y a qu’un point sur lequel je triche, c’est que je suis persuadé que nous allons vers un monde effroyable et que je ne le dis pas, et que je chante quand même l’espoir. Je suis un chanteur, un point c’est tout, et pas une idole. On me demande : pourquoi ne chantez-vous pas dans la rue ? Je réponds : parce que c’est interdit. »
M.-L. Roubaud.
Théâtre du Capitole de Toulouse, 13 mai 1970
Sans doute pour estomper le souvenir de cette soirée particulièrement remuante, Léo Ferré était de retour à Toulouse, tout juste cinq mois plus tard, cette fois-ci devant un public non d’invités, mais ayant en majorité acquitté le prix de la place. Pour ce retour, la salle la plus prestigieuse de Toulouse lui ouvrait ses portes : le Capitole, théâtre à l’italienne de mille deux-cents fauteuils et temple du Bel Canto.
Profitant de la circonstance, les échotiers sortirent les superlatifs et parlèrent à son endroit de « poète terrible et virtuose de la scène » ou encore de « semeur de foudre à la présence magnétique ». Les photos communiquées par le service de presse Barclay montraient un Léo Ferré barbu et l’un des laudateurs se demandait si l’artiste ne revenait pas d’une saison en enfer, comme le laisse penser son visage torturé de « Christ des douleurs »…
Je n’ai pu assister à ce récital, tout comme aux deux suivants dont je parle ici. Toutefois, les échos qui me sont parvenus font état d’un Léo Ferré particulièrement las, résigné à laisser ceux qui n’étaient venus que pour le contester prendre le dessus. Le programme, centré sur les nouveaux titres d’Amour Anarchie en fut plutôt gâché.
Si je n’y étais pas, en revanche la journaliste Marie-Louise Roubaud, à son habitude, était tout à fait présente.
La Dépêche du Midi du 15 mai 1970.
Pour le récital Léo Ferré, la révolte avait changé de camp.
Pour Léo Ferré, Toulouse est toujours une étape mouvementée. Elle l’aura été cette fois, un peu plus que de coutume.
À neuf heures du soir, une trentaine de jeunes anarchistes – si du moins il faut en croire le drapeau noir qu’ils ont agité en fin de spectacle comme signe de ralliement – a envahi les galeries du théâtre du Capitole réclamant l’entrée libre et occupant « sauvagement » des lieux dont on ne songeait d’ailleurs pas à leur défendre l’accès.
Le procédé n’est pas nouveau. Les « fans » du Living Theatre le pratiquent couramment ; on est du moins assuré une fois qu’ils sont dans leur place de les voir respecter et le spectacle et les spectateurs.
La non-violence n’était malheureusement pas le fait des jeunes gens de l’autre soir, très soucieux de leur propre liberté mais pas de celle de leurs voisins. Employant des méthodes qu’ils récusent chez les autres, ils justifient le propos désabusé de Léo Ferré : « Les anarchistes de ce soir ? Mais ce sont des fascistes ! C’est clair comme de l’eau de Mao. »
Il est clair aussi que ce sont des gens qui se flattent, pour reprendre un mot d’Henry Miller, d’être différents mais qui ne sont que trop semblables à ceux qu’ils savent si bien condamner.
Ils n’auront, l’autre soir, convaincu personne de leur bon droit, sinon eux-mêmes. Il est vrai que pour eux l’autosatisfaction remplace l’autocritique, et que le chahut leur tient lieu de contestation. C’est se donner à bon compte des brevets de courage et de révolutionnaire, que de prêcher à coup d’injures la révolte à un public d’avance converti aux vertus de l’anticonformisme.
La majorité s’en tint donc au silence par la force des choses, du moins pendant le spectacle, et Léo Ferré, homme de fureur, n’a pas cette fois répondu aux provocations imbéciles, grossières et anonymes d’une minorité ayant visiblement mal digéré les doctrines de la Commune et des idéaux de l’anarchie.
Il est tout de même curieux que sur les vingt spectacles organisés à Toulouse, au Capitole et ailleurs, en cours de saison et qui sont tous régis sur les mêmes principes financiers, les anarchistes aient précisément choisi le récital de Léo Ferré pour contester. On comprendrait si une telle remise en question s’adressait à un spectacle de qualité médiocre, à un poète de peu d’envergure.
« Ferré n’est pas représentatif de notre mouvement », rétorquent les « anars ».
Ferré répond : « Je ne représente que moi-même et je n’ai jamais prétendu représenter un groupe. Il faudrait supprimer le « fric » et c’est utopique. Le premier État à placer son argent en Suisse s’appelle le Vatican, le second c’est la Chine gouvernementale.
Plus je vis, plus je suis convaincu de l’inutilité de l’expression artistique. L’art est une excroissance de la solitude. Le poète converse avec des ombres. Je crois que la poésie a fait plus pour l’humanité que toutes les autres sciences. La poésie c’est une séquelle divine. Je disais, tout à l’heure, la ségrégation c’est l’argent, non c’est l’intelligence. Mais les c… aujourd’hui, sont moins c… qu’avant. Il ne faut pas être trop intelligent pour vivre. »
Léo Ferré va publier à la rentrée, un roman : Benoît Misère, où il raconte l’histoire d’un petit garçon qui devra beaucoup, bien sûr, au collégien qu’il fut :
« J’avais le matricule 38. Je ne veux plus connaître le passé. Ce sont des souvenirs qui font froid au cœur. On ressemble assez peu à celui qu’on a été, on ne peut pas ressembler à celui qu’on sera demain… »
M.-L. Roubaud.
Palais des Sports de Toulouse, 29 octobre 1971
C’est en épluchant les archives de La Dépêche du Midi que je suis tombé sur ce récital dont je n’avais jamais entendu parler. Deux articles non signés étaient censés donner le ton de ce retour au Palais des Sports de Léo Ferré, accompagné par le groupe Zoo qui devait donner une « dimension apocalyptique » à la soirée. On était prévenu des possibles débordements, la présence seule de Léo Ferré suffisant à « engendrer des cataclysmes d’enthousiasme ou de contestation » car « il fait partie de ces êtres qui ont le redoutable privilège de n’avoir que des amis fanatiques… ou des ennemis tout aussi acharnés. » Également appelé en renfort, Maurice Frot annonçait la couleur : «Insurrectionnel le récital ! »
Le groupe Zoo, dont on nous assurait qu’il avait une réputation internationale, était au complet, avec le chanteur Ian Bellamy, Daniel Carlet aux violon et sax ténor, Michel Ripoche, également au violon mais aussi aux trombone et sax, André Hervé à l’orgue, au vibraphone, et à la guitare rythmique, Michel Hervé à la guitare basse, et Christian Devaux à la batterie.

Zoo, La Dépêche du Midi, 1971.
Comme on peut le lire sous la plume de Marie-Louise Roubaud, la soirée qui avait attiré la foule des grands soirs commença violemment à l’extérieur où « ceux qui n’avaient pas de quoi payer » revendiquaient la gratuité de l’entrée. Léo Ferré vint à leur secours en exigeant que les portes du Palais des Sports restent ouvertes toute la soirée. Visiblement, cela contribua à éviter un nouveau sabotage du spectacle.
La Dépêche du Midi du 1er novembre 1971.
Au Palais des Sports, Léo Ferré : « Un immense provocateur ».
Vingt-et-une heures, vendredi soir, le Palais des Sports est en effervescence, au-dedans comme au dehors.
Dedans, il y a déjà trois mille spectateurs assis, des jeunes en majorité écrasante. Dehors, c’est l’affrontement classique entre représentants de l’ordre et ceux qui veulent entrer sans bourse délier (15 francs, étudiants ; 20 francs, entrée générale).
Entre ces deux mondes bouillonnants d’une égale violence et tendresse, Léo Ferré, lèvres serrées, crinière ébouriffée, arpente la coulisse.
« J’en ai marre. Il y a des gens qui veulent me voir et n’ont pas d’argent. Moi, je veux les laisser rentrer, et on m’empêche. Et puis, ça me retombe sur la gueule… »
Il allume une cigarette, parlemente avec véhémence avec les organisateurs, et puis s’avance seul au dehors au milieu du dernier carré de ses fidèles qui s’est reformé après le départ de la police.
L’affaire est entendue. Les grilles s’ouvrent sans coup férir, et elles le resteront jusqu’à la fin du récital.
Les Zoo ont sur la scène précédé la vedette qui arrive un quart d’heure après, chemise noire et pantalon de couleur violet, suivi de son fidèle pianiste aveugle, Paul Castanier, habillé de noir comme à l’accoutumée, mais cette fois avec des cheveux aussi longs que ceux de Léo Ferré.
Dans la salle, l’élan est unanime pour saluer les deux hommes dont les rapports ne sont pas de toute évidence des rapports de convention…
« Je cherchais un bon pianiste qui soit de surcroît un homme intelligent avec qui je puisse parler… J’ai rencontré Paul Castanier, nous ne nous sommes plus quittés. »
Le troisième homme est dans les coulisses. C’est Maurice Frot, lui aussi connaît Ferré depuis quinze ans et lui est resté fidèle. Romancier (il a écrit en 1965 Le Roi des rats ; en 1969 Nibergue, qui a obtenu le prix du roman populiste ; il prépare un autre ouvrage : L’étouffe-chrétien ; il a, par amitié, pris la relève de Madeleine Ferré ! Il assure des fonctions qui vont de celles du régisseur à celles de scénariste.
Il vient d’écrire le scénario du film que Léo Ferré va tourner comme acteur avec Philippe Fourastié (le réalisateur de La Bande à Bonnot) et qui s’appellera Mon frère le chien, ma sœur la mort, sorte de transposition moderne de Saint-François d’Assise qui ne regarde plus voler les oiseaux… mais les « Boeing ». Le pianiste aveugle jouera son propre rôle.
En attendant c’est la tournée dans le sud de la France : Aix, Montpellier, Toulouse, Perpignan, avant la reprise des concerts à la Mutualité, à Paris, à 12 francs (du 22 au 25 novembre, du 12 au 16 décembre, avec les Zoo que Ferré semble avoir définitivement adoptés ainsi d’ailleurs que son pianiste et Maurice Frot, qui n’hésite pas à reconnaître combien le nouveau spectacle doit à « ces jeunes gens qui sont très bien et qui ont secoué nos vieilles habitudes ».
Le fait est que dans le nouveau spectacle qu’il rode en province, Léo Ferré sort grandi de sa confrontation avec la pop music et les jeunes générations.
Léo Ferré artiste cède aujourd’hui le pas à Léo Ferré tribun… Commencé sur L’Âge d’or, le récital s’achève sur un poème en prose de : « Je suis un chien » qui plonge l’assistance dans un état second… Chemin faisant, Léo Ferré s’est mis en colère, dominant le Palais des Sports plein de haut en bas de sa hargne et de sa grogne, de vétéran de la contestation… Il a chanté l’anarchie, l’amour fou, la solitude ; il a tourné en dérision les gouvernements et les étiquettes politiques, les bonnes manières et lui-même, est passé de la fraternité pathétique à un narcissisme impudique.
« Je suis un immense provocateur ». Il frôle et le sublime et l’odieux. Bref, il est lui-même, véritable archange satanique, défiant les règles. À cinquante ans passés, Léo Ferré retrouve le second souffle.
Il y a six ans, son nom déplaçait à Toulouse, tout juste un millier de personnes. Aujourd’hui chacun de ses récitals fait figure d’événement.
M.-L. Roubaud.
Palais des Sports de Toulouse, 9 février 1973

Léo Ferré + Charlebois, tournée 1973.
La presse locale annonçait à la même affiche, « deux monuments de la chanson, deux générations mais la même violence pour crier à la face du monde que seule la folie est raisonnable ». Il s’agissait d’une part de Léo Ferré, « vieux loup redevenu solitaire depuis plusieurs années et qui ne désarme plus », d’autre part de Robert Charlebois qui poursuit, lui aussi, une carrière explosive et « qui progresse en sabots dans la rocaille et les escarpements du folklore québécois. »
Pour ma part, je n’ai pas assisté à ce récital dont j’ai appris les écueils par la presse. Quelques années plus tard les hasards de la vie m’ont conduit à me lier d’amitié avec un des principaux protagonistes des incidents qui ont émaillé la première partie de cette soirée. Alors étudiant, Antoine était proche des groupes maoïstes surnommés les « mao spontex » par leurs voisins trotskistes. C’est donc sa version des faits qui a partiellement inspiré les lignes qui suivent. Cette version est parfois en contradiction avec celle donnée par Maurice Frot dans son livre de souvenirs Je n’suis pas Léo Ferré (Éd. Fil d’Ariane, 2002).
Le moins que l’on puisse dire c’est que la soirée allait être des plus chaotiques, commençant de façon presque banale par des échauffourées entre ceux qui exigeaient la gratuité du spectacle et la police. Ce qui est certain, c’est que beaucoup de militants d’extrême-gauche se trouvaient dans la salle quand Robert Charlebois débuta son tour de chant, et qu’au moins un détail fut perçu par certains comme une provocation : la présence en fond de scène du drapeau québécois largement déployé. Devant un public plutôt sensible aux thèses internationalistes, cet emblème fleurdelisé faisait un peu désordre. L’indifférence de Robert Charlebois aux rudiments de la sociologie française n’a pas non plus simplifié les choses. Les calembours ne marchent pas forcément partout de la même façon et sans doute a-t-il sous-estimé la politisation du public toulousain lorsqu’il a balancé en plaisantant qu’il était « marxiste tendance Groucho ». C’est cette boutade qui faisait simplement partie de son jeu de scène, qui a été le point de départ du « foutoir » qui s’est installé sur la scène du Palais des Sports. Esprit frondeur et rigolard, Antoine, dont la stature est réellement très éloignée de celle d’un lutteur de foire, aurait à ce moment-là bondi sur scène dans le but de s’emparer du micro pour reprendre le leitmotiv bien connu de « laissez entrer nos camarades ». La bourrade qu’il aurait donnée à Robert Charlebois qui tentait d’entraver cette dépossession du micro fit rouler celui-ci à terre, avant que la scène ne soit effectivement livrée à une grande pagaille, ainsi que le décrit Marie-Louise Roubaud dans deux chroniques reproduites ci-dessous. Là aussi cette relation s’écarte de celle de Maurice Frot, concernant l’attitude de Léo Ferré en coulisses qui en réalité aurait été plus lucide et décisif que ce qu’en a dit son ancien factotum. Quant à la quinzaine de titres que le poète chanta au cours de la seconde partie, les voici en respectant l’ordre de leur interprétation : Préface – Les Poètes – Ton style – À toi – Le Crachat – Vitrines – L’Oppression – Les Amants tristes - Avec le temps – Night and day - Comme à Ostende – Ne chantez pas la mort - La Solitude – Ni Dieu ni maître – Il n’y a plus rien.
La Dépêche du Midi du 11 février 1973.
Le Québécois Robert Charlebois a mordu la poussière du Palais des Sports où Léo Ferré a triomphé.
Soirée mouvementée vendredi au Palais des Sports de Toulouse, gorgé de monde et qui a débuté dès les portes ouvertes par l’affrontement classique des forces de l’ordre et des spectateurs désargentés exigeant le droit d’entrée et le prenant.
Pas de blessés, mais des vitres cassées et quelques sévères empoignades qui ont donné le ton de la violence et échauffé les esprits.
Tout semble se calmer lorsque Robert Charlebois et ses musiciens entament leur récital. C’est la première fois qu’on les entend et qu’on les voit, donc qu’on les juge. Leur réputation n’est plus à faire auprès des amateurs de « pop music ». Avec sa chevelure rousse et bouclée de jeune Papou, avec son accent québécois où le français prend une saveur terrienne, avec un folklore puissant et un peu fou qu’il a réinventé à sa propre mesure, et qui tient du rock et de la danse indienne, Robert Charlebois est une hyper-vedette en puissance. Hélas ! il a bien failli laisser son scalp à Toulouse au terme d’un véritable pugilat qui lui a fait mordre la poussière et s’affronter avec les spectateurs. Tout a commencé quand un militant est monté sur scène pour demander le micro, la parole et le droit d’entrée pour ses camarades d’infortune. Des cris de sympathie émanent des gradins pris du frisson des combats politiques, Robert Charlebois arbitre malgré lui du conflit est déconcerté, et puis se fâche rouge lorsque son partenaire impromptu lui jette le micro aux pieds. Le Québécois lève le poing et dans l’instant les spectateurs du premier rang montent en force sur scène, la salle hurle son mécontentement tandis que Charlebois est à terre.
Tout n’est que cris, tumulte et confusion.
L’incident est passé du registre cocasse au registre dramatique.
Charlebois reprend ses esprits et tente de renouer le récital. Mais le charme est rompu, le cœur n’y est plus de part et d’autre. Désormais le récital va prendre l’allure d’un réglement de comptes entre le spectateur anonyme revenu sur scène et les musiciens excédés qui vont quitter la scène en pliant bagages.
L’entracte ne coupe pas court à la contestation. Le micro est à qui veut le prendre. Tout semble aller à la dérive. Léo Ferré est dans les coulisses et attend son tour avec son visage de jugement dernier. Il avance sur scène où l’attend Popaul, son pianiste aveugle avec l’énergie rentrée des vieux capitaines au long cours. Il ne changera pas un iota à son tour de chant : quinze longues chansons dont cinq nouvelles au verbe délirant, au style pamphlétaire et qui placent le vieux lion Ferré au-dessus de la mêlée. La partie est gagnée. La jeunesse médusée écoute ce prophète terrible à cheveux blancs qui réduit en charpie toutes les institutions « Le désordre c’est l’ordre moins le pouvoir » et qui est de la même race qu’elle, avec l’étincelle du génie en plus.
M.-L. Roubaud.
La Dépêche du Midi du 12 février 1973.
À Robert Charlebois les risques du métier, à Léo Ferré les lauriers.
La soirée de vendredi, au Palais des Sports, aura bien sûr dépassé le cadre de l’événement artistique. Les incidents qui ont marqué la première partie où Robert Charlebois officiait, n’ont fait que confirmer l’emprise de Ferré sur un public déchaîné, qui a rendu les armes au talent et à plus contestataire que lui. Le prestige de Ferré avait pourtant été mis à mal il y a trois ans, pour les mêmes raisons qui ont motivé, l’autre soir, l’insuccès personnel de Robert Charlebois. Les rapports qui régissent le dialogue entre le public et les vedettes sont, à Toulouse plus qu’ailleurs, d’ordre passionnel. Le succès n’y est jamais garanti d’avance et pas un faux pas n’est pardonné. Dure leçon pour Charlebois, flamboyant Québécois et jeune idole à la tête fière descendu, pour un soir seulement, de son Olympe.
Pour Ferré, une ferveur accrue et qui est à la mesure de sa propre maturité. Depuis qu’il a déserté sa propriété de Saint-Clair, Ferré, rendu à ses démons, continue de se battre envers et contre tous, revêtu d’une invisible tunique de Némésis qui lui brûle la peau. « Ce qu’il y a de plus profond en nous c’est la peau… »
Ses textes sentent toujours la rue et son langage cru, mais ce n’est plus la même rue, ni tout à fait les mêmes générations qu’on y croise. Aussi ses derniers poèmes en prose sont-ils des tracts fleuve dont la violence frappe comme un boomerang. Et ce n’est pas par esprit d’opportunisme, mais bien parce que Ferré hume le vent de l’Histoire, qu’il vit son temps avec tous ses pores. Poète insurgé, il n’en faut pas douter, bête de scène aussi, Ferré avec son refus nouveau de fioritures et d’artifices un peu déclamatoires, Ferré le nihiliste, poing fermé ou poing levé continue de s’abreuver aux sources de la colère.
M.-L. Roubaud.
Halle aux Grains de Toulouse, 29 mai 1979
Lorsque Léo Ferré revient plus de six ans plus tard à Toulouse, l’appellation « Palais des Sports » s’est effacée depuis quelques mois seulement au profit de celle de « Halle aux Grains », mais il s’agit bien du même lieu, complètement restauré et réaménagé ainsi que mentionné plus haut. Au cours de ces six années, Léo Ferré a lui aussi changé. Désormais il est seul sur scène, avec son piano et ses bandes magnétiques, parfois un grand orchestre, mais ce n’est pas le cas ce soir-là. Sa notoriété de poète, de musicien, d’artiste lyrique, s’est considérablement accrue et dépasse les frontières de la francophonie, si bien que dans ces circonstances, la Halle aux Grains affichant « complet », on s’attend à une grande prestation. Pourtant, selon Robert Belleret dans Une vie d’artiste, dès la veille du récital Léo Ferré avait confié à son entourage qu’il redoutait « qu’il y ait de la merde à Toulouse », et effectivement, cette soirée-là releva une nouvelle fois de la rubrique des faits divers :
La Dépêche du Midi du 30 mai 1979.
Toulouse : bagarres pour le récital Léo Ferré. Plusieurs blessés place Dupuy.
Léo Ferré était, hier soir, à Toulouse. Ses fans voulaient le voir, et ce à tout prix, la Halle aux Grains n’est pas extensible et ceux qui voulaient payer, les resquilleurs aussi, étaient nombreux.
Les choses se sont finalement envenimées lorsque des énergumènes essayèrent de forcer les portes.
Les responsables du spectacle durent alerter Police secours, qui tenta de dégager les abords de la salle. Les manifestants lancèrent alors des pierres et des bouteilles sur les forces de l’ordre qui eurent plusieurs blessés. La police dut alors charger et les manifestants qui s’étaient réapprovisionnés en munitions sur des chantiers en construction voisins, revinrent en force.
La bagarre s’est soldée par de nouveaux blessés. Un des « fans » de la chanson a même dû être hospitalisé.
Il faut souligner que les spectacles de rock avaient déjà été l’objet de semblables « émeutes » et que de ce fait les organisateurs ont décidé de les supprimer dans la Ville « rose » !
[non signé].
Désormais on ne parlait plus d’anarchistes ou de militants d’extrême-gauche, mais plus prosaïquement de resquilleurs, qui ne réservaient plus leurs exigences aux seuls spectacles de Léo Ferré mais aussi aux festivals de rock…
Concernant cette soirée, on sait qu’un commerçant victime des casseurs a adressé directement à Léo Ferré la facture des réparations. Dans l’ironique fin de non-recevoir qu’il lui opposa, l’artiste qualifia les auteurs des dégâts de « jeunes prématurément vieillis »…
Pour ce qui est de ce qui s’est passé à l’intérieur de la Halle aux Grains ce soir-là, le compte-rendu qu’en donne La Dépêche du Midiest particulièrement fidèle. Il faut dire que la grande confusion qui régnait a bien failli tourner à un mouvement de foule en proie à la panique. D’une part, on entendait dans un vacarme assourdissant comme des coups de boutoirs donnés contre les portes mêlés aux sirènes des voitures de police, sans vraiment savoir de quoi il s’agissait. D’autre part certains en avaient après Léo Ferré tandis que d’autres enfin tout aussi véhéments l’assuraient de leur solidarité en lui conseillant d’abandonner la partie, le public ne méritant pas qu’il poursuive son récital. Au bas de la scène, des spectateurs gesticulaient provoquant la colère de l’artiste qui à ce moment-là ne comprenait pas ce qui se passait et croyait que ce tumulte était dirigé contre lui. Quand enfin il s’arrêta pour demander que l’on ouvre les portes, de très longs moments de confusion s’écoulèrent, où la gorge protégée par une serviette, Léo Ferré arpentait la scène, ne laissant aucune prise à l’hostilité persistante d’une partie du public ni à l’insistance de ses proches en coulisse pour qu’il arrêtât là le concert. Sourd à tous ces discours, avec beaucoup d’abnégation, il mena son récital jusqu’au terme qu’il s’était assigné, interprétant dans les pires conditions et « dans l’ordre qui lui a plu », les vingt-trois chansons suivantes : La Mémoire et la mer – Vingt ans – C’est extra – La Solitude / L’Invitation au voyage – Avec le temps – Préface – Muss es sein es muss sein – Les Musiciens – La Vie d’artiste – La Frime – Les Étrangers – Comme à Ostende – Tu penses à quoi – Ton style – La Jalousie – Je te donne – Chanson d’automne – C’est fantastique – La Nostalgie – Ma vie est un slalom – Des mots - Ni Dieu ni maître - Thank you Satan.
La Dépêche du Midi du 30 mai 1979.
Ferré place Dupuy : rude soirée pour le « roi » Léo.
Chemise de soie noire (il y a dix ans, c’était un pull-over) col ouvert, pantalon noir, chaussettes rouges, cheveux en halo blanc et mousseux, Léo Ferré entre en scène devant une salle impatiente. Il est 21 heures 15. Il envoie, du bout des doigts, un baiser au public, et s’assied au piano noir.
Dans le recueillement s’élève cette voix depuis longtemps célèbre, murmurante et rauque de sentiments retenus ; la tendresse. « La marée je l’ai dans le cœur ».
Et la houle, aussitôt après, dans les gradins où l’on manifeste, dès la deuxième chanson. Ferré chante, debout au micro, sur une bande musicale enregistrée.
« À quand le tourne-disques, Ferré ? » « Place aux jeunes ! » Sifflets. Contre protestations. Silence revenu, tandis que sans ciller, « le vieux Léo » qui ne s’est pas interrompu, chante La Nostalgie. « Ils n’ont de noir qu’un faux drapeau de 68… » Début de réponse aux perturbateurs, qui ne s’en contenteront pas, faisant entendre leur mécontentement à chaque fois que Léo Ferré utilisera ainsi le magnétophone.
Quatre fois, avec La Vie d’artiste, L’Allitérature (sic), Avec le temps et Thank you Satan, il reviendra au piano. Quatre fois, sur plus de vingt chansons au total. Alors, les manifestations se faisant de plus en plus pressantes, il fallut bien expliquer, même si très violemment : « J’ai chanté à Paris avec quatre-vingts musiciens et soixante choristes. Alors, quand je ne peux pas les avoir, je chante tout seul ! Tu comprends ? Merde ! »
Climat qui n’était pas favorable à la délectation de textes aussi purement beaux que « l’oreille de Beethoven en train d’imaginer pour la neuvième fois des symphonies muettes », « mon ombre a son soleil qui lui lèche sa trace », « si tu le veux, ta parallèle s’entrianglera avec la mienne » ou « les ailes de l’archange au milieu des pavés », aussi simplement forts que « ces bois que l’on dit de justice et qui poussent dans les supplices », « pour la prise de la Bastille même si ça ne sert à rien » « dans ce monde où les muselières ne sont plus faites pour les chiens. »
Et des chiens, justement, muselés, et d’aucuns diront démuselés, il y en avait pendant ce temps, aux portes de la Halle aux Grains. Dans notre rubrique « faits divers », nous relatons ce qui s’est passé à l’extérieur de la salle. Dedans, la rumeur des affrontements parvint vite. On crie, pour avertir Léo Ferré de ce qui arrive. Il ne comprend pas. On l’insulte. Il continue de chanter La Musique.
À la fin de cette chanson, une vingtaine de jeunes gens s’approchent de la scène, et, troublé, Ferré les écoute. « Tu ne comprends pas ? Il y a les flics, dehors ! » « Pourquoi les flics ? » « Parce qu’il y avait des types qui voulaient entrer sans payer ! » « Les cons, il n’y a qu’à ouvrir les portes ! » On s’est un peu bousculé, on s’apaise. « Dis-le très fort, Ferré, qu’il faut ouvrir ! » Il le dit.
Le calme revient lentement. Les jugements sur l’incident sont divers. D’aucuns laissent entendre que l’on profite qu’il s’agit d’un chanteur de « gauche » pour s’en prendre à lui. Lui, répète « je ne pouvais pas le savoir, qu’il y avait les flics dehors, comme ça, que les flics partent ! »
Il chantera et dira encore « les violons de l’automne », Marie, Ni Dieu ni maître, qui le fait acclamer, la salle enfin gagnée, et, parce qu’on lui demande un « bis », Thank you Satan.
Mardi à Toulouse, une rude soirée pour le roi Léo.
[non signé].
Quelques années plus tard, lors d’une entrevue avec le poète, nous avons évoqué ce récital de la Halle aux Grains de mai 1979. C’est alors qu’il eut ce commentaire sans appel : « Ce soir-là, c’était vraiment la Halle aux cons ! »

Léo Ferré par Carlos Pradal, La Dépêche du Midi, 1971.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 24 septembre 2007
Sur la scène toulousaine, par Jacques Miquel 1/3
Je remercie une fois encore Jacques Miquel qui a fait pour nous le long panorama des spectacles donnés par Léo Ferré à Toulouse, depuis 1965. Sa note est si fournie qu’elle paraîtra en trois fois, tout au long de cette semaine : aujourd’hui lundi, puis mercredi et enfin vendredi. Bon voyage archivistique et musical en Occitanie.
« On s’aimera »
Il a fallu attendre 1965 pour voir enfin Léo Ferré se produire sur une scène toulousaine, et encore c’est en empruntant des chemins vicinaux qu’il vint à la rencontre de ce public, puisque son premier spectacle eut lieu à Noé, commune rurale située à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. Là, du 2 au 5 juillet se déroulaient les fêtes annuelles de la Belle Gaillarde, c'est-à-dire une vaste fête foraine avec quotidiennement des spectacles de variétés, des jeux, des concours et des animations, bal tous les soirs et grand feu d’artifice de clôture. En outre, le dimanche après-midi se déroulaient l’élection de la Belle Gaillarde, robuste miss labours, puis le tour de chant d’une grande vedette (Enrico Macias en 1964, Léo Ferré en 1965, Johnny Hallyday en 1966, etc.) En réalité, il s’agissait des manifestations festives les plus importantes de toute la région toulousaine, et peut-être que la tenue de ces grandes fêtes dans un si petit village n’était pas étrangère à l’influence de Jean-Baptiste Doumeng, « le milliardaire rouge » dont Noé constituait le fief électoral.
En tout cas, ce dimanche 4 juillet 1965 après-midi, en plein air et sous un soleil radieux, Léo Ferré présenta son récital devant un public fourni prenant ses aises dans l’herbe d’un champ commun. La majorité de ces spectateurs découvrait cet artiste vêtu d’un singulier costume de scène de velours noir et accompagné d’un pianiste aveugle. Si j’en crois les bribes de souvenirs de cette journée que m’a confiées il y a peu une de mes proches qui assista à cet événement artistique, ce fut vraiment un concert exceptionnel dans lequel autant les textes que la musique soutenus par une voix maîtrisée et une présence scénique hors du commun soulevèrent l’enthousiasme de la foule…
Palais des Sports de Toulouse, 27 novembre 1965
Quant à la première apparition de Léo Ferré à proprement parler sur une scène toulousaine, elle allait avoir lieu au Palais des Sports, vaste salle au confort spartiate sur laquelle il convient de dire quelques mots.
Érigée au XIXe siècle pour abriter le négoce du blé, cette halle a surtout servi de marché couvert jusqu’à la Seconde guerre mondiale, quand elle resta un temps désaffectée. En 1952, des gradins en béton furent construits et avec une capacité dépassant largement les trois mille places assises, le lieu fut rebaptisé Palais des Sports et voué aux combats de boxe et de catch mais aussi aux spectacles de cirque, matinées enfantines, festivals de rock, galas de variétés, etc. À la fin des années 70, la salle fut dévolue à l’Orchestre national du Capitole en raison de son acoustique exceptionnelle et en retrouvant son appellation première de Halle aux Grains, bénéficia de modernisations visant à améliorer le confort et à favoriser la représentation de grands spectacles lyriques comme les opéras wagnériens. Devenue un des hauts lieux de la musique toulousaine tous genres confondus, la Halle peut accueillir aujourd’hui jusqu’à deux mille trois-cents spectateurs.
Le gala de Léo Ferré était annoncé d’une part par un encart publicitaire dans Le Monde libertaire de novembre 1965 et d’autre part par deux articles non signés dans les colonnes du journal La Dépêche du Midi et complétés de plusieurs encadrés en page des spectacles. Rappelant qu’il s’agissait là de son premier récital à Toulouse, l’auteur d’un des articles rapportait ce propos récent du poète : « J’espère faire un grand gala, et je compte beaucoup sur le public toulousain que je sais très difficile. » Par ailleurs, le quotidien ne disait pas un mot sur l’organisateur de la soirée, en l’occurrence le Groupe libertaire de Toulouse. C’est sans doute lui qui avait assuré l’affichage publicitaire dont on peut déplorer la discrétion, ce qui explique en partie l’affluence limitée pour cette première toulousaine. Y avait-t-il seulement mille spectateurs ? En tout cas, les gradins et travées semblaient très clairsemés alors que, comme en attestent aussi bien le compte-rendu de La Dépêche que celui du Monde libertaire, la soirée fut de très grande qualité. En première partie, Rosalie Dubois se tailla notamment un très beau succès.
À l’entracte, tandis que la salle prenait des allures de meeting politique, on pouvait apercevoir du côté des coulisses Madeleine Ferré faisant savoir que « l’artiste ne recevait pas », l’artiste qui enfin parut sur scène et dont le premier soin fut de demander aux spectateurs du balcon et des galeries de rejoindre ceux de l’orchestre afin que cela fasse moins vide ! Ce récital dont les articles ci-après mentionnent, parfois de façon approximative, les titres des chansons interprétées, fut pour moi celui de la découverte.
Le Monde libertaire, novembre 1965.
La Dépêche du Midi du 30 novembre 1965.
Pour son unique récital, Léo Ferré toujours égal à lui-même a connu un grand succès.
Il est depuis longtemps inutile de présenter Léo Ferré au public, grand ou petit, chacun l’ayant plus ou moins entendu sur les ondes, plus ou moins applaudi, plus ou moins critiqué, plus ou moins admiré.
On prétend que c’est un intellectuel, un littéraire, un compliqué, un « brave type », etc. Ce qui est certain, c’est qu’il n’est pas yéyé, ce terme n’étant pas a priori péjoratif, et qu’il est un des plus populaires chanteurs actuels, avec « l’ours » Brassens.
Il est franc dans ses chansons comme dans sa vie, et si entre deux sanglots soudain jaillit la pointe d’une ironie amère, c’est probablement cette ironie qui lui ôte les suffrages des « chastes oreilles » et des « bien pensants ».
Samedi soir, au grand gala Léo Ferré, nous avons retrouvé et avec quelle joie, l’un des plus authentiques troubadours de notre époque, et peut-être l’un des moins compris.
En première partie, une équipe de jeunes « chauffa » la salle. Les idoles des jeunes préparaient le terrain pour l’idole des… moins jeunes.
(…) Enfin, venait Léo Ferré, après un interminable entracte qui n’en finissait plus. Salué dès son entrée par un tonnerre d’applaudissements, il devait pendant plus d’une heure, tenir la salle en haleine, en interprétant, accompagné par son pianiste aveugle, Paul Castanier, une bonne vingtaine de chansons.
Ce nouveau récital, puisque nouveau récital il y avait, comportait entre autres, les titres suivants qui seront bientôt célèbres : Espana la vida, La Mélancolie, Bagnard, Le Temps du plastique, La Chanson des amants, Ni Dieu ni maître, etc.
Les titres changent, les chansons se renouvellent, les airs se modifient, mais le « grand Ferré » demeure. Il est toujours là, tendu, révolté, cynique, mélancolique, langoureux. Sous l’éclairage des « sunlights », sa silhouette épaisse et désinvolte projette sur la salle l’ombre d’un « brave type » génial. Il chante la vie et les passions humaines, balayant l’assistance d’un œil humide et doux.
Il fut rappelé plusieurs fois, et finalement, dans une apothéose, il embrassa son pianiste et partit en le tenant par le bras.
Quand on leur demanda leur avis sur ce récital, beaucoup le trouvent bon. Beaucoup plus encore le trouvent excellent. Pour moi, ces critères sont vagues. Si on me demandait mon avis, je répondrai simplement : « C’était du Léo Ferré ». Ce qui se passe de commentaires.
[non signé].
Le Monde libertaire, janvier 1966.
Gala Léo Ferré à Toulouse [27 novembre 1965].
L’immense salle du Palais des Sports nous a appartenu… pour un soir. Pour un soir, le Groupe libertaire de Toulouse a pu donner la pleine mesure de ses moyens. Et quels moyens ? Des copains au contrôle, à la caisse, à la criée du M. L., à la régie… Pour un soir, le Palais des Sports a été l’antre de l’Anarchie.
C’était bien la première fois qu’un groupe libertaire en dehors de Paris organisait un grand gala. Avec l’aide notre amie Suzy, nous avons pu avoir le brave Léo, Léo Ferré et la bonne chanson…
(…) À l’entracte, les livres et les disques furent enlevés par un public avide de savoir, de connaître notre pensée, nos théoriciens. La récolte se fera, amis !
Franco la muerte, Graine d’ananar, voici Léo Ferré, voici notre vedette tant attendue. Madeleine, dans les coulisses, règle les éclairages rouges, blancs, jaunes, qui, tout à tour, viendront nuancer, souligner de leurs effets savamment calculés, la poésie chantée du Ravachol de la chanson. Un applaudimètre aurait explosé ! Quelle chance que tu as eue Léo pour ton premier gala à Toulouse ! et quelle chance nous avons eue nous aussi ! Faut-il dire tout ce que tu as remué dans les esprits et dans les cœurs de ces jeunes gens venus t’écouter ?
Qu’ici soient remerciés tous nos amis connus et inconnus, qui ont participé à la réussite de cette manifestation libertaire, que les artistes le soient encore, ainsi que Suzy à qui nous devons ce beau plateau. N’oublions pas de signaler qu’après l’entracte, une allocution fut lue au public par notre camarade J.-C. Bruno, afin de bien marquer notre position face aux événements sociaux actuels. Elle fut vivement applaudie… et ce n’est pas pour avoir rempli la salle de copains espagnols car ils se sont sagement abstenus ce soir-là.
Des copains de Tarbes, Bordeaux, Agen et d’ailleurs étaient venus nous encourager et nous donner un bon coup de pouce. Merci à tous.
Le Groupe libertaire de Toulouse.
Palais des Sports de Toulouse, 20 mars 1968
J’ai longtemps pensé qu’il m’avait été donné de voir un spectacle de Léo Ferré au Palais des Sports de Toulouse en 1966 ou 1967, mais si j’en crois les archives de La Dépêche du Midi, il n’en a rien été. Peut-être s’agit-il là d’un « concert de rêve » ? En tout cas, c’est réellement à un nouveau récital que j’ai assisté au même Palais des Sports le 20 mars 1968. La soirée était organisée par l’ENSEEIHT, grande école d’ingénieurs de Toulouse et qui produisait alors annuellement le festival N’7, composé d’une série de manifestations culturelles. L’invitation faite à Léo Ferré témoigne au passage de l’intérêt qu’il suscitait dans les milieux estudiantins dès avant mai 1968.
Dans la semaine précédant le spectacle, trois articles de La Dépêche du Midi le chroniquaient en évoquant entre autres la vie idyllique de l’artiste à Saint-Clair auprès de son épouse et entouré d’une horde d’animaux familiers. Histoire de mettre le public en condition, un des articles avançait que « l’on ne va pas à Léo Ferré l’âme sereine [car] il y a chez lui de l’objecteur de conscience ». Le propos était renforcé par quelques citations parmi lesquelles cet aveu assez réaliste : « J’aime l’époque où je vis même si je la critique. C’est l’ère des tyrans au berlingot. »
Depuis sa dernière apparition toulousaine, l’audience s’était nettement élargie et cette fois-ci c’étaient plus des deux-tiers des places du Palais des Sports qui avaient été réservées. Le répertoire de Léo Ferré de ce soir-là, qui était accompagné au piano par Paul Castanier, correspondait à celui présenté à Bobino à l’automne 1967 et, comme là, ce qui surprit sans apparemment heurter qui que ce soit, c’était le recours aux bandes magnétiques orchestrées pour quelques titres : Cette chanson, Spleen, La Marseillaise et la chute à l’accordéon pour À une chanteuse morte (cf. Ce qu’on disait du récital donné à Bobino en 1967 et commentaires.) La sincérité des interprétations du poète semblait atteindre la plus grande profondeur et le succès fut considérable, comme en témoigne l’article de Marie-Louise Roubaud paru le surlendemain dans La Dépêche. En fait, à ce moment-là, ce qu’ignorait la journaliste comme le public toulousain, c’est qu’en ce 20 mars 1968, la vie conjugale du couple mythique formé par Léo et Madeleine était en train de basculer vers la rupture définitive, provoquant la dispersion dramatique de la ménagerie de Perdrigal.
La Dépêche du Midi du 22 mars 1968.

Léo Ferré par Carlos Pradal, La Dépêche du Midi, 1968.
Point de vue – Festival N’7 : Ferré le grand.
Il ne ressemble à personne et personne ne lui ressemble.
Une crinière rousse, un visage de statue de commandeur, des yeux de chat, les gestes pathétiques du mime, une voix qui tonne comme l’orgue ou qui tremble comme l’archet du violon, c’est Léo Ferré, poète terrible et vieux routier du music hall, sorti pour un soir de sa retraite de Saint-Clair pour chanter sous les projecteurs du Palais des Sports.
Avec l’humour en dents de scie qui provoque quelques grincements de dents, avec les mots de la rue auxquels il donne une nouvelle noblesse, Léo Ferré décrit d’après nature une époque qui est la nôtre et sur laquelle il promène un regard sans complaisance. Ce n’est pas sa faute si cette peinture-là tient de la caricature et de la parodie. Qui aime bien châtie bien. Aussi Léo Ferré manie-t-il l’invective avec hardiesse, sans merci.
Il ne mâche pas ses mots. Sa pensée est sans détours et c’est dans l’univers du spectacle où règne une conspiration du silence, la seule voix qui ose réellement dire non. Sa chanson sur Piaf « Bayreuth de trottoir », lui a valu quelques ennuis avec son éditeur. La censure, une fois de plus, nous prive d’un chef-d’œuvre.
Cet homme qui hurle « Thank you Satan » avec une tête de Christ aux douleurs, croit-il en Dieu ou au diable ?
Ce n’est pas par hasard, on s’en doute, qu’il a mis en musique Aragon, Baudelaire, Verlaine, Apollinaire.
Pour lui aussi « l’art est un vampire » et ne le dirait-on pas né sous le signe fatidique de Saturne, cette « fauve planète » commune aux poètes qu’on appelle maudits ? Cette complicité qui unit d’instinct, au-delà du temps, les poètes de même race explique sans doute les réussites de ces mises en chansons. Si Victor Hugo avait connu Léo Ferré, peut-être n’aurait-il pas défendu qu’on dépose de la musique le long de ses vers.
Qui a, une fois vu et entendu Léo Ferré chanter Le Spleen de Baudelaire avec son visage de revenant et ses belles mains désespérées qui semblent porter le poids de la terre entière, se sent pris à son tour d’un vertige.
Au prix de quelles angoisses Léo Ferré a-t-il payé ce don de sincérité ? Ses propres chansons nous le disent assez bien où il exhale ses plaisirs et ses haines, ses amours aussi. Car cet anarchiste-né, ce fauve solitaire a des accents bouleversants de passion et de tendresse, dont on sait qu’ils s’adressent à une seule femme : Madeleine Ferré, la Muse qui ne le quitte jamais, qui est là, dans les couloirs, à veiller aux nombreux détails de son récital.
Peu d’interprètes et de compositeurs prennent aujourd’hui le risque de chanter seuls pendant près de deux heures comme Léo Ferré l’a fait, l’autre soir, pour un public de deux mille étudiants qui l’ont rappelé par trois fois. Quels artistes d’ailleurs supporteraient la confrontation sur une scène avec ce diable d’homme ? À cinquante ans passés, Léo Ferré, l’irréductible, reste dans le camp des jeunes qui reconnaissent en lui le romantisme de leur propre révolte.
Mais dans la France de Mireille Mathieu, ces pamphlets vengeurs qui sentent le soufre et où Léo Ferré se révèle un prodigieux jongleur de mots, n’ont pas, on s’en doute, la faveur de tous les publics.
Qu’importe à Léo Ferré qui n’est jamais rentré dans le rang. Les modes passeront ; Léo Ferré, lui, restera…
M.-L. R.
Cinéma Le Trianon de Toulouse, 5 décembre 1968
La page des spectacles de La Dépêche du Midi annonçait pour ce 5 décembre au Palais des Sports « Le géant Ferré, champion du monde toutes catégories », mais il s’agissait là d’un combat de catch ! Quant au poète, c’est de façon plus discrète que, moins de neuf mois après sa dernière prestation toulousaine, il était de retour dans la ville rose, investissant cette fois-ci la scène du cinéma Le Trianon, qui pour une soirée retrouvait sa vocation première de théâtre.
Les journalistes signant les articles présentant le spectacle de Léo Ferré se contentaient soit de reproduire des passages entiers de la monographie de Gilbert Sigaux, soit de résumer le dossier de presse concocté par la maison Barclay et dont certaines allusions à Madeleine Ferré dataient cruellement. Aussi, rien ne transparaissait sur les avatars de la vie privée de l’artiste et la plupart des spectateurs qui occupaient les mille trois-cent cinquante fauteuils du Trianon ignoraient tout de cela. Mais le nouveau répertoire, qui préfigurait celui présenté à Bobino à partir du 15 janvier suivant, ressemblait bien à une somme de confidences douloureuses, particulièrement les inédits comme Pépée, Le Testament, ou À toi qui donnaient sa tonalité mélancolique au tour de chant, tonalité renforcée par la nostalgie de pièces anciennes telles L’Étang chimérique et plus encore L’Amour (1956) magnifiquement accompagnées au piano par Paul Castanier. Cette impression était confirmée dès l’entracte pour ceux qui achetèrent le livret Mon programme 1969, un rapide coup d’œil sur le texte Mes enfants perdus ne laissant aucun doute sur les événements qui s’étaient tramés peu de temps auparavant près de Gourdon. Les autres chansons inédites comme L’Été 68, Les Anarchistes ou Madame la Misère, également accompagnées au piano, enflammèrent le public sans toutefois parvenir à dissiper complètement le sentiment de tristesse dans lequel baignait tout le récital.
La Dépêche du Midi du 5 décembre 1968.
Au Trianon, Léo Ferré : « Je suis un bon client de la tristesse ».
Comme à chaque fois Léo Ferré arrive les mains dans les poches, sans sonorisation, sans orchestre, avec pour seul accompagnateur son pianiste aveugle, et cette fois, sans Madeleine. La veille, il était à Bordeaux, et pour venir à Toulouse, il a fait un détour par Saint-Clair, où, il y a huit mois encore, il vivait dans une maison qui était un refuge :
« C’est à présent une maison morte. Il s’est passé dans ma vie, depuis mars dernier, des drames dont je ne veux pas parler… »
On sait seulement que la guenon « Pépée » est morte et que Madeleine est partie.
Voilà Léo Ferré rendu à la solitude, donc à lui-même.
« On ne voyage pas, on bouge. On n’emporte que soi, et c’est lourd à porter.
Sur les routes, en semaine, on ne rencontre que les routiers et les artistes de music hall. Nous faisons, les uns et les autres, de très longues étapes.
Je me suis toujours senti un peu déraciné, n’importe où que je sois. Je ne fais jamais de projets. C’est trop présomptueux. Les autres en font pour moi. Désormais, je me sens bien avec mes compagnons de fortune… et d’infortune.
Je ne me mêle jamais des affaires de mon destin. Je pense que, de toutes manières, on ne choisit pas. Des regrets ? Non je n’en ai pas. En vivant, on fait du passé, et je ne peux pas regretter de vivre.
Je suis un bon client de la tristesse. D’ailleurs, la beauté, c’est toujours triste, c’est les larmes.
Chaque soir, plus je chante et plus je me sens triste, et plus j’ai mal. C’est inexplicable. Chanter n’est pas un devoir, mais c’est quelque chose de plus effrayant. On est tout seul et il faut rester soi. Et puis, toutes les trois minutes, il y a une cassure, le public qui intervient, qui applaudit ou qui n’applaudit pas. Sur scène, chaque soir, je me montre, je vends quelque chose de moi qui est ma voix… et je me demande si, après tout, ce n’est pas pareil que les femmes qui vendent leur corps. »
Des êtres avec qui Léo Ferré a eu plus d’affinités, l’un n’est plus, l’autre s’est éloigné : « Il y avait d’abord André Breton qui était un être magnifique… et puis ma femme Madeleine.
L’absolu mais ça n’existe pas. L’amour absolu c’est Roméo et Juliette. Oui, mais ils sont morts… »
« L’anarchie, un état d’âme ».
Le sentiment angoissant du temps qui passe, du bonheur qui ne dure pas, la fascination morbide du néant ont toujours habité l’âme tourmentée du poète Ferré. « Ce qui nous caractérise nous, Méditerranéens, c’est la sensibilité. L’anarchie, c’est quoi ? C’est un état d’âme. »
Et Léo Ferré sait de quoi il parle, lui qui, dans ses chansons, tire à boulets rouges.
« La poésie est une fureur qui se contient juste le temps qu’il faut. »
Aujourd’hui, ces textes d’hier sonnent si juste qu’ils semblent prophétiques. Sans doute les événements de mai ont apporté de l’eau au moulin de cet homme qui n’a pas cessé de se battre.
Jamais Léo Ferré n’a été aussi vivant dans le cœur de la jeunesse. Ses dernières chansons sur les barricades ont soulevé des vagues de bravos, l’autre soir, dans le Trianon, plein à quatre-vingt-dix pour cent d’étudiants.
L’accueil que ces « enfants de mai » ont fait au chanteur est de ceux qui prouvent avec évidence que la révolution d’il y a six mois était vraiment celle de l’intelligence.
On a assisté l’autre soir, entre le public et le chanteur, à une de ces « communications magnétiques » qui tiennent du miracle.
Et quand Léo Ferré, sur des musiques à donner le frisson, crie : « Tu ne m’as pas dit que les guitares de l’exil sonnaient parfois comme un clairon, toi mon ami l’Espagnol » quand il se livre à une caricature au vitriol de la vie moderne ou bien quand il rend hommage aux « enragés qui dérangent l’histoire », aux anarchistes « qui ont l’âme rongée par de foutues idées » et qui sont, après tout, les mêmes qui « pour tout bagage, ont vingt ans », on n’est pas loin de penser que les générations d’aujourd’hui trouvent dans cet homme de plus de cinquante ans, leur plus impitoyable moraliste.
Cet art de l’invective serait évidemment sans effet si Léo Ferré n’était pas aussi un vieux lion de la scène qui connaît son métier par cœur, qui sait jouer de sa voix avec un art consommé.
« L’essentiel sur scène, c’est de ne pas en faire trop » dit-il.
Et puis, il y a ce visage romantique, tourné comme une figure de proue, un visage auquel les feux de la rampe, donnent parfois une allure spectrale…
M.-L. Roubaud.
1965-1968. Ces quatre rendez-vous avec le public toulousain qui semblait murmurer au poète : « On s’aimera », laissaient bien augurer des récitals à venir. Hélas, les choses ne furent pas toujours aussi faciles et tournèrent parfois à des rapports pour le moins rugueux.

Toulouse, décembre 1968 – D.R.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (9)
jeudi, 20 septembre 2007
La notion de « texte intégral »
Lorsque le Livre de Poche est apparu, en 1953, la maison Hachette, qui en était l’éditrice et l’avait introduit en France sur le modèle du paperback américain, prit immédiatement soin de préciser sur les couvertures : « Texte intégral ». Ce qui paraît aller de soi mais il faut savoir qu’à l’époque, il existait, notamment pour les romans, des adaptations condensées de textes parus auparavant dans des éditions plus sérieuses.
Je m’interroge sur ce qu’est devenue cette notion, en ce qui concerne deux recueils de textes de Léo Ferré.
Il suffit de comparer les tables des matières pour constater qu’entre l’édition originale parue chez Édition n° 1 en 1993 et le tirage en Livre de Poche sous le numéro 9626, en 1995, le recueil La Mauvaise graine a un peu maigri. Les titres manquants sont, sauf erreur de ma part : Et vogue vogue la galère, Qui pourrait maintenant, Le Faux poète, L’Homme lyrique, Paris, Ma vieille branche, À la folie, La Vie moderne, La rue est la galaxie de l’outrage, L’Araignée, Au premier hibou de service, Demain, La Banlieue, Les Amants tristes, Alma Matrix, Et… basta !, Words… words… words…, Je vivais dans une sorte de malédiction confortable, Je parle à n’importe qui, L’Imaginaire, Ma vie est un slalom, Death… death… death…
La couverture ne précisant pas « Texte intégral », il n’y a rien à dire, mais on peut s’étonner de la disparition d’une vieille tradition qui était pratiquement ressentie comme un contrat de confiance entre l’éditeur et le lecteur. Or, surprise, le volume a reparu sous une seconde couverture en 2000, avec, cette fois, la mention en question : « Texte intégral », imprimée en bas à gauche. Que nenni : les textes, les mêmes, manquent toujours. Il y a donc abus, sinon mensonge, de la part de l’éditeur.
Il n’y a qu’à comparer également Testament phonographe, paru chez Plasma en 1980, ayant connu une deuxième édition au Gufo del Tramonto (1990), une troisième chez La Mémoire et la mer (1998), une quatrième dans la collection « 10-18 » sous le numéro 3356 (2001), enfin une cinquième chez La Mémoire et la mer (2002) pour se rendre compte qu’entre les volumes de grand format et celui de « 10-18 », il y eut aussi une cure d’amaigrissement, plus réduite il est vrai que dans l’exemple précédent. Les titres manquants sont, sauf erreur de ma part : Adieu, La Damnation, La Femme adultère, Pacific Blues, Paris c’est une idée, Les Passantes, Tu sors souvent la mer. Là encore, la couverture ne précisant pas « Texte intégral », il n’y a rien à dire, mais on constate que la logique éditoriale qui était celle des collections de poche ne va plus de soi. Un coup d’œil au catalogue de la collection « 10-18 » pour l’année 2001 ne rassure guère : aucune allusion n’est faite à l’intégralité ou non des textes.
Alors, qu’est devenue la notion de « Texte intégral » ? Le Livre de Poche ou « 10-18 » ont publié autrefois des volumes bien plus gros. Il ne peut donc s’agir d’une simple question de format, de nombre de pages. Je ne comprends pas. Sans parler de cette autre question, plus importante encore : qui décide de couper, que coupe-t-on et pourquoi ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (24)
dimanche, 16 septembre 2007
Une opinion sur la musique de Ferré pour Apollinaire
« L’exemple de Poulenc ne doit pas nous faire oublier que d’autres musiciens se sont tournés moins discrètement vers Apollinaire et n’ont pas hésité, eux, à toucher au recueil Alcools. Ils sont en tout une vingtaine. Nous citons simplement parmi eux – car M. Pouilliart reviendra bientôt sur un certain nombre de noms – Jean Absil, Robert Caby, Luigi Cortese, Georges Dandelot, Léo Ferré, Arthur Honegger, Jacques Leguerney, Jean Rivier, Daniel Ruyneman et même Louis Bessières. Ces musiciens sont de répertoire et de style très différents et les poèmes les plus utilisés sont Le Pont Mirabeau, Clotilde, L’Adieu.
Nous reconnaissons volontiers que certaines de ces mélodies, au lyrisme assez appuyé, sont agréables à entendre. Mais elles ne savent pas toujours éviter l’écueil dont Poulenc s’était si bien gardé. La poésie d’Apollinaire étant dans Alcools essentiellement lyrique, elle souffre de s’ajuster à une autre source de lyrisme qui la contraint à s’effacer derrière un air et un refrain étroitement déterminés. Nous pourrions même dire que le courant mélodique existant à l’origine et celui qui lui est artificiellement imposé, finissent par se contrarier et par annihiler la puissance d’évocation du poème. La poésie ne gagne rien à passer sur ce lit de Procuste, et un long poème se montre particulièrement réfractaire à ce traitement. La Chanson du mal-aimé supporte que sa lecture se détache sur un fond musical, mais elle est elle-même défigurée par toute tentative de transformation mélodique intégrale et l’on est frappé de voir à quel point le pompeux oratorio de Léo Ferré manque d’invention et de grandeur. La convention la plus plate y tient lieu d’inspiration. Tout y est annoncé, préparé à grand renfort de thèmes élémentaires : les Cosaques Zaporogues prennent appui sur des réminiscences de Khatchaturian, le tzigane de la fin s’est vu précéder d’un air de violon réglementaire. Quant aux sept épées, elles sont environnées d’héroïques accords de trompettes. La technique est un peu trop facile : ce procédé d’anticipation sonore a pour effet d’orienter l’imagination de l’auditeur vers les clichés les plus traditionnels et ruine la variété du poème. Les sautes d’humeur d’Apollinaire, les résonances étranges des images qu’il juxtapose se dissolvent dans la monotonie. Une réussite, cependant, nous paraît d’autant plus éclatante qu’elle est unique. La traduction de la strophe « Voie lactée ô sœur lumineuse / Des blancs ruisseaux de Chanaan » est un véritable chef-d’œuvre. Elle doit son charme à la voix d’un jeune garçon qui vibre imperceptiblement comme un clignotement d’étoiles et qui la porte de façon presque immatérielle à des hauteurs vertigineuses. Elle nous prouve à son tour que l’accord total entre un poème et sa transposition lyrique ne peut être qu’un miracle de court instant ».
Voilà le jugement consigné dans les Actes du colloque « Apollinaire et la musique » réunis par Michel Décaudin (Journées Apollinaire, Stavelot, 27-29 août 1965), ouvrage publié par l’asbl Les Amis de Guillaume Apollinaire, Stavelot, 1967. Je ne connais pas le nom de l’auteur de cette contribution. On sait que les amoureux d’un poète ne tolèrent guère qu’on touche à ses œuvres. Peut-être est-ce le cas de cet exégète d’Apollinaire.
Cette opinion retrouvée dans mes archives n’est pas étonnante. La vieille question de la mise en musique des poèmes est ici encore remise sur la table avec les mêmes sempiternels arguments. On a examiné ce point dans Avec Luc Bérimont. Je relève que ce sentiment négatif concernant La Chanson du mal-aimé est le seul du genre, tout au moins à ma connaissance. Tous les échos que j’ai lus sur la question étaient plutôt positifs.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (54)
mercredi, 12 septembre 2007
De la noirceur
Après avoir regardé, l’autre soir, le DVD d’un récital de Lény Escudero – il s’agissait de son spectacle de 1990, emmené en tournée en 1991 – je me suis fait quelques remarques.
Escudero est un chanteur au répertoire extrêmement noir, qu’il détaille d’une voix agréable mais très « sèche », sombre. Cette noirceur est soulignée par un visage émacié, une silhouette qui n’a que la peau sur les os – mais cela, c’est autre chose. Il reste que, sur vingt-et-une chansons, deux seulement étaient des sourires, des pauses, des radeaux sur une mer de désespoir. C’était très éprouvant.
Beaucoup de gens disent que Léo Ferré est trop sombre pour eux, que ses chansons les déstabilisent parce qu’il leur donne le sentiment d’un homme sans espoir aucun. C’est très exactement le contraire et chacun ici, je pense, sera d’accord avec moi : l’œuvre de Ferré est pleine d’un espoir immense, jamais contredit. Les spectacles de Ferré étaient réconfortants, on en sortait plein de force.
Pourtant, objectivement, le désespoir est le désespoir. C’est sa mise en mots qui diffère. Sa mise en voix aussi car celle de Léo Ferré, avec son grain, sa tessiture, peut évidemment beaucoup.
Alors ? Qu’est-ce qui sépare Escudero de Ferré, même en-dehors d’une différence, facilement constatée, de qualité des textes et de la musique ? Escudero n’est pas Ferré, mais ce qu’il écrit n’est vraiment pas mal non plus. Pourquoi son spectacle, pourtant « affadi » par le DVD qui, comme je le dis souvent, ne restitue pas la présence, m’a-t-il écrasé par sa noirceur quand ceux de Léo Ferré, même avec les réserves de la vidéographie, me portent en avant ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (29)
lundi, 10 septembre 2007
Le poinçonneur c’est extra
En 1960, a lieu la première rencontre entre Léo Ferré et Serge Gainsbourg. Devant le micro de Pierre Guénin, ils participent au « Jeu de la vérité » en compagnie de Micheline Presle, Norbert Carbonnaux, Pierrette Pradier et Jacqueline Boyer. Le texte du débat paraît dans Cinémonde [1], puis est repris en volume chez Losfeld [2], en même temps que d’autres.
Le texte imprimé reproduit un échange, apparemment un peu vif mais sans plus :
« Guénin. - Gainsbourg, écrivez-vous des chansons par amour de l’art ou pour gagner de l’argent ?
Gainsbourg. - Mon cas est assez délicat. J’ai été peintre pendant quinze ans et maintenant je gagne ma vie en écrivant des chansons. Ce qui m’ennuie c’est que, plus ça va, plus j’ai envie d’écrire des chansons « inchantables » ?
Ferré. - En principe, quand on écrit quelque chose, c’est avec son cœur et non pour de l’argent. Vous avez tort de considérer la chanson comme un art mineur. Si vous vous laissez aller à des contingences commerciales imposées par un patron de disques… évidemment. Il y a l’art et la m…
Gainsbourg. - Si mon éditeur et ma maison de disques…
Ferré. - Ne me parlez pas de ces gens qui sont des commerçants.
Gainsbourg. - Mais enfin, si on me ferme la bouche ?
Ferré. - Je connais votre situation, c’est une situation dramatique. Ce que vous avez envie de chanter et d’écrire, il faut le chanter et l’écrire, mon vieux.
Gainsbourg. - Chez moi ?
Ferré. - Non, dans la rue. Il faut prendre une licence de camelot à la préfecture de police.
Gainsbourg. - Moi, je veux bien me couper une oreille comme Van Gogh pour la peinture, mais pas pour la chanson ».
J’ai toujours ressenti ce passage comme amical et, aujourd’hui encore, j’entends dans la voix de Léo Ferré quelque chose d’affectueux. Ferré aimait Gainsbourg et tout, dans ce dialogue, me paraît plein d’attention envers les difficultés que connaît alors le chanteur.
Or, il semble qu’il s’agisse d’un extrait seulement. Si l’on en croit Gilles Verlant, le biographe de Gainsbourg, la conversation a continué. Dans un livre collectif comportant une série de textes sur la chanson, Chroniques d’un âge d’or [3], il raconte :
« Hors micro, Guénin raconte que le débat se transforma en véritable pugilat verbal au cours duquel Gainsbourg finit par traiter Ferré de « démodé ». Pire qu’avec Béart, un quart de siècle plus tard, dans un légendaire numéro d’Apostrophes ».
Peut-être. Mais pourquoi ? On ne connaîtra jamais la suite de la conversation, ni ce que Guénin a pu raconter, ni où Verlant l’a appris. Dommage.
À plusieurs reprises, au cours de sa carrière, Ferré va parler de Gainsbourg, notamment après l’allusion amicale qu’il fait dans le courant de Pépée, à celui qui se croyait laid. Dans le recueil Vous savez qui je suis, maintenant ?, Quentin Dupont cite cinq extraits d’interviews [4] :
« Gainsbourg venait m’entendre tous les soirs dans un cabaret de la rue… Les Saints-Pères. Et quand j’arrivais, Gainsbourg me faisait signe avec les oreilles, parce que je chantais la chanson Pépée... Fantastique ! » (Il s’agit du cabaret parisien Don Camilo, 10, rue des Saint-Pères (Littré 65-80 ou 71-61), où Ferré chante dans un dîner-spectacle, durant vingt jours, à partir du vendredi 3 octobre 1969. Gainsbourg habite à quelques mètres).
« J’aime beaucoup Gainsbourg et je trouve que ses oreilles... Dans la chanson que j’ai écrite sur Pépée, ça n’est pas du tout méchant ce que j’ai dit, c’est très amical. Vous savez, moi j’aime beaucoup les chimpanzés. Les chimpanzés ont tous les oreilles comme monsieur Gainsbourg. Seulement, la nuit, ils les replient, tandis que Gainsbourg, s’il veut les replier, il faut qu’il mette du scotch. Mais c’est pas méchant, c’est fraternel ce que je dis… J’aimerais avoir Gainsbourg, avec moi, à la maison, comme ça, pour vivre avec lui quelques jours. Voilà ! C’est mon droit ! S’il veut bien, je l’invite… »
« Je me souviens d’une interview que Denise Glaser avait faite de ce garçon que j’aime beaucoup parce qu’il est infiniment intelligent et qui s’appelle Gainsbourg. Et un jour, elle lui avait demandé, après ces silences dont elle a le secret : « Mais, dites-moi, pourquoi vous avez retourné votre veste ? » (parce qu’il commençait peut-être un peu à vivre de son métier). Et il a répondu : « J’ai retourné ma veste quand je me suis aperçu qu’elle était doublée de vison ! » »
« Gainsbourg est un type qui est intelligent, qui a choisi de faire une chose qu’il fait très bien. Et puis, c’est un mec intelligent. L’intelligence gêne les cons ».
« … J’ai beaucoup de sympathie pour Gainsbourg. Et je trouve d’ailleurs que c’est un personnage curieux (je ne suis pas le seul) et intelligent. Et je pense que c’est parce qu’il est intelligent que j’ai pu me permettre de dire ça, parce qu’il a dû comprendre. C’est pas du tout contre, c’est avec beaucoup de tendresse que je dis ça. Vous savez pourquoi, parce que les chimpanzés ont les oreilles comme ça, un peu dégagées comme celles de notre ami Serge Gainsbourg. Mais ce qui était extraordinaire, un jour je m’en suis aperçu, la nuit quand elle dormait, elle les mettait à plat Ça veut dire que dès qu’elle se levait le matin, elle mettait ses amplis, elle mettait ses trucs pour écouter et c’était très émouvant… Je veux dire que c’était extraordinaire, parce que les gens imaginent que les chimpanzés ont les oreilles comme ça… mais ils ont les oreilles comme ça, parce que ça sert, parce que c’est la nature et la nuit, hop ! ils n’en ont pas besoin, ils les replient ».
On connaît la photographie des deux hommes souriants, signée Marie Ferré, prise entre 1980 et 1984 (selon les sources) à Genève, au cours d’une rencontre.
On nous parle, depuis 1969, de la conversation qui eut lieu entre Ferré et les deux grands B. de la chanson. J’avais envie d’évoquer Gainsbourg et Ferré : il y a peu à dire, mais c’est au moins aussi intéressant que le débat supposé « mythique » dont, rétrospectivement, la platitude et le total désintérêt n’ont pas fini de nous étonner.
____________________
[1]. Cinémonde du 15 novembre 1960.
[2]. Pierre Guénin, Le Jeu de la vérité, Le Terrain Vague, 1961.
[3]. Collectif Chanson, Chroniques d’un âge d’or, Christian Pirot, 2007.
[4]. Léo Ferré, Vous savez qui je suis, maintenant ?, recueil d’interviews de radio et de télévision transcrites et thématisées par Quentin Dupont, La Mémoire et la mer, 2003.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (6)
jeudi, 06 septembre 2007
À propos des premières chansons enregistrées
Écoutant le disque 33-tours 30-cm Barclay Les douze premières chansons de Léo Ferré – il s’agit bien entendu des douze premières chansons enregistrées, comme on le sait – je me fais ces quelques réflexions.
J’ai découvert ce disque lorsqu’il est sorti en 1969, l’année où j’ai appris l’existence d’un artiste qui s’appelait Ferré. Au moment où Ferré l’enregistre, soit les mardi 4 et mercredi 5 mars 1969, il n’est plus disponible au Chant du Monde, en version piano et chant. Il le ressort alors au catalogue Barclay, avec les orchestrations de Jean-Michel Defaye.
Ces orchestrations sont dans la parfaite lignée du travail que Defaye effectue depuis plusieurs années et qu’il poursuivra durant quelques années encore, pour Léo Ferré. Dans l’esprit et dans la forme, elles ne se différencient pas des précédentes ni des suivantes : Defaye sert Ferré au mieux de son talent. Ferré lui-même, en 1969, est en pleine possession de sa puissance vocale, il a acquis beaucoup de métier, sa voix est celle qui vient de triompher dans C’est extra et qui a fait les beaux soirs de soufre de Bobino, du mercredi 8 janvier au lundi 3 février. De très nombreux jeunes le découvrent cette année-là et, pour eux comme pour moi, ce 30-cm est celui qui leur permet d’entendre pour la première fois ces chansons des débuts.
D’où vient, par conséquent, que, lorsqu’on les évoque, on fasse toujours référence aux premiers enregistrements piano et chant, ceux effectués en 78-tours ou, plus généralement, toujours piano et chant, leur ré-enregistrement en microsillon 25-cm, en 1953 au Chant du Monde… alors que Ferré est sous contrat avec Odéon ? Si mon souvenir est bon – et je crois qu’il l’est – je n’ai entendu, chanté en scène sur cette bande enregistrée Barclay, que Le Bateau espagnol, à Marseille, au Théâtre aux Étoiles, le jeudi 30 juillet 1970. Or, Ferré reprendra pratiquement toute sa vie, en scène, Le Bateau espagnol, ainsi que La Vie d’artiste et À Saint-Germain-des-Prés. Et quelquefois Le Flamenco de Paris, Monsieur Tout-Blanc ou La Chanson du scaphandrier. Il le fera toujours, par la suite, au piano, mais plus jamais avec les bandes enregistrées de l’orchestre de Defaye, bandes auxquelles il fera pourtant appel pour de nombreux autres morceaux, plus du tout pour ceux-là.
Et ces « premières » chansons s’inscriront dans l’imaginaire de chacun dans leur version piano et chant de 1953, y compris pour ceux qui, comme moi, auront d’abord connu les orchestrations et n’achèteront que plus tard le disque de 1953 (intitulé Chansons de Léo Ferré interprétées par Léo Ferré puis, lors d’un changement de pochette, Léo Ferré chante… Léo Ferré), entre-temps réédité, avec un sommaire identique, en 30-cm (sous le titre Léo Ferré chante ses premières chansons puis, lors d’un changement de pochette, Premier Ferré, d’abord en pochette ouvrante puis en pochette simple). Pourquoi ?
C’est d’autant plus étonnant que le 25-cm de 1953, enregistré les mardi 27 et samedi 31 octobre ainsi que le mardi 17 novembre, ne comprend pas Le Temps des roses rouges, pourtant gravé en 78-tours le lundi 20 novembre 1950 mais ignoré lors du ré-enregistrement : il faudra attendre le vendredi 29 mai 1998 pour que cette chanson, dans sa version piano et chant, paraisse en CD (dans le livre-disque La Vie d’artiste, les années Chant du Monde, 1947-1953). Donc, ce texte-là, durant des décennies, ne sera connu – pour ceux, nombreux, qui n’avaient pas les 78-tours originaux – qu’avec les orchestrations de Defaye. Ce qui aurait peut-être pu conférer au 30-cm Barclay orchestré Les douze premières chansons de Léo Ferré (reparu plus tard en CD) une certaine autorité, à tout le moins une prééminence. Il semblerait, avec le recul, que cela n’ait pas été le cas, sans que je puisse avancer d’explication.
Ni entière nouveauté ni réédition à proprement parler, ce disque orchestré paraît avoir un curieux statut. En résumé, la question est triple. Pourquoi ces chansons se sont-elles inscrites dans l’esprit et le cœur du public sous leur forme de 1953, y compris chez ceux qui les ont découvertes, de prime abord, orchestrées ? Est-ce ou non parce que Ferré a fort peu utilisé en scène ces bandes orchestrales, préférant revenir au piano ? Pourquoi a-t-il eu si peu recours à ces bandes, alors qu’il en utilisa d’autres, du même Defaye, toute sa vie ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (50)
samedi, 01 septembre 2007
Encore Prévert
On se souvient de Pierre Misère, le père du petit Benoît, s’occupant à chercher, à l’aide de cubes sur lesquels figurent des lettres, des anagrammes pour son triste nom et ne se montrant jamais satisfait de celles qu’il trouve. Un jour, les cubes tombent et, au sol, forment un mot encore plus désespérant : « remise ». Ne pouvant supporter cette idée, Pierre Misère renonce à ses recherches.
Ce passage du roman Benoît Misère avait beaucoup frappé le jeune homme de dix-huit ans que j’étais lors de ma première lecture, à parution, en 1970. C’est dire que j’ai été surpris, au printemps dernier, de découvrir ceci.
En avril 2007, Gallimard a publié une édition de Paroles de Prévert, dans la collection « Folio », sous coffret illustré, accompagnée d’un mince livret en quadrichromie, hors-commerce, reproduisant quelques fac-similés d’éditions originales, de collages, de lettres et d’autres documents autographes de Prévert. Ce livret est intitulé Prévert en ses livres, le copyright des dessins et autographes appartient à « Fatras », la succession de Jacques Prévert. C’est plaisant, mais cela reste une opération commerciale de la part de l’éditeur, visant à faire acheter ce qu’on possède déjà.
L’objet de cette note est naturellement ailleurs.
Sur l’une de ses faces, le coffret lui-même reproduit en couleurs, dans l’autographe de Prévert, quelques anagrammes et calembours du poète, malheureusement sans date ni référence aucune. Parmi les « avenir navire », « Turc truc », « image magie », « la gauche et l’adroite » et autres, que peut-on lire ? On l’aura deviné : « misère remise ».
Bien entendu, Ferré ne pouvait avoir eu connaissance de cette page inédite. Je ne pense pas que Prévert lui en ait parlé : il l’aurait un jour ou l’autre raconté. Il n’y a donc pas de réminiscence, cette hantise de l’écrivain qui se figure trouver une chose qu’il a lue autrefois, parfois longtemps avant, sous une autre plume et qui l’a marqué. Est-ce alors que, par coïncidence, ces deux amoureux des mots auraient eu la même idée ? Ce n’est pas impossible. L’anagramme, d’ailleurs, est assez évidente. Ce qui vaut dans le roman, ce n’est pas l’anagramme elle-même, mais la dramatisation dont Ferré l’entoure. Peut-on dire – ou est-ce excessif ? – que les deux hommes avaient une tournure d’esprit commune, à tout le moins proche ? Sont-ils en cela les principaux représentants des « retombées » du surréalisme dans la poésie populaire ?
Prévert, là encore, croise Léo Ferré, ainsi qu’on avait tenté d’en parler dans une note précédente.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (24)
mardi, 21 août 2007
Réouverture prochaine du blog
Rien ne figure en ce moment en page d’accueil, car ce sont seulement les textes des trente et un derniers jours qui se trouvent à l’écran. Tout est cependant disponible par les divers moyens de recherche (archives, catégories et index).
Si vous en avez toujours envie, l’établissement rouvrira le 1er septembre prochain, comme toujours à zéro heure. Le taulier n’a pas fait grand-chose ces dernières semaines, mais un programme de rentrée est cependant prévu.
15:15 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)
dimanche, 15 juillet 2007
Le temps joli
 Je m’en vais demain
Je m’en vais demain
Parcourir le monde
Et dans cette ronde
Je battrai des mains
Je ne sais la belle
Si je reviendrai
Tout ce que je sais
C’est ma ritournelle
(LES GRANDES VACANCES)
Le taulier et la taulière partent à la campagne pour quelque temps. Sans avoir internet à portée de la main, il leur sera difficile de faire vivre ce blog durant quelques semaines, mais les anciennes notes ne portent pas de date de péremption et les commentaires restent ouverts en permanence. En fonction des ordinateurs disponibles sur son chemin perdu dans les bois, l’affreux taulier fera son possible pour répondre et animer ce lieu, au moins de loin en loin. Les discussions reprendront, par conséquent, en septembre, si le cœur vous en dit. La date n’est pas encore fixée, mais ce sera toujours à minuit, l’heure des cabarets, que naîtront les chansons. Merci pour votre participation aux huit premiers mois d’existence de ce lieu. Amicalement à tous.
(Prospectus annonçant un récital au gymnase Joliot-Curie,
Le Plessis-Robinson, le 12 octobre 1985)
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (7)
samedi, 14 juillet 2007
Dommage
Il fut un temps où les interprètes étaient des chanteurs, c’est-à-dire des gens ayant une voix, du souffle, une présence. On pouvait les écouter comme des artistes à part entière dans un répertoire qu’ils avaient construit, erreurs éventuelles comprises, avec soin. On est loin de nombreux « interprètes » d’aujourd’hui qui sont vocalement ineptes, artistiquement infâmes, scéniquement consternants, et qui ne « chantent » Ferré que pour exister eux-mêmes, de loin en loin. Le pire est qu’ils trouvent un public – qu’on veut espérer abusé ou attendri car venu pour Léo Ferré – pour les applaudir.
Ferré qui pensait, il l’a souvent dit, les chansons faites pour être chantées, avait souvent des idées originales dans ce domaine et l’on peut effectuer un rapide tour d’horizon des propositions qu’il fit lui-même aux interprètes du moment. On ne redira pas les refus que tout le monde connaît, mais on rappellera ceux qu’on peut considérer comme des pertes sèches pour la chanson.
Le plus grand regret, peut-être, les poèmes de Baudelaire avec sa musique, que Léo Ferré avait lui-même proposés à Piaf. On connaît la réponse : « Non, Léo, Baudelaire, c’est sacré ». On peut penser que Piaf a été effrayée par la perspective de chanter les Fleurs du Mal. Et pourtant, Piaf chante Baudelaire, musique de Léo Ferré, c’eût été quelque chose, il me semble. On aurait certainement pu discuter ce disque, voire le critiquer sévèrement, mais il eût incontestablement existé et compté.
On connaît le projet de faire chanter à Johnny Hallyday Les Albatros. Avorté pour une raison inconnue : selon toute vraisemblance, l’entourage du chanteur lui aurait déconseillé cet enregistrement, qui pouvait être de nature à déstabiliser son public. On n’en sait pas plus.
Comme on ignore les raisons – vraisemblablement les mêmes – de Mireille Mathieu pour ne pas chanter La Mort des loups. Léo Ferré voulait lui faire interpréter ce texte, jugeant qu’elle avait une voix lui autorisant autre chose que son habituel répertoire.
Moins connu est le refus opposé par les Compagnons de la chanson. Je m’étais souvent demandé pourquoi les Compagnons n’avaient jamais chanté Ferré. La réponse à cette interrogation est donnée dans ses souvenirs, récemment publiés par Fred Mella. Ferré aurait aimé leur donner Mon p’tit voyou. Le groupe trouva la chanson beaucoup trop intime pour figurer dans un répertoire à plusieurs voix. La règle des Compagnons, pour travailler et graver une chanson, était l’unanimité, que la proposition de Ferré ne recueillit pas. Je ne peux m’empêcher d’imaginer ce que cela aurait donné et je pense qu’au contraire, cette interprétation serait vraiment sortie des sentiers battus et aurait pu faire date. Léo Ferré, en effet, s’était certainement posé lui-même la question avant d’avancer ce titre.
Juliette Gréco a chanté plusieurs œuvres de Ferré. Elle qui pourtant peut tout oser, lui avait refusé Les Bonnes manières. Là aussi, on peut rêver à ce qu’elle en aurait fait, qui n’eût certainement pas été à jeter au ruisseau.
Je m’aperçois que cette note va paraître le 14 juillet, date à laquelle de nombreux interprètes, ici et là, chantent Ferré. Ce n’était pas préconçu et, finalement, c’est peut-être aussi bien.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (15)
mardi, 10 juillet 2007
Les articles d’Edmée Santy
La boussole des veuve(s) aveugles sous leur voile
(À TOI)
Sur internet, les voix de femmes s’expriment fort peu au sujet de Léo Ferré. C’est étonnant : depuis soixante ans, les interprètes féminines sont très nombreuses, les journalistes femmes aussi. J’ai souvent dit combien Claude Sarraute avait su tenir à un beau niveau la chronique de variétés du Monde, combien, parmi tant d’artistes dont elle a parlé, elle a célébré Léo Ferré qu’elle admirait, ne se privant pas cependant de lui dire son fait lorsqu’elle l’estimait utile. La collection de ses articles possède aujourd’hui encore une réelle valeur. Loin de là, tout au sud, aux rives de la mer antique, une autre journaliste devenait lyrique lorsqu’elle évoquait l’artiste.
À Marseille, on peut alors lire trois quotidiens du matin : Le Méridional-La France qui est de droite et dont le rédacteur en chef, Gabriel Domenech, s’illustrera plus tard en se présentant à des élections locales sur les listes du Front national ; Le Provençal, sous-titré « Journal des patriotes socialistes et républicains » ; enfin, La Marseillaise, journal communiste. Le soir, une seule feuille locale est vendue dans les kiosques, Le Soir, justement. Je précise toujours Le Soir « de Marseille » pour éviter d’éventuelles confusions avec le célèbre journal belge. Le Soir appartient au Provençal, c’est un peu son édition vespérale ; il comprend relativement peu de pages. Edmée Santy signe les chroniques de variétés.
Le 7 mars 1972, un article non signé paraît (je respecte dans les articles cités ci-après les alinéas, capitales et guillemets abondamment utilisés par la journaliste) :
PALAIS DES CONGRÈS (jeudi et vendredi)
LÉO FERRÉ
accompagné par ZOO
(Photo Jo Nahon, Le Soir)
Léo Ferré sera jeudi et vendredi prochain à Marseille avec les « Zoo » au Palais des Congrès.
Ce grand poète de la chanson française, l'homme du « dialogue avec la solitude » présentera son tour de chant accompagné par l'excellent orchestre pop « Zoo ».
À une journaliste qui lui demandait : « Avec votre dernier disque apparaît une forme nouvelle dans votre univers musical : la pop musique, pourquoi ? »
Léo Ferré répondait : « La pop musique... ça à l'air d'une blague, mais c'est vrai, du moins au début – c'est un bruit énorme – cela dit, c'est une façon neuve de concevoir la musique, c'est une esthétique particulière ».
Avant son prochain passage à l'Olympia, dans quelques jours les Marseillais pourront donc apprécier le nouveau tour de chant du grand « Ferré ».
Les places sont en vente chez Gébelin-pianos, 77, rue Saint-Ferréol, Marseille.
Le 8, soit le lendemain, Le Soir annonce :
Demain (et vendredi)
PALAIS DES CONGRÈS
FERRÉ ET ZOO
Léo FERRÉ sera demain et vendredi à Marseille, avec les ZOO au Palais des Congrès.
Le grand poète de la chanson française, l'homme du « dialogue avec la solitude », l'éternel chantre de la révolte et de la tendresse, présentera son tour de chant accompagné par l'excellent orchestre pop « ZOO ».
À une journaliste, Françoise Travelet, qui lui demandait : « Avec votre dernier disque apparaît une forme nouvelle, dans votre univers musical la pop musique, pourquoi ? »
Léo FERRÉ répondait : « La pop musique... ça à l'air d'une blague, mais c'est vrai du moins au début. C'est un bruit énorme – Cela dit, c'est une façon neuve de concevoir la musique, c'est une esthétique particulière. Ce n'est pas tellement la musique en soi que tout ce qu'il y a autour, politiquement, sociologiquement. Elle est liée à une pensée jeune, libérée ».
Avant son prochain passage à l'Olympia, dans quelques jours les Marseillais pourront donc apprécier le nouveau tour de chant du grand « FERRÉ ».
Les places sont en vente chez GÉBELIN-PIANOS, 77, rue Saint-Ferréol.
Le lendemain toujours, le 9, on peut lire :
Ce soir et demain
au Palais des Congrès
Léo Ferré
Léo Ferré sera ce soir jeudi, et demain vendredi, à Marseille avec les « Zoo » au Palais des Congrès.
À une journaliste, Françoise Travelet, qui lui demandait : « Avec votre dernier disque apparaît une forme nouvelle, dans votre univers musical : la pop musique, pourquoi? ».
Léo Ferré répondait : « La pop musique... Ça a l'air d’une blague, mais c'est vrai, du moins au début – c'est un bruit énorme – cela dit, c'est une façon neuve de concevoir la musique, c’est une esthétique particulière ». Avant son prochain passage à l’Olympia dans quelques jours, les Marseillais pourront donc apprécier le nouveau tour de chant du grand « Ferré ». Les places sont en vente chez Gébelin-pianos – 77, rue Saint-Ferréol.
Ce spectacle annoncé de nombreuses fois, se déroulera mal, comme on l’a déjà raconté. Le 10 mars, Edmée Santy signe cette fois :
Music-hall
Face aux fauves du palais des Congrès
Un ALBATROS rugissant : LÉO FERRÉ
soutenu par de jeunes lions : LES ZOO
Ses yeux de myope l'empêchant de ciller, ses mains d'enchanteur l'empêchant de cogner, son cœur d'Archange noir l'empêchant de se battre, FERRÉ, superbe et solitaire « ALBATROS » a hier, maté la hargne, la bêtise de quelques cinquante fauves perturbant par leurs farandoles « internationales » et leurs poings de blanc bec, une salle archicomble, venue, une fois encore, entendre le MAGE.
Au nom de quel « isme », de quelles frontières, de quelle révolution, ces puérils desperados croient-ils que cracher à la face du POÈTE c'est faire acte d'adulte.
« La Poésie, ça ne se lave pas », FERRÉ ne les a pas attendus pour se moucher dans l'anti-conformisme, pour fouler l'ordre, pour clamer qu'il vit « à la dimension 4 ». FERRÉ a payé assez cher de suivre son « enterrement », de se barder contre les c.., qui le « lapideront ». FERRÉ, avec ou sans « PÉPÉE » ne l'a-t-il pas vécu, lui, son « Âge d'or » ?
Alors pour ces « limonaires » auréolés d'azur, pour cette « bouche ouverte comme du feu », alors pour ces « JE T'AIME » dressés en holocaustes, alors que [sic] pour ces « papiers » extorqués au Poète pour « Ton style » charriant le sang, la vie, l'ordure peut-être, mais toujours des gemmes constellés, c'est à vous, Monsieur FERRÉ, que nous disons « Thank you ».
Anarchiste de la planète Minerve, combattant de Satan et du Bonhomme Dieu, les chaînes de Renault et des vitamines factices ne les a-t-il pas brisées pour qu'on le laisse poursuivre son monologue. Ce long et sublime cri qu'à force de pousser les étoiles elles-mêmes en ont tremblé dans la galaxie.
On ne jette pas des pièces dans la sébile de Monsieur FERRÉ, on ne bivouaque pas en campus rageurs à ses pieds. On l'écoute, et on se tait car, de Belleville à l'Huveaune, de l'Oural à Billancourt qui, à part lui, a parcouru tant de chemins, semé autant de constellations ?
Dans ce pugilat atroce, Ferré a trouvé chez les « ZOO » d'ardents chevaliers. Étonnants « lions » entonnant leurs décibels « pop » mais prouvant que pour faire du bruit, certains jeunes savent encore entendre battre leur cœur ; ce cœur qui, au rythme du « Patriarche », a repris le goût de la dignité.
Si vous êtes un « chien », Monsieur FERRÉ, permettez-nous, de faire taire la meute des roquets pour que le bruissement de « vos ailes de géant » emplissent notre « Solitude ».
Votre « Solitude », qu'avec ou sans clin d'œil, avec ou sans trompette (ni clairon) vous assumez à en mourir... d'aimer.
Edmée SANTY
LÉO FERRÉ et les ZOO seront à nouveau ce soir au Palais des Congrès. Rappelons que, paradoxalement, la venue de « l'ANAR », de l'Interdit, du « Maudit » est organisée par les concerts MAZARINE, hôtes habituels de l'Abbaye de Saint-Victor.
La tournée qu’il fait à la suite de son spectacle de l’Olympia amène Ferré à Marseille en décembre. Il se produit au théâtre Toursky, comme l’annonce Le Soir du 16.
Léo
FERRÉ
au théâtre Axel-Toursky
du 19 au
23 décembre
Léo Ferré, qui s'est produit l'année dernière [sic] avec le groupe pop « Zoo », sera de nouveau à Marseille dans les prochains jours. Il chantera, du 19 au 23 décembre, à 21 h, au théâtre Axel-Toursky (22, rue Édouard-Vaillant).
Léo Ferré, seul avec lui-même (et avec son pianiste), va dialoguer avec les étoiles, l'amour, la vie, cette « chienne de vie » dont il est le poète illuminé et incomparable.
Pour ces soirées exceptionnelles, la location est ouverte au théâtre Toursky (tél. 50 75 91).
Deux jours plus tard, le 18, une nouvelle annonce est faite :
LÉO FERRÉ
Le théâtre Axel-Toursky nous communique : location terminée pour demain mardi – complet –. On peut encore louer pour samedi et les autres jours.
Le lendemain, 19 décembre, on rappelle :
Pour 3 soirs à Marseille
(au théâtre Axel-Toursky)
Monsieur FERRÉ
Si ce soir le théâtre Axel-Toursky affiche complet pour la première du récital Léo FERRÉ, l’on peut encore louer, pour demain et jeudi soir (22, rue Édouard-Vaillant), la venue de Monsieur FERRÉ – avec son seul pianiste – à Marseille est un événement, le poète écorché n'est-il pas, déjà, entré dans la légende ?
(Photo Le Soir)
La relation du spectacle paraît le 20, dans un texte signé de la journaliste :
L'ACTUALITÉ DES ARTS ET DU SPECTACLE
Au THÉÂTRE AXEL-TOURSKY (jusqu'au 23 inclus)
FERRÉ 72 : une clameur torrentielle et constellée
Une clameur, un coup de g..., un coup de poing, une âme déchirée, constellée, un torrent de boue et d'étoiles, le cri de la Bête pour ne pas entendre les pleurs de l'Ange, un géant crucifié, déchiré, loqueteux, sublime, des cheveux enneigés auréolés d'épines et de cendres, un FERRÉ tout noir, un FERRÉ tout rouge, un FERRÉ délirant, dialoguant avec le cosmos, un « voyant » de l'an 10. 000, un amant ébloui qui tonne et insulte pour mieux prier, un déluge de pudeur, un hymne à l'Amour, voilà le FERRÉ 72.
Seul, avec Paul CASTAGNIER [sic], le complice de la nuit obscure, le compagnon du clavier, FERRÉ se met à nu, « géométrise son âme », interroge « Qui donc inventera le désespoir ? », cueille « la fleur de l'âge », rapetasse les souvenirs de « ceux qui n'ont plus de maison », déclenche le vacarme des vitrines, se gausse de la « mélancolie » et ballotté, cahoté, démiurgique face à la lèpre, au quotidien, au vice de bas étage, aux compromissions, aux évasions de « super-marché », déflingue les boutons de la télé « consommation » pour édifier une ode monumentale, déchirante, « LES AMANTS TRISTES », un mausolée qui a le goût du soufre mais une coupole en plein azur. Si LAUTRÉAMONT avait été amoureux, si RIMBAUD avait vécu, si GENET savait regarder, ils auraient employé les mêmes mots, auraient inventé un identique « miracle des voyelles ».
Et FERRÉ, lui, plie, lit, froisse l'autre jusqu'à ce qu'elle crée, jusqu'à ce que le maëlstrom du désir balaie et confonde les corps à l'anéantissement de l'âme.
Vingt-neuf titres, un glossaire, le Coran des « Mal aimés », des « Trop aimants », la Bible dégorgée des « Solitaires », un récital qui n'en est pas un tant la tension, la hargne, la vomissure, les « tripes », la voix s'entrechoquent, s'affrontent, s'empoignent, « s'archangélisent ».
• Vingt-neuf titres qui font mal et qui éblouissent,
• Vingt-neuf prières,
• Vingt-neuf colères,
• Vingt-neuf poèmes qui donnent tort à Monsieur d'Alambert, aux ordonnateurs, aux geôliers, aux revendeurs de médiocrité, à tous ceux qui veulent « culturiser » l'absurde et endoctriner les théorèmes,
• Vingt neuf merveilles nauséabondes et cosmiques qui permettent de croire en autre chose, de voir la Voie lactée, de déboulonner « la Jeune Parque », d'apporter, à la pointe du cœur, la preuve rageuse que la Poésie n'est pas asexuée ni éthérée, qu'elle est une clameur qui n'a pas fini de lézarder les HLM comme les Élysées, et qu'il faudra bien, un jour, en l'an 10. 000, parce que maintenant « il n'y a plus rien » que nous ayons alors « le temps d'inventer la vie ».
• Le drapeau noir de l'oppression, de l'opprobre, de l'injustice, le drapeau sang de la Révolution, le drapeau artificiel et « dé-hampé » d'une jeunesse étriquée, vous voyez bien que LÉO FERRÉ les a abattus pour mieux planter son étendard à lui, celui du délire, de l'amour et du génie.
Edmée SANTY.
UN HIBOU, UN VAUTOUR, UN AIGLE, UN HOMME (Photo Gaston Schiano).
ATTENTION LÉO FERRÉ EST AU THÉÂTRE AXEL-TOURSKY, 22, RUE ÉDOUARD-VAILLANT, 50 75 91, CE SOIR, DEMAIN JEUDI, VENDREDI 22 ET SAMEDI 23.
Le 21, Le Soir insiste encore :
« FERRÉ 72 »
au TH. « TOURSKY »
(22, rue Édouard-Vaillant
tél. 50 75 91)
une clameur et un
hymne à entendre
ce soir, demain, samedi
Le 23 enfin, le journal regrette :
Th. « A.-Toursky » :
dernière, ce soir
FERRÉ
FERRÉ est venu, Ferré s'en va mais ce soir encore pour la dernière fois nous entendrons sa clameur et son chant d'amour et de rage (Théâtre Axel-Toursky, 22, rue Édouard-Vaillant, téléphone 50 75 91).
Plus tard cette fois, le 12 janvier 1974, Le Soir annonce :
Au « Toursky » (22 au 27)
LÉO FERRÉ
C'est un rendez-vous à ne pas manquer avec cet authentique poète qui ne cesse de crier sa colère ou son espoir ; son amour ou sa haine.
Seul en scène ; il nous revient pour cinq soirées en ce début d'année 1974.
Lui, qui dès le départ a cru en la démarche de Richard Martin, marque son attachement au théâtre Toursky en venant se produire une fois de plus sur la scène du Toursky.
La location est ouverte librairie La Touriale, bd de la Libération, maroquinerie Dallest, cours Belsunce, au théâtre – tél. 50 75 91.
Prix des places 15 F + taxes.
Le 22, soir de la première, on peut cette fois lire :
Au « Toursky »
LÉO FERRÉ
Le voici donc qui revient, par amitié, par fidélité, par talent, le voici, ce Léo FERRÉ, encore grandi sous la neige des cheveux et encore plus solitaire dans l'arène de l'humanité.
Un FERRÉ tout noir, un FERRÉ tout rouge, le FERRÉ poète qui prie et chante son génie comme d'autres dressent des barricades ou cultivent leur jardin. Un FERRÉ qui a signé avec Richard Martin du théâtre TOURSKY un pacte de qualité, de lutte et de confiance.
Un FERRÉ qui pour les Marseillais retrouvés chantera dès ce soir et jusqu'au 26 janvier tout ce qu'il a dans la tête et dans le cœur, c’est-à-dire le monde entier.
Théâtre TOURSKY, 22, rue Édouard-Vaillant (tél. 50 75 91).
Curieusement, pour la première fois depuis des années, ce n’est pas Edmée Santy qui rendra compte de ce spectacle, mais Jean-René Laplayne.
Je ne pense pas posséder dans mes dossiers la totalité des articles qu’Edmée Santy a consacrés à Léo Ferré. Ces quelques textes sont suffisamment révélateurs, néanmoins, de l’admiration qu’elle lui portait. Ces articles, bien sûr, sont un peu brouillons, pas toujours rédigés dans une langue très correcte : Edmée Santy, avec son usage abusif des capitales, des guillemets et ses alinéas constants, n’est pas Claude Sarraute. Ils montrent en revanche – au moins en partie – l’effet que pouvait produire Ferré sur les femmes, sur une femme dont la profession était de rédiger ces comptes rendus de spectacles et qui, à ce titre, aurait pu le faire avec beaucoup plus de distance. Ces coupures de presse fleurent bon, aussi, une époque de la société, un moment du poète.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (53)
jeudi, 05 juillet 2007
Aimer Ferré
Je me suis toujours demandé ce que signifiait, pour ceux qui l’aiment, le fait de, justement, « aimer Léo Ferré ». La question vaut, d’ailleurs, pour tous les artistes et même pour tous les sujets possibles.
Aimer Ferré, est-ce que cela peut être l’aimer « comme ça », c’est-à-dire connaître quelques chansons et prendre plaisir à les écouter ? Ou bien connaître quelques chansons et apprécier d’en découvrir d’autres ? Est-ce avoir une vague connaissance de l’homme et de son œuvre, être à peu près capable de le situer artistiquement ? Est-ce collectionner stérilement les documents, de quelque nature qu’ils soient, pour le plaisir maladif d’accumuler des objets reliés par un thème ? Encore existe-t-il plusieurs niveaux de gravité de cette maladie communément désignée par le terme de « collectionnite ». Est-il utile de préciser que je n’aime pas (litote) les collectionneurs stériles ? Aimer Ferré, est-ce encore adouber tout interprète même médiocre qui ne vise qu’à se servir lui-même, et s’imaginer que la mémoire de Ferré et la vie de son œuvre ont besoin de l’interprète en question, ce qui serait d’ailleurs plutôt étonnant : confier la postérité (dont l’artiste lui-même n’avait que faire, d’ailleurs) à la nullité est un pari risqué. Aimer Ferré, est-ce pouvoir négliger la lecture d’ouvrages qui lui sont consacrés (il n’est pas besoin, je pense, de préciser ici que je ne mets absolument pas mes propres livres dans la balance ; ma question demeure de portée générale) ? Est-ce tirer un trait sur ce qui paraît a priori difficile et qui, concrètement, se révèle être, la plupart du temps, la partie de l’œuvre non chantée ? Est-ce refuser de considérer l’œuvre dans toutes ses dimensions et de tenter le cheminement intellectuel indispensable à la cohésion : y a-t-il grand-œuvre ou pas ? Et si oui, pourquoi négliger certains de ses aspects ?
Étudier un sujet, un domaine, une création, est une chose que je ne conçois pas sans un investissement complet : connaître l’œuvre dans le détail, lire tout ce qui a été écrit sur la question, en tirer des travaux personnels. C’est de cette manière que je procède, dans tous les domaines qui m’intéressent – ils sont nombreux – depuis toujours.
Que ce qui précède ne soit surtout pas mal compris. Loin de moi l’idée de dicter des conduites, d’imposer des points de vue. J’ai assez répété qu’ici, je ne disais pas le droit. Simplement, il me semble qu’aimer tel ou tel artiste, tel ou tel auteur, s’intéresser à tel ou tel domaine, cela ne peut pas être superficiel. Aimer Ferré, qu’est-ce que c’est ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (42)
mardi, 03 juillet 2007
Couleurs d’aimer
Mon p’tit voyou, très tendre chanson de Léo Ferré, dont le titre, il faut peut-être le rappeler car l’expression n’a guère plus cours aujourd’hui, signifie « mon chéri », « mon amour », est ainsi construite : quatre sixains d’octosyllabes croisés avec des tétrasyllabes, fondés sur des couleurs : gris pour la tristesse, bleu pour l’amour, vert pour l’espoir, noir pour la mort. Ce schéma très classique sert cependant une pensée émue, articulée non en une progression, mais en un bouquet de thèmes familiers de la poésie lyrique.
Bien plus tard, Léo Ferré enregistre De toutes les couleurs, dont la structure est plus complexe : cinq neuvains d’alexandrins construits selon le schéma de rimes a-a-a-b-c-c-d-d-b. Les strophes sont toujours, cependant, fondées sur des couleurs : vert pour l’espoir, bleu pour l’amour, jaune pour la folie, rouge pour la passion, noir pour la mort.
Au fond, rien n’est fondamentalement différent : seules deux couleurs sont ajoutées au spectre initial et, pour ce qui est de leur symbolique, elles demeurent classiques. Seul le jaune devient l’emblème de la folie, parce que, dans l’univers de l’auteur, il est supposé être nécessairement celui de Van Gogh. L’amour physique est maintenant très fortement présent, expressément dit : « De toutes les couleurs du rouge où que tu ailles / Le rouge de l’Amour quand l’Amour s’encanaille / Au bord de la folie dans la soie ou la paille / Quand il ne reste d’un instant que l’éternel / Quand grimpe dans ton ventre une bête superbe / La bave aux dents et le reste comme une gerbe / Et qui s’épanouit comme de l’Autre monde / À raconter plus tard l’éternelle seconde / Qui n’en finit jamais de couler dans le ciel » alors que, s’agissant de Mon p’tit voyou, les pudibondes années 50 n’autorisaient guère que « Quand tout est bleu / Y a l’ permanent dans tes quinquets / Les fleurs d’amour s’fout’nt en bouquet / Quand tout est bleu / C’est comme un train qui tend ses bras / Y a pas d’ raison que j’te prenn’ pas » – avec l’ambiguité voulue dans l’acception du verbe « prendre » : le train ou la femme ?
Chez Léo Ferré, on le sait, il n’est pas de différence intrinsèque entre l’amour courtois et l’amour physique, ainsi qu’il en va, d’ailleurs, dans toute la tradition de la poésie lyrique qui, par ses thèmes mêmes, n’a jamais fait que contourner, notamment au moyen des blasons, l’interdiction sociale de dire le corps, ses fêtes et ses fastes.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (7)
vendredi, 29 juin 2007
Du mode de fonctionnement de ce lieu
Je pense devoir rappeler de quelle manière fonctionne ce lieu. Cela, d’ailleurs, n’était pas préconçu. Ces aspects se sont éclairés au fil des mois.
Je traite les sujets en fonction, évidemment, de mon désir de le faire à tel ou tel moment (ce qu’on nomme habituellement « inspiration ») ; de ma documentation, qui n’est pas infinie ; de la possibilité d’apprendre éventuellement, et avec beaucoup d’humilité, quelque chose à quelqu’un ; de la cohérence du propos au secours de laquelle j’appelle quelquefois les liens d’une note à l’autre.
L’actualité n’est jamais un critère puisque le fond, en principe, est prédominant ou tente de l’être.
D’une manière générale, je n’écris de textes que choisis par moi. J’ai reçu à plusieurs reprises des demandes auxquelles je n’ai pas accédé, le principe étant qu’on ne passe pas commande. Comprenons-nous, surtout : on ne passe pas commande non parce que je me tiens dans ma tour d’ivoire, mais pour la simple raison que je ne suis pas omniscient et n’ai pas forcément la capacité de traiter un sujet qui m’aura été suggéré. En revanche, j’accueille qui veut dans la catégorie « Les invités du taulier » : dans ce cas, l’auteur a carte blanche.
Concernant les textes nés de conversations privées avec des participants, et singulièrement avec The Owl, l’esprit est différent. Parfois, lorsque la discussion s’étoffe, prend une certaine ampleur, je me dis qu’elle est susceptible d’intéresser d’autres lecteurs : j’en tire alors une note. Certes, tout ce qui se rapporte à Léo Ferré m’intéresse, mais il y aussi une question d’opportunité. Lorsque le sujet n’est pas de mon choix, il ne me touche pas forcément à ce moment-là. Ainsi, je n’aurais pas envisagé de traiter des contestataires de Ferré : j’avais prévu un autre billet, que j’ai repoussé de quelques jours. Toutefois, même dans ces cas-là, je fais évidemment de mon mieux pour répondre aux interrogations des participants, quand je peux y parvenir.
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (2)