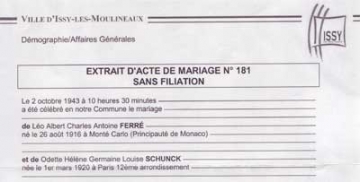vendredi, 09 mars 2007
Récital Place des Arts à Montréal, mars 1974, par Jacques Miquel
En complément des deux notes que j’ai consacrées à des récitals de l’année 1974, Jacques Miquel m’a adressé des précisions : le même spectacle (ou sans doute, très proche) a été donné au Québec. Voici le programme détaillé, qui a de plus l’avantage de répondre à une question précédemment posée par The Owl. C’est bien dans cet esprit de partage et d’apports mutuels que je comprends ce lieu. Merci à Jacques Miquel.
Après avoir réalisé ses ultimes enregistrements dans les studios Barclay à Paris les 7 et 8 janvier 1974, Léo Ferré part en tournée dans le sud-est de la France (notamment Lyon, Nice, Marseille…) Du 8 février au 1er mars, il donne sa série de récitals à l’Opéra-Comique à Paris, puis retourne en Italie où il se marie le 5 mars avec Marie-Christine Diaz, et enfin part donner une série de récitals au Québec. Les 22, 23 et 24 mars, il se produit à la salle de la Place des Arts à Montréal. Les 30 et 31, à Québec. Comme c’est désormais le cas le plus courant, il est seul en scène, et chante soit sur des bandes orchestrales, soit en s’accompagnant lui-même au piano. Au programme de ce récital québécois, vingt-sept titres qu’il enchaîne dans l’ordre suivant :
Pauvre Rutebeuf – version incomplète a cappella
La Vie d’artiste (F. Claude et L. Ferré) – accompagnement au piano
Préface – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Green (Verlaine) – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
Les Oiseaux du malheur – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Flamenco de Paris – accompagnement au piano
Marie (Apollinaire) – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Damnation – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Petite – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
On s’aimera – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
La Mort des amants (Baudelaire) – accompagnement au piano
Madame la Misère – bande orchestrale – dir. Jean-Michel Defaye
Il est six heures ici… et midi à New York – accompagnement au piano
Night and day – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Les Étrangers – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
L’Oppression – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Avec le temps – accompagnement au piano
Le Chien – a cappella
Les Amants tristes – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
Ne chantez pas la mort – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Mémoire et la mer – accompagnement au piano
La Solitude – bande orchestrale Zoo + cordes dir. Léo Ferré
Richard – accompagnement au piano
Je t’aimais bien tu sais – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
La Folie – accompagnement au piano
Il n’y a plus rien – début accompagné au piano puis le reste a cappella
L’Espoir – bande orchestrale – dir. Léo Ferré
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (30)
mercredi, 07 mars 2007
En solitaire
Après sa séparation d’avec Paul Castanier, fin mai 1973, Léo Ferré, on le sait, continue seul. Il n’aura plus jamais d’autre pianiste. Il emploiera des bandes enregistrées et s’accompagnera lui-même, comme il l’avait fait autrefois, au temps des cabarets. C’est ainsi que le public qui n’était bien sûr pas au courant découvrira un jour, en s’installant dans la salle, un piano disposé non pas sur le côté, mais au milieu de la scène, à quelques pas du micro central. Curieux… Que se passe-t-il ?
Ferré est entré en scène, a chanté a capella le tout-début de Pauvre Rutebeuf. Après le vers « Les emporta », il a mis un doigt sur ses lèvres pour demander le silence et s’est assis au piano, enchaînant avec la première chanson. Les quelques vers de Rutebeuf constituaient une réponse par anticipation aux questions que se posaient les spectateurs. C’est tout ce que le public saura de cette séparation. C’est le souvenir essentiel que conservent les trois amis de cette soirée de janvier 1974 au théâtre Axel-Toursky, à Marseille. Ferré seul en scène, vraiment seul en scène.
Le théâtre ne disposait pas, semble-t-il, d’un tabouret de piano : l’artiste est assis sur une chaise, comme en témoigne cette mauvaise photographie.
Et il alterne : assis à son clavier, debout derrière son micro, comme le découvriront les plus jeunes durant un peu moins de vingt ans encore. C’est la seule image de ses récitals qu’ils connaîtront.
« C’est un rendez-vous à ne pas manquer avec cet authentique poète qui ne cesse de crier sa colère ou son espoir ; son amour ou sa haine. Seul en scène, il nous revient pour cinq soirées en ce début d'année 1974. Lui, qui dès le départ a cru en la démarche de Richard Martin, marque son attachement au théâtre Toursky », annonce la presse [1]. « Un Ferré qui a signé avec Richard Martin un pacte de qualité, de lutte et de confiance » ajoute, quelques jours plus tard, le même journal [2]. On loue à la librairie La Touriale, boulevard de la Libération, à la maroquinerie Dallest, cours Belsunce, et au théâtre. Les places coûtent quinze francs. Jean-René Laplayne relèvera ensuite qu’« il arrive seul en scène. Une image de prophète. Aucun musicien : les accompagnements sont pré-enregistrés. Entre piano et micro, le temps de vingt-cinq chansons et textes, Léo Ferré a fait, une fois de plus, hier soir, surgir de sa tête et de son cœur l’univers d’une « poésie qui se bat » (…) Hier soir, le théâtre Toursky avait son plein de jeunesse. Face à elle, enchaînant sans un mot de chanson en chanson et de texte en chanson, Léo Ferré était bien ce prophète qui lui annonçait à la fois l’amour et le malheur, qui dessinait pour elle un monde à sa mesure et lui donnait même rendez-vous dans dix siècles [3] ».
Pour des gens comme moi, c’est une des quatre variantes : avec Popaul, avec le groupe Zoo, seul, avec orchestre symphonique. D’autres, plus âgés certainement, auront connu la petite formation qui l’accompagnait autrefois au Vieux-Colombier, à l’Alhambra ou à l’ABC, par exemple. Auparavant, il y avait eu le tandem Castanier-Cardon, piano et accordéon, ou le trio Castanier-Cardon-Rosso, piano, accordéon et guitare. Plus anciennement, on retrouve Ferré seul au piano : la boucle se ferme.
___________________
[1]. Le Soir (de Marseille) du 12 janvier 1974.
[2]. Le Soir (de Marseille) du 22 janvier 1974.
[3]. Le Soir (de Marseille) du 23 janvier 1974.
(Théâtre Axel-Toursky, Marseille,
entre le 22 et le 26 janvier 1974. Photos X)
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (15)
lundi, 05 mars 2007
« C’est pas moi… »
Aix-en-Provence, 1974. En haut à droite du cours Mirabeau, le cinéma Rex est aussi une salle de spectacles avec une vraie scène. Léo Ferré est à l’affiche. Trois amis sont venus de Marseille pour l’entendre. Ils l’ont déjà vu dans cette salle, l’année précédente, lors de sa tournée commune, maintenant achevée, avec Charlebois. Ferré est seul depuis sa séparation, l’année précédente, d’avec son pianiste Paul Castanier et son secrétaire Maurice Frot. Il chante.
Brusquement, on entend claquer une porte et un jeune homme entre en criant : « Monsieur Léo ! Y a vos enfants qui se font casser la gueule dehors. Faites quelque chose, bon sang ! » Ce sont ses mots exacts. Léo Ferré, à ce moment-là debout derrière son micro, est interrompu en pleine chanson, il hésite, dit comme un enfant : « C’est pas moi… » Le jeune homme s’en prend à la salle, lui reprochant en substance de ne rien dire, rien faire. Mais de quoi s’agit-il ? Personne ne le sait. Le jeune dit qu’il « y retourne » et sort. Ferré se remet au piano : « On dit que ce sont mes enfants, mais c’est pas vrai. Moi j’ai un fils, il a quatre ans, il s’appelle Mathieu, et c’est un mec. Voilà ». Il enchaîne : « Avec le temps… »
Depuis trois ans, le schéma est habituel : des jeunes veulent assister gratuitement au récital, la direction refuse, appelle la police, Léo Ferré en est tenu pour responsable : on dit qu’il chante sous la protection des flics. Le problème, c’est que ce soir-là, personne ne savait rien. On était entré dans la salle, le spectacle avait commencé. Effectivement, cette fois, la bagarre a été sérieuse, mais elle s’est produite après. En sortant, du verre au sol : toutes les vitrines du cinéma sont brisées. Partout, des traces de lutte. Les CRS ont frappé dur, il y a eu des arrestations. Ce n’est pas la première fois que les amis que nous commençons à connaître assistent à des spectacles mouvementés. Il y en aura d’autres.
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (6)
samedi, 03 mars 2007
Bac blanc
On a évoqué ici Gaby de l’Arlequin, et, dans les commentaires apportés à diverses notes, il a été rapidement question de Jacques Jordan des Assassins, et de Suzanne Lebrun de l’Échelle de Jacob. Il s’agissait des tauliers de cabarets, présents plus ou moins nominativement dans les textes de Léo Ferré.
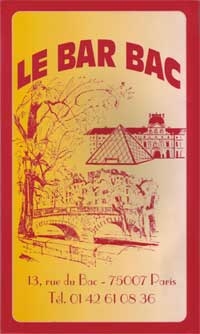 Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.
Il est une autre taulière qui, elle, est très présente, mais ne tenait pas de cabaret. Elle se contentait d’un café-tabac, sis 13, rue du Bac, dans le septième arrondissement de Paris. Ce café à l’arrière-salle vitrée avait la particularité d’être, par autorisation préfectorale, ouvert toute la nuit, afin que les typographes qui imprimaient alors non loin, nuitamment, le Journal Officiel, puissent venir boire et se restaurer, oublier le plomb dans lequel ils évoluaient en permanence. On aura reconnu Blanche, bien sûr.
En 1956, elle figure à part entière dans le feuilleton lyrique La Nuit que publie Léo Ferré, et son café sert carrément de décor à l’action : « C’est un vulgaire bistrot « de nuit » avec son décor familier de bouteilles, de tabacs alignés, son bar flambant neuf, sa putain de service ou de congé, son chauffeur de taxi en déroute, et toutes ses filles et ses garçons se nourrissant de projets et de sandwiches. Derrière son comptoir, Blanche, la patronne », écrit Ferré. Blanche parle avec la Nuit, qu’elle n’a jamais vue. Puis la Nuit donne au poète un croissant qu’elle prend dans la corbeille, sur le comptoir, avant d’endormir Blanche et de vider les bouteilles et le tiroir-caisse. En 1966, elle est évoquée dans Paris-Spleen : « Au Bar Bac y avait Blanche / Qui nous vendait l’bonsoir ». En 1980, quand paraît Testament phonographe, on peut lire dans le texte éponyme l’évocation du fameux café : « Huit heures du soir au Bar Bac / Et des hiboux plein le parterre / À s’immoler pour quelques verres / Que Blanche vide dans son sac ». Ensuite, le legs auquel elle a droit : « Taulière des soirs en allés / Je te laisse mon capuchon / Que je baissais sur mes chansons / Le soir dans ton ancien café / Maintenant c’est sous l’œil néon / Que tu lis tes comptes de bique / Et rumines sous la musique / L’oseille bleue des vagabonds ».
Cette Blanche dont j’ignore le nom était célèbre, pas seulement dans l’œuvre de Léo Ferré, mais dans toute la nuit germanopratine. C’était paraît-il un personnage. Telle qu’on la décrit habituellement, il faut imaginer un mélange de Fréhel et de Simone Signoret dans le rôle de Madame Rosa, mais plus robuste, avec la gouaille parisienne et l’accent faubourien desideratur, comme disait Verlaine. Léo Ferré avait dû être amusé par la personnalité de cette dame et s’attacher à elle, la trouver en tout cas suffisamment originale pour en faire une image littéraire. Comme toujours, sa vie est son matériau propre, mais elle est revue, relue, retouchée, revécue : Blanche existe mais elle devient personnage, puis souvenir personnel, puis prétexte à legs au travers d’une imitation de Villon.
Une fois n'est pas coutume, voici une anecdote. Le poète Bernard Delvaille (décédé le 18 avril 2006) que j’avais un peu connu, il y a vingt ans, aux éditions Seghers où il s’occupait de la collection « Poètes d’aujourd’hui », m’avait parlé de Blanche. Dans la salle du Bar Bac, Delvaille, un jour, discutait de poésie avec des amis. Ils reconstituaient de mémoire un poème de Maurice Scève et ne se trouvaient pas d’accord sur le texte. L’un d’entre eux insistait : « Je te dis qu’il manque deux vers ». La dispute, certes toute littéraire, fit monter le ton et les éclats de voix parvinrent jusqu’à Blanche. De sa caisse, elle tonitrua, de la voix qu’on imagine : « Deux verres, deux verres ! Vous n’allez pas vous disputer pour deux verres ! Je vous les offre, vos deux verres ! »
(Illustration : menu du Bar Bac, 2001)
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (9)
jeudi, 01 mars 2007
À propos de L’Été s’en fout
Panique, adjectif, du grec panikos, du nom de Pan, dieu qui effrayait, d’où le sens actuel du mot panique, qui n’est évidemment pas celui qui nous occupe ici. Pan, dieu des champs, des bergers et des bois, protégeait les troupeaux et prenait ses ébats avec les nymphes. Il finit par représenter l’univers et le grand tout.
Cette curieuse poésie, finalement peu connue, au titre inattendu, témoigne d’une inspiration panique qui le dispute sans cesse à l’érotisme.
Il y a même, parfois, confusion : « De cette rose d’églantine / Qui pleure sous la main câline », c’est aussi bien la rose elle-même que le sexe féminin. Par conséquent, les deux vers suivants (« Et qui rosit d’un peu de sang / Le blé complice de Saint-Jean »), qu’on pourrait lire initialement comme étant d’inspiration également panique, devient une allusion à la menstruation, toujours très présente chez Ferré. Quant au « blé complice », l’image est claire.
En opposition à une écriture faisant référence à des caractéristiques alors essentiellement urbaines (voiture) en même temps qu’à des comportements physiques (cheveux au vent), l’inspiration panique présente des allusions aux bains de mer (poitrines dures, fermes, Saint-Tropez) et au soleil qui met « du crêpe » (noir, donc : bronzage) sur la peau et, par extension, « dans le sang ».
Retour immédiat à l’érotisme : « De cette sève de cactus / Qui coule au pied du mont Vénus », parole évidemment très explicite. Les nuits d’été peuvent être prises pour des nuits d’amour (« De ces nuits qui n’ont pas de bout / Et qui vous pénètrent jusqu’où » – avec, de plus, une double acception du verbe pénétrer). On relève que le mont de Vénus devient mont Vénus, pour la métrique naturellement – il y aurait un pied de trop – mais aussi pour figurer un nom de montagne réelle au pied de laquelle on peut imaginer une rivière. L’ambivalence persiste.
De nouveau, alternance d’inspiration panique : « chagrin de chlorophylle », « loin des villes », « septembre paresseux ». Septembre, c’est le retour en ville après la plage. Conséquence logique : vient l’automne, mais l’érotisme n’est jamais loin puisque l’automne, par analogie, est « adolescent / Comme une fille de quinze ans / Se défeuillant jusques au bout / Pour faire une litière au loup ». L’adolescence est supposée molle, lascive, comme est « paresseux » septembre, qui amène l’automne. Est-il utile de préciser que « Se défeuillant jusques au bout » évoque aussi bien les feuilles qui tombent que les vêtements qui chutent ?
Confusion, ensuite, entre la nature et l’érotisme. On peut lire les vers « De ce galbe de la vallée / De ce mouvement des marées / De cette ligne d’horizon / Où ne rime plus la raison » aussi bien comme la description de paysages et d’éléments naturels que comme des métaphores érotiques. Le double schéma de lecture fonctionne alors parfaitement : galbe, vallée, mouvement, marées, ligne d’horizon et cette raison qui « ne rime plus » lorsque tout bascule, idée qui sera reprise dans L’Amour en 1956 : « Quand la raison n’a plus raison ».
Enfin, présence de la nature et, plus largement, de l’univers : « planètes bienheureuses », « jazz de nébuleuses » mais, comme toujours chez les poètes lyriques, la mort n’est pas loin. Gentille ou monstrueuse, elle habille d’un cercueil : « Enfin qui de sapin nous sape », avec une allitération en prime. Mais la nature (l’été) continue son chemin : imperturbable, elle « s’en tape ».
La présence de l’été comme une litanie plutôt qu’un refrain est aussi ambivalente. Il peut s’agir de la plénitude de l’été – la nature dans toute sa force, sa vigueur du mois d’août – comme de la période des vacances, la saison chaude supposée favoriser toutes les amours, surtout celles, physiques et sans lendemain. On note que « L’été s’en fout » est un vers de quatre pieds qui forme refrain entre des strophes d’octosyllabes. Cette division par deux du nombre de pieds brise chaque fois l’envolée de la strophe, ramenant le lecteur ou l’auditeur (le lecteur silencieux est auditeur dans sa tête) à l’à quoi bon de la nature qui se soucie peu de l’agitation des hommes.
J’espère n’avoir pas trop paraphrasé cette chanson que j’ai toujours beaucoup aimée et qui mérite je crois qu’on veuille bien en lire le texte.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (12)
mardi, 27 février 2007
En Angleterre
Puisque les voyag’s forment la jeunesse
T’en fais pas mon ami j’vieillirai
(LE BATEAU ESPAGNOL)
J’ai raconté ailleurs ce qu’avait représenté pour Léo Ferré le tournage du film de Basil Dearden, Cage of gold (La Cage d’or), en 1950. Je n’y reviendrai pas ici.
Il reste que, de ce séjour effectué en Angleterre cette année-là, le Ferré presque inconnu sinon des habitués des cabarets où, jusque là, il a pu se produire, a rapporté une bonne moisson de textes.
Une chanson, enregistrée en public en 1950 au cabaret Le Trou, 9, rue Champollion, Madame Angleterre, sera disponible au disque en 1998.
Dans ce qui sera le recueil Poète… vos papiers !, publié en 1956, on relève le poème Angleterre.
Il écrira en 1950 Les Noces de Londres, texte qui paraîtra en 2000.
Dans ce qui deviendra le projet inachevé des Lettres non postées (paru en 2006), on trouve Lettre à l’Angleterre.
Je ne prétends pas que ces textes aient été composés en Angleterre à ce moment précis. Quand j’écris qu’il « a rapporté » des textes, cela signifie qu’ils lui ont été incontestablement inspirés par ce voyage.
Il est très vraisemblable que le « poème lyrique » Les Noces de Londres aurait pu connaître la destinée de De sacs et de cordes qui en est à peu près contemporain, c’est-à-dire être joué à la radio nationale, interprété par quelques grands noms du moment. Auquel cas, l’œuvre enregistrée aurait été archivée et peut-être aurait-elle pu paraître au disque un jour ou l’autre. Madame Angleterre est d’ailleurs partiellement repris dans De sacs et de cordes.
Les autres voyages que fit Léo Ferré au cours de sa vie n’ont pas donné autant de fruits. De Martinique, il ramena en 1947 Mon Général et La Messe noire, mais on ne trouvait pas là de rapport avec le pays. On ne connaît pas, je crois, d’œuvres multiples ramenées du Japon, du Québec, d’Allemagne, d’Algérie, d’Espagne… Peur-être certains textes ont-ils été écrits lors de séjours dans ces pays, mais ils n’en portent pas la marque et ne peuvent par conséquent être recensés. Si les œuvres faisant allusion à l’Espagne sont très nombreuses, elles n’y ont pas été composées, puisque Ferré s’était interdit d’y aller du vivant de Franco, décédé en novembre 1975. De ses déplacements ultérieurs dans ce pays, je ne sais s’il rapporta quelque chose.
00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (13)
dimanche, 25 février 2007
Jalons pour une future biographie de Léo Ferré
Si l’on excepte les ouvrages de circonstance, publiés par exemple, et en nombre, à l’occasion du dixième anniversaire de la disparition de Léo Ferré, si l’on omet quelques autres volumes biographiques vraiment très succincts et si l’on exclut les documents, essais et exégèses qui lui ont été consacrés, il ne demeure qu’une biographie stricto sensu, celle que signa Robert Belleret en 1996, qu’il commença à rédiger deux ans plus tôt.
Le recul dont on commence à disposer aujourd’hui doit permettre d’aller plus loin, surtout si l’on tient compte des publications, éditoriales et phonographiques, d’œuvres inédites, comme des travaux effectués dans l’intervalle et de leur apport. Il n’existe pas jusqu’à présent de biographie « scientifique » de Ferré. L’improbable grande somme, l’utopique grand tout, se trouvant naturellement hors de portée, on peut néanmoins penser que la biographie de Léo Ferré reste à écrire. Par rapport à l’importance du poète dans son époque et à la durée de sa création artistique – près d’un demi-siècle – il m’apparaît, après réflexion, que ce travail ne peut raisonnablement compter moins de mille pages, voire davantage, qu’il doit évidemment rectifier les erreurs antérieures et combler les manques ou insuffisances, d’ailleurs explicables, des livres précédents. On attend une biographie qui rende un compte exact de la durée, qui prenne son temps et s’interdise de survoler telles ou telles années au profit de telles autres.
Les témoignages les plus importants ont déjà été recueillis, certains plusieurs fois, et publiés. Il ne peut être question de les solliciter à nouveau. Le nombre de souvenirs dont chacun dispose est forcément limité et, au-delà, fussent-ils passionnants, on ne peut que les répéter sous une forme ou une autre. Il faut, par conséquent, en reproduire l’essentiel et en demander de nouveaux à des personnes auxquelles, semble-t-il, et curieusement, personne n’a pensé. Le problème le plus évident est bien sûr que le recul obtenu a un corollaire tragique, la disparition des protagonistes.
Il faut aussi sortir de cette tendance biographique généralisée qui consiste à découper la vie du modèle en tranches et, pour Léo Ferré plus précisément, en périodes, lesquelles sont la plupart du temps déterminées en fonction des différents producteurs phonographiques qui l’ont inscrit au catalogue de leur maison. Cette hiérarchisation, en grande partie fausse, a montré ses faiblesses et c’est en cela que le recul est bénéfique. L’autre critère de découpage erroné consiste à imaginer des périodes liées à ses différentes épouses. C’est tout aussi inexact. L’erreur la plus grande consiste à croiser, autant que faire se peut, les deux critères et à aboutir ainsi à une vision parcellaire, morcelée et fausse de l’existence et du travail de Ferré. Car, au vrai, toutes et tous jouèrent tous les rôles que l’on voudra, eurent l’importance et l’influence qu’on ne leur nie certes pas, mais enfin, lorsqu’il fallut « y aller », ce fut lui qui « y alla », lui et pas un autre, pas une autre. Le seul découpage possible reste celui de réelles fractures – j’évite à dessein le terme de « ruptures », qu’on rapprocherait à tort des ruptures sentimentales – dans la vie et l’œuvre de l’artiste. À condition, toutefois, de pouvoir déterminer celles-ci avec précision, ce qui présente d’authentiques difficultés. Une vie ne tient pas dans un livre, naturellement. Une vie s’écoule en plusieurs directions à la fois, s’implique dans la durée et se dégage dans l’instant, s’équilibre sur le fil d’une simultanéité funambule, alors que la biographie, fût-elle uniquement chronologique, demeure contrainte dans l’espace-temps d’un volume.
00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (8)
vendredi, 23 février 2007
Pause
Pas de nouveau texte aujourd’hui. Je ne veux pas écrire à tout prix afin de publier à tout prix, ce qui est le danger des blogs.
J’ai constaté que la catégorie « Propos » devenait un fourre-tout et abritait finalement ce qui ne pouvait être classé ailleurs. Je l’ai donc subdivisée en plusieurs autres catégories : « Propos » demeure, mais est complété par « Lieux », « Personnages », « Recherche », « Souvenirs », « Spectacles et émissions » et « Organisation du blog ».
Non que j’éprouve un besoin absolu de tout découper en tranches, bien au contraire : je n’aime pas les étiquettes. Cependant, le blog compte déjà soixante-sept notes – celle-ci est la soixante-huitième – et cela pourra peut-être aider ceux qui le désireront à retrouver plus rapidement ce qu’ils cherchent.
Toutes les autres catégories demeurent inchangées.
(Photo Vic Novas)
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (13)
mercredi, 21 février 2007
Odette Schunck, épouse Ferré
Il se peut que tu t’en souviennes
(LA VIE D’ARTISTE)
Voici une tentative pour regrouper ce que l’on sait de la première épouse de Léo Ferré, c’est-à-dire peu de chose.
Autant le dire tout de suite : on ne connaît pas son visage. Elle a posé, dit-on, pour des publicités comme la brillantine Roja ou l’huile Ambre solaire, mais nombreuses étaient les femmes, alors, choisies pour ces « réclames » comme on disait et, comme les images n’étaient ni identifiées ni datées, comment savoir, même en les retrouvant, s’il s’agissait bien d’elle ? Dans l’ouvrage de Marchand-Kiss, la publicité reproduite p. 43, à l’appui de l’allusion à Odette, est un simple dessin sans visage. Les iconographes responsables de cette édition n’ont pas trouvé l’intéressée. De plus, ces publicités, la plupart du temps, étaient dessinées d’après des photographies. Quelle était la part d’interprétation du dessinateur ? On dispose en tout et pour tout du témoignage de l’ami de jeunesse de Léo Ferré, Maurice Angeli, dernier à avoir connu Odette, qui nous assure qu’elle était blonde, belle et ressemblait un peu à Madeleine Sologne : « C’était une fille superbe, très jolie. Madeleine Sologne en mieux ! » a-t-il raconté à Claude Frigara [1]. Pourtant, il existe forcément des photographies, ne serait-ce que celles du mariage : cela ne peut pas être autrement et d’ailleurs, Belleret les décrit. Un jour, peut-être des portraits sortiront-ils du néant.
Leur rencontre a lieu en août 1940. Odette, Hélène, Germaine, Louise Schunck est née à Paris le lundi 1er mars 1920. Elle est en fuite avec ses parents, Jo et Fernande, à Castres. De Monaco où Ferré est rentré lors de sa démobilisation, il gagne Castres à bicyclette pour la revoir.
Le mariage a lieu le samedi 2 octobre 1943 à 10 h 30, à la mairie d’Issy-les-Moulineaux, où Odette habite chez ses parents, 15, avenue Jean-Jaurès. Le Petit Niçois consacre un écho à ce mariage. Ferré envoie le samedi 9 un télégramme à Maurice Angeli pour l’informer. Les mariés vont vivre à Beausoleil, au lieu-dit Grima, dans une ferme, avec quarante-cinq oliviers et des bêtes : une mule, un mouton et trois vaches. Il a son premier chien, un berger allemand nommé Arkel. Il vit une vie de fermier, vend le lait de ses vaches.
À la Toussaint 1944, ils remontent vers Paris. En chemin, ils s’arrêtent quelques jours à Lyon où Ferré compose Les Amants de Lyon, qui deviendront plus tard Les Amants de Paris. En avril 1947, ils emménagent 54, rue d’Alsace-Lorraine à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un pavillon.
Selon Belleret, M. Schunck père était l’administrateur du théâtre de l’Étoile. Il aurait dit à Léo Ferré : « Je te donne un an pour réussir », ce qui était ridicule. Pour réussir si vite, même à l’époque, il fallait écrire des romances sentimentales sans prétention et, apparemment, ce professionnel ne s’était pas rendu compte que son gendre entendait faire autre chose. Mais passons. Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’ait pas fait chanter Ferré à l’Étoile, même pas en première partie, même pas en « lever de torchon ».
Par imitation, comme on l’a vu précédemment, de Villon, le texte Testament phonographe dit en toutes lettres qu’Odette ne fut pas d’une fidélité parfaite et règle les comptes de l’auteur avec tout le monde. La belle-mère d’abord : « À la maritorne de skungs / À la Fernande aux mains-poisson / Qui reprise les caleçons / Des anges qui la nuit défoncent / L’ixe de mon idiote en blond / Je laisse un rasoir électrique / Pour se peler le sens unique / Et se ravauder l’écusson ». Au tour du père, à présent : « À son régul Jo du dentier / Mon beau-daron du temps de l’ex / Et qui me mettait à l’index / Au fond d’un lit mort à moitié / Je laisse sa fille empaffée / Par quelque obscur de la cervelle / Sa fille qu’il eût dit pucelle / Dans un bordel le cul bordé ». Puis vient celui d’Odette et d’un amant en même temps : « Et celle-là Nitouche en toc / Qui jouait les planches d’amour / Où j’accrochais tous mes discours / Six ans durant dans mon paddock / Qu’elle ait un requiem en stuc / Montant triste d’une guitare / Qu’elle enjambera c’est notoire / Comme un bidet qui joue du truc / Tu mangeais des radis milords / Luxure à la mode de quand ? / Vénus pavée au plus croulant / Où rampes-tu ta gueule encor ? / Dans quel gourbi t’étales-tu ? / Devant quel miroir détestable / Vois-tu tes charmes reléguables / Lève-toi et crache dessus ! / Vois le poète que je suis / Devant son papier affamé / Il a tissé comme araignée / Une toile pendant la nuit / Ô viens ma mouche t’y moucher / En loucedé mon verbe brûle / Et pour te manger la formule / Il ne me reste qu’à signer / Ferré parent de Rutebeuf / Et souviens-toi de ce cousin / Qui remplissait ton traversin / Ton chef pesant le poids d’un œuf / À celui-là le parfumeur / Je laisse la plate lunette / Où ton bas-ventre se reflète / Quand appareillent tes liqueurs ».
Bien évidemment, il est hors de question, ici, de porter le moindre jugement moral à ce sujet, moins encore de tomber dans le potin. Seuls comptent les faits. Il semblerait que, rapidement, l’union des Ferré ait battu de l’aile, notamment à cause du manque de ressources. En tout cas, l’échec de la tournée en Guadeloupe et en Martinique qui eut lieu en 1947 n’arrangea certainement pas les choses. On en connaît le dénouement : au mois d’octobre, contraint de devoir demander de l’argent pour payer son voyage de retour et celui de son épouse, Léo Ferré écrit à Trenet, qu’il admire. Sans doute lui paraît-il qu’un artiste comprendra sa situation, se montrera solidaire. Trenet ne répond pas. Il déclarera par la suite que Ferré n’avait pas indiqué son adresse. Celui-ci soutient que oui. On ne saura sans doute jamais ce qu’il en était réellement et cela n’a pas beaucoup d’importance, à ceci près que Ferré se retrouve obligé de demander la somme dont il a besoin à son père et que cela le gêne beaucoup. En ces temps où l’homme se doit – c’est un code social – d’être à même de nourrir sa famille sans coup férir, cette demande est honteuse, aux yeux d’Odette en tout cas, certainement. J’ajoute, sur ce point, que, jusqu’en 1964, les femmes mariées désirant travailler auront besoin de… l’autorisation de leur mari. Ce qui signifie que, selon toute vraisemblance, Ferré aura dû autoriser Odette à poser pour des publicités et que cela, certainement, a dû être difficile et ne pas le grandir dans l’esprit de son épouse, contrainte de gagner quelque argent puisque son mari n’avait ni salaire, ni cachets réguliers. À moins qu’un supposé tempérament d’artiste ne lui ait fait trouver plaisante la vie de modèle, ce qui demeure une possible supposition.
On ne sait pas très bien dans quelles circonstances exactes eut lieu la séparation d’Odette et Léo Ferré. En tout cas, le jugement de divorce fut rendu le samedi 16 décembre 1950 par la 9e chambre du tribunal civil de la Seine et transcrit le jeudi 17 mai 1951.
Un peu plus tôt est née La Vie d’artiste qui n’est pas seulement une complainte de la mauvaise chance, de la dèche et de l’amour qui meurt, c’est aussi, mise en forme, l’histoire d’Odette. Ce qui, par parenthèse, pose la question de l’écriture à deux. On sait que cette chanson fut faite avec Francis Claude et l’on imagine mal que Ferré ait pu chanter quelque chose qui ne lui convienne pas tout à fait – est-ce lui qui a écrit les vers : « Mais si tu pensais à vingt ans / Qu’on peut vivre de l’air du temps / Ton point de vue n’est plus le même » ? C’est vraisemblable.
Odette se remariera, toujours selon Belleret, en décembre 1951, avec un Suédois, à Göteborg. On perd ensuite sa trace.
En 1973, dans Et… basta !, Ferré dira : « Une première femme : six ans de collage administratif ». Cette durée est parfaitement inexacte. Si l’on compte de la date de leur rencontre (1940) à celle de leur divorce (1950), cela représente dix ans. Si l’on commence à compter à partir de leur mariage, ce qui répondrait davantage à la notion de « collage administratif », jusqu’à celle du divorce, le total est de sept ans. Les six années évoquées ne compteraient-elles en réalité que de la date du mariage à celle de la séparation de corps, qu’on ne connaît d’ailleurs pas exactement ?
Remerciements : Catherine Aygalinc.
_________________________________
[1]. Cahiers d’études Léo Ferré, n° 7, « Marseille », 2003.
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (18)
lundi, 19 février 2007
Ferré et les écrivains
Voici un relevé, pas forcément exhaustif, des amitiés que connut Léo Ferré dans le monde des écrivains. Je ne crois pas que beaucoup de chanteurs aient eu autant de connaissances dans ce domaine, sauf peut-être Brassens, ce qui n’est pas sûr, Guy Béart ou Mouloudji.
On connaît l’histoire de son amitié, trop tôt interrompue, avec Breton. J’en ai examiné les aspects ailleurs, je ne les redirai pas ici, sauf s’il venait à apparaître des choses nouvelles. Cette rupture nous a privés, j’en suis certain, d’un disque qui aurait compté, auquel je ne cesserai jamais, sans doute, de rêver.
Benjamin Péret lui fait une place dans son Anthologie de l’amour sublime.
Avec Aragon, on a eu le disque. L’amitié a duré plus longtemps, Ferré a même bénéficié de l’appui des organisations communistes durant un temps (ventes du Comité national des écrivains, fêtes diverses). Jacques Vassal a parlé du projet d’un second enregistrement, avancé par Ferré lui-même, qui resta sans suite.
Il y eut un rendez-vous manqué, la rencontre avec Sartre, dont on ne sait pas bien si elle aurait pu aboutir à une œuvre artistique mais qui aurait forcément donné quelque chose d’intéressant. Au temps des cabarets, Ferré chante à la Rose rouge : dans le public, se trouve Sartre. Ferré dit lui-même qu’il a été impressionné. Il raconte avoir déjeuné avec lui longtemps plus tard, et discuté. Il ne semble pas que cela ait eu de prolongement. Quand Sartre descend vendre dans les rues de Paris le journal interdit La Cause du peuple, Ferré pense l’appeler pour agir avec lui. Il se ravise, craignant une mauvaise interprétation de son geste, dans le sens d’une publicité intempestive. Enfin, quand Jean-Edern Hallier laisse paraître un article dans L’Idiot international appelant à recevoir désormais Ferré « à coups de pavés dans la gueule », Ferré s’adresse à Sartre, au motif que Simone de Beauvoir est directrice de la publication (son nom servait de paravent, bien sûr). Sartre lui répond que, justement, elle vient de démissionner. Voilà, rapidement, ce à quoi se résument leurs rapports. Je ne peux m’empêcher de penser que c’est vraiment dommage.
Louise de Vilmorin qui le découvre à travers un disque dans un café l’invite dans l’émission La Joie de vivre qui lui est consacrée. Puis il sera invité chez elle à Verrières où il rencontrera Roland Petit et Zizi Jeanmaire. De là, sortira La Nuit qui deviendra L’Opéra du pauvre, comme on le sait. Je ne reviens pas sur cette histoire que j’ai déjà racontée.
Pierre Seghers avec qui il fit deux chansons et qu’il introduira lui-même chez Louise de Vilmorin, l’accueillera dans la collection « Poètes d’aujourd’hui », comme je l’ai raconté aussi ailleurs.
Ce même volume des « Poètes d’aujourd’hui » fut présenté par Charles Estienne, écrivain et critique d’art.
J’ai détaillé ailleurs son amitié avec Luc Bérimont.
Jean-Pierre Chabrol restera son ami fidèle avec qui il fit des émissions de radio et d’autres de télévision. Il lui trouvera une maison en Ardèche dans une période difficile.
Paul Guimard lui dédiera son roman L’Ironie du sort. Il sera sur le plateau de l’émission littéraire de Polac lors de la sortie de Benoît Misère. Ferré n’appréciera guère, plus tard, que Guimard ait accepté des responsabilités aux côtés de Mitterrand. Lui-même avait refusé de soutenir sa campagne de 1981, refus qu’il réitèrera en 1988 auprès de Hanin s’engageant à lui procurer un orchestre.
Benoîte Groult, à la ville Mme Guimard, fut aussi proche, un temps.
On a déjà parlé de Jean-François Revel, approché un moment pour l’achèvement et la publication de Benoît Misère.
Christine de Rivoyre fut reçue boulevard Pershing, avant le récital de 1955 à l’Olympia. Elle venait en tant que journaliste mais reçut-elle cette rencontre autrement qu’en écrivain ?
Ferré prit position dans « l’affaire Minou Drouet » et, à ce sujet, eut à voir avec André Parinaud et, encore, Breton.
Ferré et Mac Orlan furent proches, le temps d’une chanson et jusqu’à leur brouille.
Max-Pol Fouchet l’accueille dans son anthologie de poésie.
Calvet atteste une rencontre manquée avec Barthes, une autre, sans suite, avec Lacouture.
Enfin, de même qu’il fut reçu par Polac, il le fut par Pivot.
Je pense qu’il y eut d’autres rencontres. Cet intérêt pour Ferré, manifesté par des hommes de lettres, n’est pas sans signification. On lui reconnaît, semble-t-il, quelque chose qui le différencie des chanteurs, au sens où ce mot est habituellement employé. Ce qui peut nourrir notre réflexion esquissée dans la note Ferré, qu’est-ce que c’est ?
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (35)
samedi, 17 février 2007
Hubert Grooteclaes en mélancolie (extrait)
Je rappelle que j’ai mis en ligne, sur un autre blog, le bref essai, encore inédit, que j’ai consacré en 1987 à Hubert Grooteclaes (1927-1994). Je l’ai complété après sa disparition. Il est intitulé Hubert Grooteclaes en mélancolie. On peut le lire intégralement à l’adresse http://hubertg.hautetfort.com/ Comme il s’agit d’un texte suivi, j’ai inversé l’ordre habituel de présentation des notes : la plus ancienne se trouve en premier et la lecture se fait dans le sens habituel. Le blog est agrémenté de deux diaporamas, malheureusement altérés par la mauvaise qualité de la reproduction d’images chez Haut et Fort. Par ailleurs, je propose ci-après l’extrait de ce livre où Léo Ferré est évoqué.
Ce poète-là vivait en Italie, entre Sienne et Florence. Grooteclaes était depuis longtemps son photographe attitré. En-dehors des affiches, des pochettes de disques, des reportages pour des revues qu’il a réalisés sur Ferré et les siens, « Groote », comme l’appelait son ami, a fait toute une série de photographies, à toutes les époques de ses recherches techniques, comme en tous les moments de la vie de Léo Ferré. Il fut, au fil du temps, son biographe en images. Nombre d’entre elles datent d’avant le 7 avril 1968, et nous montrent un chimpanzé qui fut chéri du poète… Mais Pépée vit encore chez Grooteclaes, il l’a sortie du temps et la voici, parmi les arbres d’un domaine du Lot. Et voici Ferré chez lui, en Toscane, assis sur une chaise paillée, sur fond d’arbres flous, de grands feuillets imprimés ouverts sur ses jambes croisées ; en regardant bien, on reconnaît la traduction italienne de son célèbre texte Il n’y a plus rien. Et voici Ferré, au même endroit mais sous un autre angle, bras refermés sur ses papiers ; devant lui, un chien ; chaise, jambes et pattes sont comme posées sur le bord inférieur de l’image, elles y reposent – qui dira la magie du cadrage et l’infinie difficulté de l’imaginer avant ? Ferré porte une chemise trop rose, le chien a le poil flou. L’éternité de l’instant, n’est-ce pas ? Plus les couleurs nostalgiques du peintre Grooteclaes. Après ? Avant ? En même temps ? Allez savoir de quelle essence est fait l’art ! Dans quelles chambres secrètes tient-il ses quartiers ? Mieux vaut voguer, sans réfléchir, sur la mer de cet album d’images. Voici Mathieu Ferré, pris dans le feuillage, comme l’était souvent Marianne, là, dans cet ouvrage intitulé Je vous attends… [1] Voici Marie-Christine Ferré, le visage entre des herbes et des fleurs, croisée dans une pochette de disque. Voici Mathieu, encore, tel un sphynx, sur un autre disque. Au verso, père et fils, dans la campagne toscane. Mais qui trouvera ces couleurs-là, dans ce coin d’Italie, sinon Grooteclaes et son nuancier inventé ? Voici, ailleurs, Ferré dans une loge de théâtre, de noir vêtu dans l’attente des lumières et des fracas de la scène, assis de trois-quarts sur une chaise de plastique moulé, au dossier de laquelle pend son blouson de cuir fin. Voyez les plis de sa chemise. Le flou, paradoxalement, les accentue. On va toucher au mouvement. Mais pourquoi le mur de cette loge est-il rose ? Parce que Grooteclaes le fait chanter avec le noir de l’habit et la neige perdue des cheveux de son ami, quelque part dans le temps qui, on l’aura finalement compris, n’existe pas. D’ailleurs, revoici le photographisme, dans des teintes cette fois brunes et noires, avec ces façades de maisons qui deviennent des visages montés sur des cous particuliers. Nous avons ouvert, au hasard, une revue, Zoom, [2] et nous y trouvons un texte de Ferré qui se termine ainsi : « Grooteclaes est fou, je pense. Il ne fait plus de photos. Il est très bien, ce mec ». Oui, il était très bien. Tiens, voici un portrait qui a bien des années, un portrait d’art de Ferré, foulard de soie autour du cou. Plus loin dans le temps et dans l’espace, au hasard d’un numéro de Elle, [3] Pépée, perchée sur les toits d’un certain château. Au détour d’une exposition, un portrait du critique d’art Charles Estienne, autre ami de Ferré.
Mais alors, s’il travaillait le flou et les couleurs, pourquoi parler encore des portraits qu’il fit jadis ? Cette manie de coller des étiquettes et de déterminer des périodes ! Nous sommes en pays d’art. Laissons Grooteclaes tirer ses photographies comme il lui plaît, et qu’il nous soit permis de nous promener ainsi dans le temps, dans son temps… Les mêmes photos existent d’ailleurs parfois en noir et blanc, et retouchées en couleurs inventées. En net et en flou.
Il doit bien y avoir aussi, chez Grooteclaes, cette vie écorchée, cette tendresse profonde, ce besoin d’amour, constant et total, quelquefois camouflés sous une violence intellectuelle. Son photographisme n’était pas doux, loin de là, et son flou était, au vrai, très rigoureux, très ferme, même si l’alliance de ces mots peut surprendre.
Un refuge qui, dans le même temps, serait une arme ? Quand les abris sont aussi des défenses, c’est qu’ils recèlent l’intelligence. Il faut la protéger. N’est-ce pas lui qui a dit : « Je m’efforcerai toujours d’asseoir la photographie comme une fête de l’intelligence » ? On doit le respect à de telles paroles. Leur rareté, en ce monde, tient du diamant, qu’il soit brut, ou bien ouvragé de belle façon et de main d’artisan.
_________________________________
[1]. Léo Ferré, Je vous attends, poèmes, avec des oeuvres de neuf plasticiens dont Hubert Grooteclaes, Bruxelles, Paul Ide éditeur, 1981.
[2]. Léo Ferré, Hubert Grooteclaes, in Zoom, op. cit.
[3]. Elle, du 7 décembre 1967.
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (2)
jeudi, 15 février 2007
Le récital de 1955 à l’Olympia
Dans Marie-Claire, l’écrivain Christine de Rivoyre dont le nom est peu souvent associé à celui de Ferré, présente le prochain spectacle de l’artiste. Elle vient le rencontrer à son domicile, boulevard Pershing, où elle se voit offrir l’étonnant spectacle de Canaille, épouse d’Arkel, allaitant ses huit petits saint-bernard (elle les a mis au monde, raconte Ferré, sur son propre lit). Elle y apprend qu’à la suite du succès du Piano du pauvre, la vente des disques de Léo Ferré est devenue douze fois plus importante qu’auparavant. Il prépare ce récital depuis trois mois. Pour Christine de Rivoyre, il chante au piano L’Âme du rouquin et Monsieur mon passé [1].
 Le récital donné à l’Olympia en 1955 est la première grande scène parisienne de Léo Ferré. L’année précédente, il a figuré au programme de cette salle en « américaine » du spectacle de Joséphine Baker. À présent, il est en vedette boulevard des Capucines, du jeudi 10 au mardi 29 mars. Le programme vendu dans la salle comprend un texte de Jean Gabin, comme un écho de leur aventure commune dans De sacs et de cordes, quelques années auparavant. Gabin écrit : « J’aime la chanson, donc j’aime Ferré. Et ce que j’aime dans Ferré, c’est le côté « goualante » ni trop, ni trop peu ; de quoi remplir la tête d’un honnête homme sans le faire déborder pour autant... Ça ne rime pas toujours avec amour, ni amour avec toujours, mais c’est comme ça, c’est la vie, la vraie, et si chacun a son boulot, c’est un sacré boulot et un sacré talent de dire tant de choses en chantant. Et en plus ça se retient. C’est costaud comme un tigre et fragile comme un rossignol. Son piano à lui, il n’est pas pauvre ! et je me demande ce qu’il va encore en sortir ». Dans le même programme, figure un texte de Mac Orlan repris d’une pochette de disque de Catherine Sauvage, ainsi qu’il en a été question dans une étude précédente : « Léo Ferré est un poète pour qui la chanson est une forme d’expression puissante et efficace : c’est un poète de l’authenticité, un poète précis de la vérité ; et ses personnages nous apportent vraiment une présence humaine : celle de L’Homme ou celle des Amoureux du Havre, qui ne sont pas, grâce à cette précision, de simples lieux communs sentimentaux. Elle conduit à la mélancolie qui est la grande force des chansons quand elles sont de la « classe » littéraire de celles de Léo Ferré ». Le programme, enfin, présente Ferré comme « la nouvelle grande vedette de la chanson française » et propose un portrait.
Le récital donné à l’Olympia en 1955 est la première grande scène parisienne de Léo Ferré. L’année précédente, il a figuré au programme de cette salle en « américaine » du spectacle de Joséphine Baker. À présent, il est en vedette boulevard des Capucines, du jeudi 10 au mardi 29 mars. Le programme vendu dans la salle comprend un texte de Jean Gabin, comme un écho de leur aventure commune dans De sacs et de cordes, quelques années auparavant. Gabin écrit : « J’aime la chanson, donc j’aime Ferré. Et ce que j’aime dans Ferré, c’est le côté « goualante » ni trop, ni trop peu ; de quoi remplir la tête d’un honnête homme sans le faire déborder pour autant... Ça ne rime pas toujours avec amour, ni amour avec toujours, mais c’est comme ça, c’est la vie, la vraie, et si chacun a son boulot, c’est un sacré boulot et un sacré talent de dire tant de choses en chantant. Et en plus ça se retient. C’est costaud comme un tigre et fragile comme un rossignol. Son piano à lui, il n’est pas pauvre ! et je me demande ce qu’il va encore en sortir ». Dans le même programme, figure un texte de Mac Orlan repris d’une pochette de disque de Catherine Sauvage, ainsi qu’il en a été question dans une étude précédente : « Léo Ferré est un poète pour qui la chanson est une forme d’expression puissante et efficace : c’est un poète de l’authenticité, un poète précis de la vérité ; et ses personnages nous apportent vraiment une présence humaine : celle de L’Homme ou celle des Amoureux du Havre, qui ne sont pas, grâce à cette précision, de simples lieux communs sentimentaux. Elle conduit à la mélancolie qui est la grande force des chansons quand elles sont de la « classe » littéraire de celles de Léo Ferré ». Le programme, enfin, présente Ferré comme « la nouvelle grande vedette de la chanson française » et propose un portrait.
Se succèdent sur la scène le jongleur Lord X ; la chanteuse Annick Charlier ; les acrobates les Cottas ; le groupe d’Amérique latine les 6 Guaranis ; l’imitateur Claude Véga ; le comique musical Hal Monty ; la chanteuse Odette Laure ; les ballets espagnols de Pacita Tomas ; Léo Ferré. Le spectacle est présenté par Yvonne Solal et l’orchestre est dirigé par Gaston Lapeyronnie. Ferré chante en veston croisé, chemise et pochette rouges et pantalon noir. Ses chiens sont couchés sous le piano. L’orchestre est toujours traditionnellement installé dans la fosse, mais il fait monter sur scène Jean Cardon, lors du Piano du pauvre. Un observateur professionnel suit le spectacle et note sur sa fiche : « Olympia, débute très bien, puis à la sixième chanson Merci mon Dieu ressemble trop à La Prière de Brassens – inexpérience des rideaux alors que le reste de la mise en scène est excellent » [2].
 Odéon produit un enregistrement public en 30-cm, Récital Léo Ferré enregistré au cours du spectacle de l’Olympia, qui comprend un extrait du spectacle : La Vie, Monsieur mon passé, Graine d’ananar, Le Piano du pauvre, Vise la réclame, L’Homme, Merci mon Dieu, Mon p’tit voyou, Monsieur William, L’Âme du rouquin, Paris-Canaille, La Rue. C’est le premier 30-cm de Léo Ferré. Cet enregistrement ne sera réédité qu’en 1994, dans une collection de huit CD éditée par Sony et intitulée Les Années Odéon.
Odéon produit un enregistrement public en 30-cm, Récital Léo Ferré enregistré au cours du spectacle de l’Olympia, qui comprend un extrait du spectacle : La Vie, Monsieur mon passé, Graine d’ananar, Le Piano du pauvre, Vise la réclame, L’Homme, Merci mon Dieu, Mon p’tit voyou, Monsieur William, L’Âme du rouquin, Paris-Canaille, La Rue. C’est le premier 30-cm de Léo Ferré. Cet enregistrement ne sera réédité qu’en 1994, dans une collection de huit CD éditée par Sony et intitulée Les Années Odéon.
 Comment ce tour de chant est-il perçu ? Dans Le Monde, un article signé C. de R. (est-ce encore Christine de Rivoyre ? Ce n’est pas certain) relate : « Je le revois le soir de la première, arrivant sur scène à l’heure où l’on éteint les chandelles, étranglé de trac et d’impatience devant un public qui pensait déjà au départ, au souper et au métro. Je revois surtout avec peine la dernière chanson si belle, La Vie, qu’il interpréta devant une marée de dos mouvants » [3].
Comment ce tour de chant est-il perçu ? Dans Le Monde, un article signé C. de R. (est-ce encore Christine de Rivoyre ? Ce n’est pas certain) relate : « Je le revois le soir de la première, arrivant sur scène à l’heure où l’on éteint les chandelles, étranglé de trac et d’impatience devant un public qui pensait déjà au départ, au souper et au métro. Je revois surtout avec peine la dernière chanson si belle, La Vie, qu’il interpréta devant une marée de dos mouvants » [3].
On remarque au passage que La Vie, dernier titre, se retrouve en première position dans le disque. Il y a deux conceptions de l’enregistrement public : le spectacle intégral en une ou plusieurs captations, ou bien le montage de textes dans un ordre qui paraît être le meilleur au responsable artistique du moment. On ne portera ici aucun jugement, dans la mesure où le disque ne restitue pas l’intégralité du tour de chant et où, par conséquent, l’esprit d’origine n’est de toute façon pas respecté. La « mise en ordre » artistique est un procédé qui peut se justifier aussi. Elle est l’équivalent de la construction d’un livre, singulièrement de celle d’un recueil de poèmes ou de nouvelles.
C. de R. poursuit : « En dépit du succès qu’il obtint l’an dernier sur cette même scène de l’Olympia, Léo Ferré n’est pas encore adapté à cet immense cadre. Ses chansons portaient mieux, c’est incontestable, dans les brumes des caves d’où émergeaient son piano et sa longue figure inquiétante, trouée de lunettes à monture de fer – il ressemble à Schubert. Au music hall, Ferré, impressionné par l’exemple de Piaf, a voulu faire « théâtre ». Et il a compliqué de façon superflue son Piano du pauvre, par exemple, qui s’en passerait si facilement. Il a enrobé de gesticulations pas toujours très adroites L’Âme du rouquin et Vise la réclame. Ni le ravissant Monsieur mon passé, ni ce très joli chant d’amour intitulé Mon p’tit voyou, n’ont encore leur style. Quant à Merci mon Dieu, je crois qu’il vaudrait mieux le supprimer. Encore une petite erreur psychologique » [4].
Le reste de l’article est consacré aux artistes de la première partie et, en particulier, à Odette Laure. Ces remarques sur le métier de Léo Ferré, sa tenue en scène encore mal maîtrisée, continueront jusqu’en 1961. Il est difficile d’estimer aujourd’hui si elles étaient dues à une maladresse réelle ou à l’impression durable qu’il avait faite aux journalistes, au temps des cabarets. Il y a sans doute un peu des deux : Ferré avait bien sûr encore à apprendre et les critiques encore à oublier.
Un autre journaliste signant, lui, J.-G. M., écrit dans Radio-Cinéma-Télévision le compte rendu suivant : « Pourquoi les auteurs de bonnes chansons tiennent-ils toujours à les interpréter eux-mêmes quand ils peuvent les confier à des Piaf, Montand ou Sauvage ? Léo Ferré tombe dans le panneau à l’Olympia : veston croisé, lunettes de fer, front haut, l’air triste et intelligent d’un professeur de mathématiques spéciales avec un flamboyant et inutile rappel de l’anarchisme du monsieur : un col de chemise rouge et une pochette de même couleur qui jouent les pavillons » [5].
L’époque compte un grand nombre d’interprètes fort talentueux et le débat esquissé ici est alors classique : les auteurs, parfois, devraient s’abstenir de chanter eux-mêmes. Ferré essuiera plusieurs fois cette critique. On la lui fait depuis ses débuts. Dans l’esprit du moment, elle est parfaitement compréhensible.
J.-G. M. écrit encore : « Elles possèdent tellement de qualités, les chansons de Léo Ferré, que l’interprète fait un temps illusion : d’autant plus qu’il débute par « J’ai dans la tête un vieux banjo de 1925 », excellente nouveauté dont le parfum poétique séduit immédiatement. Mais vite on remarque, en retrouvant les vieux succès Le Piano du pauvre, Paris-Canaille et les autres que la présentation de Ferré accentue désagréablement le côté morbide de ses chansons et surtout qu’il les prive du rythme et de l’entrain qu’elles réclament. Il se donne pourtant beaucoup de mal et la mise en scène de Monsieur William appelle justement les applaudissements. Mais sa puissance et sa conviction ne suffisent pas ; même des découvertes théâtrales – l’apparition de l’accordéoniste aux dernières mesures du Piano – ne sauraient remplacer la gouaille souriante d’une Patachou, par exemple » [6].
Il faut redire qu’alors, le music hall, c’est un chanteur devant un rideau opaque et l’orchestre derrière, ou bien l’orchestre dans la fosse qui porte justement ce nom. En faisant monter Jean Cardon sur la scène, Ferré innove et cela est remarqué : « découverte théâtrale », « apparition », le choix des termes montre l’inhabituel. Et pourtant, l’auteur de l’article reste fidèle à quelque chose de plus classique : Patachou, qui n’a jamais dérangé personne. Par ailleurs, on a là une confirmation : la première chanson n’est pas La Vie mais Monsieur mon passé.
L’article continue : « Et puis le parolier se laisse un peu aller, sa verve le grise et il accumule tellement d’images au vitriol et de variations argotiques que l’on sent pointer le procédé : Vise la réclame ou L’Âme du rouquin, c’est toujours la poésie du faubourg, des affiches et de l’ivrogne, quelle affreuse monotonie ! Quel nouveau Trenet viendra chanter la joie de vivre ? » [7].
Ces dernières considérations constituent un exemple de l’attitude de la critique en général, à ce moment-là. L’artiste de music hall, c’est la joie de vivre, le rythme et l’entrain. Il est difficile de présenter autre chose. L’Âme du rouquin, pour le chroniqueur, c’est la poésie de l’ivrogne : le clin d’œil à Baudelaire passe inaperçu. Léo Ferré chante alors depuis neuf ans, il lui faudra encore attendre jusqu’en 1961 pour qu’on accepte son univers.
Enfin, cette dernière notation : « Quant à Merci mon Dieu, espérons que Ferré saura l’enlever de son répertoire. Ne singe pas qui veut l’émouvante Prière de Francis Jammes… » [8].
C’est la même opinion que celle de C. de R. : il faut supprimer la chanson, et que celle de l’observateur professionnel : cela rappelle La Prière. Brassens vient en effet de mettre en musique la Ballade pour prier Notre-Dame de Jammes, sous le titre La Prière. Il a pour cela utilisé la musique qu’il avait composée pour Aragon (Il n’y a pas d’amour heureux) et coupé de très nombreuses strophes dans le poème. Est-ce le recul dont on dispose maintenant ? – la comparaison ne me paraît pas si justifiée que cela. On n’est pas étonné que cette chanson puisse choquer le public de 1955 : il faut n’avoir pas connu les années 50 pour ne pas le comprendre. Plus surprenant est le fait que, plusieurs années auparavant, Monsieur Tout-Blanc avait été bien mieux reçu par la critique. On peut se demander si ce n’était pas l’effet de la valse qui apparaît au refrain, cette petite valse très réussie qui rend la chanson plus « efficace » encore. Tout compositeur de chansons sait qu’une valse « marche » pratiquement toujours. Merci mon Dieu n’est pas dansant. Ceci explique peut-être cela.
Là encore, le reste de l’article est consacré aux artistes de la première partie. Léo Ferré se brouillera ensuite avec Coquatrix et ne reviendra plus à l’Olympia avant leur réconciliation de 1972. Il s’y produira encore en 1984 et un soir unique en 1992, pour une soirée de soutien à Mme Castanier. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances Ferré s’est fâché avec Bruno Coquatrix. Ce n’est pas après ce spectacle puisqu’en 1958, il est sur la scène de Bobino dont Coquatrix, à cette période, est également le responsable (le contrat correspondant a été proposé sur E-bay il y a quelques années et n’a pas trouvé acquéreur : il était bien signé Bruno Coquatrix). Ce serait donc juste après et, dans la foulée, il écrira La Mafia.
Ferré s’est fâché avec Bruno Coquatrix. Ce n’est pas après ce spectacle puisqu’en 1958, il est sur la scène de Bobino dont Coquatrix, à cette période, est également le responsable (le contrat correspondant a été proposé sur E-bay il y a quelques années et n’a pas trouvé acquéreur : il était bien signé Bruno Coquatrix). Ce serait donc juste après et, dans la foulée, il écrira La Mafia.
Ce qui est important ici, ce n’est pas tellement la reconstitution de ce spectacle, c’est bien sûr la manière dont il a été reçu. Les articles cités proviennent d’un grand quotidien, Le Monde, et d’un des rares journaux de programmes du moment, Radio-Cinéma-Télévision, qui se trouve être l’ancêtre de Télérama. Ce sont deux publications importantes. Ces réactions nuancées (il y en eut certainement d’autres) font qu’on considère habituellement que cet Olympia n’a pas été un total succès. Conséquence : Ferré devra attendre jusqu’en 1958 pour se produire de nouveau dans une grande salle parisienne (Bobino, donc) et 1961 pour connaître la grande année de son triomphe (le Vieux-Colombier et, deux fois, l'Alhambra).
En attendant, dans la salle de 1955, on trouve Hervé Morvan et son assistant Léo Kouper. Et aussi Maurice Frot, qui voit Ferré pour la première fois. Ils se rencontreront l’année suivante. Dans sa loge, Guy Béart débutant vient lui parler. Un soir, Jean-Claude Tertrais vient trouver Léo Ferré pour lui faire savoir qu’André Breton – dont la fille, Aube, lui a parlé de l’artiste – désire le rencontrer. Mais ceci est une autre histoire.
____________________
[1]. Lire Marie-Claire, mars 1955.
[2]. Cette fiche a été reproduite par Eddy Marouani dans Pêcheur d’étoiles, profession : impresario, paru chez Laffont en 1989.
[3]. Le Monde du 18 mars 1955.
[4]. Ibidem.
[5]. Radio-Cinéma-Télévision du 27 mars 1955.
[6]. Ibidem.
[7]. Ibidem.
[8]. Ibidem.
(Photos : Harcourt, Pierre Fournier)
00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 13 février 2007
La musique, la tomate et le hibou
J’ai regardé l’autre soir une émission de 1972, qui fut tournée par la télévision belge. Entre autres choses, Léo Ferré évoquait longuement son enfance et les pâtes faites à la maison par sa grand-tante. Il racontait comment son grand-oncle se levait tôt et mettait en route une sauce tomate qui allait cuire durant de nombreuses heures. Cette histoire est connue, encore qu’on salive chaque fois tant il la raconte avec une grande sensualité. Ce qui m’a frappé dans cet entretien, c’est que, pour signifier combien la sauce cuite sur le charbon de bois durant un temps infini et jalousement surveillée par l’officiant était savoureuse, Ferré a cherché un mot avant de déclarer : « C’était de la Musique » – et l’on devine qu’ayant prononcé ce terme magique, il avait vraiment tout dit.
Là encore, rien de neuf : nul n’ignore son amour pour la musique. Ce qui était amusant, c’était le définitif qu’il mettait dans ce mot : rien de mieux, rien de plus haut. Dans sa voix, on devinait le M majuscule, on entendait cette capitale. Cette passion devenait un critère absolu, un mode qualificatif applicable même à la sauce, à quoi que ce soit de sublime. Il n’était pas de terme plus adéquat pour dire le paradis gustatif. On imagine sans peine qu’il eût pu, dans le cadre d’un autre propos, parler de musique à propos de l’amour, par exemple.
Cette émission fournit par ailleurs une information importante, toujours dans le domaine de la musique. Léo Ferré joue quelques mesures de piano, qu’il présente comme un concerto intitulé Le Chant du hibou. Ce qui signifie que cette œuvre, enregistrée en 1983 par la grâce d’une face libre dans le quadruple disque de L’Opéra du pauvre (RCA), était écrite (mais était-elle déjà orchestrée ?) depuis 1972.
00:00 Publié dans Spectacles et émissions | Lien permanent | Commentaires (23)
dimanche, 11 février 2007
Synthèse des trois premiers mois de fonctionnement de ce lieu
Il n’est évidemment pas question de rendre des comptes ni de singer la participation, mais je fais ci-après le point des premiers mois d’activité de Léo Ferré, études et propos.
Durant un mois et demi, les notes ont été quotidiennes ; elles ont ensuite paru un jour sur deux. Elles seront désormais moins régulières, afin de ne pas tomber dans l’obligation d’écrire coûte que coûte et n’importe quoi.
Les débuts de ce blog ont été lents, puis la vitesse de croisière est apparue, qui se situe actuellement à environ cinquante visiteurs par jour, parfois un peu plus, ce qui, évidemment, est dérisoire mais représente tout de même quelque chose puisqu’on ne trouve ici, sauf exception, pratiquement aucune image, aucune photographie et que, dans l’ensemble, le niveau des discussions est sérieux. Je m’efforce de rédiger les notes initiales dans un langage toujours clair mais on aura compris, je pense, qu’on ne trouvera aucune concession à la facilité ou à la mièvrerie, moins encore à l’insignifiance. C’est plutôt l’austérité qui serait recherchée.
Je n’ai eu que quelques retours, peu, en privé. Dans l’ensemble, ces correspondants se montraient satisfaits de ce qu’on pouvait lire dans ces pages. Je rappelle que figurent à l’écran les textes des trente et un derniers jours et que l’on peut accéder aux précédents par les archives : la page d’accueil n’est pas tout. Les commentaires sont ouverts en permanence et constituent une invitation constante à l’échange, à l’élargissement du débat. Je m’efforce, dans l’ensemble, de répondre à chacun et de le faire le plus rapidement possible. Toutefois, ainsi que je le disais en commençant, je n’ai pas la vérité révélée.
Je n’ai évidemment aucune idée de qui visite ce lieu. Je ne comprends pas pourquoi ce blog, qui n’est entravé par aucune forme d’accès réservé, n’est toujours pas référencé chez Google. Aucune recherche par mots-clefs n’aboutit ici. Cela n’est pas très grave, mais j’aimerais qu’on puisse aller plus loin que le noyau des commentateurs fidèles, que je remercie par ailleurs de leur intérêt. Les statistiques (anonymes, bien sûr) de Haut et Fort, pour autant qu’elles soient fiables, indiquent que, parmi ceux qui viennent ici autrement que par l’adresse directe, la plus grande partie arrive par les liens créés en novembre dernier sur la page d’actualité du site officiel. Je m’y attendais un peu, c’est vrai. Cependant, j’avais aussi averti de l’ouverture un bon nombre de personnes figurant dans mon propre carnet d’adresses. Les liens que j’ai créés sur les autres sites et blogs que j’anime n’occupent qu’une part plutôt faible des statistiques. Enfin, quelques amis rencontrés virtuellement ici et là sur la Toile ont eu l’amabilité de mettre ce blog en lien, qu’ils soient eux aussi remerciés.
S’agissant des collaborateurs extérieurs dits « Les invités du taulier », j’espère pouvoir en accueillir de nouveaux. À ce jour, seul Jacques Miquel a donné suite à ma proposition de rédaction de notes, les autres ayant décliné mon invitation. Je regrette leur décision et espère qu’ils voudront bien changer d’avis. Certains, enfin, m’enverront plus tard, m’ont-ils dit, des textes à publier. Les sujets promettent d’être intéressants.
Il est donc possible, dans l’ensemble, de parler sérieusement de Léo Ferré sur internet. Depuis trois mois, on ne s’est pas invectivé, on est resté dans le sujet et l’on a échangé des propos d’un niveau sans commune mesure avec les inepties ayant souvent cours sur la Toile, quel que soit le thème. On continuera donc, sans la moindre auto-satisfaction.
Amicalement, et en toute humilité.
00:00 Publié dans Organisation du blog | Lien permanent | Commentaires (4)
vendredi, 09 février 2007
Le château de Perdrigal
Il ne saurait, à mon sens, y avoir de blog à prétention culturelle ni, comme ici, de simples « études et propos » sans un peu d’histoire, bien évidemment en liaison avec notre sujet.
Dans de nombreux entretiens, Léo Ferré a évoqué la demeure dans laquelle il s’installe en 1963, en parlant d’« une ruine du XIIIe siècle ». À mon avis, le château de Pech-Rigal date plutôt des XIVe et XVe siècles. Jean Lartigaut, érudit local, parle du XVIe dans son étude auto-éditée Les Seigneurs de Pechrigal. Les registres paroissiaux de la commune de Saint-Clair (Lot), située à sept kilomètres de Gourdon, registres que j’avais pu consulter en 1984, font en tout cas remonter l’histoire des seigneurs de Perrigal au XVIIe (1690). Mais ils n’étaient certainement pas complets.
Le nom, tout d’abord. En Quercy, un pech est une hauteur, un tertre. Le pech rigal, c’est le tertre royal, c’est-à-dire le lieu où vivaient les seigneurs locaux. Tout en haut, ils avaient bâti un repaire à peine visible en été lorsqu’on descend de Gourdon vers la vallée et que les arbres le masquent (« le bois est fermé », dit-on dans le pays), davantage en hiver lorsque « le bois est ouvert ». Léo Ferré métamorphose ce nom en Perdrigal, qui signifie par ailleurs perdrix en quercynois. Si certaines cartes indiquent Périgal ou Perrigal, on voit au passage que, musicalement, Perdrigal évoque à la fois les sonorités de Perceval et de madrigal.
Ferré a découvert le Lot lorsqu’il est venu chanter au Casino de Saint-Céré. Séduit par la région comme tous ceux qui y passent pour la première fois, il demande à son ami Serge Arnoux, dessinateur et créateur de modèles sur tissu à Saint-Céré, de lui trouver une maison à acquérir. Il achète le château à sa propriétaire, Mme Dreyfus. Seule une aile est habitable. Il fera de la propriété une SCI sous sa gérance, dont le siège est à Paris. Il y installera un peu plus tard une imprimerie. Le cadastre de la commune de Saint-Clair mentionne « Les éditions et imprimeries de Perdrigal », inscrites au registre du commerce sous le n° RC 66 B 00029. Il vivra dans le Lot jusqu’en 1968. La demeure restera ensuite plus ou moins à l’abandon durant longtemps.
Aujourd’hui, le château a été racheté, l’accès au chemin d’entrée déplacé. Vue de la route, la restauration, qui a demandé des années de travail, paraît fort bien faite, à ceci près qu’on a cru bon d’ouvrir des « chiens assis » dans la toiture, faisant ainsi de cette demeure une aberration historico-architecturale.
00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (24)
mercredi, 07 février 2007
Tentative de reconstitution du boulevard Pershing
L’appartement qu’occupait à Paris Léo Ferré n’existe plus, on le sait. Voici une tentative de reconstitution des lieux, faite uniquement d’après des documents déjà rendus publics : quelques photographies parues dans la presse ou dans des ouvrages, quelques articles de journaux et le Bottin pour 1960, le tout en complément d’un début de reconstitution que j’avais primitivement esquissée dans Les Chemins de Léo Ferré.
Adresse : 28, boulevard Pershing, Paris XVIIe. Téléphone: Étoile 74-95. Métro : ligne 1, station Porte Maillot.
La voie est entièrement pavée.
L’immeuble appartient à la ville de Paris. Aujourd’hui, c’est un parking pour autocars.
Un porche donnant sur une cour pavée où sont garées les voitures et où sèche le linge.
À gauche du porche, lorsqu’on le regarde de face, au 28 bis, le Luna-Bar, avec de petits rideaux tendus aux vitres, une terrasse constituée d’une table et de deux chaises disposées sur le trottoir. Téléphone: Étoile 54-53.
À droite du porche, un horloger, au 28, Avron et Cie, dont l’enseigne est « Au véritable carillon ». Téléphone: Étoile 53-43.
Plus loin, un garagiste.
De l’autre côté de la voie, un grand terrain sur lequel se dressait autrefois le Luna-Park (d’où le nom du bar). Aujourd’hui, s’y trouvent l’hôtel Concorde-Lafayette et le palais des Congrès.
Sous le porche, à droite lorsqu’on entre, un escalier.
Au premier étage, une porte sur laquelle est punaisée la photographie des saint-bernard Arkel, Canaille et Egmont. Plus tard, la porte sera parfois ouverte par Pépée, chimpanzé femelle. On est chez Léo Ferré, que le Bottin signale comme compositeur de musique.
Selon les sources, il s’agit d’un appartement de deux ou de trois pièces.
Dans la grande pièce tendue de rouge, aux plinthes rouges, un tapis aux tons bleus sur un parquet sombre, un lampadaire filiforme à abat-jour conique étroit et haut, un piano de bois clair au-dessus duquel a figuré, un temps, un portrait de Beethoven, une longue table, des toiles de Gabriel Terbots, un poêle installé dans une cheminée, des niches avec des étagères à livres, un fauteuil, un canapé.
La gouttière coupe en travers l’appui métallique de la fenêtre qui donne sur le boulevard et se trouve juste au-dessus de la boutique d’horlogerie.
Les toilettes sont installées dans la cuisine.
Léo Ferré a vécu là de juillet 1951 à 1963 (environ février-mars). Il part ensuite s’installer dans le Lot.
00:00 Publié dans Lieux | Lien permanent | Commentaires (4)
lundi, 05 février 2007
Un élève et des disques
Lundi 20 octobre 1969, de dix à douze heures. Ce jeune élève de première littéraire amène en classe le double album de Léo Ferré, n° 80389-90, paru chez Barclay quelques mois plus tôt sous le titre Récital 1969 à Bobino. Il n’est pas facile de transporter ça sur une mobylette. L’électrophone gris et vert du lycée Victor-Hugo de Marseille est un appareil monophonique dont il n’existe dans l’établissement qu’un seul exemplaire qu’il faut réserver. Il fait écouter à ses camarades Les Assis, Les Poètes, L’Idole, La Révolution, C’est extra et Petite. C’est la première fois que l’élève partage ce qu’il sait de Léo Ferré avec d’autres et ce n’est pas facile parce qu’il lui est demandé, naturellement, de commenter ce qu’il fait entendre. Heureusement, le professeur vient à sa rescousse. Il aime l’artiste, qu’il appelle « Monsieur Ferré ». À la fin de l’heure, dans l’exemplaire du n° 93 des « Poètes d’aujourd’hui » également apporté par l’élève, il donne lecture de L’Homme. Ce livre et ce disque sont à peu près les seuls documents que possède alors le garçon.
Vendredi 2 octobre 1970, de seize à dix-sept heures. L’élève, maintenant en terminale, amène, dans la classe du même professeur, le premier volume du disque Barclay Amour Anarchie. Le second n’a pas encore paru et, d'ailleurs, on ne sait même pas qu’il existera un deuxième disque. Sur l’électrophone gris et vert du lycée Victor-Hugo de Marseille, appareil monophonique dont il n’existe dans l’établissement qu’un seul exemplaire qu’il faut réserver, il place le 33-tours n° 80417 et fait écouter La Mémoire et la mer et Le Chien. C’est très beau, un microsillon qui tourne avec le bras de lecture qui, en travers, lui fait chanter le souvenir.
Comme l’élève est méthodique, il note tout cela sur un feuillet qu’il encarte dans son exemplaire des « Poètes d’aujourd’hui », ce qui permet de le restituer à présent en garantissant même l’horaire des cours. Autre temps où l’on pouvait écouter en classe, sur un appareil monophonique gris et vert réservé, La Révolution et Petite auprès d’un brillantissime professeur... de droite. Cet homme est un personnage et, dans ses yeux, danse en permanence une petite flamme ironique, piquante, parfois inquiétante. Il aime beaucoup l’élève mais ne l’épargne pas, jamais.
Le professeur s’est tué en voiture un peu plus tard, sur la route d’Arles, juste avant le printemps 1971. Il n’avait pas trente-cinq ans.
00:00 Publié dans Souvenirs | Lien permanent | Commentaires (10)
samedi, 03 février 2007
Du contresens et des interprètes
Je tiens que toutes les chansons de Léo Ferré sont des chansons d’amour, y compris les plus véhémentes ou qui sont perçues comme telles.
Les interprètes – je parle ici de ceux, de plus en plus nombreux, qui le chantent sans la moindre espèce de talent avec une voix d’aphasique et un souffle inexistant, quand ils ne donnent pas simplement l’impression de ne pas comprendre ce qu’ils chantent – les interprètes qui hurlent et gesticulent pour dire, sans doute, la force, l’énergie, l’indignation, la colère, que sais-je, ces interprètes commettent tous un contresens : Léo Ferré n’a jamais écrit que des chansons d’amour.
C’est parce qu’il a appelé de ses vœux cet amour tout au long de son œuvre, qu’il l’a établi comme un « programme », qu’il faut garder présent à l’esprit cette dimension essentielle lors de l’interprétation. Cela nous évitera les interprètes hurleurs et faisant de grands gestes déplacés. Les interprètes « historiques » (ceux des années 50 et 60) étaient tous bons : on pouvait ne pas les aimer, ne pas apprécier leur voix, le visage qu’ils donnaient aux chansons, ils étaient tous bons techniquement. Ils ont continué au-delà de cette période, bien sûr, mais personne ne leur a succédé, et les petites natures d’aujourd’hui, les gorges enrouées, les poitrines d’anchois, les filets de voix rares comme un ru occitan au mois de juillet, ne savent pas que chanter n’est pas faire n’importe quoi, moins encore gueuler comme un veau malade.
Il faut rappeler que la véhémence ne peut pas masquer l’absence de talent. Cela est à rapprocher de l’attitude de certains chanteurs qui, parce qu’ils n’ont aucun souffle, vont jusqu’à ajouter à la mélodie des notes qui n’existent pas afin de ne pas avoir à « tenir » la note d’origine quand cela leur est impossible. J’ai entendu un triste sire chanter : « Les anarchiii-i-stes » parce qu’il ne pouvait pas donner vocalement « Les anarchiiiiiiiiiistes ». Je ne veux pas me moquer d’impossibilités vocales parfaitement compréhensibles au demeurant, mais signifier la facilité devant laquelle certains ne reculent pas. Quand on ne peut pas chanter une chanson, on en chante une autre, tout simplement. On ne triche pas. Et si l’on ne peut pas, vocalement, chanter Ferré, eh bien, on s’abstient. On n’est pas tenu de chanter Léo Ferré. Le sire en question, qui plus est, se produisait sur des bandes de style karaoké et chantait faux.
Je pense aussi à un autre spectacle auquel j’ai assisté, présenté dans les programmes avec une prétention incroyable. Il y était question d’arrangements dûs au pianiste. Les arrangements en question consistaient en une simplification outrancière de la partition. En gros, on avait supprimé tout ce qui était sans doute trop difficile à jouer.
Artistiquement parlant, ces exemples, qui ne sont pas les seuls, sont une mauvaise action. Sur un plan plus moral, on est effaré de constater ce que des gens qui se disent artistes se permettent envers un autre artiste qu’ils sont censés admirer et célébrer. Le problème est l’accroissement du nombre d’interprètes médiocres que ces dernières années ont vu naître. Au mieux, je veux croire à leur sincérité et ne puis que déplorer qu’aimant Léo Ferré, ils le servent si mal. Au pire, et j’ose à peine y penser, ils ne voient là qu’une possibilité de se mettre eux-mêmes en avant… sans se rendre compte de l’abîme de ridicule dans lequel ils tombent sans fin. De ces interprétations nulles, nous dirons, reprenant une phrase d’un mien professeur de lettres parlant d’autre chose, qu’elles « sonnent comme les trente deniers de Judas et nous ne les accablerons pas davantage ».
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (29)
jeudi, 01 février 2007
Ferré 1984, histoire d’un enregistrement
Comme annoncé dans la note « Sous l’arc copain où je m’aveugle », voici un tour d’horizon portant sur un enregistrement public dont les éditions sont multiples.
De tous les spectacles enregistrés de Léo Ferré, celui réalisé au Théâtre des Champs-Élysées a connu le plus d’avatars. D’ailleurs, lorsqu’on dit « Ferré 1984 », on parle généralement de ce récital. Or, la même année, Ferré chante à l’Olympia du lundi 1er au dimanche 14 octobre, mais jamais on n’évoque ce tour de chant sous le terme de « Ferré 1984 », sans doute parce qu’il n’en demeure pas de trace gravée ou filmée.
On examinera donc ici les différents visages (il en existe neuf) de ce qui demeurera « Ferré 1984 » dans l’histoire de l’artiste. C’est un parcours compliqué, qu’il n’est peut-être pas inutile d’indiquer aux personnes découvrant aujourd’hui Ferré.
Le récital est donc enregistré au Théâtre des Champs-Élysées les vendredi 6 et samedi 7 avril 1984. Il dure trois heures.

Un album de trois 33-tours paraît bientôt chez RCA, sous le titre Ferré 84, enregistrement public, concert en trois disques. Le spectacle n’est pas rendu intégralement.
 Curieusement, sous le titre Léo Ferré, paraît, toujours chez RCA, un extrait de l’extrait précédent, en un coffret de deux 33-tours. Évidemment, le spectacle est encore moins intégral.
Curieusement, sous le titre Léo Ferré, paraît, toujours chez RCA, un extrait de l’extrait précédent, en un coffret de deux 33-tours. Évidemment, le spectacle est encore moins intégral.
 Sous le titre Léo Ferré en public, RCA fait paraître un CD. Naturellement, ce n’est pas le spectacle intégral.
Sous le titre Léo Ferré en public, RCA fait paraître un CD. Naturellement, ce n’est pas le spectacle intégral.
 En 1988, EPM édite un CD maxi single (équivalent d'un 45-tours extended playing) titré Léo Ferré, enregistrement public, extrait de ce spectacle.
En 1988, EPM édite un CD maxi single (équivalent d'un 45-tours extended playing) titré Léo Ferré, enregistrement public, extrait de ce spectacle.
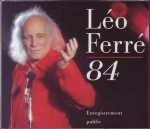 Sous le titre Léo Ferré 84, enregistrement public, paraît en 1995 un triple CD EPM, qui, cette fois, propose le récital intégralement.
Sous le titre Léo Ferré 84, enregistrement public, paraît en 1995 un triple CD EPM, qui, cette fois, propose le récital intégralement.
 Puis, sous le titre Léo Ferré au théâtre des Champs-Élysées, La Mémoire et la mer, reprenant dans le catalogue EPM le fonds Ferré qui lui appartient, fait reparaître sous sa marque ce spectacle intégral.
Puis, sous le titre Léo Ferré au théâtre des Champs-Élysées, La Mémoire et la mer, reprenant dans le catalogue EPM le fonds Ferré qui lui appartient, fait reparaître sous sa marque ce spectacle intégral.
 Parallèlement, en vidéo, sous le titre Léo Ferré, récital au théâtre des Champs-Élysées, a été publiée en 1984 une cassette RCA, proposant le spectacle intégral filmé par Guy Job.
Parallèlement, en vidéo, sous le titre Léo Ferré, récital au théâtre des Champs-Élysées, a été publiée en 1984 une cassette RCA, proposant le spectacle intégral filmé par Guy Job.
 Cette même cassette reparaîtra en 1995 chez EPM avec une autre jaquette, sous le titre Léo Ferré 84. Spectacle intégral, toujours.
Cette même cassette reparaîtra en 1995 chez EPM avec une autre jaquette, sous le titre Léo Ferré 84. Spectacle intégral, toujours.
 Sous le titre Léo Ferré au théâtre des Champs-Élysées, La Mémoire et la mer fait reparaître ce film dans un DVD publié en 2003 : il s’agit toujours du spectacle intégral.
Sous le titre Léo Ferré au théâtre des Champs-Élysées, La Mémoire et la mer fait reparaître ce film dans un DVD publié en 2003 : il s’agit toujours du spectacle intégral.
Ne demeurent aujourd’hui en vente que les éditions (CD et DVD) de La Mémoire et la mer. Toutefois, on peut toujours trouver, d’occasion, les anciennes. Le plus perturbant, ce sont les perpétuels changements de titre et les images, très voisines. Cette note ne désire qu’aider les personnes découvrant aujourd’hui Léo Ferré, s’il en est ici, à disposer de documents intégraux.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (30)
mardi, 30 janvier 2007
Benoît Misère, histoire d’un livre
Je propose ci-après un article que j’avais donné aux Cahiers d’études Léo Ferré, qui a paru en 2002 dans le n° 6. Pour sa publication en ce lieu, je l’ai légèrement complété.
Benoît Misère est l’unique roman publié par Léo Ferré. Il entreprend sa rédaction à Paris, dans son appartement du boulevard Pershing, aujourd’hui disparu, le dimanche 25 novembre 1956. C’est le début d’une longue histoire.
En 1961, il répond à une interview non signée et signale l’existence de cette œuvre à laquelle il travaille depuis cinq ans mais, bien sûr, de façon discontinue [1]. L’éditeur René Julliard retient rapidement le livre, mais il meurt le dimanche 1er juillet 1962 et le roman, finalement, reste en souffrance. La même année, Ferré mentionne de nouveau, au cours d’un entretien avec Charles Dobzynski au moment de son récital à l’ABC, que le livre va paraître [2]. En fait, Léo Ferré ne cessera d’y travailler que le mardi 9 juin 1970, date à laquelle il l’achève enfin, à Florence. Au total, il lui aura fallu quatorze années pour écrire son ouvrage.
Comme on le sait, il s’agit du récit de ses initiations. À la merveilleuse enfance monégasque aux goûts de soleil, de sauce tomate cuite durant des heures, de mandarine, aux odeurs de mer, enfance durant laquelle croisent autour de lui des personnages magnifiquement dépeints par l’écrivain parvenu à l’âge adulte, succède le déchirement de l’entrée au collège des frères des écoles chrétiennes, à Bordighera, au-delà de la frontière italienne. Huit années de « prison », d’apprentissage de la solitude et de la liberté intérieure, du refus. Le petit Benoît découvre la musique dans une crèmerie où l’emmène sa mère, qui est venue le voir dans son pensionnat, son enfermement, son exil. Puis il s’invente des amours – la fille aux souliers à semelles de crêpe – et un double, Dobrowitch dit Dobro. Et devient un homme.
L’écrivain Jean-François Revel travaille dans l’édition. Il est présenté à Léo Ferré par son épouse Claude Sarraute, qui tient alors la chronique de variétés du Monde en lui insufflant un esprit et une qualité rarement connus dans ce domaine. Revel obtient de Ferré qu’il termine son travail et le rende enfin public. Il lui propose de le donner à Robert Laffont.
 C’est ainsi qu’achevé d’imprimer le jeudi 10 septembre 1970, le roman paraît chez Laffont au mois d’octobre. Le livre est ceint d’un bandeau vert (bleu marine par la suite), qui indique : « Le premier roman de Léo Ferré » en caractères blancs.
C’est ainsi qu’achevé d’imprimer le jeudi 10 septembre 1970, le roman paraît chez Laffont au mois d’octobre. Le livre est ceint d’un bandeau vert (bleu marine par la suite), qui indique : « Le premier roman de Léo Ferré » en caractères blancs.
Un encart en noir et blanc paru dans la presse présente une photographie du poète et annonce : « Un premier roman qui conte les enfances d’un grand poète. L’histoire d’un de ces gosses, de tous ces gosses que l’on met en prison à neuf ans » [3].
Le mercredi 28 octobre 1970, Michel Polac présente l’ouvrage dans l’émission télévisée Post scriptum. Paul Guimard expose le sujet du livre et Jean-Pierre Chabrol explique qu’il l’a lu sans indulgence et l’a aimé. Quatre lecteurs donnent leur opinion, dont l’une est négative. Ferré, présent, apporte quelques précisions.
À Marseille, le quotidien Le Provençal commente le roman dans sa longue chronique littéraire du dimanche, et titre à son sujet « Contestation en rose ». Un portrait de Léo Ferré illustre l’article. Bien entendu, dans un journal du midi, le côté méditerranéen de l’histoire est particulièrement souligné. On insiste sur l’enfance ensoleillée de l’artiste. « Le seul fait que l’action se déroule entre Monaco et Bordighera, dans un "climat" typiquement méditerranéen et avec des personnages dont la plupart ont la truculence et la tendresse de ceux de Pagnol, ne peut pas ne pas être pour nous le fait essentiel. Il y a entre Ferré et nous un merveilleux sentiment de complicité et il n’est pas jusqu’aux critiques que l’on puisse formuler qui ne naissent précisément de cette complicité. Étant "en pays de connaissance", il peut arriver que nous ne nous "reconnaissions pas" nous-mêmes dans l’interprétation parfois insolite que Ferré nous propose de souvenirs qui sont à la fois les siens et les nôtres. Rien de plus excitant d’ailleurs, car il est aussi "plaisant" d’être enchanté par ses évocations qu"amusant" de les contester. […] Benoît Misère est fait de "morceaux de bravoure", c’est un roman lyrique, le contraire même d’un "nouveau roman". Par le rebondissement de l’invention, il fait songer au mot d’un des personnages (à propos de Monte-Carlo, bien sûr) : "Le sucre d’orge du hasard et de la chance". Rien de superficiel pourtant, car le délire verbal se fonde sur une sensibilité infiniment riche. On se doit de signaler entre réussites majeures les variations sur l’odorat, "la terrifiante entreprise de sentir" et l’univers de Benoît est pour une bonne part "olfactif" : "Ma mémoire d’éléphant est une mémoire de nez…" (cf. ce qu’il dit de l’encens et des mandarines de Noël). Quant aux pages sur le "cimetière du temps", où il évoque son oncle, l’horloger, elles sont simplement fascinantes. Qui ne
naissent précisément de cette complicité. Étant "en pays de connaissance", il peut arriver que nous ne nous "reconnaissions pas" nous-mêmes dans l’interprétation parfois insolite que Ferré nous propose de souvenirs qui sont à la fois les siens et les nôtres. Rien de plus excitant d’ailleurs, car il est aussi "plaisant" d’être enchanté par ses évocations qu"amusant" de les contester. […] Benoît Misère est fait de "morceaux de bravoure", c’est un roman lyrique, le contraire même d’un "nouveau roman". Par le rebondissement de l’invention, il fait songer au mot d’un des personnages (à propos de Monte-Carlo, bien sûr) : "Le sucre d’orge du hasard et de la chance". Rien de superficiel pourtant, car le délire verbal se fonde sur une sensibilité infiniment riche. On se doit de signaler entre réussites majeures les variations sur l’odorat, "la terrifiante entreprise de sentir" et l’univers de Benoît est pour une bonne part "olfactif" : "Ma mémoire d’éléphant est une mémoire de nez…" (cf. ce qu’il dit de l’encens et des mandarines de Noël). Quant aux pages sur le "cimetière du temps", où il évoque son oncle, l’horloger, elles sont simplement fascinantes. Qui ne lira sans émotion ce qu’il nous dit des fiacres et des trams de naguère ? Je m’excuse d’avoir si maladroitement parlé de ce livre, mais comment le commenter alors qu’il est envoûtant comme une chanson de Ferré ? Tout est dans le ton, dans la voix. Ce manifeste du désespoir et de l’espoir est aux antipodes de certaines recherches. Comme Ferré a raison : "Du jour où l’abstraction, voire l’arbitraire, a remplacé la sensibilité, de ce jour-là date non pas la décadence, qui est encore de l’amour, mais la faillite de l’art." Puisse sa leçon être entendue ! » [4].
lira sans émotion ce qu’il nous dit des fiacres et des trams de naguère ? Je m’excuse d’avoir si maladroitement parlé de ce livre, mais comment le commenter alors qu’il est envoûtant comme une chanson de Ferré ? Tout est dans le ton, dans la voix. Ce manifeste du désespoir et de l’espoir est aux antipodes de certaines recherches. Comme Ferré a raison : "Du jour où l’abstraction, voire l’arbitraire, a remplacé la sensibilité, de ce jour-là date non pas la décadence, qui est encore de l’amour, mais la faillite de l’art." Puisse sa leçon être entendue ! » [4].
On ne peut toutefois manquer de remarquer que la construction de Benoît Misère n’est pas à proprement parler celle d’un roman. Il s’agit de seize chapitres très distincts, qui feront dire ceci à Georges Coulonges, plusieurs mois plus tard, lorsqu’il consacrera au volume une note de lecture, dans la revue littéraire Europe : « Pottier appelait son héros Jean Misère et le mettait en chansons. Ferré abandonne la chanson pour mettre Benoît Misère en roman. Roman ? Je n’en suis pas sûr. Que Ferré nous dise: "Ce livre n’est pas autobiographique" ne suffit pas à nous convaincre : il s’agit de cet ouvrage commun à beaucoup où le je de la maturité se plonge avec délectation dans les  jeux de l’adolescence. En fait, Benoît Misère, c’est, dans une ambiance monégasque, Le Petit Chose ou Le Grand Meaulnes qui, devenu adulte, réinvente pour nous le musée Grévin de ses amis et de ses tortionnaires. Ils s’appellent Mme Tirette ou Barba Chino, Je Tâte ou Stradi, la plume de Ferré leur donne une vraisemblance pittoresque mais, invités à contempler leurs portraits successifs, nous n’avons pas pour autant l’impression qu’ils forment un roman. Une aimable collection de gravures anciennes plutôt, que l’auteur contemple tour à tour avec tendresse ou avec une ironie désabusée » [5].
jeux de l’adolescence. En fait, Benoît Misère, c’est, dans une ambiance monégasque, Le Petit Chose ou Le Grand Meaulnes qui, devenu adulte, réinvente pour nous le musée Grévin de ses amis et de ses tortionnaires. Ils s’appellent Mme Tirette ou Barba Chino, Je Tâte ou Stradi, la plume de Ferré leur donne une vraisemblance pittoresque mais, invités à contempler leurs portraits successifs, nous n’avons pas pour autant l’impression qu’ils forment un roman. Une aimable collection de gravures anciennes plutôt, que l’auteur contemple tour à tour avec tendresse ou avec une ironie désabusée » [5].
Pour présenter une émission de télévision, Jacques Marquis reviendra sur le sujet dans Télérama : « Ce Benoît Misère qui s’accrochait "comme une bernique au fond du trou noir" et raconte les "ciels désespérés de son enfance", avec la verve d’un Pagnol, mais canaille, vindicatif, amer et douloureux, c’est Léo Ferré » [6]. Plus tard encore, dans La Semaine radio-télé, Luc Seyral rappellera : « Benoît Misère, l’histoire d’un personnage qui lui ressemble comme un frère » [7].
 Pagnol, Le Petit Chose, Le Grand Meaulnes ! À l’unisson ou presque, les chroniqueurs en appellent au classique imaginaire – ou non – de l’enfance littéraire. Au vrai, si Ferré avait poursuivi – mais ce n’était pas son propos – le récit de la vie de son héros, les journalistes eussent sûrement évoqué le souvenir de Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale. Cela dit, il est des compagnonnages moins prestigieux ! On remarquera cependant combien est répandu ce que l’on tient ici pour le vice absolu, la comparaison. Quand cessera-t-on de mettre des œuvres en parallèle ?
Pagnol, Le Petit Chose, Le Grand Meaulnes ! À l’unisson ou presque, les chroniqueurs en appellent au classique imaginaire – ou non – de l’enfance littéraire. Au vrai, si Ferré avait poursuivi – mais ce n’était pas son propos – le récit de la vie de son héros, les journalistes eussent sûrement évoqué le souvenir de Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale. Cela dit, il est des compagnonnages moins prestigieux ! On remarquera cependant combien est répandu ce que l’on tient ici pour le vice absolu, la comparaison. Quand cessera-t-on de mettre des œuvres en parallèle ?
Le livre sera réédité plusieurs fois. Une première fois chez Plasma, en mars 1980. Une seconde au Gufo del Tramonto, les éditions fondées par Léo Ferré lui-même, en novembre 1989. Une troisième fois enfin, en mars 2001, dans une présentation entièrement nouvelle, par La Mémoire et la Mer, maison d’édition que dirige Mathieu Ferré. Entre temps, il aura fait l’objet d’une traduction en italien due aux soins de Giuseppe Gennari, qui fut publiée chez Gianni Maroni Editore en mai 1994. Gennari reprendra plus tard sa traduction et la fera reparaître sous le titre Mi racconto il mare, chez Lindau, en 2003. Il aura donc, au total, offert six visages.
 Maintenant, Benoît Misère est de nouveau disponible et le demeurera. L’aspect peu orthodoxe que lui reprochait la critique le sert finalement car, hors du temps, hors des modes, le roman de Léo Ferré peut être lu aujourd’hui comme en 1970. Il ignore les rides, littéraires ou autres. L’enfance est une œuvre originale et la vie, une série de rééditions.
Maintenant, Benoît Misère est de nouveau disponible et le demeurera. L’aspect peu orthodoxe que lui reprochait la critique le sert finalement car, hors du temps, hors des modes, le roman de Léo Ferré peut être lu aujourd’hui comme en 1970. Il ignore les rides, littéraires ou autres. L’enfance est une œuvre originale et la vie, une série de rééditions.
__________________________
[1]. Chansons, octobre 1961.
[2]. Les Lettres françaises du 7 au 13 décembre 1962.
[3]. Le Nouvel Observateur du 16 novembre 1970.
[4]. Le Provençal du 29 novembre 1970.
[5]. Europe, avril-mai 1971.
[6]. Télérama du 3 octobre 1971.
[7]. La Semaine radio-télé du 29 juillet au 4 août 1972.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (22)
dimanche, 28 janvier 2007
« Sous l’arc copain où je m’aveugle »
J’ai souvent imaginé un coffret de disques réunissant les enregistrements publics des spectacles de Léo Ferré. Il y a maintenant – ceux qui découvrent son œuvre, par exemple – des personnes qui ne l’ont jamais vu en scène. L’écoute attentive (l’étude) de ces disques en public pourrait peut-être les aider à imaginer ce qu’ils n’ont pas connu, la vidéographie, elle, leur donnant une idée plus précise encore de ce à quoi pouvait ressembler ce qui était non une grand-messe, mais un grand moment tout de même. Encore faut-il que ces enregistrements soient disponibles. En attendant le jour de grâce où l’ensemble des firmes phonographiques se mettront d’accord « sur une idée sur rien pour que l’horreur se taise » et produisent un coffret unique (rêve), ou bien encore le jour où La Mémoire et la mer aura pu achever la publication de « la the intégrale », voici une tentative de relevé des spectacles enregistrés de Ferré, lesquels ne sont pas tous repris en CD, quoi qu’on en dise. Bien entendu, je ne cite que les disques publiés un jour ou l’autre, pas les enregistrements qui, bien qu’effectués, ne sont jamais sortis des archives de firmes diverses. Je reproduis ci-après les titres des disques originaux (microsillons ou CD) et mentionne les éventuels nouveaux titres à la suite.
Les dates indiquées en gras au début de chaque notice sont celles des enregistrements. Lorsque le disque est sorti plus tard, cela est précisé dans la notice.

1950 Chansons sociales (enregistré au cabaret Le Trou le 2 juin 1950 et publié en 2005), CD annexé au Monde Initiatives de janvier 2005. Spectacle non intégral.
1950 La Vie d’artiste, les années Chant du Monde, 1947-1953 (enregistré au cabaret Le Trou le 2 juin 1950 et publié en 1998), album de deux CD, Le Chant du Monde. Spectacle non intégral.
1954 1954 [La Symphonie interrompue et La Chanson du mal-aimé] (enregistré le 29 avril 1954 à l’Opéra de Monte-Carlo et publié en 2006), double CD la Mémoire et la mer 9952-53. Spectacle intégral.
1955 Récital Léo Ferré enregistré au cours du spectacle de l’Olympia (enregistré entre le 10 et le 29 mars 1955), 33-tours 30-cm, Odéon OSX 109. Spectacle non intégral. En CD : sous le titre Récital à l’Olympia, coffret Les années Odéon, vol. 5, Sony.
1958 Léo Ferré à Bobino (enregistré entre le 3 et le 15 janvier 1958), 33-tours 30-cm, Odéon OSX 132. Spectacle non intégral. En CD : sous le titre Récital à Bobino, coffret Les années Odéon, vol. 6, Sony.
1961 Léo Ferré à l’Alhambra (enregistré en novembre 1961), 33-tours 30-cm, Barclay 80164. Spectacle non intégral. En CD : sous le titre Thank you Satan, en public à l’Alhambra 1961, Barclay 841 262-2, et sous le titre Léo Ferré chante à l’Alhambra et à l’ABC, Barclay 076 183-2.
1961-1963 Flash Alhambra-ABC (enregistré en novembre 1961 pour l’Alhambra et entre décembre 1962 et janvier 1963 pour l’ABC et publié en 1963), 33-tours 25-cm, Barclay 80204 S. Spectacle non intégral. En CD : sous le même titre, Barclay, 065-027 2, et sous le titre Léo Ferré chante à l’Alhambra et à l’ABC, Barclay 076 183-2.
1966 Les temps sont difficiles (enregistré à l’Alhambra le 18 novembre 1961, à l’ABC entre décembre 1962 et janvier 1963 [et non le 27 juin 1963 comme indiqué par erreur sur la pochette], au casino de Trouville le 16 juillet 1966), 45-tours, Barclay 71082.
1969 Les Anarchistes, Léo Ferré en public à Bobino (enregistré entre le 15 et le 20 janvier 1969), 45-tours, Barclay 71311. Spectacle non intégral.
1969 Récital 1969 en public à Bobino (enregistré le 2 février 1969), double 33-tours 30-cm, Barclay 80389-90. Spectacle intégral. En CD : sous le même titre, Barclay, 529 116-2.
1969 En vidéo : quatre chansons filmées à Bobino (enregistré entre le 8 janvier et le 3 février 1969 et publié en 2004 en bonus du DVD Léo Ferré chante les poètes, cf infra). Spectacle non intégral.
1969-1970 Un chien à la Mutualité (enregistré au Centre culturel de Yerres le 13 décembre 1969 et à la Maison de la culture de Saint-Denis le 3 janvier 1970 et publié en 1970), 45-tours Barclay 71416. Spectacle non intégral.
1972 La Double vie (enregistré à l’Olympia le 24 octobre 1972 et publié en 1994), CD annexé au livre de Jean-Roger Caussimon paru au Castor astral. Spectacle non intégral.
1972 Seul en scène, Léo Ferré 73 (enregistré à l’Olympia le 11 novembre 1972), double 33-tours 30-cm, Barclay 920425-26. Spectacle non intégral. En CD : sous le même titre, Barclay 589 537-2. En vidéo : sous le titre Sur la scène… (enregistré entre le 24 octobre et le 12 novembre 1972), cassette La Mémoire et la mer 20100. Spectacle non intégral filmé par la RTBF. Sous le même titre, DVD La Mémoire et la mer 10100. Spectacle non intégral filmé par la RTBF.
1973 Sur la scène… (enregistré à Montreux le 3 février 1973 et à Lausanne le 16 mai 1973 et publié en 2001), double CD, La Mémoire et la mer 10038-39. Spectacle intégral. Sous le titre Un chien à Montreux, extrait enregistré à Montreux le 3 février 1973 et publié en 2001, CD, La Mémoire et la mer 10040.
1984 Ferré 84, enregistrement public, concert en trois disques, triple 33-tours 30-cm, RCA 70445 (enregistré les 6 et 7 avril 1984 au théâtre des Champs-Élysées). Spectacle non intégral. Sous le titre Léo Ferré, extrait en un coffret de deux 33-tours 30-cm, RCA NL 70787-2. Spectacle non intégral. En CD : sous le titre Léo Ferré en public, RCA fait paraître un CD, spectacle non intégral. EPM édite ensuite un CD maxi single (équivalent d’un 45-tours extended playing) titré Léo Ferré en public, extrait de ce spectacle. Sous le titre Léo Ferré 84, triple CD EPM 983712 puis La Mémoire et la mer, spectacle intégral. En vidéo : sous le titre Léo Ferré, récital au théâtre des Champs-Élysées, cassette RCA, spectacle intégral filmé par Guy Job. Cette même cassette reparaîtra en 1995 chez EPM avec une autre jaquette, sous le titre Léo Ferré 84. Spectacle intégral, toujours. Sous le titre Léo Ferré au théâtre des Champs-Élysées, publié en 2003, DVD La Mémoire et la mer 10101, spectacle intégral.
1986 Léo Ferré chante les poètes, en vidéo : cassette EPM 982978, spectacle intégral, publié en 1993, filmé par Guy Job. Sous le même titre, publié en 2004, DVD La Mémoire et la mer 10102, spectacle intégral filmé par Guy Job (en bonus, quatre chansons du récital à Bobino en 1969). En son uniquement : dans le coffret Léo Ferré au Théâtre libertaire de Paris, double CD La Mémoire et la mer, spectacle intégral.
1987 La Fête à Ferré, (enregistré le 9 juillet 1987 à La Rochelle), 33-tours 30-cm, EPM FDD 1024. Spectacle non intégral. En CD : sous le même titre, EPM FDC 1024 avec deux chansons supplémentaires. Spectacle non intégral.
1988 Léo Ferré en public au TLP-Déjazet (enregistré les 3, 4 et 5 mai 1988), triple 33-tours 30-cm, EPM FDD 31050). Spectacle intégral. En CD : sous le même titre, double CD EPM, spectacle intégral. Dans le coffret Léo Ferré au Théâtre libertaire de Paris, double CD La Mémoire et la mer, spectacle intégral. En vidéo : dans le coffret Léo Ferré au Théâtre libertaire de Paris, DVD La Mémoire et la mer, spectacle non intégral filmé par Raphaël Caussimon.
1990 Alors, Léo…, enregistrement public (enregistré les 20, 21 et 22 novembre 1990 et publié en 1993), coffret de deux CD, EPM 982942-52. Spectacle intégral. Dans le coffret Léo Ferré au Théâtre libertaire de Paris, double CD La Mémoire et la mer, spectacle intégral.
1992 Avec le temps (enregistré le 27 août 1992 à Saint-Florentin et publié en 1995), CD annexé au livre de Léo Ferré et Hubert Grooteclaes avec un texte de Patrick Buisson paru aux éditions du Chêne. Spectacle non intégral.
On ne tient pas compte ici des enregistrements figurant dans des archives radiophoniques ou télévisuelles diverses, qui n’ont pas fait l’objet d’une sortie en disque ou en vidéo.
N. B. : compte tenu de ses multiples éditions, le récital de 1984 fera l’objet d’une note spéciale, illustrée, à paraître le 1er février 2007.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (0)
vendredi, 26 janvier 2007
À la recherche de Guillaume
À part, naturellement, La Chanson du mal-aimé, les mises en musique d’Apollinaire par Léo Ferré n’ont jamais été regroupées dans un disque. Comme si son oratorio lyrique avait remplacé en lui toutes les interprétations éparses qu’il a pu faire et le dispenser de construire des ensembles comme il le fit pour d’autres poètes.
On en est réduit, par conséquent, à imaginer ce qu’aurait pu représenter la réunion dans un ou deux grands microsillons des pièces suivantes.
Le Pont Mirabeau (studio, 1953).
Marizibill (Bobino, 1969).
L’Adieu (studio, 1970).
Marie (studio, 1973).
Marie (Lausanne, 1973).
Marizibill (Théâtre des Champs-Élysées, 1984).
La Porte (Théâtre des Champs-Élysées, 1984).
L’Adieu (Théâtre des Champs-Élysées, 1984).
Les Cloches (et) La Tzigane (studio, 1986).
Marie (TLP-Déjazet, 1986).
La Porte (TLP-Déjazet, 1986).
L’Adieu (TLP-Déjazet, 1986).
Les Cloches (et) La Tzigane (TLP-Déjazet, 1986).
Le Pont Mirabeau (TLP-Déjazet, 1986).
Marie (studio, 1986).
Automne malade (studio, 1990).
(Tableau de Marie Laurencin)
Ces enregistrements, qui plus est, s’étendent de 1953 à 1990, sont épars dans les catalogues de plusieurs maisons d’édition phonographique, et sont réalisés avec des accompagnements aussi divers que l’orchestre de J. Faustin ; au piano, Paul Castanier ; arrangements et direction d’orchestre de Jean-Michel Defaye ; arrangements et direction d’orchestre de Léo Ferré ; orchestre symphonique de Milan dirigé par Léo Ferré ; au piano, Léo Ferré ; a capella ; à l’accordéon, Jean Cardon. Certains ont été effectués en studio (parfois dans des versions différentes), d’autres en public uniquement (parfois dans des versions différentes, eux aussi), quelquefois les deux. Quelques uns existent, parallèlement au disque en public, en DVD, dans des récitals filmés par Guy Job.
Je trouve d’autant plus étonnant que Léo Ferré ait laissé ces poèmes en chansons ici et là, qu’il se disait lui-même, sur le plan de l’écriture, très influencé par Apollinaire : « Du point de vue poétique, j’ai surtout été influencé par Apollinaire. (...) Il avait cette espèce de parole d’avant la parole, il parlait comme un grand oiseau sur la pierre » [1]. On a vu précédemment qu’il avait même marché sur ses traces avec son Bestiaire.
______________________
[1]. Françoise Travelet, Dis donc, Ferré..., Hachette, 1976 (rééd. Plasma, 1980 ; La Mémoire et la mer, 2001).
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (16)
mercredi, 24 janvier 2007
Du portrait à l’épure
Léo Ferré est aussi un portraitiste. La chanson Les Retraités le montre suffisamment : traits acérés, ton à la fois caustique et désolé, personnages situés dans un décor, il s’agit bien d’un portrait brossé sans complaisance. Les Parisiens en est un autre, d’un ton différent, plus humoristique, plus complice – mais tout aussi lucide, si davantage enlevé.
À l’opposé, le tryptique Les Poètes, Les Artistes, Les Musiciens ne constitue pas réellement une série de portraits, pas plus que Les Anarchistes. On peut se demander pourquoi Retraités et Parisiens sont des textes très visuels, les quatre autres moins.
Certainement parce que ces quatre autres sont plus allusifs, parce que l’auteur y emploie la troisième personne du pluriel : « Ils » désigne poètes, artistes, musiciens, anarchistes (ce « Ils » est moins fréquent dans Les Parisiens, pas du tout dans Les Retraités). On ne les ressent pas comme des personnages dans un décor, bien plutôt comme des entités éternelles, fraternelles. Ils sont surtout des épures. Et puis, on devine que de ces quatre-là, Léo Ferré se sent très proche, évidemment.
Un cas intéressant, celui des Copains d’la neuille qui est certes un portrait mais sans description précise, plutôt une suite de contours, de silhouettes et, surtout, une détermination essentiellement effectuée par les mots. Ici, le registre de langue paraît être la peinture même, ce qui constitue une piquante transmutation du matériau en création. Comme si l’outil devenait l’objet qu’il fabrique.
Naturellement, on n’oubliera pas la plaisante série de portraits en prose contenus dans le roman Benoît Misère, série que Georges Coulonges qualifia d’« aimable collection de gravures anciennes (...) que l’auteur contemple tour à tour avec tendresse ou avec une ironie désabusée » [1]. Cette définition n’est pas fausse. On peut encore considérer que L’Opéra du pauvre comprend beaucoup de portraits « indirects », ceux que dressent d’eux-mêmes les témoins appelés à la barre : ils se peignent alors par des mots, des déclarations, l’aveu de leurs rêves et de leurs problèmes. C’est un aspect de Ferré portraitiste qui vaut bien non une messe, mais une note. On y reviendra.
____________________
[1]. Europe, avril-mai 1971.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (19)
lundi, 22 janvier 2007
Censure à la radio
Voici quelques faits précis et datés, sans commentaires, suivis d’un souvenir personnel.
Le jeudi 23 avril 1953, le comité d’écoute de la Radiodiffusion française interdit Paris-Canaille.
Le jeudi 19 novembre 1953, le comité d’écoute de la Radiodiffusion française interdit Et des clous.
Le jeudi 12 juillet 1956, le comité d’écoute de la Radiodiffusion française interdit Le Temps du plastique.
Le mardi 13 février 1962, le comité d’écoute de la Radiodiffusion française interdit Regardez-les.
En 1960, Ferré présente la chanson Les Poètes à la radio, disant en introduction que les ministres seront oubliés mais pas les poètes, ajoutant être heureux de chanter ce texte en ce moment. L’émission passe en différé trois jours plus tard, les mots « ministres » et « en ce moment » sont coupés. Pour protester contre cette affaire de censure, il écrit La Liberté d’intérim, que publie France-Observateur dans son numéro du jeudi 20 octobre. On l’a vu dans une note précédente.
Les samedi 18 février, vendredi 17 mars et mercredi 26 avril 1961, il enregistre un 25-cm de chansons censurées à la radio, Les Chansons interdites de Léo Ferré, qui comprend Les Rupins, Miss Guéguerre, Thank you Satan, Les 400 coups, Pacific Blues, Regardez-les, Mon Général et La Gueuse. Ce disque est interdit à la publication et le pressage est détruit (il n’en demeure qu’un 45-tours portant le même titre et proposant Les Rupins, Miss Guéguerre, Thank you Satan, Les 400 coups).
À la fin des années 60, peut-être au début des années 70, j’achète pour cinq francs, chez un bouquiniste du cours Julien à Marseille, le double album Barclay Verlaine et Rimbaud chantés par Léo Ferré. Cinq francs, c’est une somme pour un lycéen, mais c’est peu de chose pour un double 30-cm. La raison de ce prix bas est très simple. Les deux 33-tours sont cassés. Ils sont cassés de la même manière, c’est-à-dire qu’un morceau de quelques centimètres manque, qui empêche l’écoute du premier morceau de chaque face, soit quatre chansons en tout. Cette brisure n’est pas accidentelle – d’ailleurs, on se demande comment on pourrait casser accidentellement un disque de cette manière, à plus forte raison deux disques. Manifestement, cela a été fait volontairement, sans doute avec une pince. Les deux disques sont estampillés « ORTF » sur l’étiquette centrale. C’est une censure par le fait, dirigée contre l’interprète car on ne voit pas pourquoi Verlaine et Rimbaud auraient été frappés d’ostracisme à la radio à ce moment-là. Par quel hasard ce disque appartenant à une discothèque de service public à Paris s’est-il retrouvé à Marseille, chez un marchand de livres et de disques d’occasion, tenant étal en plein air ? Pendant des années, le plateau tournant déjà, je poserai comme je pourrai le bras du tourne-disques au-delà des deux cassures. C’est une époque où le bras de lecture se manœuvre à la main ; il n’y a pas encore de levier avec descente amortie. Même avec un appareil de professionnel comportant cet équipement, aucun régisseur, à la radio et dans des conditions normales de travail, ne se donnera la peine de viser ainsi. Le disque est bel et bien inutilisable sur les ondes. Pendant des années, je ne pourrai pas écouter quatre morceaux de ce double album. Plus tard, je rachèterai ce disque, neuf, chez le disquaire Raphaël sur la Canebière, et je découvrirai les quatre chansons dont j’ignorais tout. Je regrette de n’avoir pas conservé l’ancien.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (15)
samedi, 20 janvier 2007
De l’imitation
En art, le mot « imitation » a un sens spécifique. Le Petit Robert indique : « Le fait de prendre quelqu’un pour modèle (dans l’ordre intellectuel, moral). Imitation d’un maître, des ancêtres » et aussi « Action de prendre l’œuvre d’un autre pour modèle, de s’en inspirer. L’imitation des anciens ».
Léo Ferré, au-delà des influences qu’il a pu subir de par ses lectures, au-delà des auteurs dont il a pu se nourrir, a pratiqué l’imitation par deux fois au moins, celle de Villon et celle d’Apollinaire.
Son Testament phonographe qui donne son titre au recueil initialement publié chez Plasma en 1980, est évidemment imité du Lais de Villon, dans le tour (des huitains d’octosyllabes, la forme du legs répétée à l’envi) comme dans le fond (de multiples allusions autobiographiques cryptées, en réalité presque parfaitement claires pour qui connaît la vie et l’œuvre de l’auteur).
Son Bestiaire dont des extraits ont été donnés dans La Mauvaise graine, d’autres dans l’album de photographies de Marouani est, lui, imité du Bestiaire ou Cortège d’Orphée d’Apollinaire. Dans l’écriture (chez Apollinaire, ce sont essentiellement des quatrains d’octosyllabes, quelquefois d’alexandrins, mêlés de rares quintils ou sixains ; chez Ferré, la prosodie est plus vaste : il ne s’est pas fixé de contrainte) comme dans le ton (courts tableaux allégoriques et petites fables dans lesquels la présence d’animaux est un prétexte à l’illustration de vérités éternelles ou, au contraire, de petits riens du quotidien).
Que se passe-t-il dans l’esprit d’un créateur, quelle que soit sa discipline, lorsqu’il se met à imiter un illustre prédécesseur ? Il est bien évident qu’on n’est plus ici dans le domaine des simples influences littéraires ou artistiques, moins encore du pastiche, mais dans la reproduction consciente d’une œuvre existante et célèbre. S’agit-il d’un hommage ? Certainement mais pas uniquement, je pense. Y a-t-il volonté d’identification, de descendance revendiquée et assumée ? Existe-t-il un désir de rattachement à une lignée littéraire ? Est-ce au contraire vécu comme un pur et simple exercice de style ?
Léo Ferré n’est évidemment pas seul dans ce cas. Quand Verlaine et, plus fréquemment, Théodore de Banville composent des ballades selon les règles, ils imitent les poètes médiévaux.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (13)
jeudi, 18 janvier 2007
À propos du grand-œuvre
On sait que Léo Ferré doit à la chanson et à la scène sa notoriété, même s’il aurait préféré – l’a-t-il suffisamment répété – n’écrire que de la musique. S’agissant du spectacle, il possédait un incontestable métier. On peut supposer que les très nombreuses tournées qu’il effectuait, ses quelques trois cents spectacles annuels parfois, l’ont empêché, sur le simple plan du temps disponible, de mener à bien de nombreux projets.
On peut supposer également que ce manque de temps l’a contraint à extraire de textes très longs des chansons, c’est-à-dire des choses immédiatement utilisables à la scène et au disque, alors que le travail d’écriture de livres, son travail de prosateur, nécessitait évidemment davantage de disponibilité, de « patience et longueur de temps ». Je passe sous silence la durée de la composition musicale et du travail d’orchestration. Son sens du raccourci et de l’image a sans doute contribué à une aisance constante dans l’écriture de chansons et de textes plus ou moins brefs, plus ou moins longs, écriture qui n’était bien sûr pas celle d’ouvrages plus conséquents.
La chanson lui a donc permis – pas tout de suite – de vivre et de faire vivre les siens. Elle l’a aussi enfermé dans un mode d’expression qui, même s’il fit sauter toutes les barrières habituelles, notamment celle de la durée moyenne, peut figer dans l’esprit du public une image insuffisante d’un créateur qui se souciait peu des étiquettes.
Ce qui importe, c’est de comprendre qu’il pouvait s’exprimer, peut-être avec plus ou moins de bonheur, peut-être avec plus ou moins de difficultés, dans plusieurs domaines et que c’est l’ensemble de ces créations qui contituent son œuvre au sens où l’on entend « un » œuvre, c’est-à-dire l’œuvre complet, le grand-œuvre.
La chanson – l’œuvre présentée vocalement et sublimée par le disque et la scène – lui a aussi imposé les barrières (les limites) de l’oralité. Il ne faut pas prendre cela pour une déclaration péjorative vis-à-vis de la chanson mais pour un simple et unique constat. L’oralité n’aide pas forcément à acquérir ou à conserver la persistance nécessaire au travail écrit de longue haleine. Inversement, certains écrivains sont incapables de s’exprimer oralement et leurs entretiens radiodiffusés ou télévisés sont une catastrophe. Ferré, sans doute, eût pu concilier les deux aspects (notamment avec son sens du spectacle et de l’abattage), mais il lui aurait sans doute fallu plusieurs vies pour tout mener à bien.
Il faut en effet prendre la mesure des créations artistiques à l’échelle des vies de leurs auteurs. Un artiste qui débute à trente ans et devient célèbre à quarante-cinq dispose de suffisamment de temps pour vivre de son travail et de sa notoriété, mais pas pour achever l’ensemble de la construction qu’il prévoit… ou qui se découvre à lui au fur et à mesure des années. Ferré, en effet, avait beaucoup d’idées, ce qui conduit souvent les créateurs à l’inachèvement.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (0)
mardi, 16 janvier 2007
De Méjean à Castanier
Courant 1956, Jean Méjean devient directeur du cabaret Chez Plumeau, 7, place du Tertre à Montmartre. Il possèdera plusieurs autres cabarets, au point qu’on le surnommera « l’Empereur ». Président-directeur-général de la Société parisienne de spectacles, il est aussi responsable de la programmation au théâtre de l’ABC, 11, boulevard Poissonnière (Central 19-43). Régulièrement, il mettra Léo Ferré à l’affiche.
Selon Gilles Schlesser, historien des cabarets [1], Méjean était généreux en matière de cachets et aimait les artistes. Il avait par ailleurs des accointances avec le milieu et était joueur. Il finira par devoir vendre tous ses établissements et purgera une peine de prison à Fresnes avant de partir quelque temps au Canada. À son retour, il ouvrira de nouveaux lieux.
On s’attarde ici sur cet entrepreneur de spectacles car il a, au moins indirectement, joué un rôle dans la carrière de Léo Ferré. S’il ne l’avait pas engagé en 1957 Chez Plumeau, Ferré n’aurait pas rencontré là celui qui allait devenir un compagnon durable de son aventure artistique.
 En novembre 1957, en effet, il chante durant quinze jours dans ce cabaret. Il y rencontre le pianiste Paul Castanier, dit Popaul, né à Alger le vendredi 5 juillet 1935, rendu aveugle à cause de l’emploi d’un mauvais collyre dans sa toute-petite enfance. On connaît la fameuse réaction de Ferré – il l’a souvent racontée lui-même – quand il aperçoit Popaul pour la première fois : « Oh là là, ce type, même de dos, il a l’air intelligent ». Il faudra, quelque jour, reconstituer l’histoire de Castanier afin de comprendre dans quelles circonstances il quitte Alger et se retrouve pianiste accompagnateur, à vingt-deux ans, à Montmartre. C’est lui qui ouvre le bal à 22 h, avec Fred Orbeck.
En novembre 1957, en effet, il chante durant quinze jours dans ce cabaret. Il y rencontre le pianiste Paul Castanier, dit Popaul, né à Alger le vendredi 5 juillet 1935, rendu aveugle à cause de l’emploi d’un mauvais collyre dans sa toute-petite enfance. On connaît la fameuse réaction de Ferré – il l’a souvent racontée lui-même – quand il aperçoit Popaul pour la première fois : « Oh là là, ce type, même de dos, il a l’air intelligent ». Il faudra, quelque jour, reconstituer l’histoire de Castanier afin de comprendre dans quelles circonstances il quitte Alger et se retrouve pianiste accompagnateur, à vingt-deux ans, à Montmartre. C’est lui qui ouvre le bal à 22 h, avec Fred Orbeck.
____________________
[1]. Gilles Schlesser, Le Cabaret « rive gauche », 1946-1974, L’Archipel, 2006.
(photo Geneviève Vanhaecke)
00:00 Publié dans Personnages | Lien permanent | Commentaires (4)
dimanche, 14 janvier 2007
De l’utopie
Le rêve d’un monde meilleur, chez les poètes lyriques, s’exprime toujours par l’évocation (l’invocation) de lendemains qui chantent. C’est cette expression qui contrebalance le désespoir exprimé au fil de leur œuvre et procure au lecteur ou à l’auditeur l’indispensable ressource d’espoir, ce même espoir dont le poète a lui-même besoin pour poursuivre et sa vie et son travail. Cette double postulation est constante, elle est même constitutive de l’art, dans toutes ses disciplines. On peut appeler « utopie » ces lendemains plus beaux, rêvés et promis.
Chez Léo Ferré, l’utopie s’exprime en de nombreux endroits, très souvent sous la forme « Un jour », très souvent aussi à travers le mot « Quand », sans même parler de l’appel, constant dans l’œuvre, à « l’an dix-mille ».
« Un jour nous nous embarquerons sur l’étang de nos souvenirs », est-il écrit dans L’Étang chimérique et cette prophétie est doublée d’un « Un jour nous nous embarquerons mon doux Pierrot ma grande amie / Pour ne jamais plus revenir ».
« Un jour » peut être exprimé d’une manière moins vague. Il s’agit alors de « Quand ». Quand… quoi ? « Quand il y aura » (Allende), « Quand je sombrerai » (Le Parvenu), « Quand je fumerai autre chose que des celtiques », « Quand le soleil se lèvera ». On remarque que ce « quand » peut être la mort (les Celtiques ou la fin du Parvenu ; ou bien encore, peut-être, le non-retour de L’Étang chimérique), celle-ci étant alors l’âge meilleur. Mais l’espoir est toujours présent : « Quand il y aura des mots plus forts que les canons / Ceux qui tonnent déjà dans nos mémoires brèves / Quand les tyrans tireurs tireront sur nos rêves / Parce que de nos rêv’s lèvera la moisson ». La chanson Allende est ainsi une suite de vers dédiés à l’espoir, dans une construction anaphorique.
Au « Quand » doit nécessairement répondre quelque chose, sans quoi le propos ne serait plus cohérent et l’artiste lui-même s’y perdrait. Survient donc « alors », qui est l’essor de la parole proférée vers le résultat du « Quand » enfin atteint. « Alors nous irons réveiller Allende », « Alors… Alors… le pouvoir fera sous lui ».
Bien sûr, le comble de l’utopie est atteint dans Il n’y a plus rien, dont le final disait initialement : « Un jour, dans dix-mille ans » avant de conclure : « Nous aurons tout dans dix-mille ans ». En 1984, au Théâtre des Champs-Élysées, le propos est modifié et comporte une rémission : « Un jour, bientôt peut-être », puis : « Nous aurons tout demain matin ». La même année, à l’Olympia, la chute devient : « Nous aurons tout demain matin, si tu veux ». Il y a toujours l’espoir, mais le « tu » (à la fois le public dans son ensemble et chacun des lecteurs-auditeurs-spectateurs individuellement) est mis à contribution et doit prendre sa part de responsabilités, assumer sa part d’action pour que survienne l’utopie.
Cette utopie, quelle est-elle ? Elle est expressément décrite dans L’Âge d’or : il n’est donc pas utile d’épiloguer, moins encore de paraphraser la chanson. L’âge d’or est présent dans notre littérature et notre imaginaire depuis – au moins – Virgile.
Il faudra quelque jour étudier l’emploi du futur de l’indicatif chez Léo Ferré, qu’il exprime une soumission à l’inéluctable (« Puisque les voyag’s forment la jeunesse / J’te dirai mon ami à ton tour ») ou une tension vers autre chose (« Je prendrai tes deux mains de brume dans mes mains / Et les tendrai vers quoi je ne puis tendre seul »). Il faudrait de même comparer l’emploi du conditionnel dans À vendre et dans L’Opéra du ciel.
00:00 Publié dans Jalons | Lien permanent | Commentaires (5)
vendredi, 12 janvier 2007
Trois aspects de la recherche universitaire
Le commentaire ferréen, ce n’est pas seulement la rubrique des spectacles des quotidiens, les potins de tel ou tel magazine, les sites de vente et d’enchères. Discrètement, la recherche s’installe. La vie et l’œuvre de Léo Ferré font ainsi, parfois, l’objet d’études universitaires fort spécialisées qui portent sur des domaines très différents. J’ai relevé trois textes, mais il en existe certainement davantage.
Domaine juridique
Claude Champaud, « Apollon et Mercure, à propos de l’affaire Léo Ferré-Barclay », in Revue internationale du droit d’auteur, n° LXI, juillet 1969. Vingt-quatre pages (édition trilingue français-anglais-espagnol).
Passionnante étude de Claude Champaud, professeur à la faculté de droit et des sciences économiques de Rennes, qui montre que l’affaire de la chanson À une chanteuse morte est un avatar du conflit permanent qui, entre l’art et le commerce, existe depuis la nuit des temps. Loin des potins et des cancans habituels, Champaud pose le problème de « la nature juridique du disque en tant qu’œuvre artistique, par exemple, et par voie de conséquence, la consistance et l’étendue des droits que l’artiste peut revendiquer sur cette œuvre ». Il pose une autre question, celle de « la censure que l’éditeur peut exercer sur l’œuvre de l’auteur-exécutant à raison des répercussions que les paroles censurées pourraient avoir à son égard ». Il étend les problèmes du droit de la propriété intellectuelle à ceux posés par l’invention du microsillon et du transistor. Dans une langue d’une parfaite limpidité, loin de tout jargon juridique, Champaud renvoie dos à dos mais avec une évidente sympathie et une grande honnêteté, Léo Ferré, « le poète, un vrai, qui chante aussi bien qu’il écrit les paroles et la musique », poète qui « remplit une fonction sociale évidente et défoulante en faisant vibrer la corde anarchiste qui, dans l’âme des Français, se rencontre tout à côté de la corde cocardière » – et l’éditeur, « efficace et chanceux, qui connaît son métier et son marché et sait aussi bien faire éclore les éphémères talents qu’éditer les génies confirmés ». Il met en scène l’ombre « de la chanteuse morte, sainte et idolâtrée » et « le personnage inquiétant de l’impresario de l’idole vivante ». Une étude d’une réjouissante intelligence et, j’y insiste, d’une parfaite lisibilité, avec toutes les analyses juridiques qu’on peut souhaiter et une conclusion ouverte, comme il se doit. Un texte de haute tenue.
Domaine littéraire
Alain Corbellari, « De Rutebeuf à Léo Ferré : les fortunes du "poète maudit" », in Médiévales, n° 23, « Réception du Moyen-Âge dans la culture moderne », Amiens, Presses du Centre d’études médiévales de l’université de Picardie, 2002. Neuf pages.
Cette étude serait intéressante si, d’évidence, ne la sous-tendait pas une très nette défiance de l’auteur envers Léo Ferré. On s’étonne même d’une si faible sympathie dans la mesure où Corbellari reconnaît « la voix inspirée du chanteur », reconnaît encore qu’« on ne parviendra ni à prouver avec certitude que sa connaissance de l’ancien français est défectueuse, ni (et encore moins) que sa chanson [est] un patchwork stylistique ». Ce que l’auteur veut signifier, lorsqu’il en arrive, dans son étude, à Ferré, c’est que celui-ci a démonté les poèmes originaux pour effectuer un montage propre, ce que tout le monde sait depuis 1955. Ce qui est plus intéressant, c’est sa démonstration qu’en effectuant ce montage, Léo Ferré a fait de Rutebeuf son double et qu’il a tiré le sens des poésies originales vers une complainte du poète maudit auquel lui-même s’identifie. L’acharnement que met Corbellari à le prouver devient très étonnant, dans la mesure où on l’admet sans difficulté. Le problème est que, parlant de la chanson, le médiéviste avance deux dates et que les deux sont fausses. Il nous assure sans rire que Pauvre Rutebeuf date de 1958 (sans doute parce qu’il ne connaît que l’enregistrement effectué à Bobino en janvier de cette année) et parle ensuite d’une autre version « extraordinairement étirée » qu’il date de 1990 (il faut sans doute lire 1986, dans l’enregistrement du spectacle du TLP-Déjazet, Léo Ferré chante les poètes). Corbellari écrit : « L’équation pauvreté = liberté = génie dessine l’auréole du poète maudit autour du chanteur », ce qui est ignorer totalement le dégoût sans fin qu’inspirait à Ferré la pauvreté qu’il avait connue (« La vie d’artiste, l’important, c’est de pouvoir en sortir », disait-il, en cela précédé et conforté par Rimbaud : « J’exècre la misère »). Il déduit que « les modifications que Ferré apporte au contenu s’expliquent bien mieux par une adaptation directe du texte original que par un travail sur des versions plus ou moins traduites et un détail textuel (le "droit au cul", coquille pour "froit au cul") désigne sa source de manière sûre : c’est l’anthologie médiévale de la Pléiade, dirigée par Albert Pauphilet en 1952 ». On le croit sans peine. On aime moins lorsqu’il parle de « tripatouillage », avançant que Ferré « refusant (ou ne comprenant pas ?) la technique du "tercet coué" » transforme « les vers entrelacés de Rutebeuf en une série de petites strophes autonomes qui éloignent le texte de sa versification première pour le rapprocher des conventions modernes de la poésie strophique chantée » – ce qui est parfaitement exact mais le terme de « tripatouillage » évoque une malhonnêteté qui n’est certainement pas réelle. On mesure aussi combien Corbellari refuse (ou ne comprend pas ?) le travail de « mise en chanson », comme disait Aragon, d’un poème original : les textes d’Aragon (et de nombreux autres) devenus chansons sont aussi découpés et remontés, pas seulement chez Ferré (Ferrat s’en donne à cœur joie et Brassens coupe des strophes multiples chez Hugo). Au fond, c’est toujours le refus de la poésie chantée, problème longuement évoqué ici dans le texte Avec Luc Bérimont, question qui a fait se déchirer intellectuellement tant d’auteurs durant des années, au mépris de l’histoire de la poésie, chantée dès l’origine. La preuve : « Il a fallu attendre le livre de Nancy Freeman-Regalado, en 1970, pour voir paraître la première étude érudite sérieuse sur Rutebeuf, alors même que le poète connaissait un succès public si retentissant ; mais ceci explique peut-être cela ». Pour Corbellari, la chanson et le succès populaire empêchent l’étude sérieuse. Attitude de mandarin car, au vrai, en quoi est-ce incompatible ? On ne recopiera pas ici l’ensemble des accusations portées contre Ferré, ce serait long et vain. Il suffira peut-être de relever que l’auteur attribue à Léo Ferré, parmi ses transformations des poèmes originaux, « un suggestif syntagme ». Quel est-il ? « Pauvre d’hiver ». Est-il utile de préciser que la chanson ne contient nulle part ce syntagme ? On regrette cette aigreur de la part de l’auteur de l’étude : ce qu’il avance n’est pas faux, peut à tout le moins être pris en compte. Il n’était pas besoin de tant d’acrimonie pour exposer un point de vue légitime.
Domaine sociologique
Peter Hawkins (du département de Français à l’université de Bristol), « The career of Léo Ferré : a bourdieusian analysis », in Barbara Lebrun et Catherine Franc, « French popular music conference », actes du colloque de l’université de Manchester, Angleterre, 19-20 juin 2003, publiés dans la revue Copyright Volume !, n° 2, 2003. La préface indique : « Analysant la carrière de Léo Ferré à travers le modèle sociologique de Pierre Bourdieu, Peter Hawkins démontre à la fois la fascinante ambivalence de l’artiste (dont l’engagement politique s’accompagne d’un fort succès commercial) et les limites de cet appareil théorique (qui souligne le processus de légitimation culturelle mais omet le rôle des facteurs politiques) ». Treize pages.
Très décevante communication, d’autant plus décevante qu’elle constitue – à ma connaissance, évidemment – le seul document en langue anglaise consacré à Léo Ferré. Une série de portes ouvertes qu’on enfonce gaiement. Rien de neuf n’est apporté. Il n’y a pas de commentaire à proprement parler, moins encore d’étude, seulement un bref exposé de la vie et de l’œuvre de Léo Ferré découpées en périodes (avec de nombreuses dates fausses). La conclusion est que Ferré n’a pas pu réunir les trois champs (chanson populaire, musique classique, poésie mise en musique et chantée) de sa création, champs que délimite Hawkins, suivant en cela Bourdieu, dit-il (tout en précisant que le modèle de Bourdieu est insuffisant puisqu’il ne comprend pas de champ politique). Il n’est pas parvenu à effectuer cette fusion qu’il portait en lui, c’est-à-dire à l’installer durablement dans la culture française. Selon Hawkins, Ferré était, politiquement, d’un anarchisme vécu non comme un programme politique mais comme une prise de position morale et individuelle, alors qu’il était plutôt proche, en réalité, du Parti communiste (adhésion de cinq minutes en 1948, disque d’Aragon, admiration de Marx, fête de L’Humanité sont les exemples donnés par l’auteur, sans aucune espèce d’éclairage).
00:00 Publié dans Recherche | Lien permanent | Commentaires (10)
mercredi, 10 janvier 2007
Un OVNI artistique
On continue aujourd’hui à se demander si Léo Ferré est un poète ou un simple auteur de chansons de variétés. C’est un débat qui m’amuse et m’agace à la fois car il existait déjà lorsque j’ai découvert cette œuvre, en 1969. Je me rappelle les interminables discussions de 1971-1972, d’un peu après encore, à ce sujet. Si, en 2007, la question n’est toujours pas tranchée, c’est peut-être qu’elle n’a pas à l’être ou qu’elle est mal posée.
Je vais essayer de ne pas tenir compte de mon avis personnel et de raisonner objectivement. On a tendance, souvent, à comparer Ferré à Baudelaire, Rimbaud et autres poètes de cette envergure, ce qui a inévitablement pour résultat de provoquer l’ire ou l’ironie de ceux qui ne sont pas d’accord et trouvent cela nettement exagéré. On peut d’abord répondre que, s’il faut absolument comparer Ferré à d’autres, il suffirait de le comparer à ses pairs en chanson : il n’y aurait alors, je pense, aucune difficulté à le situer.
On peut également envisager d’apporter à la sempiternelle question la réponse que je proposais dans une note précédente : l’important n’est pas que Ferré soit ou non l’égal de ces grands artistes, mais qu’il soit nourri d’eux et de leur œuvre. Je crois que c’est la seule réponse sérieuse et objective qu’on puisse formuler. Ensuite, il est loisible de disserter sur la nature des influences subies et leur profondeur. Cette optique impose alors Léo Ferré comme un artiste (mot que personne, il me semble, ne contestera) authentiquement original en ce sens qu’il a supprimé les cloisonnements connus (subis ?) jusqu’à lui et qu’il a conjugué des talents multiples (tout le monde, là encore, sera d’accord). On aboutit donc à l’image d’un créateur inclassable, un OVNI intéressant qui, en un demi-siècle de carrière, a pu croiser plusieurs générations qu’il a su émouvoir par son authenticité. Ajoutons à ses influences un apport personnel, celui de sa voix qui participe énormément de l’émotion qu’il transmet. À cette voix, nulle comparaison avec de grands poètes ne peut être faite ou niée.
Bien entendu, ces mêmes remarques sont valables dans le domaine de la composition musicale.
Peut-être, finalement, cette solution est-elle la seule possible. Ferré, nourri de grandes ombres et de prédécesseurs illustres, devient un artiste original, sans filiation excessive ou exagérée et, à ce jour en tout cas, sans descendance artistique.
00:00 Publié dans Propos | Lien permanent | Commentaires (7)
lundi, 08 janvier 2007
À propos de Cecco, par Jacques Miquel
Après nous avoir présenté Leonid Sabaniev et Jamblan, Jacques Miquel continue à nous faire connaître ces personnages qui passent dans la vie et l’œuvre de Léo Ferré et sont moins célèbres que d’autres. Ces notes biographiques très documentées permettent de cerner mieux encore l’univers artistique de Ferré. Je remercie Jacques Miquel pour son goût de la recherche et pour l’aide qu’il m’apporte.
Vers 1981, Léo Ferré enregistre sous le titre de Cecco, un sonnet d’un poète toscan du XIIIe siècle plaqué sur l’orchestration symphonique de Pauvre Rutebeuf [1]. Le disque sort en Italie avec, au verso de la pochette, la transcription du poème original et l’indication de l’auteur, « Cecco Angiolieri 1260-1312 ? »[2], à propos de qui le chanteur souligne par ailleurs des similitudes existentielles avec Rutebeuf († 1280). Ce single vinyle n’est pas distribué en France où il faut attendre une vingtaine d’années pour que l’on découvre Cecco en CD [3]. Parmi les rares auteurs qui ont mentionné cette chanson, certains [4] ont malencontreusement attribué le texte à un autre poète italien, Cecco d’Ascoli.
Francesco Stabili dit Cecco d’Ascoli [5], cité où il vit le jour en 1269, enseigna l’astrologie à Bologne. À la fois poète et savant, son nom reste attaché à L’Acerba, une somme de vers à résonance scientifique dans laquelle il s’oppose à Dante. Accusé d’hérésie et de sortilèges pour avoir commercé avec des succubes, il fut condamné au bûcher par l’Inquisition en 1327. Si cet opposant à l’oppression religieuse avait de quoi inspirer Léo Ferré, il n’est dit nulle part qu’à l’instar de Rutebeuf il connaissait « des problèmes de femme et d’argent » et il n’est pas le « Cecco » de la chanson.
Né à Sienne vers 1260, Cecco Angiolieri est de la même génération que Francesco Stabili ; comme lui, sa vie s’écoule dans une Italie divisée entre gibelins inféodés à l’empereur et guelfes fidèles au pape, situation localement aggravée par la rivalité politique entre Siennois et Florentins. Dans ce paysage troublé, le parcours d’Angiolieri confine souvent à la légende du poète maudit tour à tour guerrier puis déserteur, rétif aux lois de la cité et impliqué dans une rixe meurtrière, tâtant la paille du cachot et frappé de bannissement. En réalité, sa biographie ressort en filigrane de ses œuvres poétiques, constituées de plus de cent cinquante sonnets rassemblés sous le titre de Canzoniere ou encore de Rime. Au fil de ces vers, il se pose en contempteur sarcastique de son temps, nourrissant une rancœur farouche à l’égard de son père, riche patricien dont l’avarice le réduit à la pauvreté et au dénuement. Avouant cyniquement n’avoir pour seules passions que « la femme, la taverne, et les dés », ses provocations caustiques semblent n’avoir d’autre but que de masquer un profond désarroi et le dépit de voir son talent occulté par le succès de Dante. Allant jusqu’à l’autodérision, il parodie la noblesse des sentiments du Florentin pour Béatrice en lui opposant la trivialité de ses propres déconvenues amoureuses avec la fille d’un savetier, cupide et rouée. L’expression parfois crue de sa poésie est en fait une réaction littéraire au « style nouveau » qui s’affirme alors et qui n’est pas sans évoquer l’amour courtois. Mais les inspirations passionnées et les saillies burlesques qui font de Cecco Angiolieri le principal tenant de la poésie réaliste bourgeoise, ne doivent pas faire oublier la sensibilité à fleur de cœur d’un auteur floué par l’existence. Son œuvre, longtemps négligée, n’obtint une place de choix dans la littérature italienne qu’à l’aube du XXe siècle.
En France, le romancier et poète symboliste Marcel Schwob contribua à sortir le rebelle siennois de l’anonymat en lui consacrant sous le titre de Cecco Angiolieri, poète haineux un chapitre de Vies imaginaires, recueil de contes paru en 1896 décrivant des personnages souvent méconnus, au destin atypique. Dans ce récit picaresque on découvre un Cecco à la bouche tordue, détestant dès son plus jeune âge son père, dont il souhaite ardemment la mort pour récupérer son magot. Fils prodigue désargenté, il gagne Florence où il n’a d’autre alternative que la mendicité. Amoureux transi de la belle et moqueuse Becchina pour laquelle il écrit en pure perte des vers enflammés, il ne cesse d’épancher sa bile sur Dante, son irréductible rival en littérature. « Pauvre et nu comme une pierre d’église » il entre dans les ordres, ce qui ne l’empêche pas de nourrir toujours une aversion viscérale à l’égard de ses semblables exprimée dans le fameux sonnet dont Marcel Schwob propose cette traduction tronquée : « Si j’étais le feu, pensa-t-il, je brûlerais le monde ; si j’étais le vent, j’y soufflerais l’ouragan ; si j’étais l’eau, je le noierais dans le déluge ; si j’étais Dieu, je l’enfoncerais parmi l’espace ; si j’étais Pape, il n’y aurait plus de paix sous le soleil ; si j’étais l’Empereur, je couperais des têtes à la ronde ; si j’étais la mort j’irais trouver mon père… si j’étais Cecco… voilà tout mon espoir… » Après avoir abandonné le froc et s’être joint à une horde de guelfes noirs mettant à feu et à sang le quartier des élites florentines, il apprend avec bonheur la mort de son père. Devenu riche et venant enfin à résipiscence, sans vergogne aucune il exhorte le pape à lancer une Croisade contre tous les fils indignes !
Léo Ferré connaissait-il ce sombre portait de Cecco dû à Marcel Schwob ? On l’ignore… Quoiqu’il en soit, il est probable qu’il ait découvert lui-même cet auteur par d’autres voies. On sait en effet qu’il s’était suffisamment penché sur la littérature italienne du Moyen-Âge pour souligner sa lisibilité à l’époque moderne, contrairement au vieux français devenu hermétique pour le commun des lecteurs. De plus, sa compassion pour Angiolieri dont il rapprochait la situation de pauvreté de celle de Rutebeuf, laisse penser qu’il avait fait une lecture attentive de son œuvre. Quant à la thématique du sonnet considéré, elle est réellement celle d’un « immense provocateur ». Se substituer au XIIIe siècle au pape ou à l’empereur pour assouvir sa misanthropie constitue déjà une grave transgression ; utiliser cet habile procédé pour inférer la cruauté des princes constitue un crime de lèse-majesté. Lorsque l’on agit de même avec Dieu, hier comme aujourd’hui, cela relève du sacrilège et au « Si j’étais Dieu » de Cecco fait écho le « Si j’avais les yeux du Bon Dieu » de L’Opéra du ciel de Ferré, tissant ainsi à travers les siècles une complicité libertaire entre les deux poètes. Peut-être est-ce au nom de cette fraternité intemporelle qu’en 1983, Ferré met en scène le Toscan dans L’Opéra des rats en lui faisant déclamer cette traduction [6] sinon littérale, en tout cas très fidèle à l’esprit du poème de Cecco Angiolieri :
Si j’étais le feu je foutrais le feu au monde
Si j’étais le vent j’y foutrais la tempête
Si j’étais l’eau je le noierais
Si j’étais Dieu je l’enverrais au plus profond
Si j’étais le Pape je serais alors très joyeux
Car je me taperais tous les chrétiens
Si j’étais empereur tu sais ce que je ferais ?
À tous je couperais la tête
Si j’étais la mort j’irais chez mon père
Si j’étais la vie je foutrais le camp de chez lui
Je ferais pareil avec ma mère
Si j’étais moi comme je suis et comme je fus
Je prendrais les femmes jeunes et chouettes
Et je laisserais les vieilles et les laides aux autres.
[1]. Le catalogue des orchestrations réalisées par Léo Ferré dans les années 70 (in Paroles et musique de toute une vie, La Mémoire et la mer, 1998, vol. 7) signale l’enregistrement, le 8 octobre 1973, de la bande orchestrale de Rutebeuf, suggérant que l’artiste avait l’intention de reprendre ce titre avec une partition plus élaborée que celle de 1955. Ce qu’il fera en 1984 sur un album live imputant l’accompagnement à l’orchestre symphonique de Milan. C’est ce dernier accompagnement qui est utilisé pour Cecco.
[2]. 45-tours single, G&G Records, GG 0016 avec, en face B, Allende (en français). Les deux titres sont repris sur un album italien proposant une compilation d’artistes français (Gli intramontabili, G&G Records, RL 8650).
[3]. La musica mi prende come l’amore, La Mémoire et la mer, CD 10.004 (2000).
[4]. Notamment Robert Belleret in Léo Ferré, une vie d’artiste, Actes Sud-Leméac, 1996 (p. 369) et Christophe Marchand-Kiss in Passion Léo Ferré, Textuel, 2003 (p. 162).
[5]. Ascoli Piceno, ville de la région des Marches (Italie).
[6]. Traduction de Léo Ferré extraite de L’Opéra des rats, © La Mémoire et la mer, 2000 - LMMCD004.
00:00 Publié dans Les invités du taulier | Lien permanent | Commentaires (42)